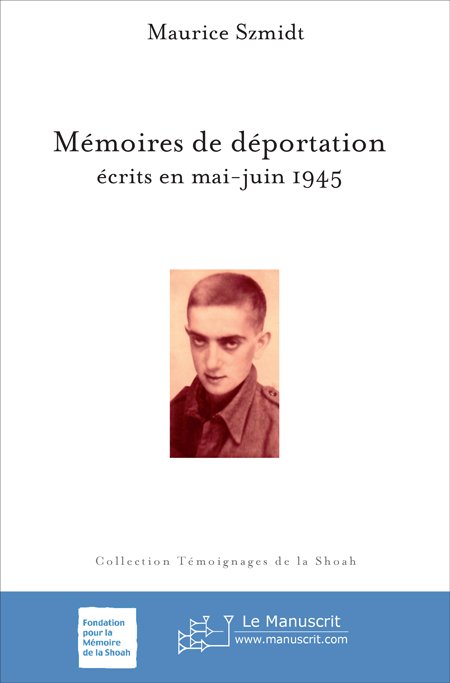
Éditions Le Manuscrit/Fondation pour la Mémoire de la Shoah, 2009
Maurice Szmidt, né le 18 mai 1925 à Rawa Mazowiecka en Pologne.
1928 : la famille émigre en Belgique. 1940 : la famille fuit en France.
Déporté le 9 septembre 1942 par le convoi no 30 à destination d’Auschwitz. En chemin, à Cosel, Maurice est sélectionné avec d’autres pour le travail forcé et intègre le camp de Johannsdorf. Transféré à Kochanowitz puis à Borsigwerk et enfin à Blechhammer. Tatoué du matricule 178764.
Janvier 1945 : « marche de la mort » vers le camp de Gross-Rosen puis celui de Buchenwald.
11 avril 1945 : les détenus libèrent eux-mêmes le camp quelques heures avant l’arrivée des Américains. Maurice rejoint la France et rédige immédiatement son témoignage.
Il part en 1946 pour la Palestine mandataire. Avec son épouse Rosa, ils ont deux filles.
Nous sommes en train de manger la soupe quand la radio commande : « Tous les Juifs sur la place d’appel ! » Cet appel arrive comme une bombe après la déclaration du chef de camp. Que faire ? Qu’arrivera-t-il ? Hermann a disparu ainsi que Jacques. Je reste seul avec Levin, qui me dit qu’il faut se cacher. Je le sais bien. Mais où ? Très décidé à ne pas quitter Buchenwald vivant, après avoir compris ce que c’est que l’évacuation, j’entre dans un bloc des Français (bloc 14). Là, je retrouve Jacques, qui à ce moment du danger vient me dire : « Maurice, chacun pour soi. J’ai ici un copain qui me cachera, mais nous deux, c’est impossible. » « Très gentil de ta part, lui dis-je. Je me débrouillerai tout seul. »
J’ai vu sur la route beaucoup de pères laisser leur fils, les fils leur père, les frères leur frère. Pourquoi un ami s’en ferait-il pour un autre ? Tout de même, je trouve que cette explication n’est pas valable.
(…) Un Français qui m’a vu assis sur une chaise me propose de partager son lit avec moi, ce que j’accepte bien volontiers. Pendant que je suis au bloc, dehors les Juifs sont conduits vers un nouveau massacre. Dix mille Juifs, c’est trop pour être libérés.
« Ouf ! Je me suis bien sorti d’affaire », me dis-je, surtout que, d’après les derniers bobards, il n’y aura plus d’appels. Mon triangle avec le « F » ne peut pas me trahir après que j’ai enlevé le numéro 1 de mon matricule. À partir de maintenant, j’ai le numéro 25 103, ce qui est la série des Français.
On entend que cette fois-ci, le bloc doit sortir à l’appel. Attendant que les derniers sortent, je me cache au troisième étage du lit, sous le matelas, pour ne pas être remarqué en cas de recherches. J’aimerais être n’importe où sauf à ma place quand j’entends la radio annoncer : « Chefs de blocs, allez chercher s’il n’y a pas de Juifs cachés chez vous. » J’entends les chefs du bloc qui, heureusement, ne cherchent pas, sachant qu’ils en trouveront. Mais j’entends les chiens aboyer dehors, les cris des Juifs mordus, des coups de feu.
Au bout de trois heures que je suis ainsi caché, j’entends des bombardiers russes qui bombardent tout près du camp. Dans la panique, l’appel s’est tu, mettant ainsi fin à ma situation. Jacques, qui me demande de l’excuser, redevient mon meilleur ami.
Le calme revenu au camp, Jacques et moi sortons voir les autres. Le premier rencontré est Nissan Levin, qui nous dit de venir au petit camp, où le refuge des Juifs est quasi officiel.
Au petit camp, la vie de chien traqué recommence. Jacques ayant trouvé refuge chez ses concitoyens, je reste avec des Juifs communistes polonais. Chaque fois que je suis pris dans les rafles au camp, ils m’aident à m’en tirer.
Voyant que l’évacuation prend du temps, les SS entrent au camp pour accélérer le mouvement. Maintenant, tout le monde doit être évacué. Pendant que les SS organisent l’évacuation, la police du camp la désorganise. Se sentant impuissants, les SS arrêtent les distributions de nourriture, disant que seuls ceux qui sortent en recevront. Beaucoup sortent pour la nourriture mais surtout à cause du silence qui règne autour du camp. (…)
Le sixième jour de l’évacuation, des SS entrent brusquement dans notre bloc. Tirant avec leurs revolvers, ils nous sortent comme des bêtes effrayées. C’est drôle de voir ces jeunes, qui ne savent même pas ce que c’est que vivre et qui cherchent à se cacher. Comme ils montent sur le toit dans l’espoir de ne pas être vus, celui-ci s’écroule sous leur poids.
Chassé sur la place d’appel, je vois les jeunes se ranger à côté d’une baraque. Vite, comme un éclair, j’entre parmi eux sans savoir de quoi il s’agit. Assis, j’attends le SS qui vient vers nous pour nous trier ; la sueur me coule le long du corps. Le SS marche droit vers un homme couché qui fait semblant de mourir. « Qui es-tu ? », demande le SS. « Polonais », répondit-il. « Juif ? », demande le SS. « Non », lui dit-il. « Enlève ton pantalon. » L’homme obéit. Des coups de pied et de cravache pleuvent sur ce pauvre homme, qui est juif.
Le SS sort les plus âgés d’entre nous en les battant, et laisse les autres retourner au bloc. Me trouvant parmi ces derniers, je retourne en vitesse au bloc, attendant qu’on vienne nous chercher le lendemain, qui sera la dernière journée d’évacuation.
Levés tôt, nous attendons qu’on vienne nous sortir. C’est une journée magnifique. Sauf les canons qui tonnent, tout est tranquille. Cette tranquillité nous énerve, surtout après l’annonce du radio que tout SS qui se trouve au camp (au bordel constitué par des femmes politiques) doit immédiatement sortir. Quelques instants plus tard, alerte. Ce qui signifie également couvre-feu pour nous. Les chefs de la Résistance, qui peuvent se promener pendant le couvre-feu étant donné qu’ils sont policiers, pompiers, etc., transmettent l’ordre de se tenir prêts. L’heure H a sonné. De deux choses l’une : soit les Allemands nous laisseront comme nous sommes, soit ils essaieront de détruire le camp.
Une deuxième alerte se fait entendre durant cinq minutes. Cela signifie que l’ennemi est proche. Quelle joie entre nous ! En même temps, nous craignons que le camp soit détruit. Des coups de mitraillette retentissent, suivis par la fuite des soldats allemands, qu’on voit à travers la fenêtre. Nos yeux restent avant tout fixés sur le gardien placé en haut de la tour : c’est lui qui nous donnera le signal.
Nous n’avons pas besoin d’attendre longtemps : les sentinelles en fuite, Buchenwald est libéré, les portes sont ouvertes, les fils électriques coupés à différentes places, nous nous embrassons les uns les autres. Enfin, nous sommes LIBRES (…).
