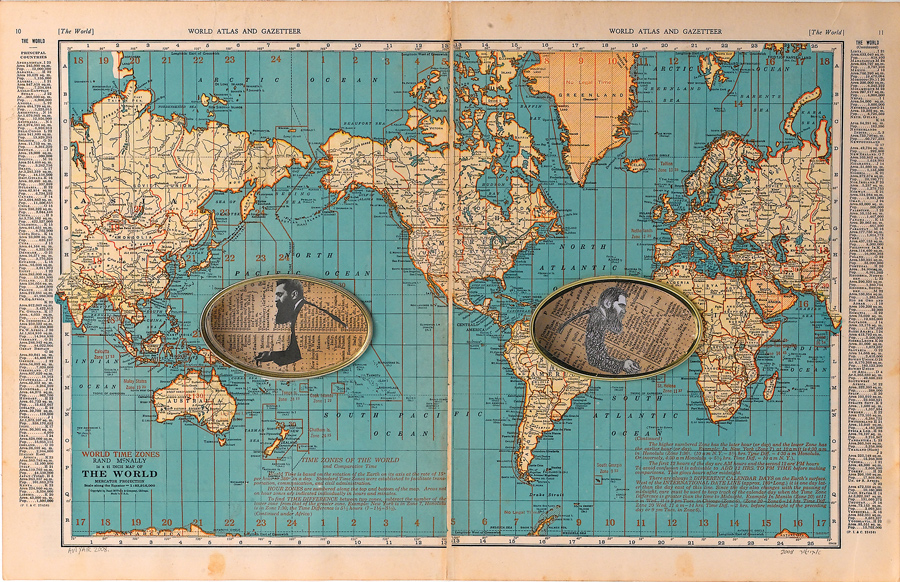
C’était pendant le mois d’avril de 2020, on était confinés depuis un mois. On avait le droit de sortir, mais une heure seulement, et un kilomètre seulement autour de la maison. Les gens portaient le masque comme des extraterrestres, ils n’en avaient pas encore l’habitude. On se croisait sur le trottoir sans se regarder, en s’écartant, comme des pestiférés. Dans mon quartier, je me souviens d’un dimanche de mars venteux et gris où tout était fermé sauf les pompes funèbres dont la vitrine était éclairée, avec des gens dedans, à côté de l’hôpital Cochin. Mon téléphone a sonné, c’était Orly Castel-Bloom, je lui ai décrit en riant ce que je voyais, le magasin des morts avec des clients dedans, un peu comme dans ses livres. Son appel était inattendu, elle s’inquiétait pour nous, j’ai continué de rire, croyant l’apaiser, mais elle a eu très peur pour ma santé mentale et m’a demandé de vite rentrer chez moi. Le virus n’était pas encore arrivé chez elle, elle ne savait pas de quoi je parlais, l’irréalité que nous avons tous vécue au quotidien. La peur les uns des autres, le silence dans les rues, la solitude, les sirènes du Samu, l’hélicoptère de la Pitié.
Puis très vite, un printemps fou a envahi la ville, tiède, bleu, foisonnant de fleurs et d’herbes sauvages sur le bord des trottoirs, avec un ciel rond, profond, renversé, et les oiseaux dans le silence. Même à la Santé, les détenus faisaient moins de bruit. Les gens avaient commencé à se regarder un peu, à avoir moins peur les uns des autres, à découvrir le bavardage des yeux. Il y avait dans l’air comme un vague frémissement de solidarité, d’une chose qui pourrait se dessiner entre les humains masqués. On trichait un peu avec le kilomètre, on mordait un peu sur la ligne. Il y avait des promeneurs en sac à dos, qui découvraient des ruelles inconnues tout près de chez eux, dépaysés, légers, l’allure plus libre que d’habitude. C’est alors que c’est arrivé, un après-midi ensoleillé, lors d’une des sorties autorisées.
Dans mon périmètre, arrivée à Denfert-Rochereau, j’atteignais le bord de la circonférence affichée sur mon téléphone, il fallait que je fasse demi-tour. Il était deux ou trois heures de l’après-midi, le grand carrefour pollué et bruyant, avec son lion incongru sous le soleil de plomb, était absolument désert. Au loin, de l’autre côté de la place, j’ai aperçu une petite rue à l’ombre qui débouchait à la perpendiculaire sur un mur couvert de végétation et d’arbres touffus, le tout inondé de lumière. C’était comme un autre pays, j’étais soudain dépaysée, j’ai eu comme un goût dans la bouche, une nostalgie de quelque chose à venir. C’était très fort, j’ai voulu aller là-bas, voir où c’était. J’ai franchi la ligne imaginaire dont j’ai appris plus tard qu’elle avait réellement existé, la barrière d’Enfer qui délimitait la ville et son au-delà et n’avait rien à voir avec l’enfer. J’ai traversé comme dans un rêve le vaste espace béant et me suis dirigée, en face, vers la petite rue à l’ombre. Elle était fraîche, j’ai eu un frisson et j’ai pressé le pas vers le soleil, vers l’autre rue perpendiculaire, avec son mur de pierre et ses arbres. À l’instant où j’y suis arrivée, je l’ai située dans l’espace, peu importe son nom, elle était digne d’intérêt, une de ces surprises agréables que les villes ménagent aux flâneurs. Mais le charme était rompu et le goût avait disparu.
Une année entière s’est écoulée depuis, entre confinements, couvre-feux, moins de silence, moins de patience, moins de civisme, une certaine habitude morose. L’instant de grâce de ce mois d’avril 2020, tragique et prometteur à la fois, est passé. Ce goût que je sais reconnaître à présent m’est revenu quelques autres fois. De nouveau de loin, une lueur, l’ampoule d’une librairie de quartier allumée à la fin du grand confinement et les gens faisant la queue, avec des sacs à dos, pour y mettre des livres. La vision du fleuve au bout d’une rue déserte et silencieuse. Qu’était-ce ? D’où me venait cette chose ? J’étais intriguée.
J’ai pensé à un écrivain, le premier que j’ai traduit de l’hébreu : Itshak Orpaz. Dans un de ses livres, il raconte un souvenir d’enfance : celui d’un cédrat enveloppé dans du papier de soie, envoyé de Palestine jusqu’aux confins de l’Ukraine soviétique, pour la fête de Souccot. Il décrit, non pas l’odeur ni le goût du cédrat, mais la vue du fruit qui soulève le cœur et réveille la nostalgie d’un ailleurs inconnu et prometteur. J’ai pensé au goût de l’Amérique, Amerika, cet endroit qui porte dans les plis de son nom la mer, la traversée, la richesse et même l’amertume, une promesse de vie au tournant du XXe siècle, pour nombre de peuples oppressés dont les Juifs. Une terre, non pas promise par Dieu à un peuple élu, mais un endroit où la vie est possible pour tous, plus juste, moins violente. Moi aussi, comme une possible Amérique, j’ai rêvé de la France alors que j’étais toute petite. J’ignore jusqu’à aujourd’hui ce qui m’a poussée à la désirer si fort. Dès ma tendre enfance, j’ai pensé qu’à Paris, il n’y aurait pas les mendiants que je voyais sur le chemin de l’école et que les maîtresses de classe ne seraient pas aussi injustes et criardes que là où je vivais, sur les rives du Bosphore.
Un philosophe, doublé d’un poète et d’un romancier, a consacré sa vie à cette « pulsion », à cet « affect » de l’être humain. C’est Ernst Bloch, le penseur de l’esprit d’utopie, du goût de l’utopie, ami de Thomas Mann, de Bertold Brecht, de Walter Benjamin et d’Otto Klemperer. Solitaire dans son refuge américain, il écrit entre 1938 et 1947, Das Prinzip Hoffnung, Le Principe espérance, pendant que la terreur allemande règne sur l’Europe. « Un jour, un homme partit au loin pour apprendre la peur, écrit-il dans sa préface. Il y a peu, il ne fallait pas aller si loin, c’était aussi plus facile, car cet art était alors pratiqué avec une maîtrise effroyable. Mais maintenant, sans plus tenir compte des artisans de la peur, c’est un sentiment plus digne de nous qu’il est temps d’apprendre. Il s’agit d’apprendre à espérer (…) à chercher dans le monde même ce qui peut venir en aide au monde ; et cela peut se trouver (…) La philosophie aura la conscience du lendemain, le parti pris du futur, le savoir de l’espérance, ou elle n’aura plus aucun savoir du tout », tranche Ernst Bloch et il pose un quasi-axiome sur lequel reposera toute sa pensée d’une utopie active : « Penser veut dire franchir. Mais sans passer outre à ce qui existe, sans vouloir l’ignorer. » Et sa traductrice, Françoise Wuilmart, insiste sur le mot « franchir » remplacé malencontreusement par un commentateur par « outrepasser ».
Pour des oreilles hébraïsantes, franchir fait penser à la’avor, à ivri, au premier homme qui, dans le récit de la Genèse, franchit le fleuve, ce pour quoi on l’appelle père-des-peuples-le-franchissant, Avram HaIvri. Et ceux qui le suivent s’appellent les franchissants, les Hébreux, HaIvrim. Ceux qui, dans des temps reculés et au milieu d’autres cultures, ont eu un jour la pensée d’une autre forme de transcendance, de conscience, de société. Longtemps après, à l’orée du XXe siècle et dans l’esprit du temps qui inspire Ernst Bloch, entre Berlin, Londres, St-Pétersbourg, Odessa, une utopie concrète voit le jour, elle a pour nom Eretz Israël. Cinquante ans plus tard, je la rencontre, par hasard, sans même l’avoir cherchée, mais avec cet affect lointain de l’enfance, de la nostalgie d’un ailleurs meilleur. Et je la reconnais, j’en ai le goût sur la langue jusqu’à ce jour. Un goût d’aube naissante, de pauvreté laborieuse et intelligente, de musique et d’espoir. Et j’en ai la nostalgie, tous les jours au réveil, de cette chose à venir, pas encore advenue. Là-bas, de l’autre côté.
