
A-T-ON LE CHOIX ?
Tout le monde a une mère, mais pas forcément une mère juive, même s’il ne faut pas forcément être juif pour accéder à ce titre puisque « juif » devient un adjectif lorsqu’il est accolé à mère. Et souvent les deux mots côte à côte enclenchent des rires. Est-ce grâce à la pièce Comment devenir une mère juive en dix leçons ou au personnage joué par Marthe Villalonga dans Un éléphant, ça trompe énormément ? Ces références datent. Or avant de déterminer si la mère juive existe toujours, il faudrait déjà la définir : aimante, envahissante, oppressante, angoissée, angoissante, omniprésente, déterminée, possessive, exigeante, insupportable et généreuse. Si elle est archétypale, la vraie question est de savoir si elle est un idéal à atteindre ou un exemple à fuir. En observant différentes mères de Sigmund Freud, Marcel Proust, Romain Gary, Albert Cohen et les Marx Brothers, peut-être pourra-t-on décider alors qu’en penser ? Faut-il être une mère juive ?
RÈGLE N° 1
NE PAS AVOIR D’AUTRE VIE QUE CELLE DE SON FILS
« Ma mère n’avait pas de moi, mais un fils », dit Albert Cohen. Cet adage peut s’appliquer à toutes les mères juives, quels que soient leur origine et leur milieu. La mère de Marcel Proust appartient à la bourgeoisie cultivée d’Alsace, celle d’Albert Cohen de Courfou et ne parlait qu’un dialecte judéo-vénitien, celle des Marx Brothers, une famille de réparateurs d’horloges et de ventriloques en Allemagne, Amalia Freud vient d’une famille de négociants prospères en Galicie et toutes, nées entre 1835 et 1883, se sont consacrées à leur fils. Elles n’avaient pas la possibilité de réussir elles-mêmes, ce n’étaient que des femmes et elles ont été confrontées pour la plupart à la guerre et aux pogroms. Ambitieuses par procuration, la réussite de leur fils devait justifier tous leurs sacrifices. Aussi se sont-elles dédiées à leur fils avec un acharnement, une détermination, un amour exclusif pour qu’il leur fasse honneur.
Romain Gary fait dire à sa mère, Mina Kacew, dans La promesse de l’aube : « Tu seras un second Guynemer ! Tu verras ta mère a toujours raison… Tu seras un héros, tu seras général, Gabriele d’Annunzio, ambassadeur de France ». Elle se vantait auprès des commerçants du marché de Nice et de son voisin, le fameux M. Piekielny, du futur glorieux de son fils. Et le plus extraordinaire est que ce rêve inatteignable est devenu la réalité. Il est le seul romancier à avoir reçu deux fois le prix Goncourt, sous son nom de Romain Gary en 1956 et sous celui d’Émile Ajar en 1975. Il réussit au-delà des espoirs de sa mère. Suffit-il de répéter « Tu réussiras mon fils ! » pour que cela se produise ?
Il faut croire que oui. Minnie Marx décide que ses fils réussiront dans le show-business, et les baptise les Marx Brothers en devenant leur manager. Tyrannique et excessive, elle se projette sur ses enfants au point de les amener contre leur gré jusqu’au succès dont elle avait rêvé. Elle a interdit à Harpo de devenir docteur car elle considérait que c’était un métier qui ne rapportait rien et qui nécessitait des études trop longues. Lorsque Harpo mue en dévoilant une voix catastrophique, cela ne décourage pas Minnie ! Il n’aura qu’à jouer de la harpe sans jamais parler ! L’obstination de Minnie Marx porte ses fruits ; ils ont eu une influence immense sur l’humour et la culture américaine.
RÈGLE N° 2
MISER SUR SON FILS AÎNÉ
Marcel Proust avait un frère, Robert mais, pour Jeanne, il n’y en a que pour Marcel. Son mari l’assomme. Elle a accepté le mariage arrangé par son père avec Adrien Proust, un médecin catholique qui lui permettra de s’assimiler dans la société française mais elle ne l’aime pas. Pas comme Marcel !
S’il y avait un prix, il serait gagné – dans cette catégorie – par Amalia Freud. Huit fois mère, elle donne naissance à Sigmund, Julius, Anna, Rosa, Mitzi, Dolfi, Paula et Alexander mais il n’y en a que pour son aîné, son « Sigi en or ». Il avait une chambre pour lui seul alors que ses frères et sœurs devaient s’entasser dans une seule pièce. Elle non plus ne considère pas son mari, qui a vingt de plus qu’elle, comme un obstacle à l’amour inconditionnel qu’elle porte à Sigmund. Ce favoritisme, Sigmund Freud l’a intégré tant et si bien qu’il en fait une théorie : « Quand on a été sans contredit l’enfant préféré de sa mère, on garde pour la vie ce sentiment conquérant, cette assurance du succès qui, en réalité, reste rarement sans l’amener ».
RÈGLE N° 3
S’INQUIÉTER
Dès avant sa naissance, Jeanne Proust s’inquiète pour Marcel. En juillet 1871, affamé par le siège des Prussiens pendant la Commune, il a failli mourir à la naissance. À l’âge de dix ans, il connaît sa première crise d’asthme au bois de Boulogne et manque de mourir étouffé. Enfant fragile, difficile, émotif, Jeanne veille sur lui. Elle ne cessera pas.
Chez les Freud, une épidémie de tuberculose tue le second fils, Julius, en 1858, après le petit frère d’Amalia, qui a peur pour les autres membres de sa famille, en particulier pour Sigmund qu’elle surprotège.
Quant à Albert Cohen, il écrit : « Elle me bénissait sacerdotalement et regardait presque animalement, avec une attention de lionne, si j’étais toujours en bonne santé ou, humainement, si je n’étais pas triste ou soucieux ».
RÈGLE N° 4
TOUT SURVEILLER
Tout doit être mis en œuvre pour atteindre un résultat triomphal. Jeanne Proust est un modèle absolu : elle ne lâche pas Marcel, exige de tout savoir de son hygiène de vie. Alors qu’il était à son service militaire, il devait l’informer de son emploi du temps, heure par heure. Elle veille sur ses économies, ses amis, ses sorties. Il dort le jour, sort la nuit, ne travaille pas, se montre velléitaire, et alors ? Rien ne la décourage ; Jeanne traduit Ruskin pour qu’il puisse retravailler son texte, lui qui ne parle pas l’anglais. Elle l’oblige à respecter des horaires de travail et va même jusqu’à lui écrire ses résolutions : « Pouvoir me lever en même temps que toi, prendre mon café au lait près de toi, sentir nos sommeils et notre veille répartis dans un même espace de temps, aurait, aura pour moi tant de charme ».
RÈGLE N° 5
NE JAMAIS MOURIR
Personne ne remplace une mère. Pas même une épouse. L’idée étant de ne jamais couper le fil, rester relié. Albert Cohen ne trouve le bonheur qu’avec sa troisième femme, Bella, qu’il épouse après la mort de sa mère et il écrit Le livre de ma mère pour se faire pardonner. Le meilleur moyen de ne pas se retrouver en concurrence est de conseiller à son fils de nombreuses conquêtes pour rester la seule élue, comme le fait la mère de Romain Gary.
« Il n’est pas bon d’être aimé, si jeune, si tôt. Cela vous donne de mauvaises habitudes. On croit que c’est arrivé. On croit que ça existe ailleurs, que ça peut se retrouver. On compte là-dessus. On regarde, on espère, on attend. Avec l’amour maternel, la vie vous fait une promesse qu’elle ne tient jamais. Chaque fois qu’une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances », écrit-il dans La promesse de l’aube.
Romain Gary m’a convaincue : il ne faut pas être une mère juive. C’est l’assurance de rendre son fils malheureux en amour, angoissé, malade, névrosé. Pourtant, est-il possible d’y échapper ? Les deux premières règles sont passées de mode ; les mères peuvent aujourd’hui réussir et il est rare de choisir un de ses enfants – trop mal vu. En revanche, la troisième règle s’est étendue : toutes les mères dignes de ce nom s’inquiètent de tout, tout le temps. La quatrième règle est plus que jamais d’actualité dans cette société de surveillance où même les portables peuvent traquer les enfants. Et la cinquième aussi ; les mères aimeraient toutes transmettre quelque chose à leurs enfants, et de fait, ne jamais complètement mourir. Faut-il en conclure que la mère juive est actuelle ? Il me semble qu’elle est plus que jamais omniprésente. J’irai même plus loin : comment peut-on ne pas être une mère juive ? Même les pères le sont !
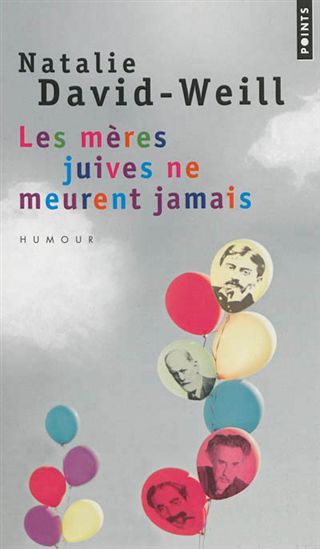
Natalie David-Weill,
Robert Laffont, 2011 / Points,
2013, 19,50 €.
Natalie David-Weill anime l’émission littéraire 4e de couverture sur Radio Judaïca Belgique.
