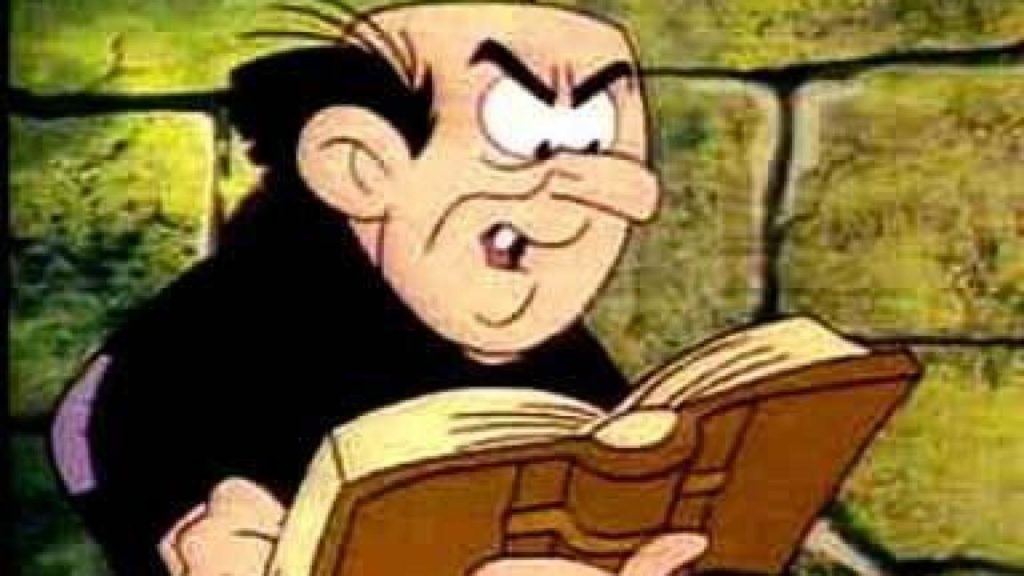
Le film Wicked bat son plein, offrant une réécriture du Magicien d’Oz du point de vue de la sorcière de l’Ouest, à la peau verte et au grand cœur. C’est le dernier exemple en date d’une fascination pour la figure du méchant, où leurs histoires sont revisitées de leur point de vue avec plus d’empathie. Avant ça, Cruella avec Emma Stone réexaminait Les 101 Dalmatiens et Maléfique avec Angelina Jolie renversait La Belle au bois dormant.
Mais cette réhabilitation de ces illustres vilains s’accompagne d’un mouvement plus discret: l’effacement de leur Jew-coding d’antan, ou des marqueurs antisémites qui traversent l’histoire de l’écriture du mal dans l’imaginaire occidental.
De Maléfique et ses cornes à Mère Gothel dans Raiponce, brune calculatrice et séductrice: nez arqué, “masculines” et déviantes, elles partageraient un désir de détournement d’une tête blonde, évoquant l’idée de pureté de la culture chrétienne menacée par la population juive corrompue.
Walt Disney, ouvertement antisémite, (il reçoit notamment la réalisatrice nazie Leni Riefenstahl en 1938 quand Hollywood lui ferme les portes) n’épargne pas non plus les figures masculines.
Aujourd’hui, si ces méchants ont été “nettoyés”, il n’empêche que leur version originale témoigne de la façon dont le monde occidental à construit sa vision du mal, en y projetant sa haine de l’Autre et l’affirmation de sa propre puissance.
Le Jew-coding, alter-ego repoussoir
Ce schéma narratif ne date pas d’hier. Dans l’adaptation de Les Trois Petits Cochons par Disney en 1933, le Grand Méchant Loup apparaît sous les traits d’un marchand de brosses au grand nez, brun, parlant avec un accent yiddish. L’image était si flagrante qu’elle a été censurée dans les rééditions ultérieures.
Dans Les Schtroumpfs, Gargamel incarne un sorcier cupide, obsédé par l’idée de capturer les Schtroumpfs pour les transformer en or. Son nez proéminent, son dos voûté, ses cheveux hirsutes et même son chat roux, Azraël, l’ange de la mort dans la tradition kabbalistique, rappellent les figures du Juif sorcier du Moyen Âge – un imaginaire que dénonce Le Petit Livre Bleu: Analyse critique et politique de la société des Schtroumpfs d’Antoine Buéno.
Dans Harry Potter, les gobelins sont rapidement accusés de renforcer des clichés antisémites par la presse américaine: ils dirigent la banque Gringotts, possèdent des doigts longs et crochus, des sourires carnassiers, un amour pour l’or – une esthétique qui rappelle les caricatures du journal nazi Der Stürmer, où les Juifs étaient représentés comme des financiers avides contrôlant l’économie mondiale.
Avant le cinéma, la littérature européenne regorgeait de telles imageries. Dans l’Angleterre élisabéthaine, Shakespeare écrit Le Marchand de Venise, où Shylock incarne l’archétype du Juif avare et cruel, réclamant un livre de chair comme gage de dette. Au XIXe siècle, les frères Grimm publient Le Juif dans les épines, un conte où un Juif est piégé par un chrétien, contraint de danser sur des épines avant d’être pendu – un récit qui témoigne d’un antisémitisme populaire profondément ancré.
Sans oublier comment, dans une autre époque et un autre registre, la version originale du Diable s’habille en Prada dépeint la despotique Miranda Priestly comme “née Miriam Princhek, dans l’East End de Londres. Elle venait d’une famille orthodoxe juive comme toutes les autres du quartier: extrêmement pauvre mais profondément pieuse” et comme une “paysanne juive devenue mondaine laïque”. Ici, c’est le fantasme d’une ascension sociale suspecte qui est activé, suggérant que sa réussite repose sur un masque trompeur, une dissimulation de ses origines.
Trouble dans la race
L’association au mal a marqué l’histoire du peuple accusé de déicide, ou tenu responsable de la mort du Christ et donc à tout jamais persécuté et diabolisé.
Dès le Moyen-Âge, les Blood Libels accusent les Juifs d’enlever des enfants chrétiens pour incorporer leur sang à la préparation de la matsa; mais aussi d’empoisonner les puits pendant les épidémies de peste, encore une fois pour tuer de précieux Chrétiens.
Les premières iconographies apparaissent par le biais de caricatures qui traversent l’Histoire. Plus tard, on retrouve ces codes visuels dans l’Affaire Dreyfus, les Protocoles des Sages de Sion et la presse nazie: l’homme juif y est dessiné avec un nez proéminent, crochu, bulbeux des yeux perçants ou globuleux, un sourire carnassier, censés suggérer une essence corrompue. “Le Juif du XIXe siècle est dévirilisé. Son danger n’est pas dans sa force physique, mais dans son intelligence perverse, son intellect manipulateur. Il s’oppose à la “bonne” masculinité solide et solaire”, dit Julien Maelstrom, essayiste spécialisé dans l’histoire des apparences et auteur de Vilains, Vilaines: les figures du mal au cinéma. Accusé dès le Moyen Âge d’avoir ses règles, il devient l’inversion parfaite de l’Übermensch, sorte de miroir en creux de l’idéal aryen, renforçant l’image d’un homme corrompu à tous les niveaux.
À cette figure repoussoir s’oppose celle de la Belle Juive, mythe ambivalent à la fois érotisé et castrateur, se développe au XIXe siècle à travers la litérature, la peinture et l’univers des maisons closes, et témoigne de la proximité entre antisémitisme et philosémitisme. “La Belle Juive est à la fois hyperféminine et perversement masculine, généralement représentée comme une femme fatale qui attire les hommes vers leur perte. Cette figure incarne une identification qui reflète la paranoïa fin-de-siècle autour du Juif perçu comme féminisé et malade, ainsi que celle de la femme « moderne » émancipée”, écrit Roberta Mock dans Jewish Women on Stage, Film, and Television, d’une femme faisant écho à des tentatrices comme la Reine Esther ou Salomé. Elle cristallise des paradoxes sexistes anciens mais sans cesse réactivés, rejouant l’ambivalence historique projetée sur la féminité juive fantasmée: à la fois objet de désir et symbole d’émancipation, figure de subversion et de menace. Cette fascination du patriarcat autant que de l’Occident pour cette Autre fait d’elle la surface de projection de ses propres désirs et angoisses face à une époque qui lui échappe.
À Julien Maelstrom de rappeler que “Le Juif, c’est l’Autre. Pour l’Occident, c’est tout ce qui n’est pas White Anglo Saxon Protestant, et désigne un grand sas nommé Orient vague dans lequel toutes les peurs sont projetées.”
Inquiétante judéité
L’antisémitisme européen ne repose pas uniquement sur un rejet du Juif comme Autre extérieur, mais sur un trouble intérieur. Il s’appuie sur un refoulé collectif : “l’étranger de l’intérieur” est familier et pourtant perçu comme irréductiblement autre. Cette structure peut rappeler le concept freudien de l’Unheimliche ou de “l’inquiétante étrangeté”, décrit par Freud en 1919. L’Unheimliche surgit lorsqu’un élément familier devient soudainement étrange, inquiétant, menaçant, un élément refoulé qui refait surface.
On peut comprendre l’antisémitisme comme une expérience d’Unheimliche à l’échelle collective. Le Juif n’est ni totalement assimilé, ni totalement exclu, trop visible ou pas assez, trop assimilé ou pas assez. Comme l’analyse notamment Delphine Horvilleur dans Réflexion sur l’antisémitisme, il incarne un trouble dans les catégories identitaires fixes de l’Occident, une figure mouvante qui dérange; une ambiguïté entre l’intérieur et l’extérieur, un défi aux catégorisations classiques. Il oscille entre victime et maître du monde, capitaliste et révolutionnaire, errant et infiltré. Tantôt fétichisé, tantôt diabolisé, cet Autre juif à l’écran continue de jouer la figure repoussoir d’une société qui se regarde en lui. On peut ici penser à l’expression de Eva Illouz parlant d’une longue histoire de “cet antisémitisme de confort où le Juif cristallise ce que certains esprits jugent bon de reprocher à une partie de l’humanité.” dans son texte Le 8 octobre: Généalogie d’une haine vertueuse..
Une instrumentalisation en mouvement
Cette inclassabilité, cet état d’entre-deux, est analysé par Roberta Mock comme une nécessité pour les communautés juives de négocier et contrôler en permanence leur identité en fonction des normes locales.
Nombre de Juifs font l’expérience du passing – cette capacité à « passer » pour un membre de la culture dominante, à se conformer aux codes attendus, tout en restant perçus comme une menace latente.
Et si le mouvement et la transformation, inscrits dans l’histoire d’un peuple diasporique, répondent aux besoins du discours dominant, les iconographies aussi évoluent sans cesse. C’est précisément ce que révèlent ses figures au cinéma: tour à tour Juif errant ou tirant les ficelles du monde, ces tropes sont aussi multiples que les contextes occidentaux qui eux aussi mutent.
“La figure du Juif est toujours incertaine. Est-il blanc ou non? Dans certains cas, c’est juste un immigré de Brooklyn, un brun aux cheveux bouclés au physique méditeranéen”, analyse Julien Kojfer, scénariste. Selon lui, on pourrait faire opérer une relecture antisémite de films comme The Social Network qui retrace le succès de Mark Zuckerberg: “Le film le suit alors qu’il veut intégrer des fraternités, ces cercles blancs de la vieille élite universitaire américaine. Lui, le petit Juif outsider, veut s’y faire une place. On peut très bien y voir un imaginaire antisémite: ce gamin aigri, qui ne se sent pas à sa place, va créer son empire pour écraser tout le monde grâce à son intellect démesuré, comme une revanche contre un monde qui ne veut pas de lui.” ajoute-t-il.
À se demander quels seront les prochains “méchants” façonnés en miroir de conflits actuels. Ce que Eva Illouz nomme la haine vertueuse, un antisémitisme réactualisé associant désormais le Juif à l’oppresseur, au colonisateur, au symbole d’un pouvoir dominant à abattre, produira sans doute un imaginaire actualisé – support de tous les maux contemporains de l’Occident et d’une prise de conscience de soi que ce dernier ne saurait affronter.
