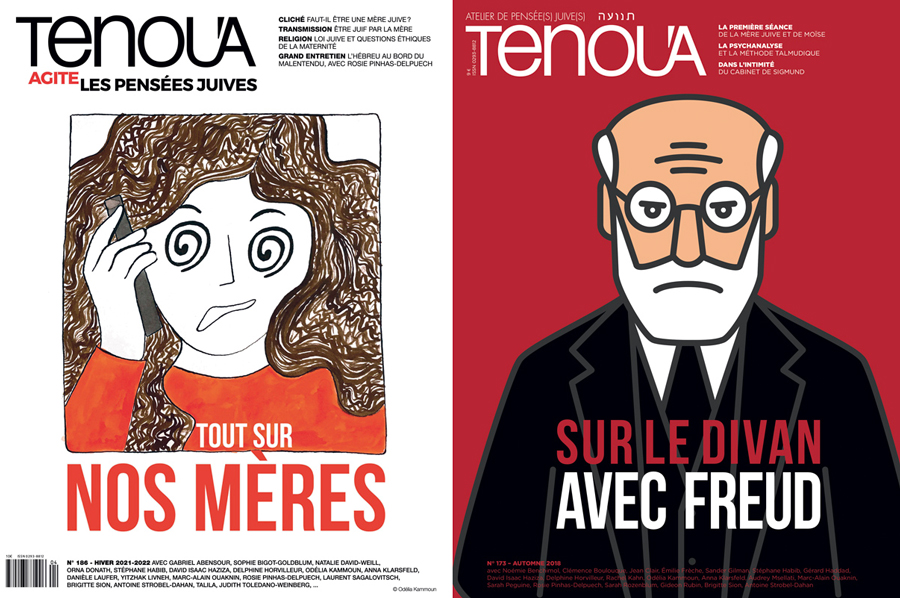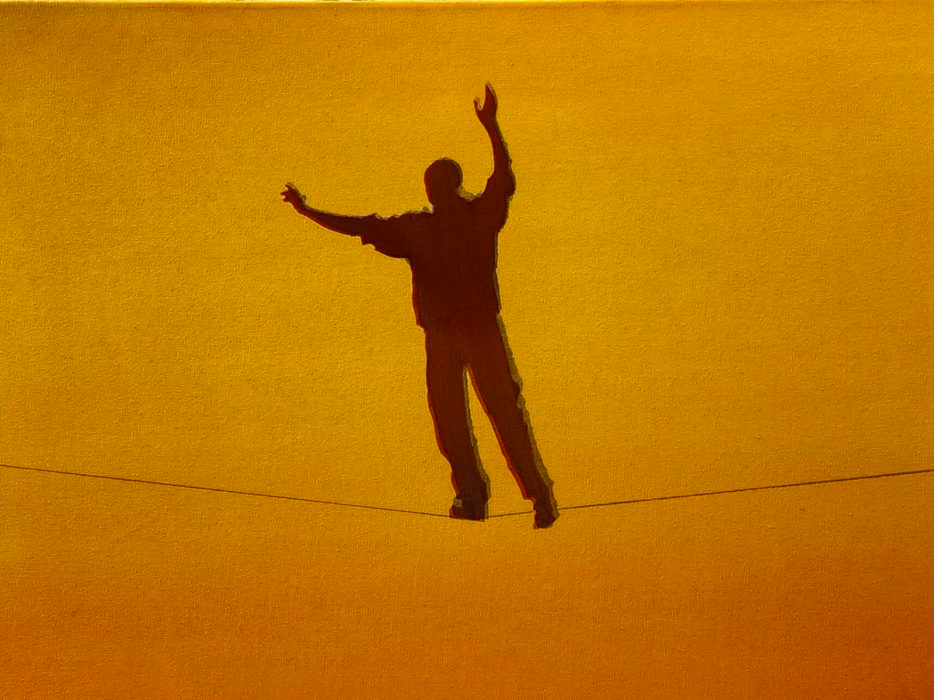La tentation est forte de se laisser happer par le dernier numéro, celui de cet hiver 2023-2024. Noir comme nos pensées d’après le 7 octobre. Il aurait d’ailleurs aussi bien pu, à l’inverse, être blanc et vide comme l’hébétude, comme la réflexion empêchée de se fixer, d’imaginer le monde d’après, marqué par notre chagrin absolu, nos indignations renouvelées, nos certitudes démolies, notre questionnement ontologique, notre positionnement politique bousculé…
Mais je résiste, et repars vers une des couv’ du début, l’un des numéros que je ne peux plus lire mais qui excite mon imagination.
Le numéro 156 d’il y a dix ans, « C’est quoi être un Juif ? », est au fond le numéro de tous les numéros ! Qui nous oblige à des autodéfinitions : n’étant pas à l’image de mes arrière-grands-mères d’Alsace ou de Bratislava, quelle sorte de Juive suis-je en ce premier quart de XXIe siècle ? Juive d’appartenance par toutes mes fibres, mais plus laïque que mes ancêtres ; Juive de Rosh haShana et de Kippour peut-être, tout en étant profondément attachée à une identité juive revendiquée.
Mais la journaliste que je suis, qui aime synthétiser, a une furieuse envie de faire un « mix » de plusieurs numéros, qui découlent de celui-là.
D’abord, le génial double numéro 181 de l’automne 2020 sur les Séfarades et les Ashkénazes, à lire dans les deux sens. J’ai fait le fameux test génétique. Je me suis frotté la joue, j’ai envoyé l’échantillon de salive, j’ai attendu les résultats en espérant des horizons un peu inattendus. Résultat : 85 % d’origine ashkénaze ! Parmi mes quatre grands-parents, l’une est ma grand-mère séfarade d’Alger, mais elle compte pour du beurre ou presque ! Pas étonnant que j’affiche les stigmates parmi les plus pesants des Ashkés, du pessimisme noir au gefilte fish, et que je porte en permanence la Shoah en bandoulière, heureusement tempérée par l’humour désespéré venu d’un lointain shtetl !
Si bien que je suis fière de mes petits 15 % de Sef, qui se battent comme des chiens pour me permettre de ressentir quelques bouffées de joie de vivre, de soleil et de chakchouka. Croyez-moi, je les couve, je les bichonne, pour qu’ils résistent avec vigueur aux 85 % autres, plombants.
Le numéro 186, « Tout sur nos mères », est le complément essentiel du précédent, s’appliquant aux uns comme aux autres, indifféremment affublés. Salutaire exercice de plongée dans son ascendance qu’il est indispensable d’entremêler avec le n° 173, « Sur le divan avec Freud », qui nous permet d’aller creuser le fond de nos ressentiments. Et depuis des années, je creuse, je creuse…
Il est urgent de saupoudrer aussi un peu du n° 159, « Dieu a-t-il de l’humour » sur les nombreuses et récurrentes livraisons de Tenou’a au moment de Yom haShoah. Des numéros qui explorent notre rapport à la mémoire et l’impossibilité de comprendre ce qui échappe à la raison. Je pense notamment au hors-série de 2018, « La justice après la Shoah », avec cette photo insoutenable tirée de L’Album d’Auschwitz (et qui me hante comme celle du petit juif de Varsovie, étoile jaune et bras levés), de cette grand-mère sur la rampe de Birkenau, courbée sous l’absolu malheur, et qui conduit ses petits-enfants à la chambre à gaz. C’est sans doute cela, cette obsession de la Shoah qui augmente avec l’âge et qui fait de moi une juive différente de mes aïeux.
Mais j’aimerais m’arrêter sur un numéro récent, le 192, de l’été 2023, sur les « Révoltes ». En Une, des femmes déguisées en servantes écarlates, avec coiffes et longues robes pourpres, défilant dans les rues de Tel Aviv il y a un an, lors des protestations contre la « réforme judiciaire » du gouvernement de Nétanyahou, liberticide et dangereuse. Tout cela paraît loin depuis le 7 octobre. Mais ce qui me plaît aujourd’hui dans cette Une, c’est le sous-titre « Le courage de dire non », qui me paraît une exigence essentielle aujourd’hui. Dire non à l’air du temps, aux doxas impérieuses qui imposent de se définir et d’exclure du groupe toute personne qui apporte une nuance, une inflexion par rapport à l’opinion dominante du groupe en question.
Ainsi de cette guerre à Gaza. Elle a été voulue, pensée, entretenue, alimentée par le Hamas et l’abominable pogrom du 7 octobre. Il aurait pu y mettre fin, en protéger la population dont il avait la charge, en relâchant les otages qui sont détenus depuis plus de six mois dans des conditions atroces et violentés comme on le devine.
Mais on ne peut pas, surtout quand on est juif, ne pas être épouvanté par les morts civils palestiniens, les femmes et les enfants mutilés, même s’ils sont les victimes de ce conflit déclenché par les massacreurs du Hamas.
On ne peut pas se taire, en tant qu’humain devant l’intensité de la détresse et des privations que subit cette population, en regard du peu de résultats obtenus dans la quête des tueurs du 7 octobre dernier.
On doit pouvoir dire qu’on souhaite que ces hostilités cessent, qu’Israël y mette fin, à condition de récupérer tous les otages qui restent.
On doit pouvoir appeler, pour la protection même d’Israël, à la fin des colonies et à l’avènement, dans des conditions à définir, d’un État palestinien.
On doit pouvoir attendre du gouvernement d’Israël, qui a aujourd’hui la majorité de la population contre lui, qu’il se soumette à des élections et rende des comptes à la justice qui est saisie.
On doit pouvoir exprimer et écrire cela sans être pour autant désigné comme traître à la cause, comme suppôt de LFI, comme incarnant – je l’ai entendu – la « honte du peuple juif ». Dire non est dans notre ADN. Nous devons retrouver notre réflexe de minoritaires, de révoltés, justement. Il y va de notre humanité, de notre essence même de peuple juif. Agiter nos idées, nous exhorter à la dissidence, à penser contre nous-mêmes, c’est le rôle et l’ambition de Tenou’a après tout. Il ne tient qu’à nous de continuer.