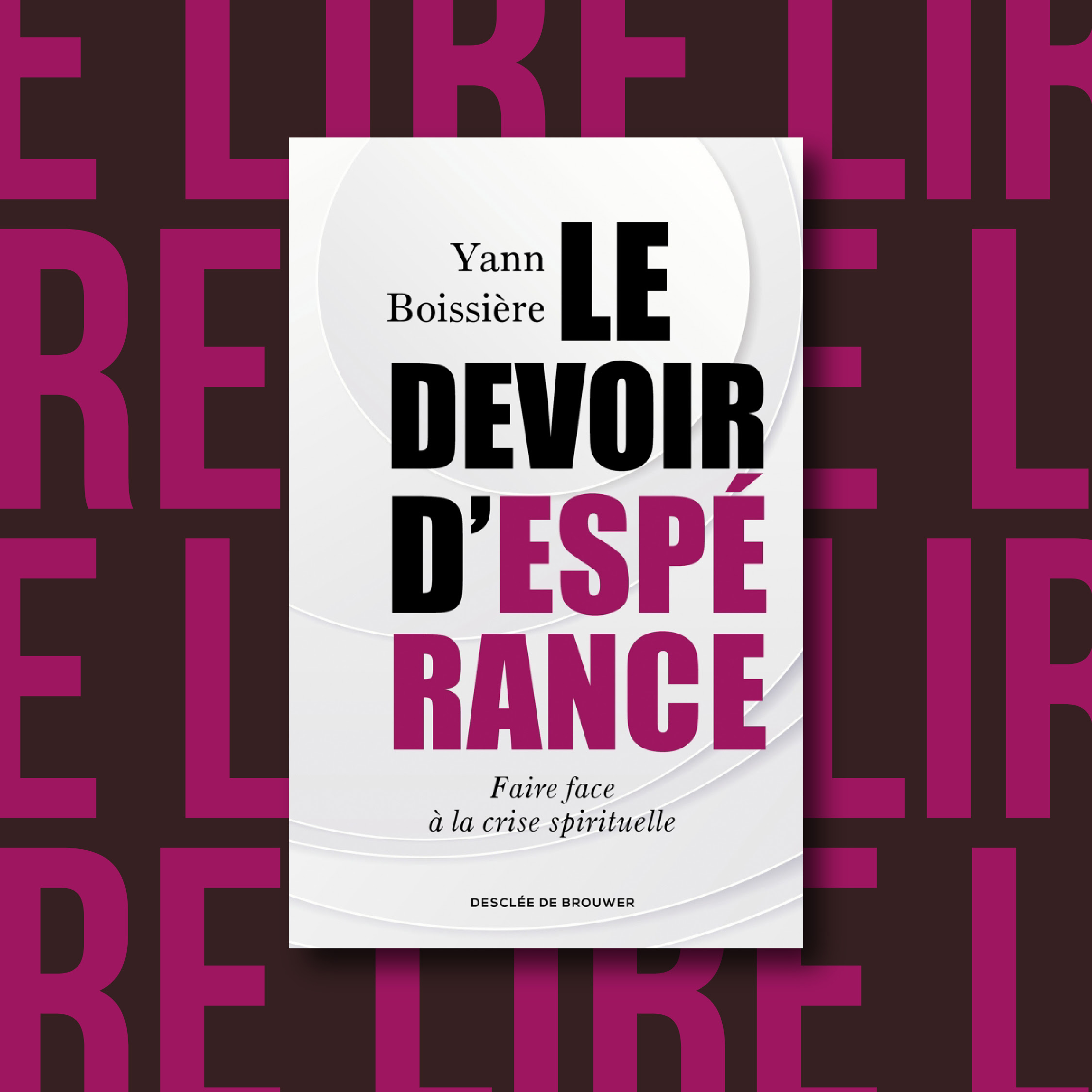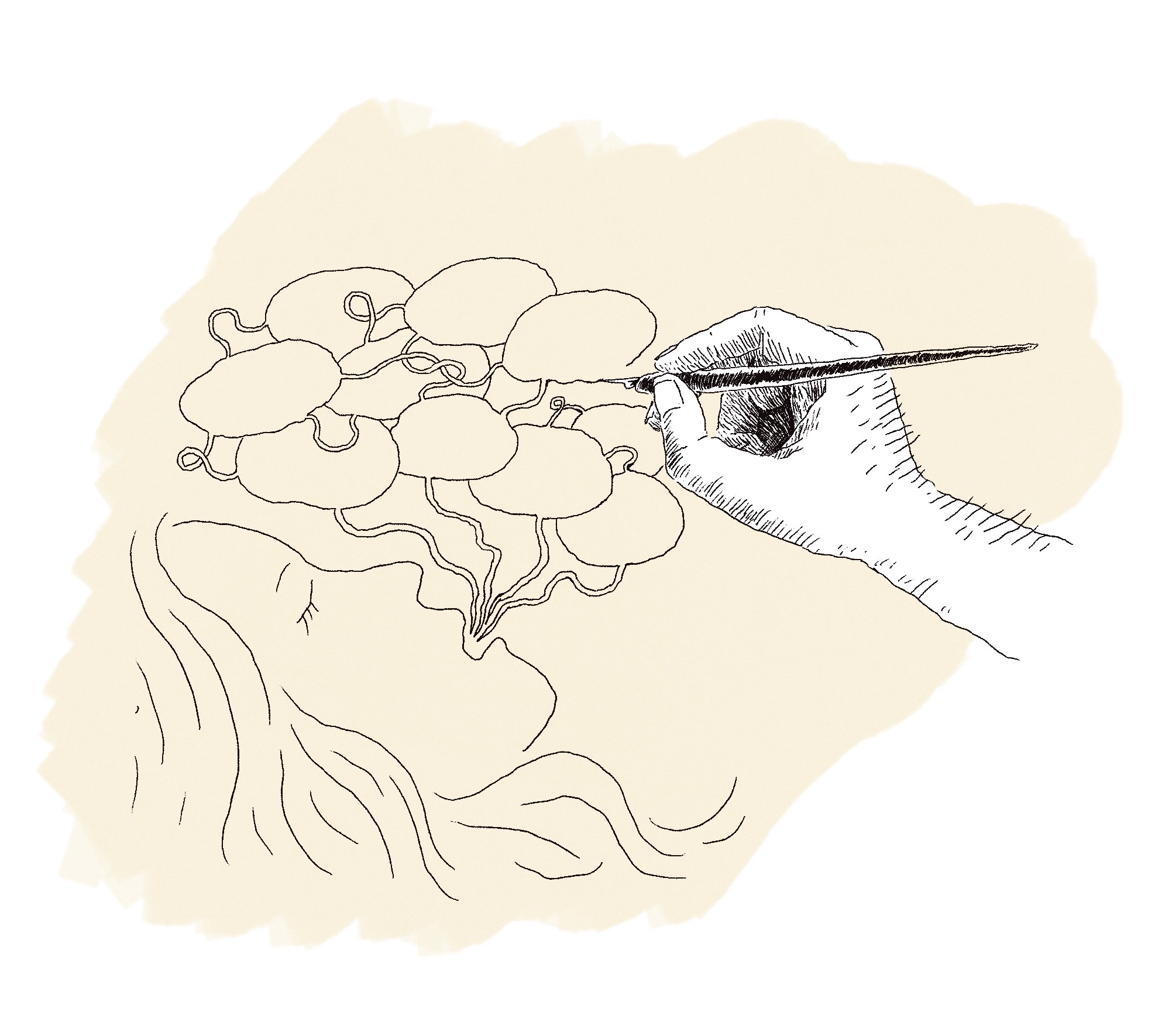Trois questions à Ronit Elkabetz
Actrice et réalisatrice israélienne
Le judaïsme se soucie-t-il, d’après vous, de l’égalité entre hommes et femmes ?
Les textes traditionnels juifs ont beau définir la femme comme une « reine » ou comme une « femme d’excellence », ils ne conçoivent pas pour autant de véritable égalité entre hommes et femmes. La trilogie de nos films parle précisément de cela et explore la question du statut de la femme en général à travers la situation d’une femme en particulier (Viviane Amsalem), dont la famille a immigré depuis un pays arabe vers la société israélienne. Viviane aspire à être occidentale à tous points de vue et veut adopter la culture et le style de vie moderne. Mais pour son mari, il est un peu plus difficile de s’adapter à cette culture et, de là, naissent d’importantes tensions.
À travers l’examen de ces tensions, les films analysent la place des femmes dans la société israélienne. Malgré les valeurs patriarcales, religieuses et orientales dans lesquels elle évolue, Viviane veut croire à ce que la société israélienne lui promet. À travers le rêve d’un monde nouveau, plus égalitaire, cette société se définit en effet comme une démocratie libérale au sein de laquelle tous seraient égaux. En fait, nous ne parvenons pas encore à créer cette réalité par des lois qui permettraient une égalité véritable ; alors, pour bien des gens, le conflit est permanent entre des repères anciens et des définitions nouvelles qui restent souvent théoriques. Mais ce que la société israélienne permet incontestablement, c’est le débat. S’y expriment les voix différentes, et certaines aspirent ouvertement à plus de liberté malgré le carcan d’un monde ancien.
Votre dernier film, Gett, le Procès de Viviane Amsalem, dénonce l’inégalité entre hommes et femmes face aux tribunaux rabbiniques, spécifiquement au moment du divorce religieux. Comment a-t-il été accueilli en Israël ?
J’ai reçu énormément de réactions. Les tribunaux rabbiniques sont un lieu fermé et tout s’y passe derrière des portes closes. Personne n’est en général témoin des débats qui s’y déroulent. Le film constitue donc une sorte de pass d’entrée particulier vers un monde méconnu.
C’est la première fois dans l’histoire du cinéma qu’on peut y pénétrer et voir comment les choses se passent. Pour de nombreuses personnes, cette découverte fut un choc. Certains voulaient savoir si les choses se passent comme cela partout dans le monde ou seulement en Israël. D’autres avaient tout simplement du mal à croire que de telles choses pouvaient se produire dans un pays démocratique. Mais, en filigrane, le film ne parle pas que de la situation en Israël mais plus largement du statut des femmes à travers le monde, que ce soit dans des régimes patriarcaux et même des pays occidentaux où les femmes vivent encore des discriminations.
Dans le monde juif, le refus de donner le gett est un phénomène qui touche beaucoup plus de gens qu’on ne le pense. Pendant de longues années, j’ai reçu des témoignages très semblables à celui de Viviane dans le film. À l’issue d’une projection récente en avant‐première en Israël, de nombreuses femmes m’attendaient, toutes venues témoigner et me dire « c’est mon histoire… c’est l’histoire de ma sœur… c’est l’histoire de mon amie ».
Pensez-vous que ce film a créé chez certains une prise de conscience dans la société israé- lienne ?
Lorsque les gens se marient, ils ne veulent pas penser au divorce. Bien sûr, tous les divorces ne ressemblent pas à celui de Viviane. Mais il est incontestable qu’une femme qui va divorcer religieusement se retrouve dans une situation de vulnérabilité par rapport à son mari qui a un certain pouvoir sur elle et qui peut décider de son l’avenir, de sa situation financière ou de sa relation avec ses enfants. Pour toute femme qui découvre cela, il y a quelque chose de terrifiant. On a toutes tendance à se dire que pour nous les choses ne se passeraient pas comme cela, mais la vie est pleine de surprises.
Je crois que le cinéma à la capacité de changer les consciences. Et ce changement de conscience peut produire un changement de réalité. Cela commence parfois à un niveau individuel : celui d’une femme qui se dit « je ne suis pas prête à vivre ce que Viviane traverse dans le film. Je ne laisserai pas ma vie me porter au bord du précipice ». Cela continue avec dix ou cent autres femmes. Et une fois que l’individu exige un changement pour lui‐même débute un changement au niveau de la société et du débat national. Il est inconcevable qu’une femme vive sous la menace simplement parce qu’elle est une femme. Je crois que cette prise de conscience est une réalité. Je ne dis pas qu’il faille annuler le mariage religieux. Mais je pense qu’il est essentiel de proposer des alternatives et aussi de protéger celles dont la voix doit être entendue. Il est essentiel que, devant le tribunal, une femme ait au moins autant de droits que son conjoint.
J’espère que ce film, réalisé avec mon frère Shlomi, va produire un bouleversement de conscience important pour la société israélienne. Et, qui sait… peut‐être déboucher sur des changements très concrets.
Propos recueillis par Delphine Horvilleur