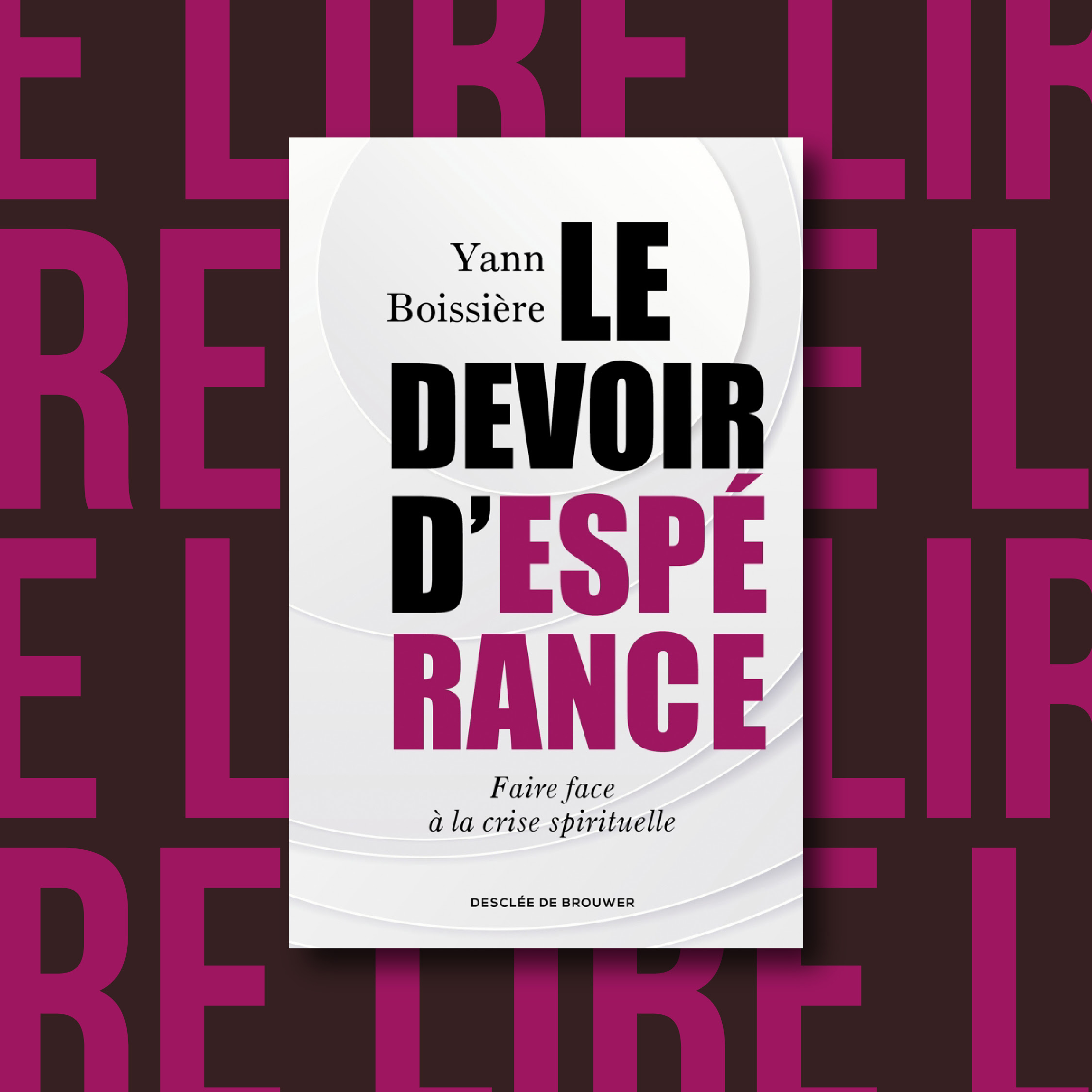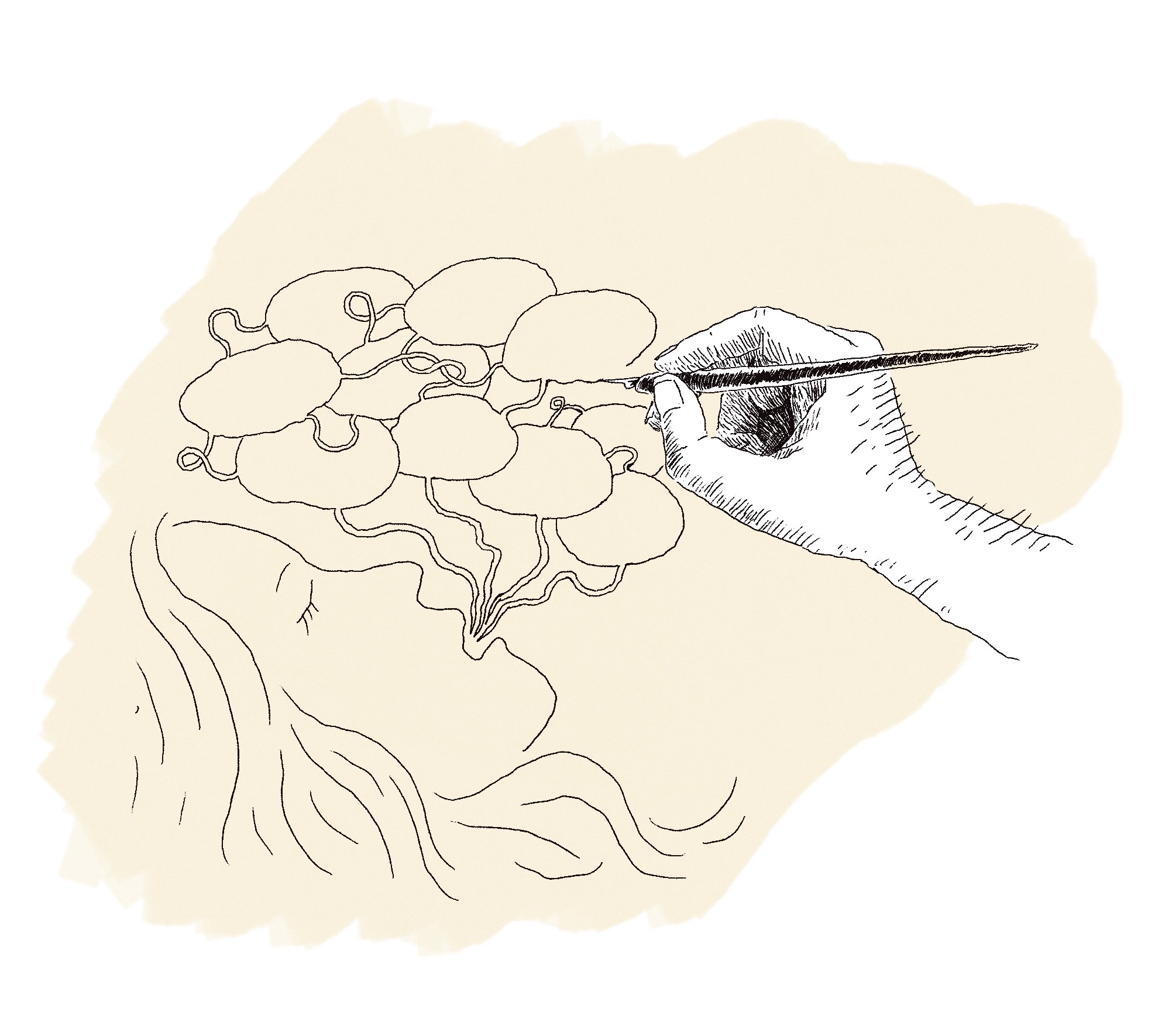C’est une curiosité du calendrier juif qui passe souvent inaperçue : Souccot, la fête automnale des cabanes, est la seule célébration à faire partie des deux cycles festifs que le Judaïsme connaît depuis la nuit des temps bibliques : le cycle des trois fêtes de pèlerinage (avec Pessah et Shavouot), et celui des fêtes de Tishri (avec Rosh haShana et Yom Kippour).
Au carrefour de ces deux grandes modalités temporelles, Souccot constitue une sorte de point nodal spirituel, et je voudrais brièvement sonder ici quelques unes des implications de cette intersection. Avec, comme point de départ de l’investigation, une suggestion peut‐être audacieuse : dans ma lecture, chacun des deux cycles de fêtes, pris en tant qu’unité intrinsèque, sera perçu comme représentant l’un des pôles de la tension philosophique entre l’Être et le Devenir.
Le cycle des trois fêtes tout d’abord : c’est sous le signe du Devenir que je propose de le placer, afin de le lire comme un cycle de construction identitaire en trois temps, consécutifs mais néanmoins bien distincts. En d’autres termes, chacune des trois fêtes de pèlerinage correspond à une étape précise de la structuration identitaire de l’être humain.
Suivons ici la chronologie de l’année juive : deux semaines à peine après le nouvel an, la première des trois fêtes se trouve être – précisément – Souccot. Or, sans doute possible, Souccot est la plus universelle de toutes nos fêtes : le Talmud (Soucca 55b) note ainsi que les soixante‐dix sacrifices bovins qui étaient présentés au Temple pendant la fête de Souccot avaient pour but d’éveiller la compassion divine envers l’ensemble des soixante‐dix nations du monde, afin qu’une pluie fécondatrice tombe sur l’ensemble du globe.
Ceci reflète, dans ma lecture, un premier stade de l’agencement identitaire : au niveau le plus basique de notre personne, nous sommes tous des citoyens du monde. Nous appartenons à cette fantastique tapisserie vivante qui porte le nom d’humanité, et cette appartenance fonde le socle même de notre ontologie personnelle.
Toutefois, l’identité est souvent vécue à un autre niveau, plus restreint cette fois : celui de la collectivité, du peuple ou de la nation. Ce deuxième niveau correspond au message essentiel de la deuxième fête de pèlerinage : Pessah, le moment pendant lequel nous célébrons l’émergence du peuple d’Israël.
Saviez‐vous que le chapitre 12 de l’Exode interdit aux non‐Juifs de prendre part au sacrifice de l’agneau pascal ? Et qu’à suivre les opinions de certaines autorités rabbiniques, il serait interdit de partager la matsa du Seder avec nos amis non‐Juifs ? Ces restrictions sont hautement inhabituelles dans le Judaïsme, dont l’un des messages essentiels reste l’ouverture sur autrui. Toutefois, aussi hospitaliers et tolérants que nous souhaitions être, nous avons parfois besoin de nous retrouver en comité plus restreint ; ces sortes d’occasions familiales nous permettent de nous recentrer sur ce qui fait le cœur de notre identité collective.
Et enfin il existe un troisième niveau, encore plus étroit : celui de l’individu. Chacun d’entre nous existe en tant qu’être humain et en tant que membre d’une « tribu », certes ; mais aussi en tant qu’individu distinct. Ceci est le message de la troisième fête de pèlerinage : Shavouot, qui célèbre, comme chacun sait, le don de la Torah. Or, c’est au singulier que la Divinité choisit de Se révéler : « Je suis l’Éternel ton Dieu » – un Dieu personnel et immanent, avec lequel même une fragile créature faite de chair et de sang peut entretenir une relation individuelle.
Ces trois niveaux de l’identité (universelle, nationale, et personnelle) que je viens de mettre en relation avec les trois fêtes de pèlerinage que sont Souccot, Pessah et Shavouot, sont cumulatifs et interdépendants : chacun enrichit les deux autres.
Mais peut‐on les discerner en préfiguration dans les versets de la Torah ? Le texte biblique a parfois de ces fulgurances qui laissent pantois même ses lecteurs adeptes d’une méthodologie historico‐critique.
Il me semble que c’est le cas en l’espèce : par trois fois, la Torah répète, dans trois passages distincts du Pentateuque, l’obligation de se présenter devant Dieu lors des fêtes de pèlerinage ; mais, et c’est le point important, la divinité est présentée à chaque fois différemment : la première fois, le texte biblique la décrit comme « l’Éternel, le Souverain universel » (Exode 23:17); la seconde fois, la divinité est « l’Éternel, Dieu d’Israël » (Exode 34:23) ; et la troisième fois, le verset parle de « l’Éternel, ton Dieu » (Deutéronome 16:16).
Coïncidence ou non, ces trois versets recoupent à nouveau les trois dimensions déjà évoquées que sont l’universel, le national et le personnel. Voilà pourquoi j’ai proposé que les trois fêtes de pèlerinage forment le cycle du Devenir : une sorte de périple dans le temps au cours duquel l’identité humaine est, chaque année, revisitée et approfondie sous tous ses aspects.
Passons maintenant au deuxième cycle annuel, celui des fêtes de Tishri. A priori, ce deuxième cycle est placé sous le signe peu réjouissant de la stricte Justice : le jugement divin serait tout d’abord prononcé à Rosh haShana, puis ratifié à Yom Kippour et, selon certaines traditions mystiques tout du moins, finalement exécuté vers la fin de Souccot.
Oserai‐je le dire ? Toute cette pesante imagerie d’une divinité vengeresse et scrutatrice, installée sur le Trône céleste du Jugement, et mesurant incessamment les plus insignifiantes actions de Ses créatures afin d’en punir les infractions et récompenser les mérites, a des relents franchement médiévistes qui ne me plaisent guère. Dieu n’a‑t-Il donc rien de mieux à faire, dans Son existence cosmique, que de punir les petites compromissions qui ne font, on le sait bien, que trop partie de la condition humaine ? Manie‐t‐il vraiment le bâton et la carotte, dans l’espoir que, chétives créatures que nous sommes, nous revenions à Lui dans un subit accès de repentir, dont la sincérité et l’authenticité seraient finalement quelque peu douteuses ? Dans la continuité de la pensée développée ici, je souhaite proposer une nouvelle interprétation, et suggérer que le cycle de Tishri est celui de l’Être ; en d’autres termes, il ne s’agit plus, comme précédemment, d’un mouvement dynamique d’expansion vers de nouveaux horizons identitaires, mais au contraire cette fois d’un moment de consolidation et de stabilisation des acquis.
Dans cette lecture, je suggère que les fêtes de Tishri soient perçues comme une période privilégiée permettant de réparer ce qui exprime le plus authentiquement es personnes que nous aspirons à être : nos relations. Nos relations avec autrui, en particulier avec nos proches. Nos relations avec cet Autrui absolu qu’est Dieu. Et nos relations avec nous‐mêmes, aussi.
Cette vision de Tishri comme une opportunité de restaurer l’intégrité des relations privilégiées qui forment le cœur de notre existence est, me semble‐t‐il, la clef permettant d’accéder à une nouvelle compréhension de cet antique concept d’une justice écrasante et inquisitrice.
Pourquoi cela ? Parce qu’une relation plus proche implique nécessairement une part accrue d’ouverture et de vulnérabilité réciproques de la part des protagonistes impliqués ; et, si l’autre est plus vulnérable, il faut d’autant plus se garder de ne pas le heurter. La plus petite offense recèle le potentiel de grièvement blesser un conjoint, un enfant ou un ami proche, alors qu’elle laisse indifférent un parfait étranger. Au bout du compte, le meilleur examen de la santé d’une relation est donc celui de la qualité des petites actions qui l’entretiennent. Au‐delà de la sémantique punitive, le message essentiel du mois de Tishri est une célébration du détail, une piqûre de rappel que nos plus petites actions sont des marqueurs de proximité dans nos rapports à autrui – fût‐il Dieu ou Homme.
Ce mois de Tishri nous présente ainsi le défi de nous retrouver, et de redécouvrir le sens d’une vie intense dans les myriades d’interactions quotidiennes avec ceux qui nous entourent. La Teshouva : un processus de retour sur soi, de Retour vers l’Être.
Devenir et Être. Construction identitaire d’un côté, consolidation identitaire de l’autre. Il y a un rythme presque respiratoire à nos cycles de fêtes.
Or donc, pour en revenir à Souccot, il est frappant que les deux cycles se recouvrent ce jourlà. La fin d’un cycle est le début d’un autre, et ainsi de suite jusqu’à l’infini.
Souccot est donc tout à la fois un a b o u t i s s e m e n t et un renouveau. L’accomplissement d’un processus d’internalisation des acquis, et une nouvelle ouverture vers l’extérieur et de nouveaux horizons.
Dès lors, est‐il vraiment surprenant que cette nouvelle ouverture au monde extérieur s’exprime via l’abandon provisoire de nos demeures afin de résider, pendant une semaine, dans une fragile cabane ouverte à tous les vents ?
La soucca est un symbole de fragilité : elle représente une décision consciente de ne pas se reposer sur ses lauriers ni de s’enfermer dans la sécurité des expériences passées, mais au contraire de quitter notre zone de confort, pour aller à la rencontre de nouveaux défis, et de continuer à construire, encore plus haut et encore plus fort, l’Humain.