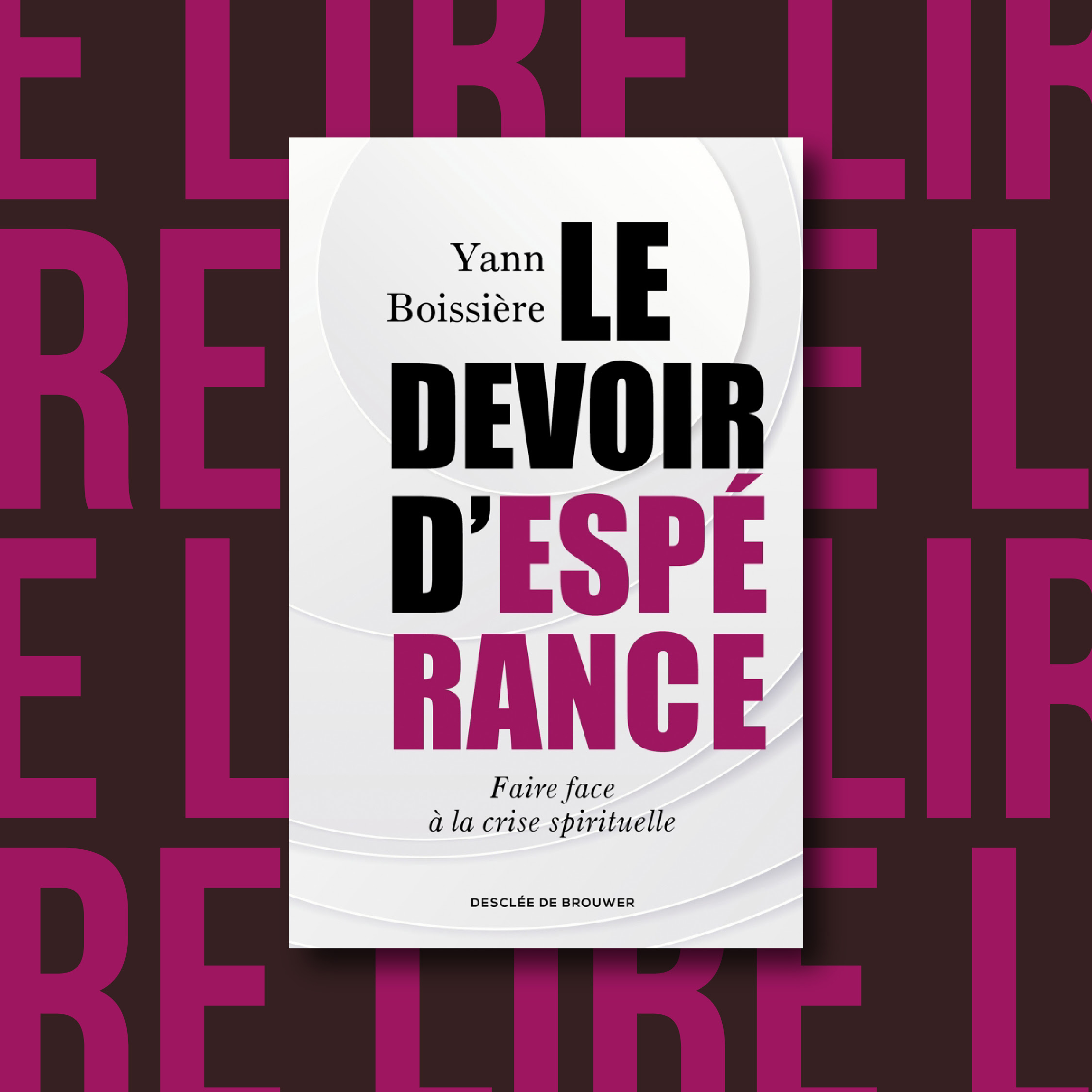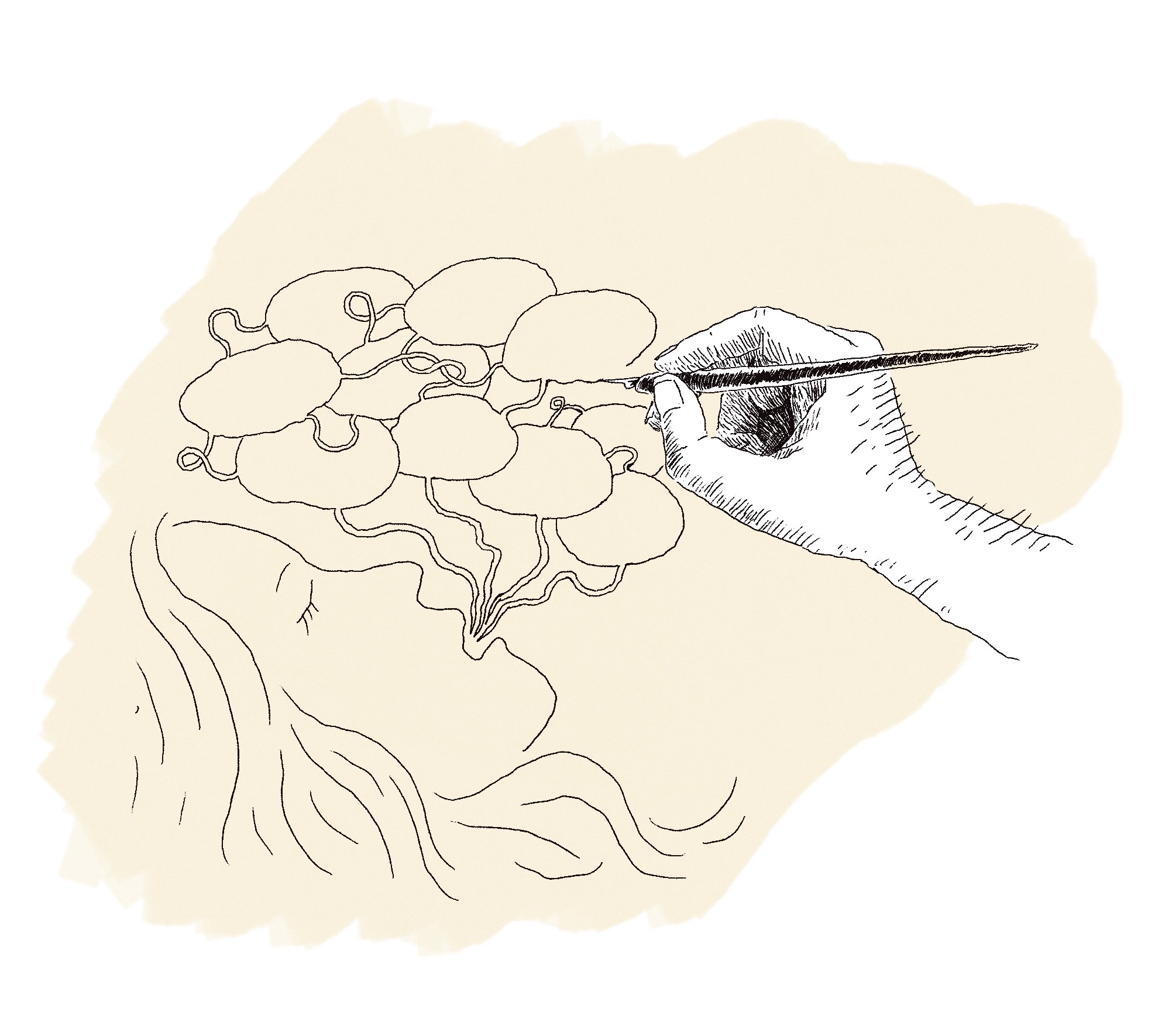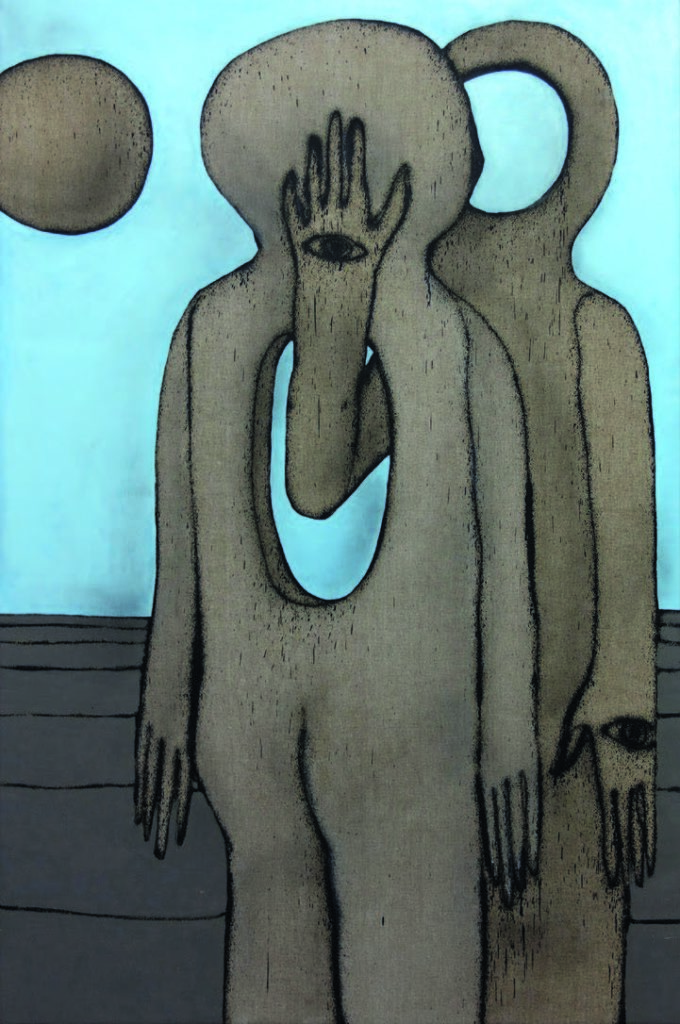
Courtesy Hezi Cohen Gallery, Tel Aviv
Un regard juif sur le pouvoir temporel et spirituel
Les Catholiques ont leur pape, dont les bulles et les encycliques s’imposent à plus d’un milliard de fidèles. Ils ont leurs prêtres, investis du pouvoir de bénir, d’unir et même de pardonner au nom de Dieu. Juifs, qu’avons-nous de tel ? Rien, ni personne.
Pour en comprendre les raisons, voyons d’abord comment la Bible aborde le principe du pouvoir temporel. Une âme juive ne sait pas ce qu’est un homme providentiel. Vouloir un chef est un signe d’immaturité, qui se révèle dans toute son étendue quand le peuple supplie Samuel d’avoir un roi : « Il nous faut un roi ! Nous voulons être comme les autres peuples, nous aussi ; et notre roi (…) marchera à notre tête ! » 1. Samuel commence par s’opposer à cette exigence puérile : un peuple adulte n’a pas besoin de guide. Puis il cède, comme on baisse les bras devant un caprice. D’accord ; le peuple aura un roi, puisqu’il y tient. Mais ce roi ne devra jamais oublier les trois limites à l’intérieur desquelles s’exerce le pouvoir.
Première limite : le roi est là pour servir la loi, et non pas la loi pour servir le roi. Ainsi l’exprime le Deutéronome : « Quand il occupera le siège royal, il écrira dans un livre, une copie de cette Doctrine. Il doit y lire toute sa vie, afin (…) qu’il respecte et exécute tout le contenu de cette Doctrine, afin qu’il ne s’écarte de la loi ni à droite ni à gauche » 2. Le roi exerce ainsi, au sens le plus strict du terme, le pouvoir exécutif : il exécute la loi ; il garantit le respect du droit. C’est aussi le langage des prophètes, et notamment du premier d’entre eux, Isaïe : « Des princes gouverneront pour le droit » 3. Le chef s’efface derrière le droit. S’il venait à oublier ce devoir, il ne serait plus digne de sa fonction 4.
Deuxième limite : le chef est humble. C’est l’un des traits les plus marquants de l’autorité dans la Bible, que le sentiment d’incapacité dont sont habités ceux qui sont amenés à l’exercer. Moïse, lorsqu’il reçoit de Dieu la mission de constituer tout un peuple en tant que nation, s’écrie : « De grâce, Seigneur ! Je ne suis pas habile à parler, ni depuis hier, ni depuis avant-hier, car j’ai la bouche pesante et la langue embarrassée » 5. La faiblesse d’Achille était dans son talon ; celle de Moïse est dans sa langue, ce qui est autrement plus handicapant pour un chef dont la suprématie doit s’exercer par la parole. À chacune des occurrences bibliques innombrables 6 où il est dit que « Moïse parla aux enfants d’Israël et leur dit : (…) », il parlait aux enfants d’Israël en bégayant ; cette faiblesse apparaît non seulement comme compatible avec son pouvoir, mais comme une condition de ce pouvoir. Et quand l’humilité du chef n’est pas forcée, elle est acquise. C’est le cas des rois d’Israël, à commencer par David qui, malgré l’étendue de son pouvoir et la fourberie avec laquelle il était parfois capable de l’exercer, n’a jamais cessé d’avoir conscience de ses propres limites. Les Psaumes de David sont une ode aux limites, celles du pouvoir royal et celles de la condition humaine : « Mon cœur n’est pas gonflé d’orgueil, mes yeux ne sont pas altiers. Je ne recherche point de choses trop élevées pour moi, au-dessus de ma portée » 7. Le pouvoir, dans la Bible, n’est pas la source de la démesure, mais au contraire l’origine de la mesure.
Enfin – c’est la troisième borne que le pouvoir temporel se fixe à lui‐même – le roi est un sage. Voyons l’œuvre de Salomon : les Proverbes, l’Ecclésiaste, livres d’un homme qui a tout et qui a l’esprit assez libre pour comprendre à quel point ce tout n’est rien. Il faut imaginer, quand on évoque l’histoire ancienne d’Israël, un peuple qui aurait eu pour plus grands rois 8 des sortes de Marc‐Aurèle, des sages d’une impitoyable lucidité sur eux‐mêmes, ce qui emporte notamment une conséquence : les phénomènes de cour ne peuvent pas exister dans ces conditions. De tels chefs sont inaccessibles à la flatterie. Ils sont au‐dessus de cela. Ils échappent ainsi à cette fatalité qui est la clef de toutes les dérives totalitaires, et qui veut qu’un être dont la vocation est de diriger le peuple se laisse griser par la foule 9. Comme Abraham gravissant seul le mont Moriah, comme Moïse se hissant seul au sommet du mont Sinaï, leur solitude choisie est la clef de leur sagesse. Ils sont à la tête d’une nation – et ils savent donc qu’il leur est interdit de perdre la tête.
Ces trois limites, dans l’ordre de la politique, en entraînent, dans l’ordre de la religion, trois autres, dont l’examen permettra de cerner la différence, fondamentale, entre un prêtre et un rabbin, et la nature de l’autorité sacerdotale dans le judaïsme.
La première de ces trois données, c’est qu’il n’y a pas, dans la religion juive, de sacrement. Le rabbin Leo Baeck établit un lien direct entre l’absence de dogmatisme dans le judaïsme et cette impossibilité, pour quiconque, de délivrer un sacrement au nom du Dieu d’Israël : « Le dogme n’existe que si une formule est fixée et déclarée par une autorité reconnue. Ces présupposés manquent dans le judaïsme, qui a toujours recherché les commandements tout en refusant les sacrements et leurs mystères » 10. La brit mila n’est pas un baptême, mais une entrée dans l’Alliance. La prière pour un agonisant n’est pas une extrême‐onction, mais un accompagnement vers l’au-delà. Le mariage n’est pas non plus un sacrement mais un contrat. Entre l’être humain et Dieu, il n’est d’intermédiaire humain.
La deuxième donnée, c’est le fait que tout homme est investi d’une part de sacré. Si personne n’est supérieur, c’est parce que tout le monde est supérieur. Tout être a en lui une part de divinité, sans aucune hiérarchie. Israël est « un peuple de prêtres » 11 : c’est pour cela qu’il n’a pas de prêtres – pas d’intercesseurs entre l’humanité et la divinité.
Troisièmement, les textes sacrés ont autant de sens qu’ils ont de lecteurs. Et aucune lecture n’est illégitime. Ouvrons notre vieux Maïmonide : « Il faut nécessairement avoir recours à l’interprétation allégorique, toutes les fois que, le sens littéral étant réfuté par une démonstration, on sait d’avance qu’il est nécessairement sujet à l’interprétation » 12. Ce recours à l’interprétation est l’autre nom de la liberté, qui permet à chacun (voire qui impose à chacun) de se servir de son esprit souverain, pour donner du texte toujours jeune une lecture toujours neuve. À cette souveraineté de l’esprit, aucune autorité morale, religieuse, spirituelle n’a la légitimité d’imposer une limite. Ainsi la notion même d’hérésie est‐elle étrangère à l’esprit du judaïsme dont le principal dogme est peut‐être le refus du dogme.
Quelle place, dès lors, pour le rabbin ?
La plus éminente. Car cette liberté absolue laissée à chaque membre de ce peuple de prêtres fonde, précisément, la noblesse de la mission pastorale. La liberté n’existe pas si elle n’a ni exemple, ni source, ni but. Le rabbin est là pour cela. Il n’est pas un prêtre, mais un maître, qui sait ce que les autres ne savent pas ; qui se tient debout quand les autres s’effondrent ; qui raconte une histoire ancienne quand les autres s’échouent dans un présent sans écho ; qui incarne une permanence quand les autres sont submergés par la contradiction des impermanences. Voici ce que, de sa vocation, disait l’un de ceux qui l’ont incarnée avec le plus d’humilité et de noblesse, le grand rabbin Jacob Kaplan : « Le rabbin ne possède pas les pouvoirs conférés au prêtre catholique. Mais il se doit de devenir, dans l’exercice de ses fonctions, comme le berger de sa communauté. (...) C’est lui qui est appelé à calmer les peines des fidèles dans les épreuves de l’existence par la confiance et l’espérance qu’il leur inspire en leur parlant de Dieu » 13.
Le rabbin est donc le consolateur suprême. Mais il est aussi plus que cela : il siège dans cette instance auguste, le tribunal rabbinique, qui fait de lui, comme jadis les rois d’Israël, non seulement un juste, mais un juge – à ceci près que ce juge a appris, quand il le faut, à s’abstenir de juger. Ainsi refermons‐nous la boucle où se rencontrent les pouvoirs temporel et spirituel.
Il arrive que la poésie aille plus loin en philosophie que la philosophie ; c’est peut‐être Victor Hugo qui exprime le plus exactement ce qu’a d’original l’idée d’autorité dans le judaïsme : « Les tribus d’Israël avaient pour chef un juge » 14. Puissent toutes les communautés d’Israël avoir pour maîtres des justes.
1 I Samuel, 8,19−20.
Rappel de texte
2 Deutéronome, 17,18−20.
Rappel de texte
3 Isaïe, 32,1
Rappel de texte
4 Voilà qui rappelle les paroles du God save the Queen : « May she defend our laws and always give us cause to sing : God save the Queen » ; « Puisse‐t‐elle défendre nos lois et toujours ainsi nous donner une raison de chanter : Dieu sauve la reine. » Si la monarchie cessait d’être la garante des lois, elle ne mériterait même plus d’être sauvée.
Rappel de texte
5 Exode, 4,10
Rappel de texte
6 « Innombrables » est excessif.
On doit pouvoir les compter.
Disons qu’elles sont nombreuses.
Rappel de texte
7 Psaume 131,1
Rappel de texte
8 Il a eu aussi de plus petits rois. L’oubli les recouvre, qui est la vengeance immanente de l’histoire.
Rappel de texte
9 « Un chef est un homme qui a besoin des autres » (Paul Valéry, Mauvaises pensées, Œuvres complètes, Gallimard, Pléiade, T. II, p. 900).
Rappel de texte
10 Leo Baeck, L’essence du judaïsme, Presses universitaires de France, p. 49
Rappel de texte
11 Exode, 19,6
Rappel de texte
12 Maïmonide, Guide des égarés, Deuxième partie, ch. 25 (éd. Verdier, p. 322)
Rappel de texte
13 Jacob Kaplan, Justice pour la foi juive, éditions du Cerf, p. 30
Rappel de texte
14 Victor Hugo, « Booz endormi »,
La légende des siècles, II, VI.
Rappel de texte