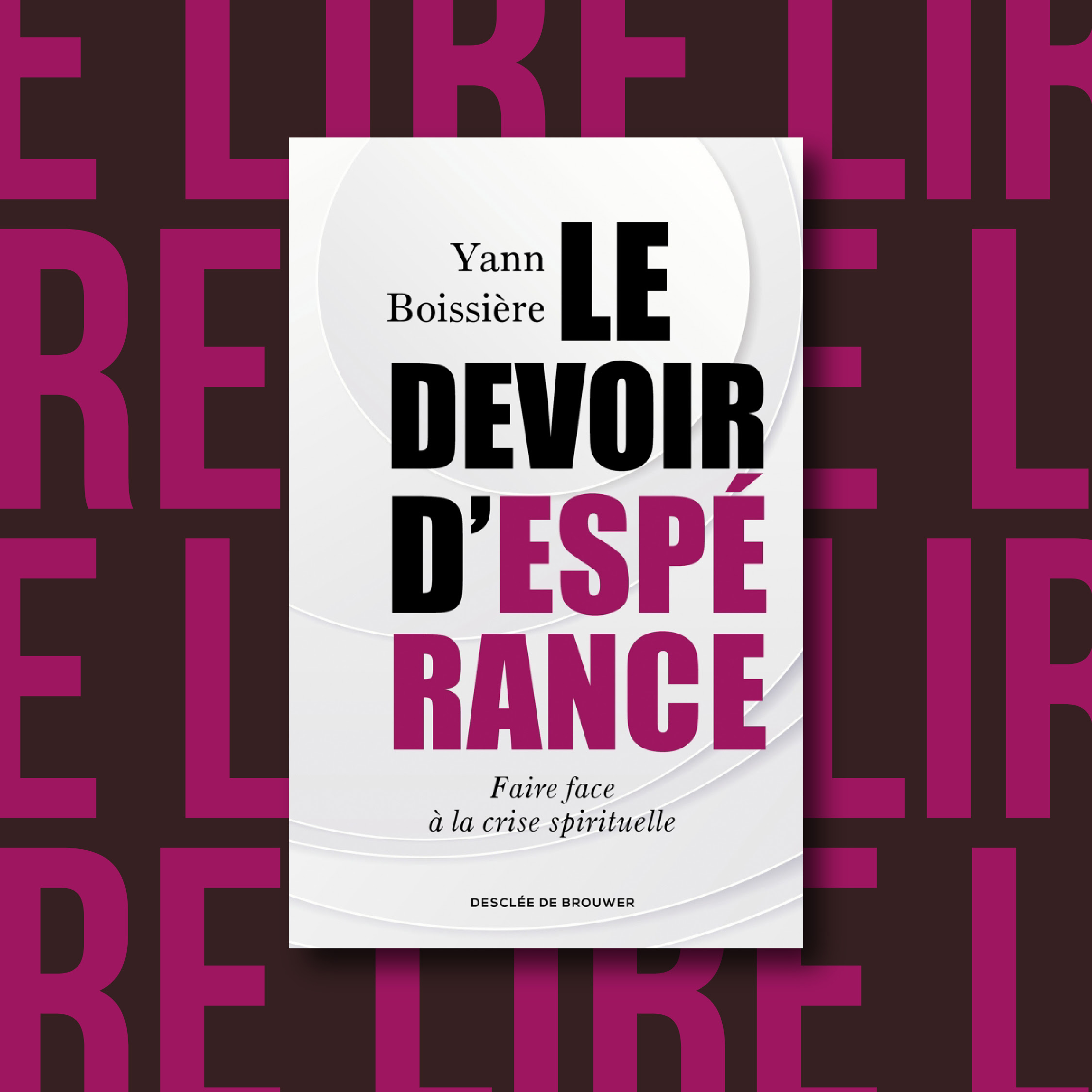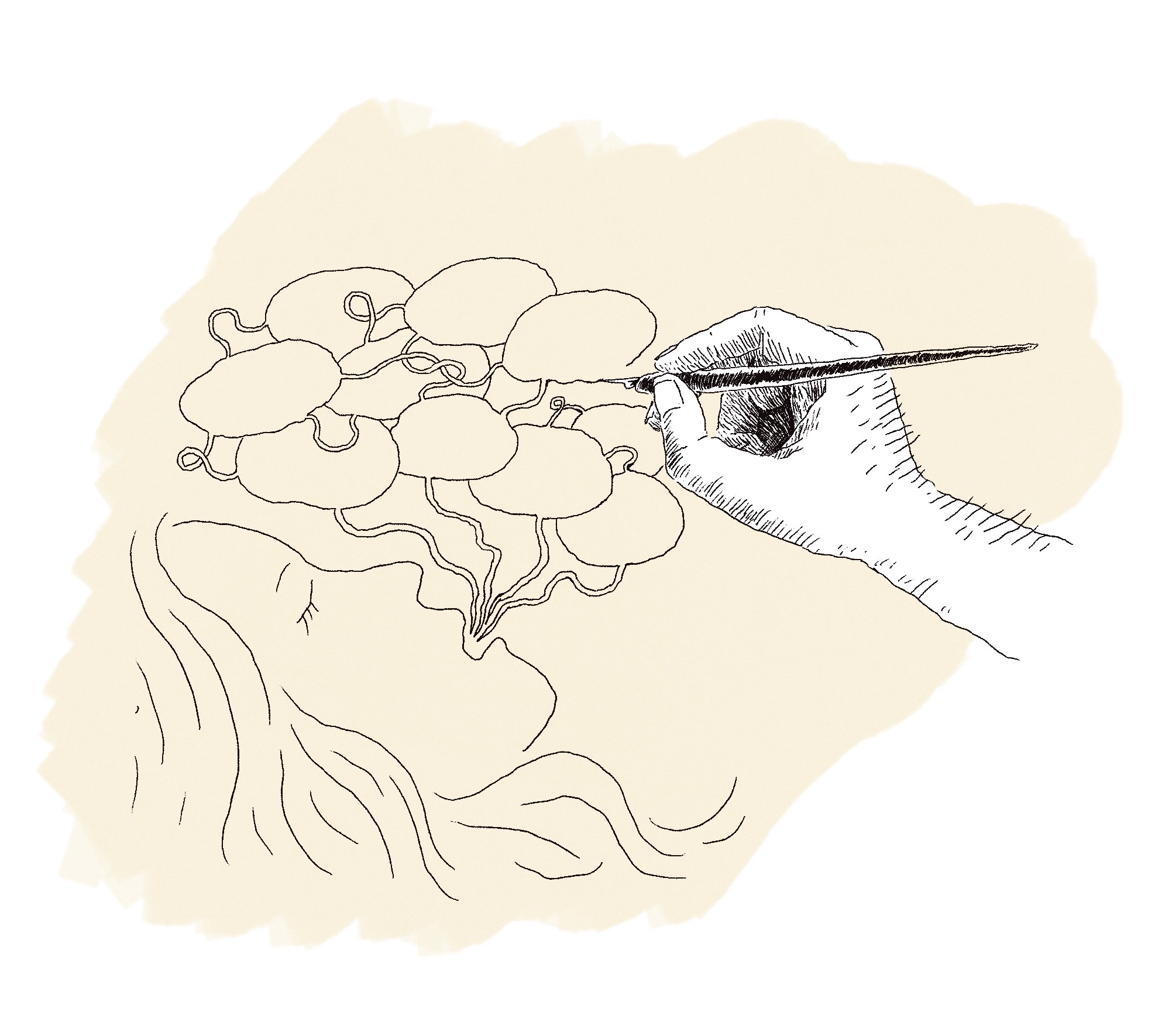installation view, Tel Aviv Museum of Art, 2020
Courtesy Sommer Contemporary Art, Tel Aviv
La Torah raconte à deux reprises la rencontre au sommet entre Dieu et le peuple d’Israël au Mont Sinaï. Le texte nous parle d’une révélation à sens unique, celle d’un Dieu‐Tout‐Puissant déchirant les cieux dans un tonnerre d’orages, pour donner – voire imposer – sa loi au peuple d’Israël. Même si la Torah nous affirme que le peuple d’Israël consentit a posteriori à respecter la parole divine, les Prophètes témoignent continuellement de ce manque d’allégresse à accepter une Parole qui fut somme toute imposée.
La littérature rabbinique est, elle aussi, largement consciente de ce problème, à tel point qu’elle va jusqu’à affirmer que Dieu souleva la montagne « tel un bol », prêt à écraser le peuple si celui‐ci refusait d’accepter sa Torah. Un consentement vicié car obtenu par la force, nous dit le Talmud, est frappé d’invalidité juridique. Sans alliance valable, Dieu ne pouvait donc reprocher aux enfants d’Israël leurs futures transgressions.
Cette théophanie littéralement écrasante n’était que le prélude aux rapports compliqués des Juifs à leur Dieu. Le Talmud par exemple, n’hésite pas à formuler à plusieurs reprises une critique acerbe de ce Dieu parfois agaçant, souvent oppressant, trop présent quand il ne le faut pas et absent quand on l’attend. Nous n’avons jamais rencontré Dieu, disent les sages entre les lignes. Tout au plus, Dieu s’est révélé à nous, tel un roi apparaissant brièvement devant une foule. Mais en relisant l’épisode du Sinaï, le commentaire des sages va se désintéresser de Dieu, pour se recentrer sur la véritable rencontre qui occupe les Juifs depuis des millénaires – celle avec la Torah :
« Qu’il me baise des baisers de sa bouche » (Cantique 1,2) – Rabbi Yohanan enseigne qu’un ange extrayait la Parole de devant le Saint-Béni-Soit-Il, l’apportait à chaque membre d’Israël et lui disait : « Acceptes-tu cette parole ? Elle contient tant et tant de lois, tant et tant de punitions, tant et tant de décrets, tant et tant de commandements, tant et tant de récompenses. » Le Juif disait « Oui ». L’ange lui demandait à nouveau : « Acceptes-tu la divinité du Saint-Béni-Soit-il ? », il répondait : « Oui, oui ». À ce moment, il l’embrassait sur la bouche, comme il est dit : « Il t’a fait voir pour que tu connaisses » (Deutéronome 4,35), par le biais d’un envoyé.
Les sages, eux, enseignent que la Parole elle-même se rendait chez chaque membre d’Israël et lui disait : « M’acceptes-tu ? Je contiens tant et tant de lois, tant et tant de punitions, tant et tant de décrets, tant et tant de commandements, tant et tant de récompenses. » Il répondait par l’affirmative. À ce moment, la parole l’embrassait sur la bouche… Comme il est écrit : « De crainte que tu oublies les paroles que tes yeux ont vues » (Deutéronome 4,9). Tu as vu la parole te parler.
Shir Hashirim Rabba 1,2
Dès l’ouverture, le cadre est donné. Très loin des éclairs et du tonnerre décrits dans la théophanie biblique, le Midrash imagine la rencontre entre le peuple d’Israël et la Parole de Dieu, la Torah, comme celle de deux amants s’embrassant passionnément. Alors que le Tout‐Puissant se révélait à la masse désindividualisée, le Midrash décrit la Parole comme le quittant pour venir à la rencontre de chaque individu.
Deux lectures s’ensuivent. La lecture minoritaire de Rabbi Yohanan imagine un ange intermédiaire entre Dieu et les hommes, proposant à chaque individu d’accepter ou non la Torah et la divinité du Dieu d’Israël. La révélation était imposée, mais la Parole ouvre immédiatement le dialogue pour proposer une alliance individuelle et scellée par la libre volonté de chacun‑e. Dieu est encore là, mais secondaire, comme une condition indiscutable dans les notes de bas de page de l’alliance. La théophanie décrite par la Bible n’est rien de plus qu’une introduction pyrotechnique à la véritable alliance cachée par le texte, scellée par la mutualité, le désir et l’intimité.
La deuxième lecture, celle des sages, continue sur cette lancée mais de façon plus subversive encore. Les sages aussi conservent les notions d’alliance individuelle et consentie, mais propose une personnification totale de la Parole divine. Plus d’ange, plus de Dieu, mais une parole personnifiée et libre qui vient séduire un après un les cœurs des enfants d’Israël. N’oublie pas les Paroles que tes yeux ont vues, nous dit le texte biblique. Dans une lecture volontairement ultra‐littéraliste, les sages transforment ces paroles en autant d’amants aimés, désirés, possédés, que nos yeux ont vus, que nos corps ont touchés et que nos bouches ont goûtés. Ces Paroles, nous disent les sages, ne pourront jamais être oubliées.
Le grand absent de cette Révélation réinventée est évidemment Dieu. La Torah acquiert ici une indépendance pleine et entière, une existence à part. Cette lecture fait écho à un autre commentaire talmudique, présentant Dieu comme le témoin du mariage d’amour de sa fille – la Torah – avec Israël. Malgré la filiation indéniable, le beau‐père reste extérieur à ces noces. Conscient de son sort, le Talmud l’imagine suppliant les deux amoureux de daigner à lui construire une chambre, le Temple de Jérusalem, pour qu’il puisse visiter sa fille bien‐aimée. Dieu le Père devient Dieu le Beau‐Père, celui qu’on invite quand il connaît ses limites mais avec lequel on coupe les ponts quand il devient toxique.
Une blague juive bien connue met dans la bouche d’un Juif persécuté la prière suivante : « Merci mon Dieu de nous avoir choisi pour peuple élu, mais tu ne pourrais pas changer un peu ? ». Nombreux sont les Juifs à travers les siècles ayant été en proie à un ras‐le‐bol compréhensible pour ce Dieu absent, incapable de protéger les siens. Bien souvent, les mêmes Juifs restaient pourtant profondément amoureux de cet héritage juif, qui a acquis une existence et une indépendance propre hors du divin. Les pionniers sionistes, révoltés contre les souffrances de l’exil, en avaient fait un oxymore : « Il n’y a pas de Dieu, mais il nous a promis cette terre ». Ou une variante moins nationaliste : celle d’un fils revenant de son école catholique et racontant à son père juif la Trinité. Celui‐ci, scandalisé, lui répond « Sache mon fils qu’il n’y a qu’un seul Dieu et que nous n’y croyons pas ! ». Autant de façons différentes de dire simplement que la théophanie biblique seule n’aurait jamais pu traverser l’exil.
Le Talmud opère cette transition de Dieu à la Torah, de la théophanie spectaculaire et à sens unique, à la rencontre amoureuse d’un peuple avec l’infini de son héritage culturel et spirituel. Au Sinaï, le peuple d’Israël a rencontré Dieu à la manière d’un jeune amoureux obligé de passer par le père autoritaire pour voir son aimée. Son premier baiser n’était pas pour Dieu, mais pour cette Torah indépendante et désirée. À travers les siècles, à travers l’étude, les deux amants continuent à se couvrir de baisers sous l’œil parfois bienveillant, parfois agacé, de celui qui se demande peut‐être encore si c’était là le meilleur parti pour sa fille bien‐aimée.