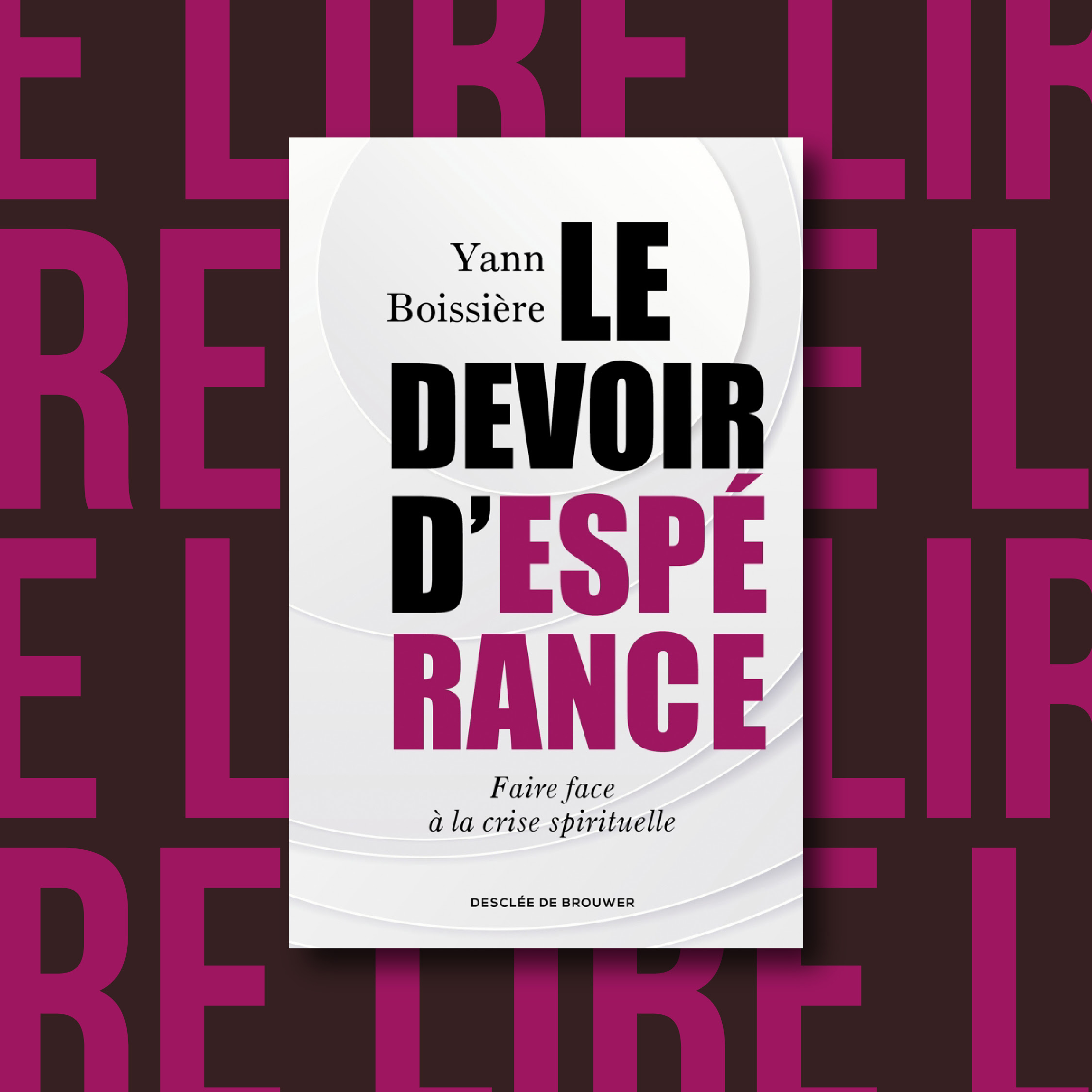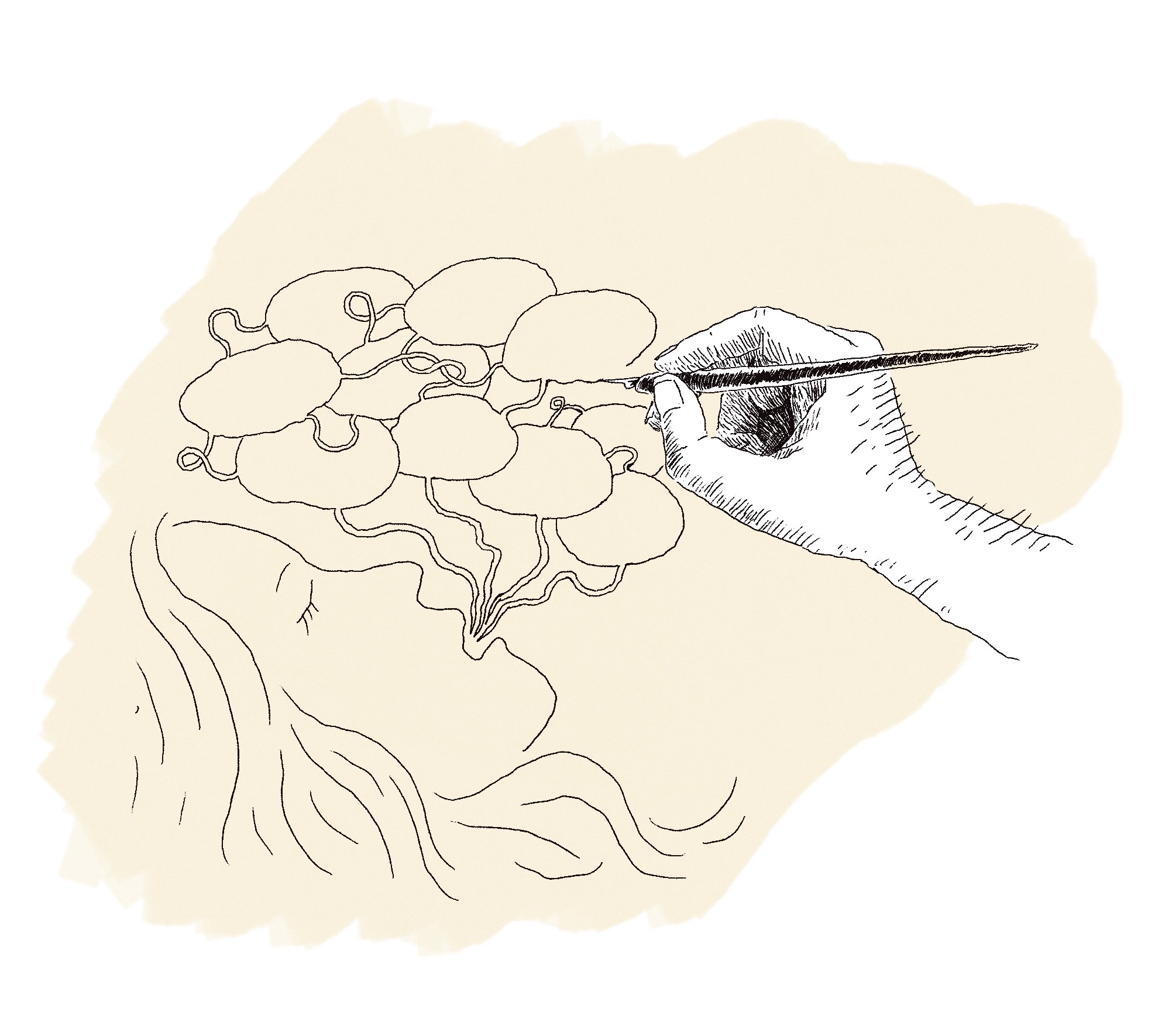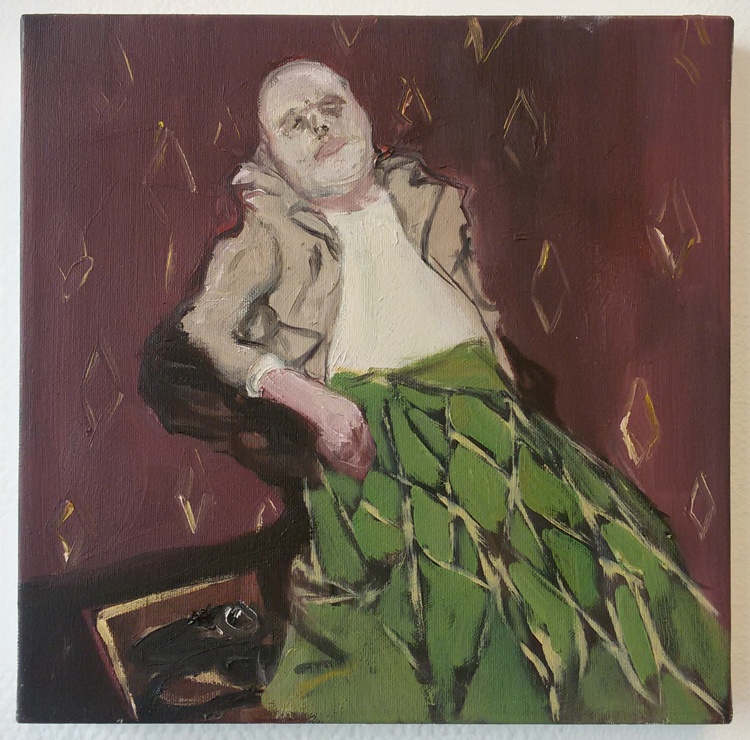
Courtesy Gordon Gallery, Tel Aviv
Sémiotique des corps sexués 1
Le grand historien du judaïsme Jacob Katz a expliqué l’émergence de l’orthodoxie juive moderne comme une réaction à l’implosion de la vie juive traditionnelle et à la perte de l’autorité des rabbins. Tout comme le judaïsme réformé, l’orthodoxie est donc une réponse aux défis que pose la modernité. Ce jeu de balancier où, pour répondre à ce qu’on considère être une innovation blâmable, on durcit soi‐même sa position qui devient alors tout aussi peu organique que celle à laquelle on répond, se retrouve dans beaucoup de débats controversés et animés de nos sociétés surtout quand il est question d’opposer progrès et tradition. Ainsi, sur la question du genre dans le judaïsme : ceux qui adoptent joyeusement et sans circonspection toute nouvelle idéologie en la plaquant grossièrement sur leur tradition, soit pour dire qu’elle y était déjà, soit pour dire qu’elle doit s’y adapter, font alors face à un backlash conservateur qui est tout aussi caricatural. La Torah et la tradition juive deviennent alors, sous les coups de boutoir des uns et des autres, ou bien le woke plus ultra, ou bien le garant sévère d’un ordre patriarcal hétéronormé prétendument éternel.
Chacune à sa façon, ces positions font fi de l’histoire et du pluralisme inhérent aux traditions juives tout autant que de leurs épistémologies et contextes : ainsi, la tradition kabbalistique est‐elle très différente de la tradition halakhique sur cette question et son symbolisme riche permet, pour peu là aussi qu’on évite les vagues ressemblances, de trouver un réservoir de langue et de métaphores pour penser le côté féminin de la divinité, la dysphorie de genre etc.
De plus, il n’est pas interdit de féconder la tradition avec de nouvelles idées ou à l’aune de valeurs morales : Moshe Halbertal a ainsi magistralement montré dans son premier livre Commentary Revolutions in The Making que dans le midrash halakha, les valeurs morales fonctionnent comme des critères de réinterprétation de la Loi biblique pour les Sages et qu’ainsi, un mécanisme de progrès moral est built-in dans la tradition herméneutique et juridique du judaïsme. Il convient toutefois d’être attentif aux erreurs de catégories et aux ressemblances vagues afin d’éviter ce double écueil de la malléabilité absolue de la tradition ou au contraire de sa rigidité hostile.
Il n’est pas rare de voir affirmer que le judaïsme serait une tradition qui aurait six genres et qui serait un exemple fascinant de pensée non binaire (par binarité, il faut entendre l’opposition naturalisée et sans reste entre hommes et femmes, mâles et femelles). Une telle affirmation fonctionne sur un malentendu fondamental et une erreur de catégorie. Le judaïsme rabbinique vise explicitement à faire que ce que nous faisons entrer sous la catégorie de genre (le vêtement, les apparats, les attitudes) corresponde parfaitement au sexe, qui est pensé comme naturel, fixe, donné, et sans possibilité d’en changer à volonté, même si là encore, il y a des cas incertains ou ambigus qui peuvent se dévoiler ou se fixer dans le temps. L’interdiction biblique du travestissement (Deutéronome 22,5) suppose déjà des évidences quant à l’habillement masculin ou féminin et à la congruence désirée entre genre et sexe. Les comportements sexuels sont aussi codés en féminins et masculins (mishkevei ishah et mishkav zakhar).
Le droit rabbinique connaît des personnes qui, notamment selon leur sexe, sont soumises, exemptées ou interdites de certaines obligations religieuses et rituelles. La détermination du sexe est une question qui travaille beaucoup les Rabbins, à la fois dans une perspective de casuistique juridique d’explorations des cas rares, bizarres ou limites ou dans un objectif de codifier une science des signes corporels (une sémiologie) afin de veiller à la reproduction du corps collectif juif par le mariage ou à l’accès à l’âge de la bar ou bat-mitsva (qui n’étaient pas des cérémonies mais des stades de développement des caractéristiques sexuelles). Certains passages talmudiques relatant que tel sage avait l’habitude de vérifier sa théorie du développement sexuel sur une servante à peine pubère restent d’ailleurs assez difficiles à lire aujourd’hui.
Il y a d’abord les organes sexuels, « l’endroit où on peut reconnaître si c’est un homme ou une femme » (Genèse Rabbah 46,5). Puis les caractéristiques sexuelles secondaires, tels les poils pubiens ou le développement de la poitrine (Mishna Niddah 5,7−8), puis la voix, la largeur des épaules et des hanches etc. Pour les rabbins, l’absence de poils pubiens à l’âge de 18 ou 20 ans est signe d’une incapacité à se reproduire. Ces personnes sont appelées saris (qui veut d’ordinaire dire eunuque, mais que l’on peut traduire par stérile) ou aylonit pour le cas féminin. Ainsi, saris et aylonit ne sont pas tant des genres que des êtres humains desquels on infère une potentielle incapacité reproductrice avant qu’un mariage ne soit contracté. Il n’est pas ici question de traquer l’homme efféminé ou le garçon manqué, d’affubler les personnes de monstruosité ni d’exprimer un dégoût moral. En ce sens, s’il est difficile de faire des rabbins des woke avant l’heure, il faut leur reconnaître une certaine neutralité morale doublée d’une passion classificatrice mue par la curiosité pour la création divine et ses possibilités, fussent‐elles rares ou ambiguës. Ainsi, on peut noter l’absence de discours du dégoût ou de physiognomonie accordant une valeur morale aux variations des personnes, mais un goût pour la catégorisation, la description, l’exploration théorique des concepts et les cas limite. C’est dans ce contexte qu’on peut aussi comprendre la bénédiction sur les créatures différentes, qui fait partie des bénédictions « de la vue » et qu’on doit faire face à une créature bizarre, rare, surprenante : non pas la foire aux freaks mais bien la reconnaissance de la différence et que cette différence possède le même statut de créature divine que tout le reste.
L’autre couple de catégories présentant des variations sexuées ayant des conséquences importances sur la halakha, est le couple tumtum et androgynos. Le tumtum est une personne dont le sexe est incertain et indéterminé mais qui peut se développer plus tard en homme ou en femme naturellement ou par intervention chirurgicale. L’androgynos est ce que nous appelons aujourd’hui une personne intersexe. Charlotte Fontrobert montre que les textes de la Tosefta Bikkurim discutant la nature de l’androgynos, homme, femme, homme et femme ou ni homme ni femme, sont parallèles aux textes discutant la nature du koi dans le monde animal, qui est un hybride entre animal domestique et animal sauvage. Selon elle, « le parallélisme entre les deux listes suggère que l’humain hybride “homme-femme” et l’animal hybride “domestiqué-sauvage” fonctionnent avant tout comme des test‐cases théoriques des systèmes respectifs binaires ». Ces explorations sont parfois l’objet d’avis et d’intuitions pouvant nourrir des réflexions contemporaines comme l’avis minoritaire de Rabbi Yossi qui soutient que tout comme le koi, l’androgynos est une créature sui generis et que les sages n’ont pas à décider si iel est un homme ou une femme (Tosefta Bikkurim 2,2) et parfois prouvent que la binarité du système halakhique n’est pas symétrique entre mâle et femelle et que le premier a précédence sur la seconde. Ainsi, la présence d’un organe génital masculin sur l’androgynos n’a pas le même poids ni la même signification que celle d’un organe génital féminin puisque l’androgynos est censé.e s’habiller comme un homme. Iel (le pronom inclusif n’a jamais été aussi justifié qu’ici) peut prendre femme mais ne peut pas être pris.e comme femme. C’est donc un système androcentrique.
Pour conclure, les prémisses et paradigmes très généraux communs aux théories du genre (constructivisme social, différence de nature entre sexe et genre et malléabilité des deux, création de soi) semblent difficilement compatibles avec les prémisses et paradigmes de la pensée rabbinique (condition de créature donnée, binarité naturelle comme fait statistique massif et comme norme religieuse et juridique avec prise en compte des variations dans une optique classificatoire juridique).
Finissons cette amorce de réflexion sur un appel à la prudence épistémique : le système halakhique, finalement comme tout système avec sa propre terminologie, contexte et histoire, reste rétif aux hold‐up idéologiques qu’ils soient progressistes ou conservateurs. Il ouvre toutefois à un monde intellectuel et conceptuel qui peut parfaitement contribuer à nos discussions contemporaines, pour peu qu’on prenne la peine de ne pas le maltraiter comme de la vulgaire pâte à modeler ou comme de la pierre inamovible.
C’est d’ailleurs ce qui se fait, dans le monde vivant et palpitant de la halakha, à l’abri des polémiques : il suffit de prendre pour exemple le livre récent du rabbin orthodoxe séfarade Idan Ben‐Efraïm Dor Tahafoukhot 2 (« Génération des inversions »), publié avec une haskama [une validation] du rabbin Yitshak Yossef sur les lois relatives aux personnes transgenres pour s’en convaincre. Le cas qui a été posé au rabbin est celui d’un homme transgenre (FtM, né femme et transitionné en homme avec opération de réassignation sexuel) qui a fait teshouva [retour à la pratique religieuse] et qui demande quelles mitsvot il doit faire, celles des femmes ou celles des hommes. La réponse du rabbin dit substantiellement la chose suivante : fondamentalement, il est une femme mais comme il a l’apparence sociale d’un homme et qu’une chirurgie de réassignation est dangereuse et problématique du point de vue de la halakha, il doit malgré tout prendre en compte les conventions sociales de genre comme s’asseoir du côté homme à la synagogue sans compter dans le quorum. Plus intéressant, il peut monter à la Torah et mettre ses phylactères car les femmes peuvent théoriquement le faire et que ce serait perçu comme contraire aux conventions de ne pas le faire. Quand on porte des lunettes juridiques, rien de ce qui est humain n’est étranger.
Retour au texte
1. Le sous‐titre est une reprise de l’expression de Charlotte Fontrobert, « semiotics of sexed bodies » qu’elle utilise pour désigner la science des signes rabbiniques qui permettent de caractériser les corps soumis aux obligations
Retour au texte
2. Je remercie Gabriel Abensour d’avoir attiré mon attention sur ce livre et d’avoir lu une première version de ce texte.
Pour en savoir plus :
• Charlotte Fontrobert, « The semiotics of the sexed body in early halakhic discourse », dans How Should Rabbinic Literature Be Read in the Modern World? Georgia Press, 2006
• Moshe Halbertal, Commentary Revolutions in the Making: Values as Interpretative Considerations in Midrashei Halakhah, Magnes Press, 1997
• Jacob Katz, A House Divided: Orthodoxy and Schism in Nineteenth-Century Central European Jewry, Brandeis University Press, 1998