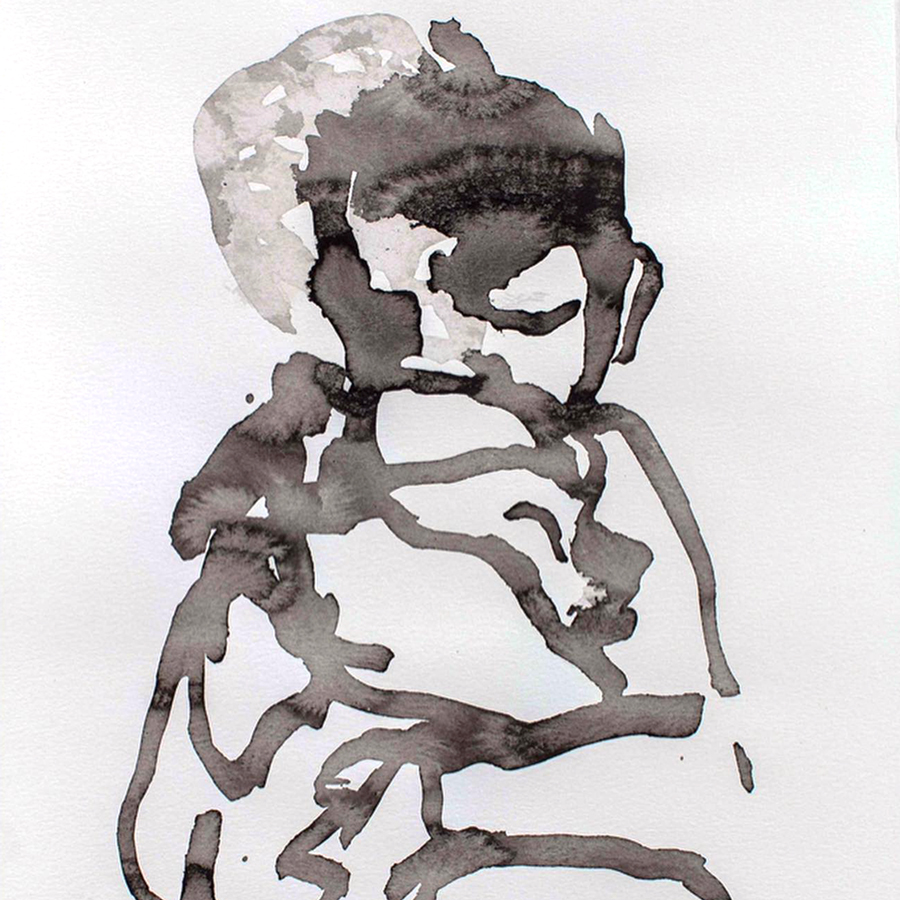7 octobre 2023. Naama Levy, 19 ans, est enlevée par des terroristes du Hamas. Sur des images qui ont fait le tour du monde, on la voit à Gaza, tirée par les cheveux, les mains liées derrière le dos, les talons cisaillés, le jogging tâché de sang au niveau de l’entrejambe.
25 janvier 2024. Naama est libérée en compagnie de Karina Ariev, Daniella Gilboa et Liri Albag en échange de 200 prisonniers Palestiniens, dans le cadre de l’accord de cessez‐le‐feu conclu entre Israël et le Hamas.
Deux points communs relient ces deux moments : Naama Levy a suscité une émotion particulière puisqu’elle est devenue le symbole des violences sexuelles commises par le Hamas lors des massacres du 7 octobre, et pourtant son enlèvement comme sa libération n’ont donné lieu qu’à peu de réactions de la part de féministes en France.
Alors que les récits de violences sexuelles ont rapidement afflué après le 7 octobre 2023, les réactions de personnalités et d’organisations féministes se sont inscrites dans l’une de ces trois catégories : le silence, le déni ou l’accusation de pinkwashing. Les prises de parole se sont faites attendre, jusqu’à ce que le silence ne soit plus tenable – notamment après l’exclusion du collectif “Nous vivrons” de la manifestation du 25 novembre 2023. En ce qui concerne le déni, malgré l’accumulation de témoignages et de rapports, des féministes ont persisté, plusieurs mois après le 7 octobre, à réclamer des preuves détaillées des exactions. Enfin, on a aussi observé des personnes qui ne nient pas la réalité des violences sexuelles, mais estiment qu’elles sont instrumentalisées à outrance par le gouvernement israélien afin de s’attirer la sympathie et de justifier la riposte excessivement violente qui s’abat sur Gaza.
Étant donné le climat de suspicion qui a dès le départ entouré le sujet des violences sexuelles du 7 octobre, il n’est pas étonnant que ces mêmes personnalités et organisations n’aient pas un mot pour la libération des Israéliennes. Mais les femmes et les féministes qui, depuis plus d’un an, se sentent abandonnées par leurs sœurs, s’enfoncent encore un peu plus dans la déception et la solitude. La libération de Naama Levy aurait pu être l’occasion de poser les mots justes, de dire « Vous n’êtes pas seules, nous sommes à vos côtés », et pourquoi pas – on peut toujours rêver – d’excuses sincères et d’une remise en question.
Au lieu de cela, samedi 25 janvier – jour de la libération des quatre otages – la Coordination féministe et le collectif Féministes révolutionnaires ont préféré donner la parole à Urgence Palestine lors d’une table‐ronde de l’événement « Retour de flammes » à la Parole Errante à Montreuil. Le porte‐parole d’Urgence Palestine, Omar Alsoumi, avait alors minimisé voire nié les violences sexuelles du 7 octobre (notamment dans sa tribune du 1er mars 2024 intitulée « Lettre ouverte aux sionistes (de gauche) qui convergent à Médiapart »).
Les témoignages et les rapports étayant ces violences ne manquent pourtant pas. On pourrait citer, de façon non exhaustive, le documentaire Screams before silence de Sheryl Sandberg, le rapport de la Représentante spéciale des Nations unies sur la violence sexuelle dans les conflits, Pramila Patten, divers rapports israéliens (par exemple celui de l’Association of rape crisis centers in Israel) ou encore les déclarations de la juriste et enquêtrice criminelle internationale Céline Bardet, spécialiste de la violence sexuelle dans les conflits. Dernier en date, un rapport du ministère de la santé israélien fait état de violences sexuelles subies par les otages libérées en novembre 2023.
Le 25 janvier, des organisations et personnalités féministes se réjouissaient de la libération des « otages » Palestiniens, à l’instar du collectif Kessem Juives décoloniales qui commentait « 200 otages palestiniens retrouvent la liberté » ou de Mona Chollet qui s’insurgeait contre les excuses de France Info qui avait affiché un bandeau mentionnant « 200 otages palestiniens et non « 200 prisonniers palestiniens ». S’il est certain que des personnes sont emprisonnées injustement par Israël, sans condamnation, sans accès aux accusations dont elles font l’objet et en subissant des mauvais traitements, il faut tout de même rappeler que 120 des 200 Palestiniens libérés le 25 janvier ont été condamnés à perpétuité, souvent avec le sang de dizaines de civils sur les mains.
Il faut espérer que les ex‐otages libérées témoigneront de ce qu’elles ont subi le 7 octobre et en captivité. Cependant, d’un point de vue féministe, une absence de témoignage ne saurait laver les terroristes de tout soupçon : les militantes féministes ne savent que trop bien à quel point un traumatisme peut enfermer une victime dans le mutisme. Elles savent qu’un témoignage de violences sexuelles peut mettre des années à franchir les lèvres, au même titre que l’amnésie traumatique peut l’enfouir pendant des années.
Nous devons réaffirmer un principe fondamental du féminisme : toute victime de violences sexuelles mérite d’être crue et soutenue, indépendamment de son identité ou de celle de son agresseur. Lutter contre les violences sexuelles ne doit souffrir d’aucune exception. Engageons‐nous à ce que le terrible slogan « #MeToo unless you are a Jew » n’ait plus de réalité. Ne laissons plus seules les féministes juives qui, depuis plus d’un an, ont pour beaucoup l’impression de crier dans le vent.