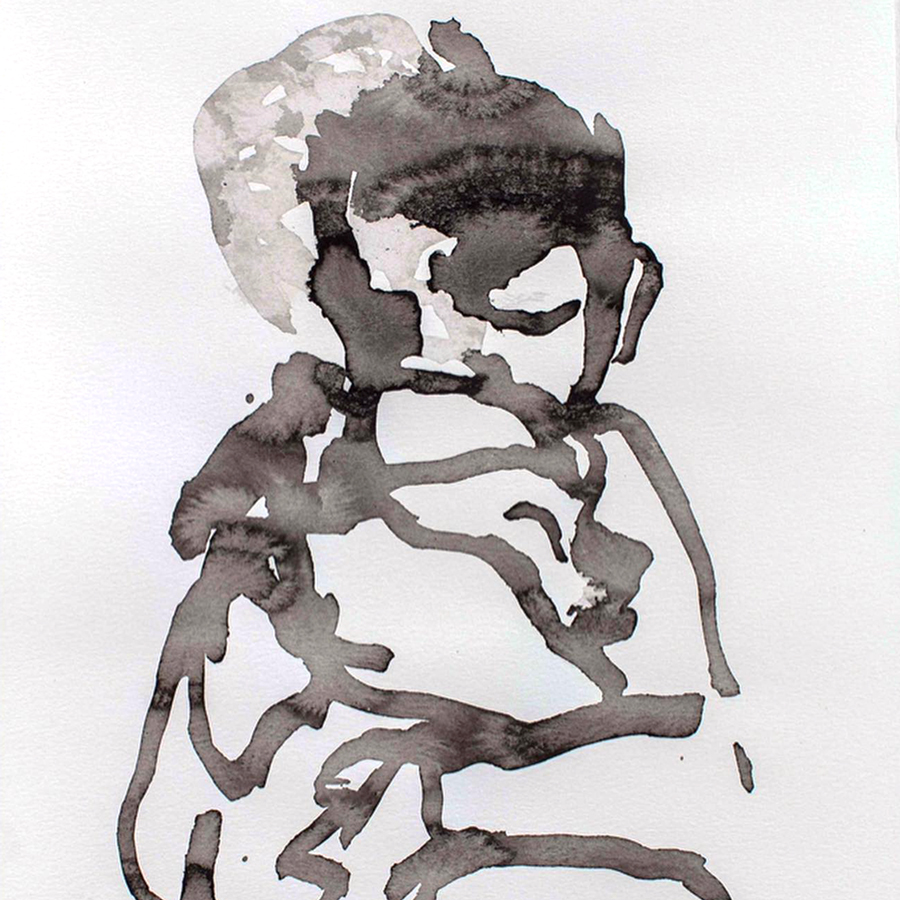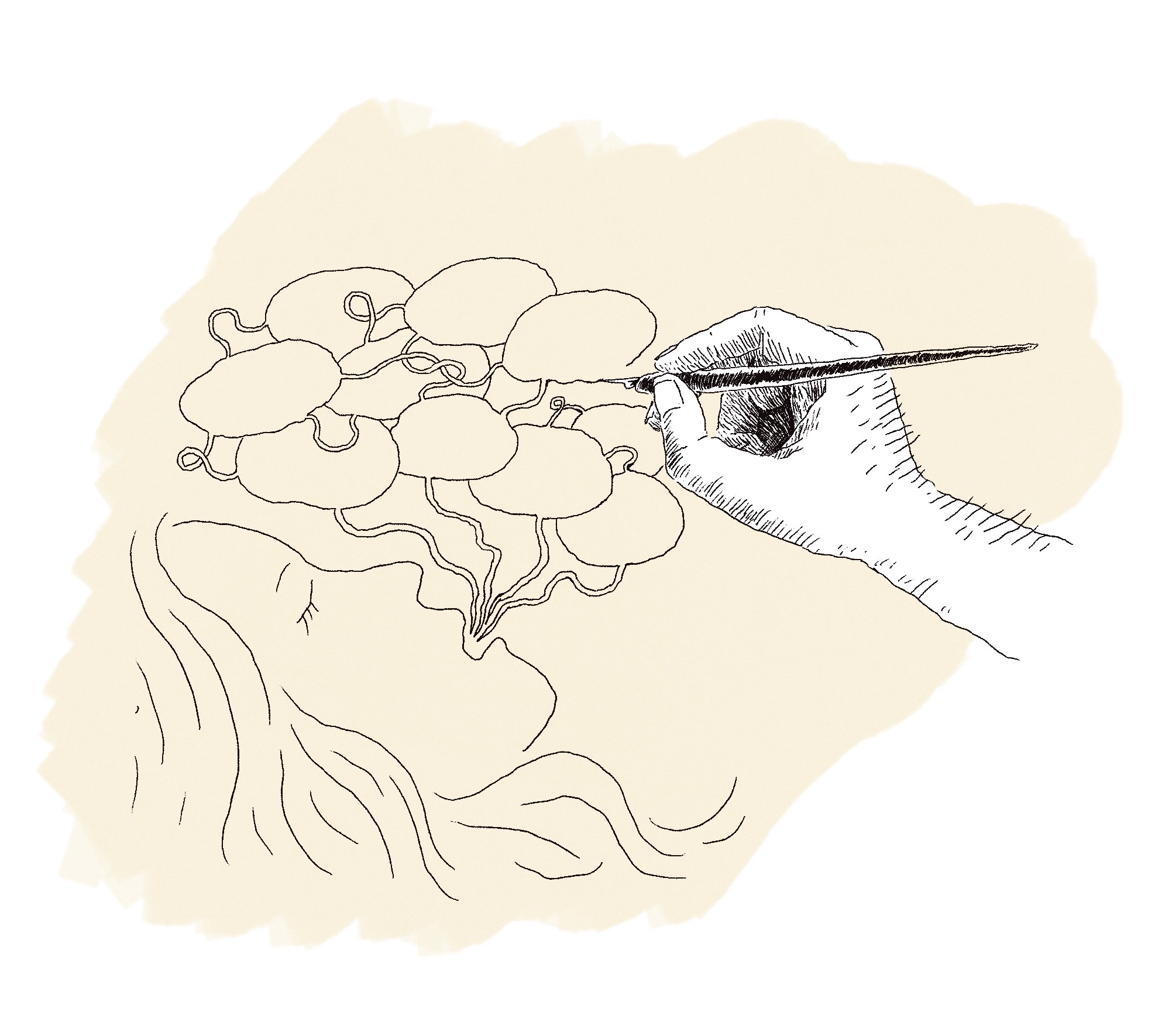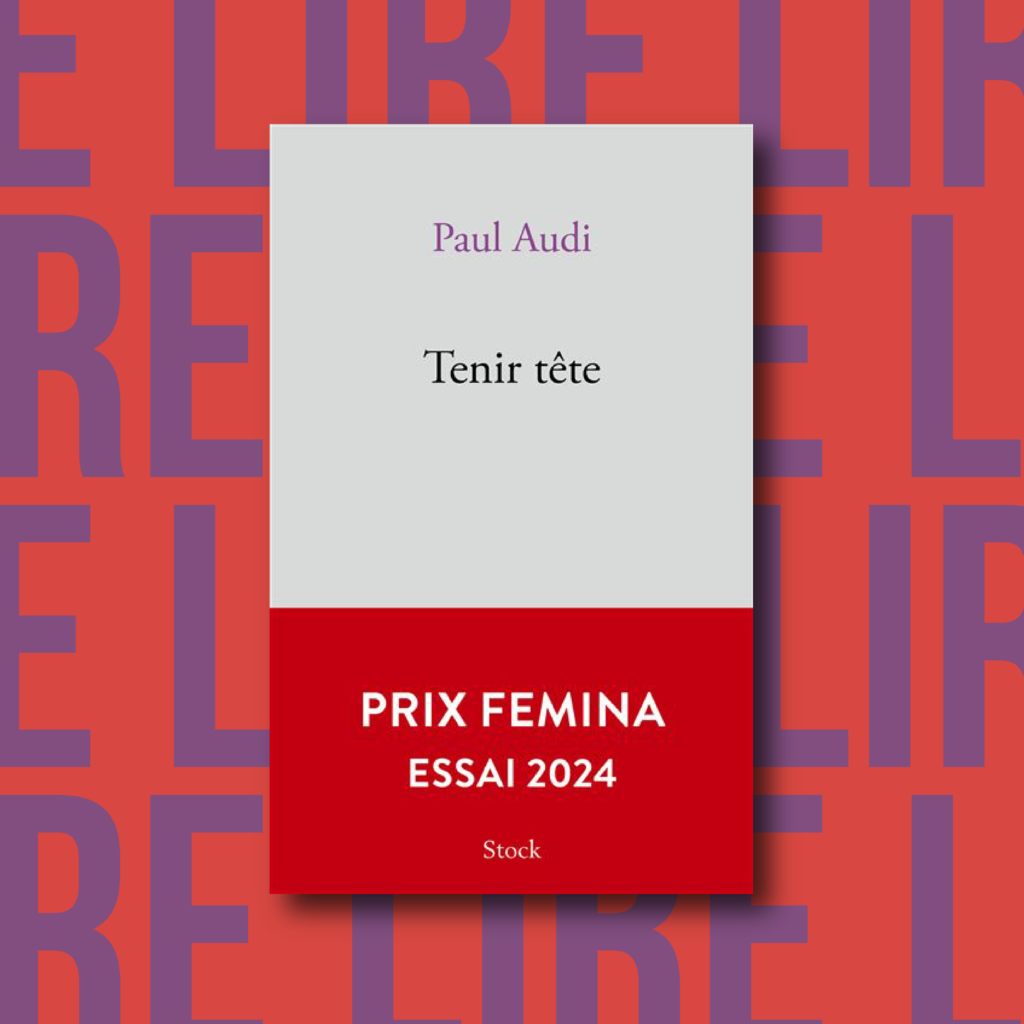
Ces textes, prononcés le 29 janvier 2025 à l’École Normale supérieure, rue d’Ulm à Paris, sont ici reproduits avec le concours amical de Paul Audi, Marc Crépon et Perrine Simon‐Nahum
Aller à Retour sur Tenir tête, par Paul Audi
Aller à Incorporations de l’antisémitisme, par Marc Crépon
Retour sur « Tenir tête »
Paul Audi
Depuis la parution de Tenir tête, et même avant, on m’a dit que je prenais un risque, que ce risque ne valait pas la peine d’être pris, que je ferais mieux de parler d’autre chose que d’antisémitisme, ou plutôt d’antijudaïsme – car tel est en vérité le sujet de mon livre –, à l’horizon, qui plus est, des pogroms du 7 octobre 2023 en Israël et, plus généralement, de ce conflit israélo‐palestinien dont nul ne pouvait imaginer, avant le 7 octobre, qu’il allait mettre le monde entier dans tous ses états.
Ce conflit, qui est d’abord un conflit judéo‐arabe, ceux qui ont lu Troublante identité savent que, depuis ma naissance ou presque, je le porte sur mes épaules comme un poids mort – disons plutôt comme une charge léthale. Il fut la cause de mon départ du Liban à l’âge de dix ans ; et j’ajouterai que si la paix avait régné dans la région du monde où je suis né, à l’époque où j’y ai vécu, il y a cinquante ans, peut‐être ne serais‐je pas devenu philosophe, et n’aurais-je écrit aucun livre.
Aurais‐je dû me taire, et laisser « tenir tête à l’antisémitisme » ceux qui en sont les victimes directes ? Mais justement ! il m’est impossible de prétendre que je n’en suis pas moi‐même victime, car rien de ce qui est juif ne m’est étranger, étant donné que, pour reprendre la formule célèbre de Térence, rien de ce qui est humain ne m’est étranger. Je dirais même : bien que je ne sois pas juif, rien de ce qui est juif ne devrait m’être étranger, si être juif c’est reconnaître précisément qu’il existe un humain fondamental – un « Adam » – à partir duquel, que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou pas, nous sommes tous autant que nous sommes et chacun pour sa part le très certain descendant.
Mon vieux professeur, Jean‐Toussaint Desanti, disait que le sujet éthique est celui qui se reconnaît dans la formule de Térence – ou plutôt il est celui à qui il appartient de s’y reconnaître, cette « charge » à elle seule inscrivant son être dans le champ de l’éthique. C’est donc en tant que sujet éthique que je me suis senti requis d’écrire Tenir tête. Qu’aurait valu mon engagement au service de la philosophie si, au regard du 7 octobre, cet engagement n’avait pas pris cette forme‐là ?
La lutte contre l’antisémitisme, ce n’est pas l’affaire des Juifs, qui ont déjà fort à faire pour esquiver le coup porté. C’est l’affaire de ceux qui ne sont pas nés juifs mais qui refusent le schéma discriminateur du « nous c’est nous, et eux c’est eux ». Schéma qui se met en place dès que l’on ignore – volontairement ou involontairement, il n’importe – ce qu’être juif veut dire en dehors de la somme de phantasmes que cette existence supposée différente – donc inquiétante – éveille en eux.
Or savoir ce qu’être-juif veut dire, cela débouche sur une question que j’ai essayé d’aborder à la fin du livre – une question de reconnaissance de dette. C’est que nous sommes tous les héritiers, plus ou moins conscients, d’une histoire, d’un passé, d’une culture, d’une morale, d’une façon de donner un sens aux choses. Si, comme le disait James Joyce, notre culture est greek-jew, jew-greek, il incombe à chacun d’entre nous d’apprécier cet héritage pour ce qu’il représente. Et pour cela, il importe de se rendre vigilants à tous ces mots que nous utilisons sans y penser et qui sont chargés de quelque chose de terrible, qui vient du fond le plus obscur de notre histoire. Des mots qui sont pétris de haine envers les Juifs, des mots sanglants, chargés de célébrer la messe noire de l’antijudaïsme, et qui ne laissent pas de résonner douloureusement sitôt qu’on les replace dans un contexte historique plus ou moins long.
Aujourd’hui, nous avons tendance à oublier ce contexte, et nous utilisons certains mots sans nous rendre compte qu’ils véhiculent le souvenir d’une histoire meurtrière. Et si je dis cela, c’est parce qu’une grande partie de la rhétorique « antisioniste » employée par beaucoup à tort et à travers combine, quelquefois sans le voir, ni même le vouloir, une rhétorique antijuive avec une rhétorique d’opposition politique, qu’il n’est pas question, par ailleurs, de dénigrer. Il est donc très important de ne pas se laisser abuser par la fausse transparence du langage.
D’autre part, l’idée même de dette ne vient pas de nulle part : elle nous a été transmise, précisément, par le judaïsme lui‐même, parce que la transmission n’advient pas au judaïsme par surcroît : le judaïsme est, pour l’essentiel, la transmission de génération en génération d’un patrimoine symbolique qui doit être reçu et entretenu, si l’on s’accorde pour dire qu’il en va de la responsabilité de chaque Juif, devenu attentif à sa propre naissance, c’est-à-dire au sens même de la naissance, de transmettre ce patrimoine symbolique à la génération suivante – de façon pour ainsi dire charnelle.
Le judaïsme c’est évidemment mille choses de plus, et encore beaucoup plus. Mais c’est aussi et d’abord – comme Bergson l’avait reconnu dans une page splendide des Deux sources – ce qui fait de la justice une transcendance inatteignable. Cette élévation unique en son genre aura produit une coupure décisive dans l’histoire des sociétés humaines. Le judaïsme a extrait la justice du droit des sociétés et l’en a séparé par principe. L’affirmation de cette transcendance est ce qui a permis à l’humanité de se soumettre à des obligations universelles, dont nous avons tous hérité, que nous soyons juifs ou non.
La Loi, qui marque la limite entre ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire, n’a de poids que celui que lui confère une justice qui ne se réduit pas à elle ni ne s’épuise en elle. Or le poids de la Loi est très lourd, il est insoutenable, même, pour des hommes qui, comme nous, n’ont pas encore accédé à leur humanité pleine et entière. Car, comme le disait Romain Gary, ce Juif toujours demeuré fidèle à sa judéité et auquel j’ai la faiblesse d’accorder une certaine importance, nous sommes "à moitié hommes et à moitié innommables". Le jeu sur les mots (l’innommable faisant un signe en direction de l’inhumain) est ici d’une portée considérable. Au point que, aussi longtemps que nous rangerons notre humanité sous la bannière de son contraire – l’innommable –, nous trahirons le testament reçu.
Dans l’antijudaïsme il y a, me semble‐t‐il, et je m’avance, en disant cela, à pas comptés, avec prudence, il y a l’aveu que le fait de devoir honorer sa dette spirituelle à l’égard de l’héritage judaïque est, pour l’être humain, quelque chose d’insupportable. Disons : de trop requérant pour être aisément supporté. D’autant que, quand on doit impérativement quelque chose à quelqu’un, on finit par le détester – c’est une règle psychologique habituelle que de chercher à s’en prendre à la source d’un devoir…
Ce poids du devoir se révèle déjà dans le judaïsme lui‐même, avec l’idée de « peuple élu ». Si l’élection renvoie à quelque chose en effet, c’est à une certaine mission qui aura été donnée à des individus justement rassemblés autour de cette mission – les Juifs –, des individus qui, à titre personnel, ne s’attendaient à rien, à rien devoir… Mission donnée avant et à leur naissance, sous la forme d’un « À vous autres il sera demandé plus qu’aux autres…«
Ce schéma, qui ne prend sens qu’à un niveau collectif, laisse entrevoir ce que signifie recevoir une tâche ou une mission en héritage : il y a, dans ce genre d’injonction destinale, quelque chose de très exigeant, et de très éprouvant. Quelque chose qui remplit de culpabilité, car nul ne sait, nul ne saura jamais, s’il est ici et maintenant à la hauteur de ce qu’il lui est requis de faire.
Aussi de deux choses l’une : ou bien l’on nie l’existence de l’injonction en faisant en sorte que ce que l’on a reçu en héritage est sans conséquence, ou bien on la prend en compte, mais à la condition qu’elle soit « retournée contre elle‐même », comme c’est le cas dans le christianisme (je ne parle ici que des réactions de rejet face à la mission).
En effet, en tant qu’hérésie juive, le christianisme aura veillé à ce que le Nouveau Message ne remplace pas la Loi, mais « l’accomplisse », comme il dit, de sorte que le judaïsme prophétique et sacerdotal n’apparaisse plus que comme une préfiguration de ce que l’avènement du Christ apporte, à savoir l’appel à un amour universel, cet apport rendant inutile le maintien de l’ancienne piété. Quant à l’islam, qui ne cache pas que son message s’inspire du judaïsme – mais c’est en réalité bien plus qu’une affaire d’inspiration –, il fait un geste non pas identique mais analogue : dans un même mouvement, le Coran valide et invalide les deux religions précédentes en prétendant que les écritures juives ont falsifié le message d’Allah.
Bref, si le christianisme et l’islam se réclament du message hébraïque, abrahamique, chacune de ces religions vise à sa manière à s’y substituer. Ce qui revient à dire que le peuple juif devrait cesser d’avoir la nuque raide… Par cet appel à la disparition, jamais énoncé en ces termes, mais qui n’en est pas moins d’une infinie violence, ces religions reconnaissent bel et bien l’origine du sens dans son antériorité historique, mais pas du tout dans sa prééminence spirituelle, et encore moins dans son originalité doctrinale. De sorte que là où les Chrétiens et les Musulmans disent avoir besoin des prophètes du judaïsme, les Juifs sont montrés comme ayant besoin du christianisme ou de l’islam pour être pleinement eux‐mêmes.
Eh bien, c’est sur cette base‐là qu’est récusée la moindre souveraineté juive sur un territoire dont la propriété n’a pas cessé d’être revendiquée, d’abord par les Chrétiens, puis par les Musulmans, en raison de la localisation de leurs lieux saints…
Cette récusation va de pair avec un reproche, dont tout suggère qu’il alimente une vindicte. Tout en contestant la préséance du judaïsme, on se réfugie dans la conviction purement fantasmatique que ceux‐là mêmes qui ont voulu être les porteurs d’une Loi offerte aux Nations pour qu’elles s’élèvent au‐dessus d’une condition humaine finie, sont incapables de se l’appliquer à eux‐mêmes. La preuve, dit‐on, c’est qu’ils ne cessent de bafouer cette Loi par mille et une perfidies ou autres actes dissimulés, occultes, et leur besoin de dominer… Et si on ne le voit pas, eh bien on les poussera à la faute, de façon à prouver qu’ils sont intimement pervers, comme le dit une sourate du Coran. Ainsi l’antijuif passera son temps à énumérer frénétiquement les vices et les défauts dont seraient dotés selon lui les zélateurs de la Loi – litanie invariable que l’on retrouve dans la bouche de tous les antisémites à toutes les époques, et qui se cristallise dans le fait que la seule référence culturelle à laquelle renvoie la charte du Hamas est faite de ces sinistres Protocoles des Sages de Sion, ce faux forgé par la police tsariste, qui continue d’être un best-seller au Moyen‐Orient.
Ou bien, on fera en sorte que ceux qui témoignent de l’existence de la Loi disparaissent corps et bien, comme en témoigne aussi la charte du Hamas quand elle renvoie à un Hadîth qui évoque le tout dernier Juif sur la terre, qui se cache derrière un arbre et qu’il faut aller débusquer afin de le tuer.
En rappelant tout cela, Tenir tête s’efforce cependant de faire écho à une situation qui aura vu, en France, mettons entre fin 2023 et fin 2024, les actes antisémites augmenter de plus de 300%. Et ce que le livre tente de faire dans cette perspective, c’est de mettre en scène ou en image, si j’ose dire, l’impact d’un événement considérable et douloureux sur des consciences qui ont du mal à l’appréhender. C’est à cette condition que j’ai voulu montrer en quoi les massacres et les enlèvements du 7 octobre sont susceptibles de révéler des choses qui définissent directement, et centralement, notre époque : le nihilisme, le rapport à la violence, la valeur que nous accordons à la vie, l’écart entre la morale et la politique, la nuance balayée par la nécessité de réagir à chaud…
De cette façon, le livre espère dénouer le nœud coulant du choc provoqué par le retour de l’antisémitisme. Autant dire que j’ai écrit ce livre en cherchant à tâtons une issue à l’angoisse, surtout en interrogeant les raisons pour lesquelles l’opinion publique mondiale en est arrivée à croire au bien‐fondé de l’équation « Juif = sioniste = colonialiste », équation qui transforme les relations humaines en un véritable champ de mines, ou en un stand de tir, où chacun, en fonction de son identification, risque sa peau.
Mais c’est surtout sur les Arabes qui détestent les Juifs parce qu’ils sont juifs, que se penche la réflexion. À ce titre, elle met en relief le fait que ceux‐ci ne voient pas les choses sous un angle strictement politique. Leur antijudaïsme – leur antisionisme même – est planté dans un sol religieux ; aussi est‐il bien plus vieux que la constitution d’un Foyer national juif en Palestine sous la tutelle des Britanniques dans les années 1920. À la rigueur, ce qui a changé depuis cette date, c’est l’aspect farouchement identitaire que prend désormais l’antijudaïsme oriental, aspect qui nous fait croire qu’il est plus politique que religieux. Mais il ne faut pas s’y tromper : dans ce berceau des trois religions monothéistes qu’est le Moyen‐Orient, ce que nous appelons en Occident « l’autonomie du politique » n’existe pas. (En Occident même, la lutte pour y arriver a été séculaire et d’une extrême violence – ne l’oublions pas.)
Croire que la sphère politique se suffit à elle‐même, c’est adopter une idée qui ne s’applique pas aux sociétés moyen‐orientales. L’autonomie du politique y est aux pays de cette région du monde ce que la contre‐culture aura été aux États‐Unis : une parenthèse historique. Ainsi, on remarquera que la « cause palestinienne », qui avait une dimension laïque et marxiste dans les années soixante, et qui était largement défendue à cette époque par des intellectuels athées de culture chrétienne, est aujourd’hui captée, phagocytée par les suppôts de l’islamisme, je dirais même engloutie dans l’islamisme, et singulièrement dans l’idéologie de ces Frères musulmans qui n’ont jamais voulu d’une solution à deux États dans la mesure où celle‐ci légitimerait de facto l’existence de l’État hébreu.
Quoi qu’il en soit, chez bon nombre d’Arabes, qu’ils soient chrétiens ou musulmans, qu’ils soient croyants, agnostiques ou athées, la politique s’inscrit inévitablement dans un contexte de coutumes et de traditions, qui reflètent elles‐mêmes une vision religieuse du monde. Inversement, la religion se doit toujours d’être politiquement articulée. Et c’est pourquoi, dans le monde arabe qui entoure de tous côtés l’État d’Israël, la judéophobie est l’ombre portée de religions dominantes qui structurent les mœurs et la culture. C’est ce qui explique notamment qu’au Moyen‐Orient, lorsqu’on parle des Israéliens, on dit toujours "al-Yahud", ce qui signifie « les Juifs », en tant que peuple identifié par sa seule foi. Il n’est pas nécessaire d’avoir l’oreille absolue pour sentir que cette appellation recouvre un antijudaïsme qui se traduit aujourd’hui dans la vie quotidienne par la transformation qu’a subie cette absence insurmontable de sympathie exprimée, affichée, exhibée pour tout ce qui touche au peuple juif : la transformation de l’antipathie en une haine inexorable.
Quelle est la cause de cette transformation ? Elle résulte de la montée aux extrêmes de la violence, de l’intensification d’un ressentiment abyssal qui est devenu lui‐même fonction de la place occupée par les extrémismes politico‐religieux de toutes sortes dans ces pays, y compris, évidemment, en Israël.
Plus encore, la transformation d’un a priori d’antipathie en une haine inextinguible et sanguinaire est due aux tragédies historiques successives, aux mythes non déconstruits, aux victoires et aux défaites mal digérées, à l’humiliation des uns et à l’arrogance des autres, en tout cas à la conviction de plus en plus ancrée chez la plupart des Orientaux, qu’il est impossible de trouver une issue à un conflit non pas seulement politique, mais identitaire et politico‐religieux.
C’est à cette haine que, dans le prolongement du 7 octobre, s’est greffé un fond indéracinable d’antisémitisme occidental, qui n’attendait qu’une occasion pour resurgir, occasion que la fureur antisioniste lui a alors donnée sans vergogne. Cette greffe est tellement forte, et tellement évidente pour beaucoup, qu’on n’a pas attendu longtemps pour entendre sur l’esplanade de l’Université Columbia à New York des jeunes venant du monde entier scander en chœur : « Nous sommes tous le Hamas ».
Demain [30 janvier 2025], des otages israéliens seront rendus à leur familles, et nous les attendons le cœur battant. Mais combien d’otages retenus par le Hamas sont encore vivants ? Personne ne le sait. On soupçonne que le Hamas lui‐même ne le sait pas… Toutefois, ceux qui les libèrent au compte‐goutte continuent d’en appeler à la création d’un avant‐poste du Califat « du fleuve jusqu’à la mer », comme si, depuis le 7 octobre, rien ne s’était passé… C’est dire que cette folie n’est pas près de s’arrêter. Il n’empêche – je dois l’admettre en ce qui me concerne –, le Juif en moi retient et retiendra sans doute toujours le non‐Juif que je suis de désespérer de l’être humain.
*
Marc Crépon
Incorporations de l’antisémitisme
(Sur le livre de Paul Audi)
J’avais au moins trois raisons d’accepter sans hésiter la proposition qui m’a été faite de discuter aujourd’hui avec Paul de son livre Tenir tête. La première est le dialogue que nous avons l’un avec l’autre depuis très longtemps. S’il fallait dire le nom de ses contemporains, avec lesquels l’échange n’est pas seulement possible, mais attendu et nécessaire, Paul serait le premier nom qui s’impose à moi comme une évidence. De même qu’il est usuel de parler entre poètes de « frères en poésie », il n’y a pas de raison de ne pas éprouver une fraternité de cet ordre en philosophie. Je remercie donc infiniment Perrine et Benjamin de me donner l’occasion aujourd’hui de la manifester. Nous nous étions retrouvés, Paul et moi, il y a moins de trois ans, sur la question de l’identité, avec la parution presque simultanée de son livre Troublante identité et de L’héritage des langues. Nous nous retrouvons aujourd’hui sur celles de la violence et de la haine, qui m’auront tant occupé, avec ce livre Tenir tête. Pour autant, il ne s’agit pas de n’importe quelle violence et de n’importe quelle haine, il s’agit de l’antisémitisme. Et c’est de cela, de cela avant tout dont je voudrais parler avec lui, après y avoir consacré une partie de mon séminaire cette année. La seconde raison donc que j’avais d’accepter comme une évidence de dialoguer avec Paul aujourd’hui, ce sont les questions qu’il aborde : la violence et la haine antisémites, prioritairement au Proche‐Orient, mais par ricochet partout dans le monde. C’est par la troisième que je commencerai ce bref salut introductif, parce qu’elle est essentielle à mes yeux. La troisième raison pour laquelle je suis heureux d’être à ses côtés aujourd’hui tient à l’opportunité qu’elle me donne de saluer le courage dont témoigne ce livre. Non pas n’importe quel courage ! Celui, dont j’emprunterai la désignation à Michel Foucault, comme j’aurais pu l’emprunter à Jan Patocka : un certain « courage de la vérité ».
En quoi consiste‐t‐il ? Qu’est-ce qui fait le courage d’un livre ? Deux critères s’imposent pour le définir. Le premier est son caractère intempestif. Un livre courageux ne s’inscrit jamais dans l’air du temps. Il le prend à rebours, il défie et défait patiemment ses certitudes, en s’interdisant cette forme de « confort intellectuel », à laquelle aucune philosophie n’est assurée d’échapper, si elle ne se donne pas comme boussole d’en éviter l’écueil. « Le confort intellectuel », voilà la menace qui plane sur toute pensée, y compris celle qui se pare des atours de la critique, en se donnant des airs de radicalité. Le courage donc est intempestif, ou il n’est pas. À défaut de ne pas s’aventurer à contre‐temps, il ne prend aucun risque, se confondant avec sa posture. Quel est donc le courage de ce livre, Tenir tête ? Une dernière considération, si vous me permettez, qui n’est générale qu’en apparence, avant de rentrer dans le vif du sujet, en répondant à cette question. Le premier risque que court un livre intempestif, c’est celui de la désolidarisation. S’il est vrai que témoigner sa solidarité est une manifestation nécessaire de notre interdépendance, s’il est légitime que soit attesté ainsi un sentiment d’appartenance commun, il faut reconnaître aussi – et c’est le plus difficile – que son expression est toujours susceptible de nous prendre en otage, nous dictant ce que nous devons dire, faire et penser, et parfois taire (si souvent taire) au nom de cette appartenance. Qu’est-ce que la désolidarisation alors ? Quel risque court‐elle ? Celui de ne pas (de ne plus) être compris par les siens, de quelque façon qu’ils se définissent : la famille, les proches, les amis, le milieu intellectuel, les journalistes, les compatriotes et d’être vilipendé pour s’être montré infidèle à une alliance qui est toujours le présupposé implicite de la solidarité. C’est peu dire qu’en temps de guerre, comme le savait Romain Rolland et quelques autres avec lui, l’appel à la solidarité est démultiplié et que l’accusation de ne pas lui rendre droit s’en trouve aggravée : « Comment peux‐tu écrire ce que tu écris ? Soutenir ce que tu soutiens ? Faire si peu de cas de ton pays, de tes “racines”, de tes “origines”, de nos souffrances et de nos morts ? Tu n’es plus des nôtres ».
Qu’est-ce donc que dit et que fait ce livre, au risque d’être non pas mal compris, mais précisément trop bien compris, et donc de déranger ? Qu’est-ce qu’il donne à voir avec rigueur et méthode, au fil de son ouverture, de ses neuf lettres et des deux essais qui en ponctuent le cours, « haine » et « devoir » ? Je le dirai avec des concepts qui sont les miens – et comme toujours avec Paul, je suis saisi par la façon dont nos préoccupations se recoupent, se croisent, se font écho, avec chacun ses propres mots qui sont parfois les mêmes. Ce que Paul nous dit, avec beaucoup de clarté et de fermeté, non sans colère, est qu’il faut prendre les choses dans l’ordre et que le problème du Moyen‐Orient, celui dont il faut repartir, parce que tous les conflits s’y enracinent est l’incorporation de l’antijudaïsme, la haine des Juifs, comme une raison d’être. Soutenir cette thèse implique alors deux gestes, d’une redoutable difficulté. Cela suppose tout d’abord de faire l’histoire de cette incorporation – et c’est pourquoi ce livre est aussi un livre savant, érudit, informé. À l’opposé d’une diatribe, d’un règlement de comptes ou de toute autre inflammation de la parole de cet ordre, il redonne de la profondeur historique à notre compréhension du présent, dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle en aura beaucoup manqué, y compris dans la bouche des plus farouches de ses commentateurs qui n’ont que faire de son éclairage et de sa médiation. C’est un fait que la haine se moque de la vérité historique, qu’elle l’arrange à sa façon, qu’elle ne cesse donc de réécrire (ou d’oublier) le passé. La guerre, avec son cortège de faits insoutenables, ses destructions, ses victimes s’y prête davantage encore.
D’un côté, les comptes qu’elle demande devraient toujours être ceux de la vérité, mais celle‐ci est souvent difficile à accepter – et c’est précisément ce qui la rend intempestive. Il faut du temps pour qu’elle se laisse écouter. Il en faut d’autant plus – à supposer que ce temps vienne un jour – que les forces auxquelles elle s’oppose sont redoutables. Aussi, parler de l’incorporation de l’antijudaïsme et de l’antisémitisme ne consiste pas seulement à en retracer l’histoire. Cela exige qu’on affronte aussi bien la stratégie que les vecteurs contemporains de son héritage, de son entretien et de son réveil spectral. Le caractère intempestif de Tenir tête, c’est de garder le cap d’une telle vigilance. Le titre le dit si justement. « Tenir tête ». À quoi ? Pour quoi ? L’entêtement, qui est une obstination de la pensée, consiste à rappeler inlassablement, à ceux qui voudraient l’oublier, à ceux qui le minimisent, qui refusent d’en prendre la mesure, ou pire, qui lui trouvent des excuses sinon des raisons, ce que les attentats du 7 octobre et la riposte israélienne ont réveillé aux quatre coins du globe : cet antisémitisme qui ne permet plus aux Juifs de se sentir en sécurité nulle part dans le monde, au Proche‐Orient depuis longtemps, en Europe aujourd’hui, d’une façon accrue qui ravive les pires cauchemars.
Ce que je voudrais souligner alors pour conclure, c’est la signification transversale et universelle de cette obstination de la pensée. Pourquoi tenir tête ? Paul et moi partageons beaucoup d’auteurs, beaucoup de livres se retrouvent dans le panthéon de chacun, avec lequel nous avançons, des poètes, des romanciers, des philosophes, que nous lisons chacun de notre côté et auxquels nous nous reportons comme un recours de la pensée. Et parmi eux, il y a Camus qui nous est essentiel à l’un et à l’autre, auquel Paul a consacré un essai, en 2013 : Qui témoignera pour nous. Albert Camus face à lui-même. Je ne sais s’il en sera d’accord avec moi, mais dans son œuvre imposante, je serai tenté d’extraire une série, dont ce livre serait le premier relai, suivi sept ans après par un autre grand livre Réclamer justice (2019), deux ans plus tard par Troublante identité (2022) et aujourd’hui par Tenir tête. Quel est le fil secret qui relaie tous ces livres les uns aux autres ? Rien de moins que la plus difficile des articulations : celle qui lie l’une à l’autre notre idée de la justice et notre idée de l’humanité. Il est, en effet, une certaine façon de penser l’une, en se fourvoyant, qui ruine aussitôt l’autre, et réciproquement. Elles ne se laissent pas penser l’une indépendamment de l’autre. Elles se tiennent mutuellement, parce que le naufrage de l’une signifierait aussitôt le naufrage de l’autre. « Tenir tête », c’est donc tenir à ce qui les tient ensemble. Et c’est ce qui fait de l’opposition radicale à l’antisémitisme, de la dénonciation de ses résurgences, de ses réveils – qui sont l’esprit de ce livre – une responsabilité universelle.