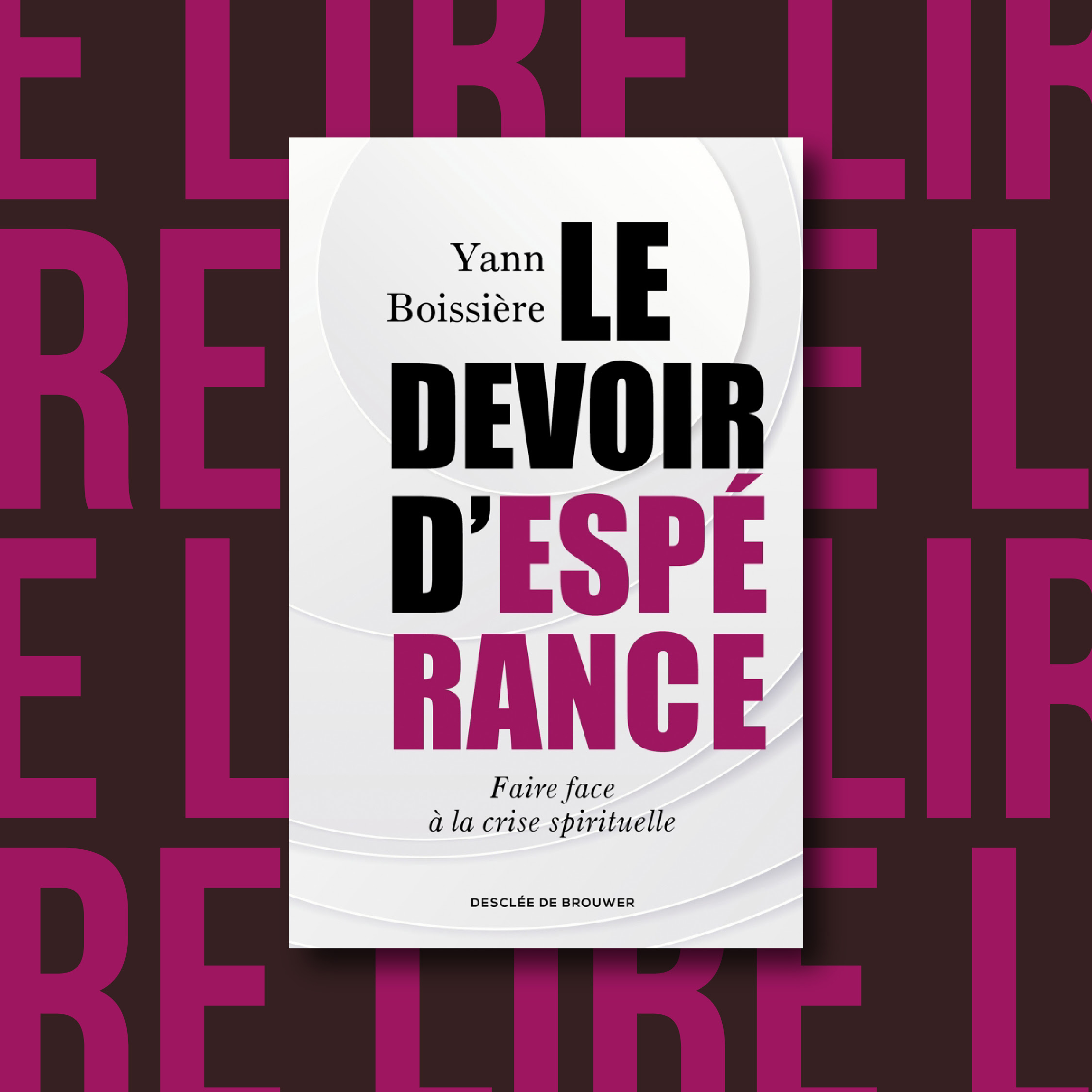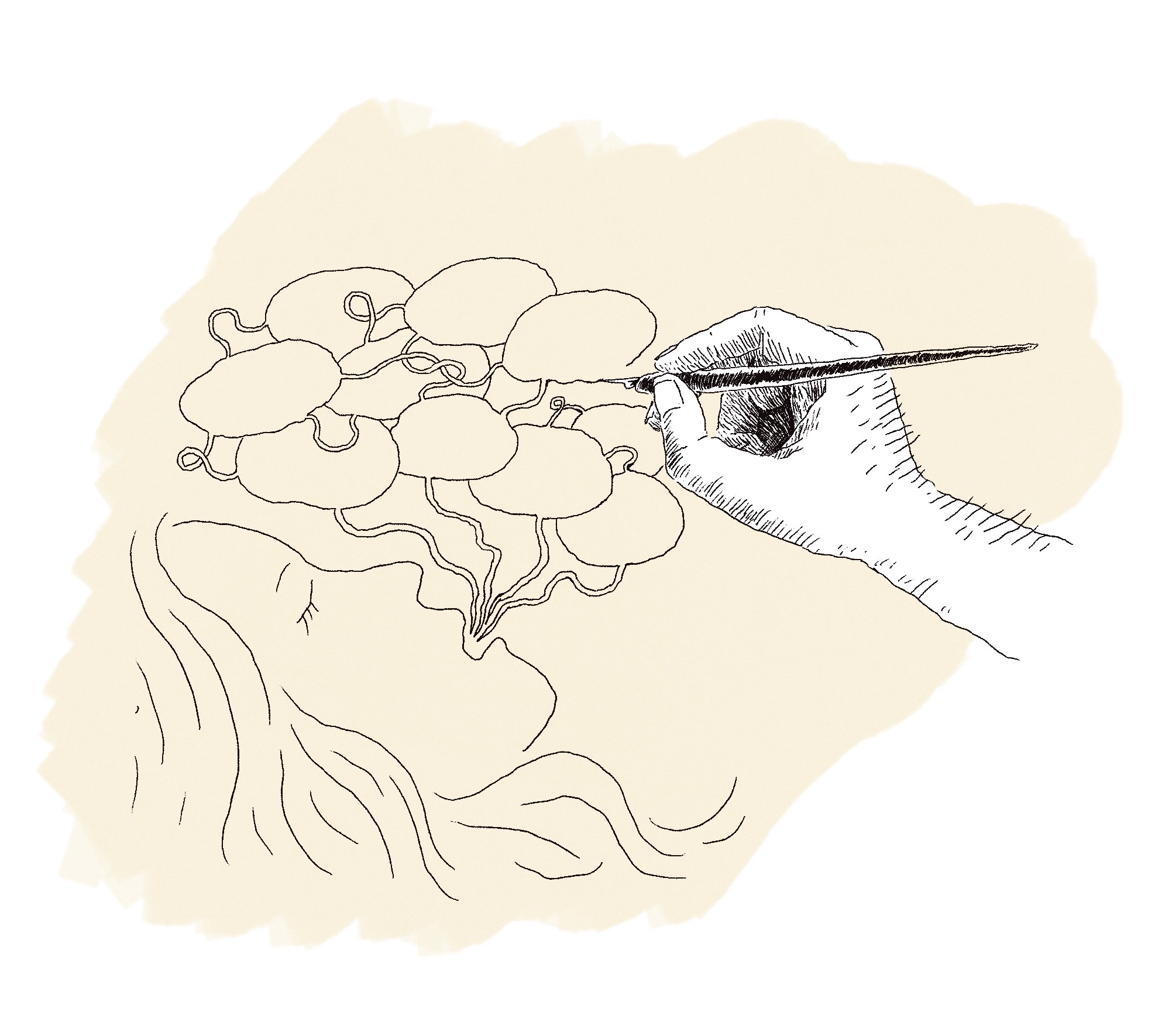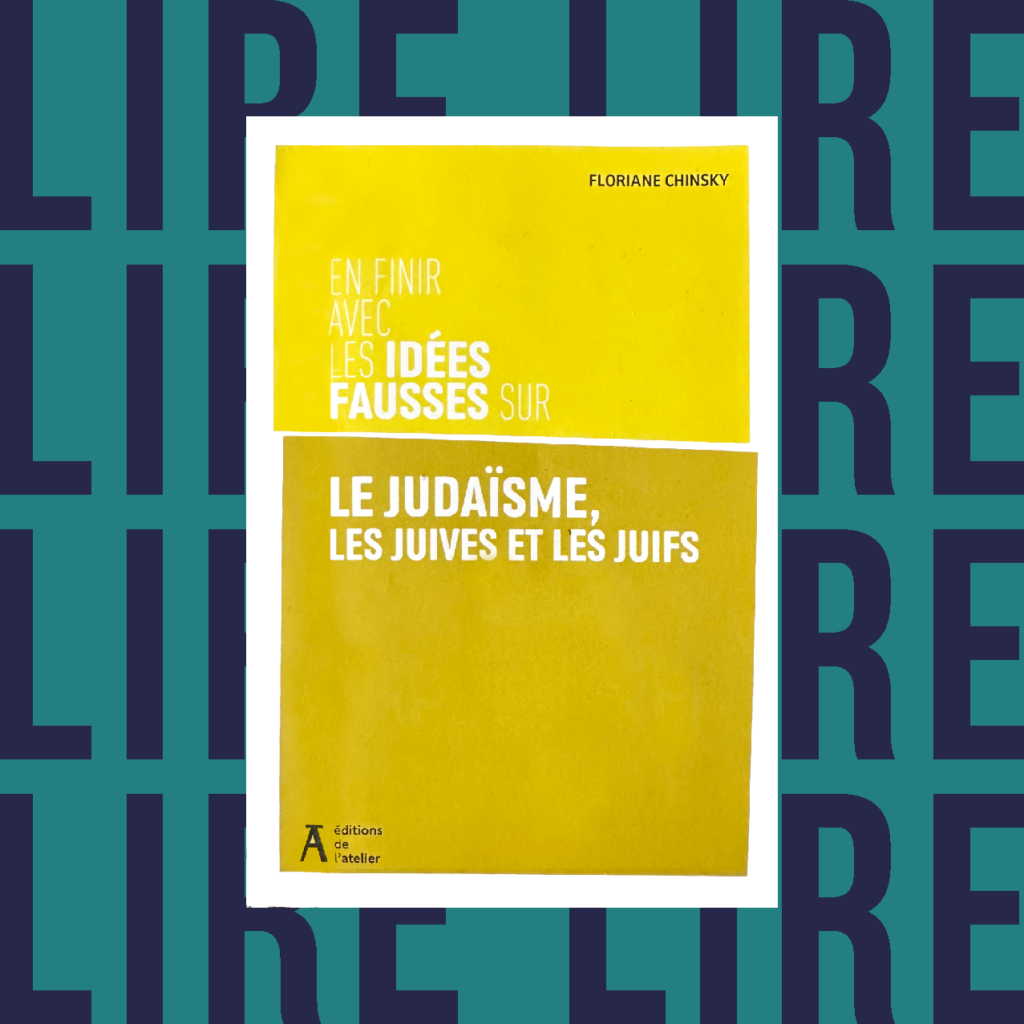
Nous sommes plus d’un an après le 7 octobre, les idées reçues sur les Juifs, les Juives et le judaïsme sont aussi populaires que virales. Les malentendus se perpétuent. Dans cette actualité, avez-vous ressenti le besoin d’écrire un ouvrage didactique destiné à nourrir le débat, à ouvrir le dialogue ?
Depuis assez longtemps, un projet d’écriture se construisait. J’exerce en tant que rabbin depuis plus de vingt ans et j’enseigne depuis plus longtemps encore, je trouvais important que ce que j’enseigne puisse prendre place dans un livre. Mais le contexte en France comme en Israël m’a imposé la forme et la temporalité. Sur le plan de la forme, ce livre peut servir de référence à toutes les personnes qui se trouvent à la recherche d’informations précises. J’ai souvent inséré des citations, des outils pour que mes lecteurs et lectrices puissent fonder leur pensée sur des sources, s’interroger à partir de quelque chose de commun, s’y frotter. Au niveau du fond, j’ai souhaité véhiculer l’idée que le judaïsme est vivant, qu’il ne se laisse pas devenir prisonnier des stéréotypes du passé.
C’est aussi un livre dont vous êtes le héros, l’héroïne, vous choisissez la façon dont vous souhaitez vous confronter à vos idées reçues, vous pouvez entrer en résistance avec ce que vous pensez savoir. J’éprouve du respect pour les personnes qui font face à leurs préjugés. J’espère aussi que ce livre réussira à réunir des personnes non juives qui luttent contre toutes les formes de racisme, pour qu’elles n’oublient pas l’antisémitisme.
Ce livre aborde une très grande diversité d’idées reçues, des plus classiques (et antisémites) au plus insoupçonnées (pas plus philosémites). "Les mariages mixtes sont plus destructeurs que la Shoah", "Dieu.e veut qu’on meure en martyr.e", "Les femmes ne sont pas légitimes pour accomplir les commandements". D’où viennent toutes ces idées reçues, en avez-vous été témoin ?
J’ai choisi les idées qui revenaient le plus dans les discours, celles dont le caractère me paraît le plus pernicieux, le plus dangereux. Depuis la question des « Juifs ayant tué Jésus » à la question de l’avortement, sans laisser de côté les conversions ou les couples mixtes. Je comprends l’angoisse autour de l’assimilation, de la rupture dans la transmission du judaïsme, mais désigner des boucs émissaires ne règle pas les difficultés ; au contraire, cela nous écarte des solutions. Pour retrouver un positionnement juste, je propose de revenir aux sources, aux textes, d’étudier ensemble toutes ces questions quitte à ne pas être d’accord sur l’issue. Nous avons besoin de tout le monde, et bien sûr également des femmes, pour faire face à l’avenir.
Chaque idée reçue a droit à un chapitre et chaque chapitre se compose d’une argumentation sourcée destinée à détricoter l’idée reçue, d’un résumé et d’une conclusion formulée sous la forme d’une blague juive. Pourquoi cette approche ?
J’adhère à cet enseignement fondamental des Pirkei Avot 6,6, selon lequel toute personne qui cite ses sources sauve le monde (“rapporter la parole au nom de son auteur”). C’est un principe qui s’applique aussi aux sciences sociales : on dit d’où on vient. Je sais bien que tout le monde n’est pas d’accord avec ce que je défends dans ce livre, le judaïsme est pluriel, et ses composantes doivent rester en dialogue. C’est la raison pour laquelle je reviens aux sources que je traduis d’une façon qui me semble fidèle, j’invite à re‐discuter à partir de ces éléments.
En France, nous nous sommes peut‐être trop acculturés à la norme hiérarchique française. Autrement dit : le maître parle, les élèves l’écoutent, Paris décide, la province obéit. C’est une vision très napoléonienne du judaïsme et ce n’est pas ainsi que j’envisage l’avenir du judaïsme. Je suis assez confiante sur la capacité de chacun à se nourrir de ces textes pour accéder à sa représentation du judaïsme. Je ne cherche pas à maîtriser le résultat, simplement à proposer ce qui peut nourrir, permettre de bâtir.
J’ai choisi de conclure chaque chapitre par un pas de côté, en espérant faire comprendre ce qu’est l’humour juif, de quoi il se compose, de quoi il se joue. C’est aussi une façon de faire correspondre la forme et le fond : il y a de l’humour dans la Torah, dans le Talmud, dans la Mishna donc il y a de l’humour dans ce livre. Les blagues comme les histoires peuvent aussi servir d’antidote à la pensée des experts, des costards‐cravate, du barbe‐kippa.
À plusieurs moments dans le texte, vous rappelez à quel point les textes de la tradition juive sont voués à se réinventer, qu'ils ne sont pas des objets finis, figés. Pourquoi répéter cette idée ?
Je voudrais que l’on cesse d’opposer un judaïsme religieux codifié et fermé à un judaïsme culturel libre. Les textes anciens sont eux aussi culturels, et eux aussi porteurs de liberté. « Renouvelle nos jours », dit‐on en reposant la Torah, pour que l’étude vivante ne s’arrête jamais. Pour cela, émancipons‐nous du modèle chrétien qui distingue les laïcs des religieux, chose qui ne trouve pas son équivalent dans le judaïsme. Les religieux peuvent être libres dans leur pratique comme les culturels peuvent se retrouver dans l’étude des textes…
Plusieurs chapitres sont consacrés à la place des femmes dans le judaïsme, à leur accès à l’étude, au contrôle de leur corps, à leurs obligations par rapport à la loi juive. Vous écrivez qu’en France, donner de la place aux femmes relève encore du défi. Comment ça ?
Oui, il y a de plus en plus de femmes qui veulent se saisir de l’ensemble de leurs libertés et ce n’est pas quelque chose qui m’étonne. Oui, les femmes veulent étudier parce qu’en tant que population mise de côté, elles ressentent le besoin d’étudier pour asseoir leur légitimité. Cette plus grande présence féminine ne s’accompagne pas de plus de places accordées aux femmes dans des endroits structurés avec un salaire et une liberté dans les pratiques synagogales. Pour gagner en liberté, j’estime souhaitable que chacun ou chacune puisse initier un groupe d’études, puisse s’exprimer au même titre que ses pairs. Que l’on puisse sortir de la logique de concentration des pouvoirs. Différentes initiatives récentes s’inscrivent dans ce mouvement.
Vous avez choisi de recourir à l’écriture inclusive, de désigner "Dieu.e" comme étant non binaire…
Je ne peux pas défendre les Juifs et les Juives en étant légère sur la question du sexisme, c’est une obligation de congruence. Je souhaite que les femmes soient nommées au même titre que les hommes tout comme je souhaite que les personnes juives soient respectées au même titre que les autres. L’effort de non‐discrimination touche toutes les catégories.
En ce qui concerne la non‐binarité de Dieu.e, j’ai surtout choisi de ne pas le masculiniser, de pas l’associer au genre, au corps masculin. Puisque dans le judaïsme, Dieu.e ne se définit pas, il ne se représente pas… J’ai donc souhaité déjouer l’évidence conformément à la tradition même si, cela peut créer une forme de dissonance dans le langage.
Pendant l’écriture, j’ai tenu à faire face à tous les sujets, et pour certains, cela m’a permis d’évoluer dans ma vision.
Qu’attendez-vous des générations futures, comment peuvent-elles utiliser cette somme de connaissances ?
J’ai en tête l’image de Bernard de Chartres repris par les Tossafot : celle des nains assis sur les épaules des géants, ils sont plus hauts, ils voient plus loin. Je ne dis pas que je suis géante, mais j’ai eu la chance de m’appuyer sur des sources inspirantes, et j’aimerais que mes épaules soient confortables, pour que d’autres puissent aller plus loin encore. J’attends également que les plus jeunes puissent partager leurs enthousiasmes, leurs critiques, leurs désaccords pour que je puisse toujours rester en lien avec le réel.
Propos recueillis par Léa Taieb