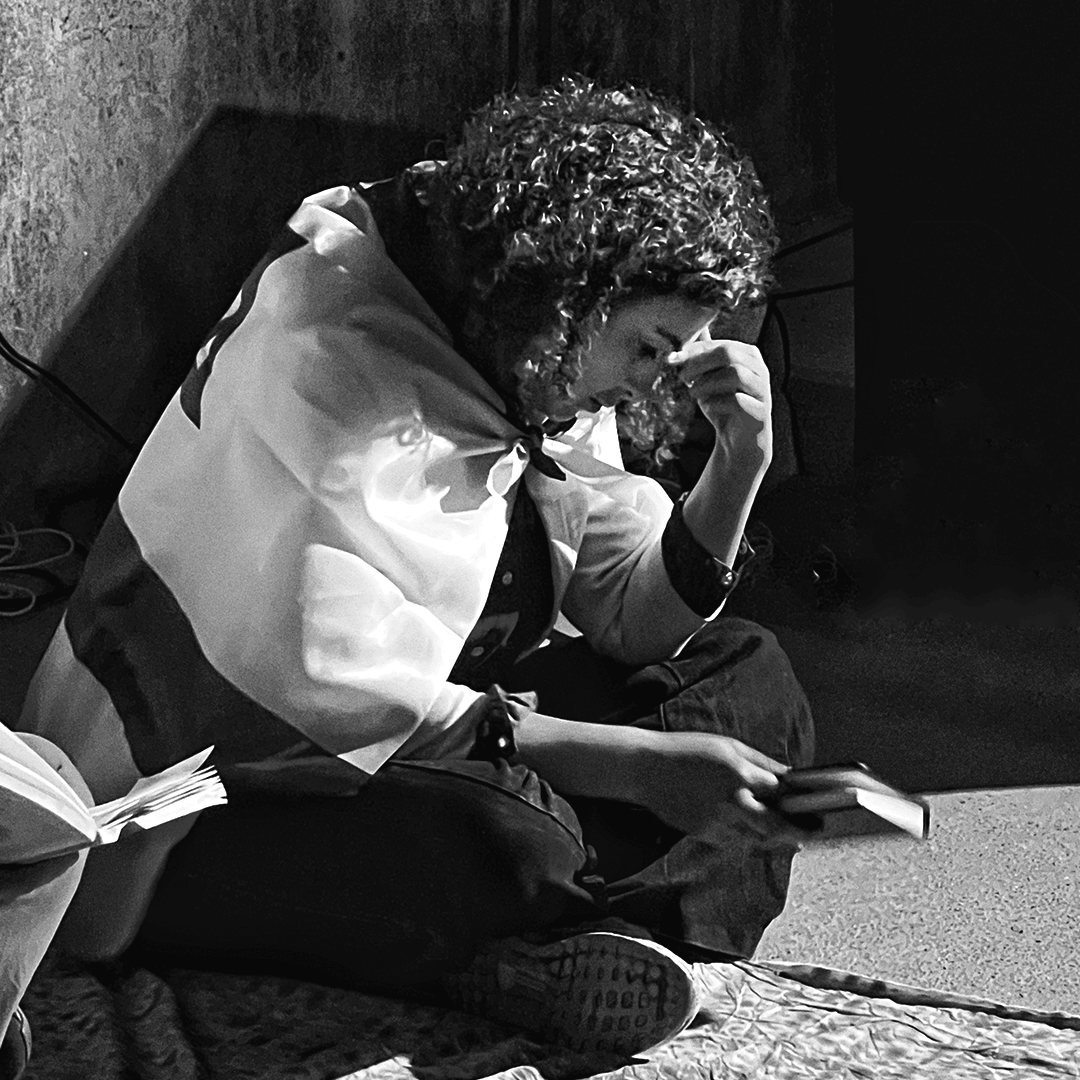Dans le Talmud, au traité Baba Metsia 59a, il est enseigné :
ואמר רב כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנם שנאמר רק לא היה כאחאב וגו׳ אמר ליה רב פפא לאביי והא אמרי אינשי איתתך גוצא גחין ותלחוש לה לא קשיא הא במילי דעלמא והא במילי דביתא לישנא אחרינא הא במילי דשמיא והא במילי דעלמא
Nous traduisons :
Rav dit que quiconque suit les conseils de sa femme descendra dans la Géhenne, car il est écrit: "Il n’y avait personne comme A’hav etc." (I Rois, 21,25). Rav Papa a objecté à Abbayé: pourtant les gens disent: "si ta femme est petite de taille, baisse-toi et consulte-là". [Abbayé lui a répondu:] cela ne pose pas de difficulté, car ceci a été dit en ce qui concerne les affaires du monde et ceci en ce qui concerne les affaires de la maison. Autre explication: ceci en ce qui concerne les affaires du ciel et ceci en ce qui concerne les affaires du monde.
L’enseignement de Rav, de prime abord, évoque un propos de Napoléon Bonaparte, dont la légendaire misogynie a pu inspirer certains articles du Code civil : « Pour une qui nous inspire quelque chose de bien, il en est cent qui nous font faire des sottises[1] ». C’est le sens immédiat de l’enseignement rapporté au nom de Rav : "quiconque suit les conseils de sa femme descendra dans la géhenne"; si ce n’est que son propos est donc fondé sur un verset. En I Roi, 21,25−26, il est écrit, au sujet d’Achab, roi d’Israël : « En vérité, personne encore ne s'était, comme Achab, adonné à faire ce qui déplaît à l'Eternel, entraîné qu'il fut par sa femme Jézabel. Il commit force abominations, en adoptant le culte des impures idoles, comme avaient fait les Amorréens, que l'Eternel avait dépossédés en faveur des enfants d'Israël" (trad. Rabbinat). Achab est donc l’exemple même du roi qui, parce qu’il a suivi les conseils de sa femme, a enchaîné les mauvaises actions pour, finalement, y perdre son âme. Or, quelle est la nature du conseil que sa femme lui a prodigué ? L’histoire est la suivante : le roi Achab désire acquérir la vigne de Naboth qui jouxte sa maison, mais celui‐ci refuse de la lui céder, y compris en échange d’un carré de vigne de meilleure qualité. C’est ce refus qui introduit le personnage de Jézabel :
Achab rentra chez lui triste et abattu, à cause de la réponse que lui avait faite Naboth le Jézreélite, en disant: "Je ne te céderai pas l'héritage de mes pères." Il se jeta sur son lit, la face tournée vers le mur, et ne prit point d'aliments. Jézabel, sa femme, vint le voir et lui dit: "Pourquoi ton esprit est-il abattu et ne prends-tu pas de nourriture?" Il lui répondit: "C'est que j'ai parlé à Naboth, le Jezreélite, et lui ai dit: "Donne-moi ta vigne à prix d'argent, ou, si tu le préfères, je t'en donnerai une autre à la place. Il a répondu: Je ne te donnerai point ma vigne." Jézabel, sa femme, lui répondit: "Est-ce bien toi qui exerces aujourd'hui la royauté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et sois de bonne humeur; c'est moi qui te procurerai la vigne de Naboth, le Jezreélite." Elle écrivit des lettres au nom d'Achab, les scella du sceau royal et les expédia aux anciens et aux nobles de sa ville, qui demeuraient près de Naboth. Elle avait écrit dans ces lettres: "Proclamez un jeûne, faites asseoir Naboth à la tête du peuple; placez en face de lui deux individus sans scrupules, qui déposeront contre lui, en disant: Tu as outragé Dieu et le Roi. Puis on le fera sortir, et on le tuera à coups de pierres." Les anciens et les nobles, qui habitaient dans sa ville, exécutèrent l'ordre de Jézabel, tel qu'il était consigné dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. (I Rois, 21, 4-11, trad. Rabbinat).
L’attitude peu conciliante de Naboth afflige le roi Achab qui désire acquérir sa vigne ; l’épouse du roi, Jézabel, lui rappelle alors que c’est lui, Achab, qui est le roi, et qu’il est donc en son pouvoir de contraindre Naboth à lui céder sa vigne. Elle conçoit aussitôt un stratagème afin de mettre à mort Naboth et de donner à ce crime l’apparence d’un juste châtiment. Le conseil de Jézabel porte ainsi, en dernière analyse, sur la manière d’exercer le pouvoir. Et son conseil est significatif : exercer un pouvoir, c’est contraindre autrui à céder à son désir, sous peine de mort. Le paradoxe est donc ici que c’est la femme qui convainc l’homme d’exercer un pouvoir phallique sur autrui [2].
Rav Papa, apparemment, s’étonne que Rav ait pu tirer de ces versets une telle généralité au sujet des femmes, comme si l’intervention de Jézabel signalait une perversion spécifiquement féminine. Il lui objecte donc. Et son objection consiste à rapporter un dicton populaire : "si ta femme est petite de taille, baisse-toi et consulte-là". Autrement dit, bien que la femme soit, dans le monde tel qu’il va, dans une position d’infériorité sociale, ne perds pas de vue que c’est auprès de ton épouse que tu trouveras les meilleurs conseils. Rav Papa, dans le Talmud, rapporte souvent de tels dictons populaires. Il accorde apparemment à la sagesse proverbiale une importance particulière. Mais irait‐il jusqu’à opposer un dicton populaire à un verset biblique ? Certainement pas. En revanche, il considère que le dicton populaire est un guide éminemment fiable et que, par conséquent, si une exégèse des versets bibliques contredit la sagesse proverbiale, il est fort à parier que cette exégèse confine au contre‐sens. Autrement dit, Rav n’aurait pas interprété les versets avec justesse.
Intervient alors Abbayé qui résout l’apparente contradiction entre d’une part l’enseignement de Rav qui invite l’homme à se méfier des conseils de sa femme, d’autre part le dicton populaire rapporté par Rav Papa qui, au contraire, appelle l’homme à se fier aux conseils de sa femme : « ceci a été dit en ce qui concerne les affaires du monde et ceci en ce qui concerne les affaires de la maison ». Les "affaires du monde" ("milé de-alma") s’opposent donc ici aux "affaires de la maison" ("milé de-betah"). Est‐ce à dire qu’il y a d’une part l’espace public où doit régner sans partage le masculin, de l’autre l’espace domestique où est confinée le féminin, toute intrusion du féminin dans l’espace public menant inévitablement au désastre ? C’est du moins en ces termes que l’antiquité gréco‐romaine paraît avoir conçu la différence sexuelle : aux hommes, la délibération et l’action dans l’espace public, aux femmes la garde de la maison. Ce serait donc relativement aux affaires domestiques qu’il importerait de prendre conseil auprès de sa femme, tandis que Rav aurait en vue les "affaires du monde", domaine dont il conviendrait d’exclure non seulement les femmes, mais aussi leurs conseils.
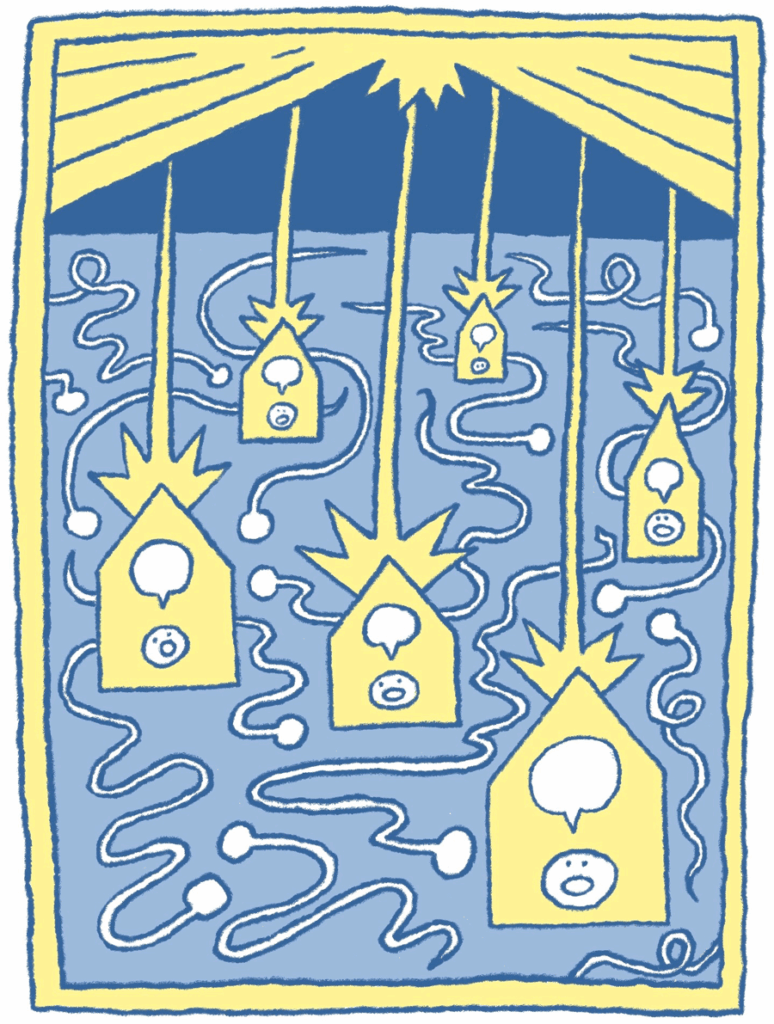
Selon une seconde version, l’explication serait la suivante : "ceci en ce qui concerne les affaires du ciel et ceci en ce qui concerne les affaires du monde". Cette fois, c’est au sujet de ce qui touche à la loi divine qu’il conviendrait de se méfier du conseil de la femme, tandis qu’il serait judicieux de prendre conseil auprès d’elle pour ce qui touche aux "affaires du monde".
Une telle lecture de ce passage du Talmud est‐elle pertinente ? Nous pensons qu’elle repose sur deux erreurs de lecture : la première est que, sous prétexte de maintenir la symétrie formelle, à savoir que le premier "ceci" renvoie à l’enseignement de Rav, le second "ceci" au dicton populaire, elle introduit une contradiction flagrante entre les deux explications avancées, puisque selon la première version c’est concernant "les affaires du monde" qu’il ne faut pas écouter le conseil de sa femme, selon la seconde version c’est précisément à ce sujet qu’il faut l’écouter. La seconde erreur consiste à entériner un système de valeur qui n’est précisément pas celui du Talmud, l’opposition entre un "espace public", domaine de la liberté par excellence, et un "espace privé", domaine de la subsistance matérielle (« économique »), étant gréco‐romain. Le Talmud est construit sur une tout autre approche de la question, l’espace public étant conçu comme celui de la pluralité essentiellement grégaire, l’espace de la « maison » étant celui de la construction singulière.
Ainsi, le domaine du multiple (reshout ha-rabim) s’élève jusqu’à seulement 10 tefa’him, soit environ à mi‐hauteur d’une taille humaine, tandis que le domaine du singulier (reshout ha-ya’hid) s’élève jusqu’au ciel. On ne saurait mieux exprimer le renversement axiologique qui s’opère d’un monde (gréco‐romain) à l’autre (juif). Et à cette lumière, les "affaires de la maison" correspondent donc aux "affaires du ciel". Autrement dit, la réponse d’Abbayé est la suivante : l’enseignement de Rav porte sur le conseil de la femme dans "les affaires du monde", tandis que le dicton populaire porte sur le conseil de la femme ou bien dans "les affaires de la maison", ou bien dans "les affaires du ciel". (Un enseignement du traité Pessa’him 88b en est l’illustration : pour ce qui est des affaires de la maison comme du ciel, lorsqu’on interroge le roi, il répond : "demandez à la reine").
Quelle leçon en tirer ? Selon nous, ce que le Talmud met ici en évidence, c’est la manière dont le conseil de la femme élucide le désir du mari et le guide vers sa réalisation, (la femme étant, en ce sens, dans la position de l’analyste qui mène l’analysant sur la voie de son propre désir). Dès lors, si le désir du mari porte sur les "affaires du monde", autrement dit s’il porte sur l’exercice rapace de la puissance, alors le conseil de sa femme lui sera maléfique, non parce qu’il échouera, mais précisément parce qu’il réussira dans son entreprise. En revanche, si son désir porte sur la "maison", c’est-à-dire sur la construction de sa singularité, de même que s’il porte sur le "ciel", c’est-à-dire sur la loi divine, alors le conseil de sa femme lui sera bénéfique. Bref, Jézabel n’était ni spécialement bonne, ni spécialement mauvaise, elle aimait tout simplement son mari qui, lui, avait un désir mauvais.
Mais la principale leçon à tirer de ce passage talmudique est peut‐être ailleurs et concerne également le masculin et le féminin. A revenir à la lettre du texte, ce que nous avons traduit par "autre explication" est l’araméen : « lishna a’harina », ce qui signifie plus littéralement "autre manière de dire". Les affaires du "ciel", ce serait donc une autre manière de dire les affaires de la "maison". Parce que l’injonction divine primordiale, c’est, qu’on soit homme ou femme, de se soustraire à la grégarité et de construire sa singularité, sans quoi l’existence n’est qu’une ombre, et la parole est vaine. En ce sens, le conseil d’une femme à son mari qui justifie par excellence le dicton populaire, c’est celui de construire sa singularité : singularité dont est précisément incapable le roi Achab en désirant la vigne de son prochain et qui, tel Caïn, ou Ève, prêtant l’oreille à la bête immonde, s’égare pour cette raison dans le néant.
Lire aussi : L’éthique de la parole
Lire aussi : De la conversation des femmes
Lire aussi : De la différence sexuelle
Lire aussi : Mariage : le “oui” d’une femme
[1] Cité par André Stil, Femmes que vous êtes…, Editions Sociales, 1963, p.24.
[2] L’histoire de Jézabel rappelle celle de Tanaquil, l’épouse de Tarquin, « représentative d’un certain nombre de femme ‘‘conseillères’’ présentes chez Tite‐Live, dont l’autorité est ‘‘le reflet exact de [la] personnalité rusée et dominée par la passion du pouvoir’’; chez l’historien misogyne, ce second aspect disqualifie ces femmes, qui ‘‘ne peuvent être de bon conseil parce qu’elles sont intéressées et prêtes à toutes les démesures pour arriver à leurs fins’’ » (Fanny Cailleux, cité par Sylvie Laigneau‐Fontaine, Rome par les textes. Anthologie, Les Belles Lettres, 2023, p. 72).