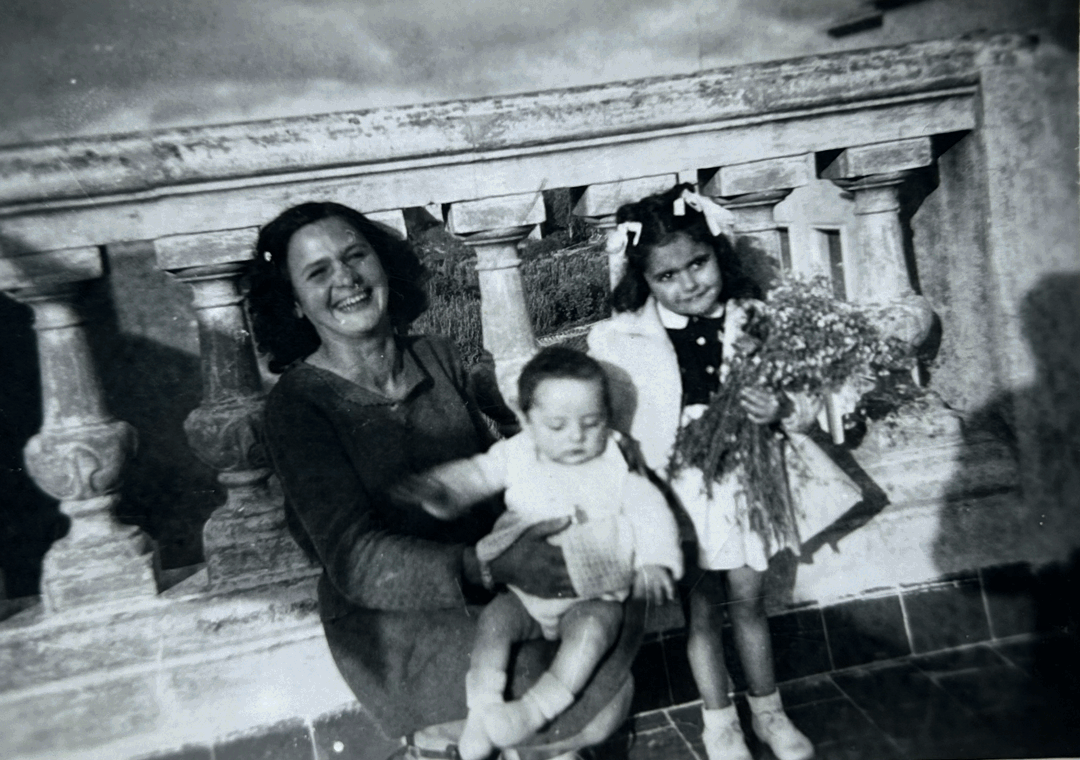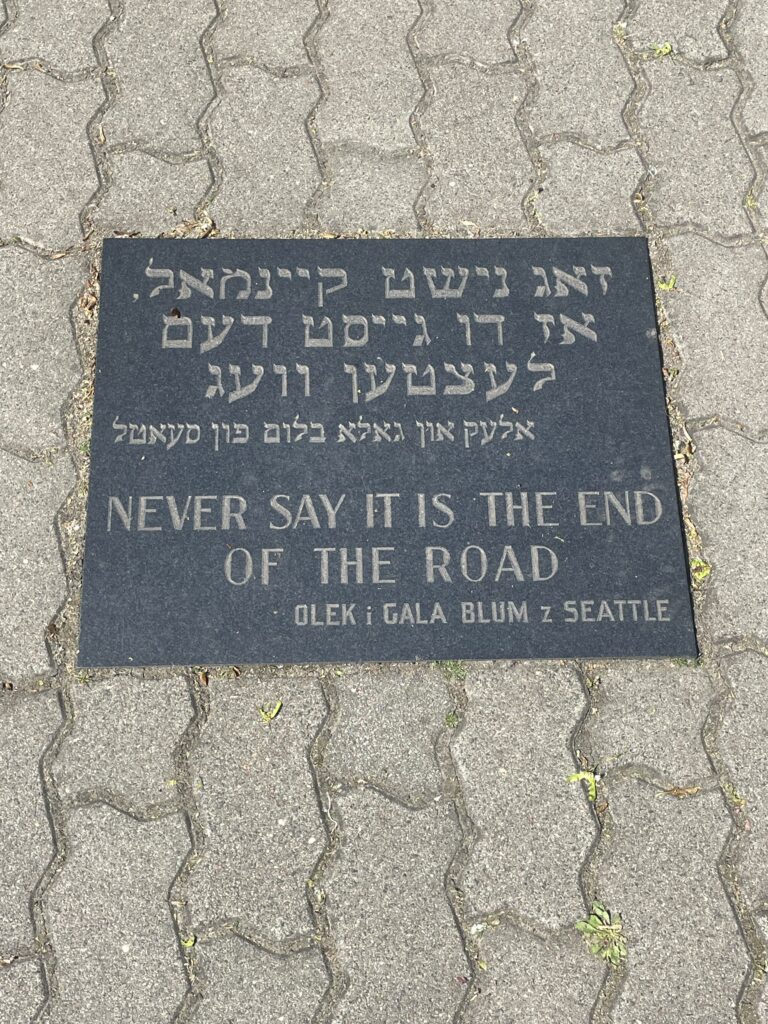
Tellement de gens n’en ont rien à faire. C’est l’impression principale qui me reste en rentrant de 6 jours en Pologne. De 6 jours dans un cimetière. Pendant que nous marchions, nous, notre petit groupe d’une vingtaine de personnes, parmi les morts, dans cette atmosphère lourde de fantômes, d’autres personnes marchaient autour de nous, au même endroit mais pas dans le même monde. Nous marchions sur la même terre, mais alors que nos pas se posaient sur des ossements, des gravats et des cendres, eux marchaient paisiblement sans penser à ce qu’il y avait sous leurs pieds.
Jour 1, j’ai à peine dormi, l’avion atterrit à 9h, direction Auschwitz sans transition. Nous descendons du car devant la Judenrampe, l’endroit de débarquement des Juifs qu’on amenait, en fonction de leur état physique, soit directement à la chambre à gaz, soit au travail. Je regarde les rails, le wagon reconstitué. Et puis je me retourne et je mets un moment à comprendre ce que je vois : une jolie petite maison, dans un joli petit jardin derrière une jolie petite clôture. Il y a une balançoire, un toboggan, des fleurs bien soignées, une cabane pour les enfants. Une maison tout sauf abandonnée. Des gens vivent là. Là, à 10 mètres de l’endroit où, il y a un peu plus de 80 ans, on emmenait des êtres humains pour les tuer à la chaîne. Plus d’un million de personnes mortes ici, et aujourd’hui, 35 000 personnes vivent dans la ville d’Oświęcim (le nom d’Auschwitz en polonais). C’est une ville normale.
Nous rentrons dans le camp. Le choc entre les images mentales et la réalité est rude. La première chose qui nous frappe, après l’étendue du lieu – 175 hectares –, c’est l’herbe bien verte, les fleurs, le grand soleil. C’est presque beau. « Il ne faut pas retourner à Birkenau au printemps », écrit Ginette Kolinka dans son témoignage. C’est indécent, que la vie puisse revenir ainsi sur ce lieu de mort. Comme si la nature elle‐même effaçait les horreurs qui se sont produites ici, en nous donnant ainsi la permission d’oublier. Des fleurs poussent sur les cendres, nous marchons sur les morts, sur la dernière terre qu’ils ont foulée. Nous avançons et je suis presque déçue d’apprendre que la majorité de tout ce qu’on voit, les baraquements, les rails, les wagons, est reconstituée. Reconstituer des engins de mort ? Mais pourquoi ? Sommes‐nous dans un parc d’attractions ? Montrer pour faire comprendre ou laisser les cendres là où elles sont : question irrésolue.
Lorsque nous marchons le long du chemin que les déportés empruntaient pour aller jusqu’aux chambres à gaz, le malaise grandit. Ça devient plus réel. L’apogée est atteinte lorsque je me tiens à l’entrée de ce qui reste du crématorium. Quelques marches qui mènent à un trou dans le sol. On nous explique que là, les déportés se déshabillaient, que là, on les enfermait avant de les gazer, et que là, on brûlait les corps. Je suis prise de vertige. Est‐ce que quelque chose comme ça a vraiment pu se passer, ici, il y a moins d’un siècle ? Il faut imaginer, mais comment ?
Ce sentiment de disproportion, je l’ai ressenti pleinement dans le musée d’Auschwitz I. Ce sont les images que tout le monde connaît : les tas de cheveux, de chaussures, de valises, de lunettes derrière des vitres. Exposés là comme des œuvres d’art. Un génocide dans une vitrine. Comment faire saisir la mort industrialisée à un tel point ? Qu’est-ce qui est le plus efficace : un récit, une vidéo, des objets, des ruines ? La première pensée qui me vient, c’est : ça ne rentre pas dans un musée. C’est trop grand, et le musée est trop petit. D’un côté, il faut bien raconter tout ça. De l’autre, ça rapetisse ce qui s’est passé.
Dans une salle presque vide, des écrans projettent des vidéos en noir et blanc. Des nazis, Hitler en train de crier. Rien de nouveau, j’ai vu des vidéos de ce genre des centaines de fois. Mais cette fois‐ci, quelque chose se produit que je n’avais jamais ressenti avant : je l’entends parler en allemand, et je ressens un dégoût viscéral de ma langue maternelle. Bien sûr, entendre un nazi parler en allemand n’a jamais été une expérience agréable. Mais là, dans ce musée, je pense : je déteste que ma langue soit rattachée à ces horreurs. Et une part de moi comprend les personnes qui ne supportent pas d’entendre cette langue ou d’aller dans ce pays. C’est bête, peut‐être. Surtout lorsque l’on sait l’important travail que l’Allemagne a effectué après la guerre.
Dans la dernière salle du musée, c’est le livre des noms. Des pages et des pages noircies par 4 millions de noms. 4 millions sur 6. À peine entrés dans la salle, la majorité de notre groupe se précipite sur le livre et commence à chercher dans les pages. Mon cœur se brise encore une fois. Une femme s’exclame, heureuse : « j’ai trouvé toute la famille ! » Plus tard, elle nous dira : « Je suis contente d’avoir attrapé quelque chose parce qu’on vit avec des fantômes. Dès que je vois une liste, je cherche des noms, je ne peux pas m’en empêcher. C’est bête, hein ? »
Jour 2. Visite de Cracovie où 65.000 des 68.000 Juifs de la ville sont morts. Le cimetière, le ghetto, l’ancien quartier juif. Puis direction le camp de Płaszów. Ici, il n’y a plus rien. C’est un joli parc en bordure de la ville. Avant d’entrer, la guide nous montre une maison de l’autre côté de la route : c’était la maison du commandant du camp. Une maison, nous dit‐elle, qui a été rachetée, rénovée et habitée. Mon estomac se retourne. Je pense au film La zone d’intérêt. Quand je l’ai vu avec ma mère, elle m’a dit en sortant de la salle : “c’était vraiment comme ça, les Allemands savaient très bien ce qui se passait”. Je me demande si c’est pire d’habiter là après la guerre, en sachant ce qui s’est passé. Ou peut‐être que ces gens qui vivent là ne savent pas. Peut‐être qu’ils ne veulent pas savoir, peut‐être qu’ils n’ont pas cherché, peut‐être qu’ils n’en ont rien à faire.
Nous marchons dans les allées bordées de fleurs, sous un soleil radieux. On se croirait dans un parc normal d’une ville normale, si ce n’était pour les quelques pierres carrées qui longent la route et indiquent ce qui se trouvait là. Des personnes promènent leur chien ou font leur jogging. Il faut faire un effort pour voir ce qu’on ne voit pas, et ne pas voir ce qu’on voit. Soudain, une femme traverse notre groupe au pas de course en nous bousculant. Nous l’interpellons mais elle ne se retourne pas. Je suis certaine que son geste était intentionnel.
La guide nous mène à l’unique mémorial du camp. Il est situé à côté d’un grand trou, un fossé de forme ronde qui creuse l’herbe. Elle nous indique en passant qu’il s’agit d’une fosse commune. Pendant qu’elle parle du mémorial, je reste plantée là, à côté du trou. Il n’y a pas de plaque. Si elle ne nous l’avait pas dit, je ne saurais pas que des centaines de corps ont été jetés là, avant d’être déterrés à la hâte et brûlés par ceux qui ne voulaient laisser aucune trace de leurs crimes. Encore une fois, ce sentiment de disproportion. Est‐ce que ça peut être réel ? J’envie presque ceux qui préfèrent penser que tout ça n’est qu’une invention. C’est plus rassurant. Comment croire encore en quoi que ce soit lorsqu’on sait que nous, humains, sommes capables de choses pareilles ? Comment l’humanité peut se remettre de ça ? La guide nous explique que tous les arbres qui ont poussé dans l’ancien camp n’ont pas été plantés mais ont poussé de façon spontanée. Une personne du groupe me dit : « Imagine, et si c’était les âmes des morts qui ont ressurgi de terre ? »
Jour 3, nous partons tôt pour Łódź. Aujourd’hui, on repose un peu ses émotions, après le ghetto, la gare de déportation, le cimetière. Nous rions beaucoup, trop fort, pour un rien, certains racontent des blagues. Les Israéliens qui sont avec nous expliquent que, chez eux, ils ont l’habitude de faire des blagues sur la Shoah. Ce n’est que comme ça que c’est supportable. En même temps, est‐ce que ça doit être supportable ?
Jour 4, direction Varsovie. Ça se corse. La vieille ville de Varsovie a été complètement détruite après la guerre, puis reconstruite à l’identique. Si on ne sait pas, on croirait qu’il ne s’est rien passé ici. Il y a peu de plaques et d’explications. Comme si on voulait effacer la mémoire. La guide nous explique que l’architecte a construit la ville de façon un peu surélevée par rapport au niveau originel, pour symboliser les ruines et les cendres qui se trouvent en‐dessous. C’est beau. Mais qui connait cette information ?
Dans le cimetière, à la fin de la visite, nous nous arrêtons devant une statue de Janusz Korczak, déporté à Treblinka avec les 200 enfants de son orphelinat. Derrière, un mémorial : « En mémoire du million d’enfants juifs assassinés par les barbares allemands nazis ». Ça y est, les vannes s’ouvrent, je pleure à chaudes larmes. Tout ce qui est resté bloqué ces trois derniers jours est lâché. Un mémorial, c’est triste, ça fait pleurer. Devant un four crématoire – pas une reconstitution, un vrai –, il y a quelque chose qui est au‐delà des larmes. Une horreur trop grande pour être exprimée par des pleurs.
Treblinka, c’est encore autre chose. 900 000 morts. C’est un camp‐mémorial. Il ne reste plus rien de l’époque. Les rails sont symbolisés par des planches de bois, de grandes pierres évoquent les SS qui accueillaient les convois. Au centre, un grand monument, l’inscription « plus jamais ça » et, autour, une forêt de pierres de toutes les tailles, gravées des villes d’où provenaient les déportés. Nous nous réunissons en cercle pour lire quelques textes et réciter une prière, là encore les larmes coulent abondamment. Devant la maquette du camp, les Israéliens, comme d’habitude, font des blagues douteuses. Une amie nous dira qu’elle a voulu les engueuler, avant de se raviser parce que ce n’est qu’à moitié des blagues, et peut‐être la seule chose à dire à ce moment‐là.
Dernier jour du programme, la journée est réservée au musée Polin, un musée sur l’histoire des Juifs en Pologne du Moyen‐Âge à la fin du XXe siècle. Je passe plus de trois heures dans l’exposition permanente, puis la même chose dans l’exposition temporaire, consacrée à l’histoire des Juifs en Pologne après la Shoah. Ok, c’est bon, cette fois ça m’a achevée. En gros, alors que 90 % de la population juive du pays est décimée, des Polonais ont continué, tranquillement. Par exemple, en 1946, 42 Juifs ont été tués à Kielce, à la suite d’une accusation de crime rituel – rien n’a changé. Les différentes flambées antisémites ont provoqué plusieurs vagues d’émigration, dont près de 200.000 départs après la guerre. Après 1968, il reste 25.000 Juifs en Pologne sur les 3 millions d’avant 1939. Des bateaux remplis de survivants ont été refusés, des rescapés ont été parqués dans des camps de déplacés, avec des Allemands, sur des anciens sites nazis. Des orphelinats ont été attaqués par l’armée polonaise qui s’opposait pourtant aux nazis – ils ont ça en commun, la détestation des Juifs. C’est d’une tristesse infinie.
J’ai traversé l’exposition dans une espèce d’état de sidération. Ce n’était qu’une seule et même histoire qui se répétait. Pendant ce temps‐là, la même question, si simple, si naïve, tournait en boucle dans ma tête : pourquoi ? Comment ça a commencé ? Pourquoi, depuis la nuit des temps, c’est la même chose ? Pourquoi les Juifs sont‐ils aussi souvent haïs ? Et puis, une question qui, si je m’y attarde trop, risque de me faire sombrer dans une dépression sans retour : si on n’arrive pas à apprendre de quelque chose comme la Shoah, qu’est-ce qu’il faut pour que les choses changent ? Si même après ça, on continue, est‐ce que ça peut changer un jour ? Et comment dialoguer encore, aujourd’hui, avec des gens qui peut‐être auraient laissé faire ça ?

Le soir, on a passé le diner à se raconter des blagues juives. « C’est le grand rabbin d’Israël qui se rend au Vatican pour parler avec le Pape. Il lui demande s’il peut parler à Dieu. Le Pape lui passe son téléphone, le rabbin appelle Dieu et parle rapidement avec lui, juste une minute et il raccroche. Puis il demande au Pape combien il lui doit. “C’est 20 000 euros”, lui dit-il. C’est beaucoup mais bon, pour parler avec Dieu, ça vaut le coup. Alors le rabbin sort son chéquier et lui fait un chèque de 20 000 euros. Un peu plus tard, le Pape rend visite au rabbin en Israël. Il lui demande s’il peut parler à Dieu, le rabbin lui passe son téléphone et le Pape discute avec Dieu pendant une heure, il prend son temps. Puis il demande au rabbin combien il lui doit. Le rabbin réfléchit et finit par répondre : “c’est un euro !” “Mais non, dit le Pape, j’ai passé beaucoup de temps au téléphone, je peux payer.” “Non, c’est un euro”, répond le rabbin. “Je suis le Pape, je peux payer, répond le Pape ! Toi tu as passé une minute et tu as payé 20 000 euros.” Et le rabbin répond : “Oui, mais ici, c’est un appel local.” »
Le lendemain, la majorité du groupe est déjà partie, nous allons avec quelques personnes nous promener dans la ville et déjeuner une dernière fois dans un restaurant. Marcher jusqu’à l’épuisement pour que la douleur physique remplace la douleur psychique. J’ai hâte de partir d’ici, de ce lieu de mort et, en même temps, j’appréhende le retour à la vie réelle.
L’avion atterrit en France dans une grosse secousse. Je me rends tout de suite chez mon amie, qui a gardé mes chats, nous passons le reste de la soirée à boire de la vodka en fumant des clopes polonaises. Je me sens dissociée, partagée, distraite. À côté de la plaque et de mes pompes. J’ai envie de rire et de pleurer, de parler et de me taire, de parler de choses très sérieuses et de choses très triviales, d’être entourée et d’être seule. J’ai envie d’oublier, et de ne penser qu’à ça. Je veux reprendre ma vie et, en même temps, comment reprendre ?
Le jour de mon départ en Pologne, avant de prendre l’avion, je me suis rendue compte que j’avais perdu le pendentif en forme de haï חי accroché à mon bracelet. Le mot haï, en hébreu, signifie la vie. Le jour de mon retour, en enlevant mes chaussures chez moi, je l’ai retrouvé là, par terre. Je n’aurais pas pu rêver d’un symbole plus clair : la vie m’a abandonnée juste avant de partir dans ce terre‐cimetière, et je l’ai retrouvée en revenant.
Pour aller plus loin : lire le portrait de Diane Richard, une alliée éprise de justice