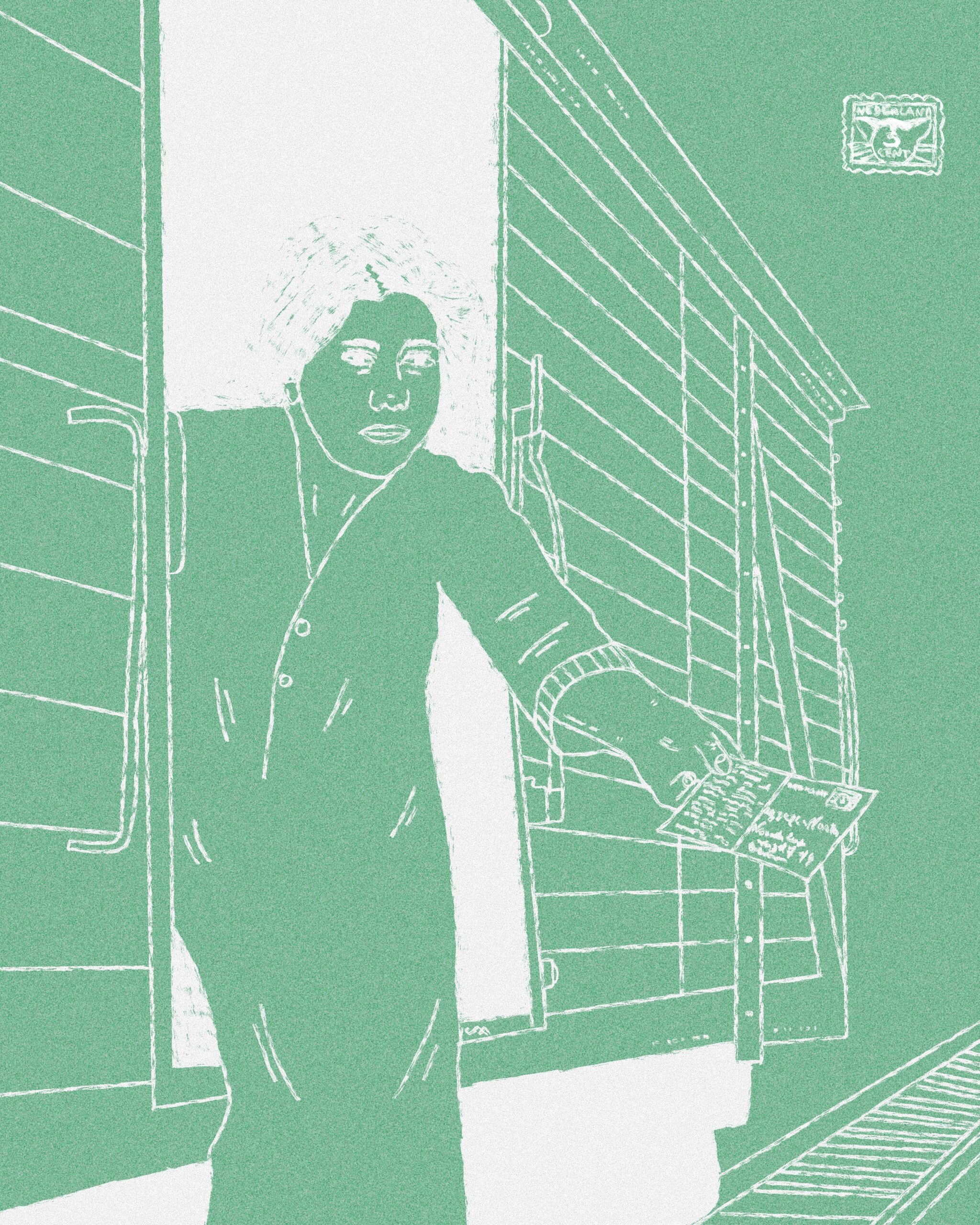Pourriez-vous nous raconter votre jeunesse au Liban et nous décrire l'environnement dans lequel vous avez grandi ?
Je suis né en 1965, à Beyrouth. Dans cette ville, la communauté juive résidait historiquement à Wadi Abou Djmil, son quartier traditionnel (en raison de la présence de la grande synagogue), situé en zone musulmane.
Mes années scolaires se sont déroulées dans une école jésuite, réputée pour sa rigueur et son excellence. La composition de cet établissement était particulière : 95% des élèves étaient chrétiens, mais avec une grande diversité. Une anecdote illustre cette mosaïque religieuse : une fois par an, notre professeur exigeait de chaque élève qu’il décline sa religion. Cela commençait par les Maronites, puis les Grecs catholiques, les Grecs orthodoxes, les Melkites, les Nestoriens, suivis des Musulmans sunnites, des Musulmans chiites et des Druzes. Le professeur reprenait sa liste, omettant de nous appeler, mon frère jumeau et moi. Il passait même à des religions plus rares comme les Zoroastriens ou les Yézidis, mais jamais les Juifs. Finalement, il nous demandait : « Mais alors, vous êtes quoi ? », et nous répondions : « Nous sommes Juifs. » Il s’exclamait alors : « Ah, mais oui, j'avais oublié ».
Nous étions de très bons élèves, et dans ces écoles fondées sur la méritocratie, les bonnes notes ouvraient les portes de la considération, nous épargnant des soucis particuliers avec les autres élèves en raison de la religion. En dehors de l’école, dans mon quartier, mes amis étaient majoritairement musulmans. Ils m’invitaient chez eux, me présentant à leurs frères et sœurs. Toutefois, ces invitations me valaient souvent d’être perçu comme un « extraterrestre » : les gens étaient stupéfaits de rencontrer un Juif au Liban – ils ignoraient notre présence. Je me souviens qu’un ami musulman m’a un jour demandé d’apporter une kippa pour qu’il puisse la voir. Après avoir invité tous ses copains, l’un d’eux a eu l’idée de la prendre et de se promener avec dans la rue. Immédiatement, tous les autres se sont rués sur lui, lui disant : « Attention, si tu sors avec, tu feras 10 mètres et tu te feras abattre. »
Pourriez-vous nous éclairer sur les origines de votre famille et son enracinement au Liban ?
Mon père est né à Damas, en Syrie, issu d’une lignée syrienne établie de longue date. Ma mère, quant à elle, a vu le jour à Beyrouth. Ma grand‐mère maternelle est née à Héliopolis, en Égypte, tandis que mon grand‐père maternel est un Juif libanais.
Mon père, après ses études de médecine à Paris, n’est pas retourné en Syrie. Les Juifs y étaient alors sous surveillance étroite, limités à un périmètre de 50 kilomètres autour de Damas. Il s’est alors installé au Liban. Il n’était pas isolé dans cette démarche puisqu’au moins 10.000 Juifs syriens s’étaient aussi installés à Beyrouth.
En ce qui concerne ma nationalité, c’était une affaire particulièrement complexe. Au Liban, la nationalité ne se transmet que par le père. Mon père étant syrien, j’aurais dû hériter de cette nationalité. Mais ayant quitté la Syrie, il était de facto apatride, et moi aussi. Ma mère, elle, possédait un passeport libanais. Au Liban, sur la carte d’identité, la religion était obligatoirement précisée. Étonnamment, il était écrit « Israélien » et non « Juif ».
Pour contourner mon apatridie, j’ai eu accès à un passeport mexicain, puis un panaméen. Il y a eu un tournant majeur à l’époque du Shah d’Iran : son premier ministre proposa un passeport iranien avec état civil à tous les Juifs apatrides d’origine syrienne résidant au Liban. C’est ainsi qu’à l’âge de dix ans, je devins Iranien, sans jamais avoir foulé le sol iranien. D’ailleurs, personne parmi les quelque 4.000 à 5.000 personnes ayant réclamé ce passeport ne parlait persan. Ce fut un formidable passeport sous le Shah, permettant de voyager en Europe et même aux États‐Unis sans visa. Malheureusement, cette période fut de courte durée. L’arrivée de Khomeini au pouvoir en 1979 transforma le passeport iranien en le pire des documents de voyage.

La guerre civile éclate en 1975 au Liban. Quel était la situation de la communauté juive face à ce chaos ?
La guerre civile était d’une violence inouïe. Les affrontements se déroulaient parfois de balcon à balcon, les habitants s’armant directement sur des marchés ouverts, où l’on pouvait acquérir des armes de guerre, voire même un char, si l’on en avait les moyens, pour viser l’immeuble d’en face. Au fil du conflit, des lignes de démarcation se sont établies, séparant les différents clans : les Chrétiens d’un côté, les Musulmans et les Palestiniens de l’autre. Dans ce paysage fragmenté, les Juifs occupaient une position unique : ils étaient les seuls autorisés à franchir ces lignes, car ils n’étaient affiliés à aucun camp.
Cette neutralité forcée s’accompagnait d’une situation politique délicate, comme l’illustre l’expérience vécue par mon père, le Dr Elie Hallak, alors vice‐président de la communauté juive. Je me souviens de son récit concernant une interview surréaliste pour un journal libanais. Le journaliste avait déjà formulé non seulement ses questions, mais aussi les réponses attendues. Le message à faire passer était limpide : les Juifs n’avaient aucun besoin d’Israël. La seule question réelle qu’on lui posa fut : « Avez-vous peur ? », à laquelle il devait, bien sûr, répondre par la négative. Le lendemain, le journal affichait en titre un message que mon père n’avait jamais prononcé : « Les Juifs libanais n'ont pas besoin d’Israël. »
Pourriez-vous nous raconter les événements qui vous ont conduit, vous et votre famille, à quitter définitivement le Liban?
La guerre civile a bouleversé nos vies. À un certain moment, il était devenu impossible d’aller à l’école, tout était à l’arrêt. Les trois premières années furent d’une atrocité inouïe, avec des jours où l’on dénombrait jusqu’à 500 morts. Pendant cette période incertaine, mon père, dont les sœurs vivaient en Israël, nous y a emmenés pour quelques mois. Cependant, sa vocation de pédiatre et son rôle de directeur d’un grand hôpital le ramenaient inlassablement au Liban. Nous sommes donc revenus aussi.
Mon premier départ définitif pour la France, en 1978, a eu lieu dans un contexte d’incertitude. Je suis parti sans mon père, avec ma mère et mes frères. Nous avons vécu à Paris, dans le 15e arrondissement. À cette époque, trouver un appartement à Paris était simple si l’on pouvait payer le loyer, bien loin des difficultés actuelles.
Des événements plus tragiques ont malheureusement scellé notre destin. En 1985, le Hezbollah a ciblé les Juifs du quartier musulman, enlevant les hommes de 15 ans et plus. Mon père fut parmi eux. Ils tuaient un otage chaque semaine. La plupart des corps ne furent jamais rendus. Mon père était un médecin très apprécié, soignant gratuitement les plus démunis. Il y eut même une manifestation d’une centaine de Musulmans chiites réclamant leur « médecin juif », mais sans succès.
Ma mère, pour tenter de le libérer, est allée au Liban. Ses voisines l’ont aidée à rencontrer le Grand imam, mais la réponse était invariablement la même : « C'est politique, ça vient d'Iran, la balle n'est pas dans notre camp ». Comprenant que le Hezbollah n’était qu’un exécutant, elle s’est rendue à l’ambassade d’Iran à Beyrouth. Elle y fut jetée dans un cachot pendant cinq heures, puis libérée sans plus de résultat. Elle est revenue en France et, environ deux semaines après son retour, l’exécution de mon père fut annoncée en 1986, après un an de détention.
Nous avons également tout perdu matériellement. Je n’ai aucune photo de mon enfance au Liban ; tout est resté à Beyrouth. L’appartement familial fut immédiatement occupé par une famille du Hezbollah. Mon père n’a pas eu de sépulture et, dans notre religion, l’absence de sépulture signifie l’absence de mémoire. Il n’a même pas son nom sur un « mur », à l’image de ce qui a été fait pour les victimes de la Shoah.

Aujourd'hui, quels liens gardez-vous avec le Liban ?
Malgré mon départ définitif en 1978, j’ai continué de passer mes étés au Liban jusqu’à l’âge de mes 18 ans. Cependant, cette connexion s’est brisée brutalement après le décès de mon père en 1986. J’ai pris la décision irrévocable de tourner le dos au pays dans sa totalité. L’absence de toute condamnation ou même d’un simple commentaire de la part de la classe politique libanaise, après la mort de mon père et celle de tant d’autres Juifs, a engendré en moi un rejet profond. Pour moi, c’était fini, et je n’ai jamais eu le désir de retourner au Liban.
Au‐delà de ce rejet, cette tragédie a profondément ancré en moi une conviction inébranlable : l’importance de contrer les discours racistes et toute forme de xénophobie. Mon père ayant été tué pour des raisons antisémites et xénophobes, cette cause me tient particulièrement à cœur. Je ne supporte aucune forme de racisme ; c’est quelque chose qui me révolte profondément.
Aujourd’hui, mon engagement se manifeste au sein de l’Observatoire des Juifs réfugiés des pays arabes, une association que j’ai découverte par l’intermédiaire de mon épouse. Présidée par David Dahan, cette organisation représente pour moi un moyen essentiel de demander justice pour toutes les communautés juives contraintes de fuir les pays arabes. C’est ma manière de contribuer et de donner un sens à l’Histoire et aux pertes que nous avons subies.
Propos recueillis par Paloma Auzéau
Dates à retenir
- 1948 : la communauté juive du Liban compte environ 20.000 personnes.
- 1958 : première guerre civile libanaise, qui provoque une vague d’émigration parmi les Juifs.
- 13 avril 1975 : début de la grande guerre civile libanaise, un conflit dévastateur qui a profondément affecté toutes les communautés et a marqué le début du déclin rapide de la présence juive.
- 6 juin 1982 : début de l’Opération « Paix en Galilée », une intervention militaire majeure d’Israël dans la guerre civile libanaise.
- 13 octobre 1990 : fin officielle de la guerre civile libanaise, après 15 ans de conflit.