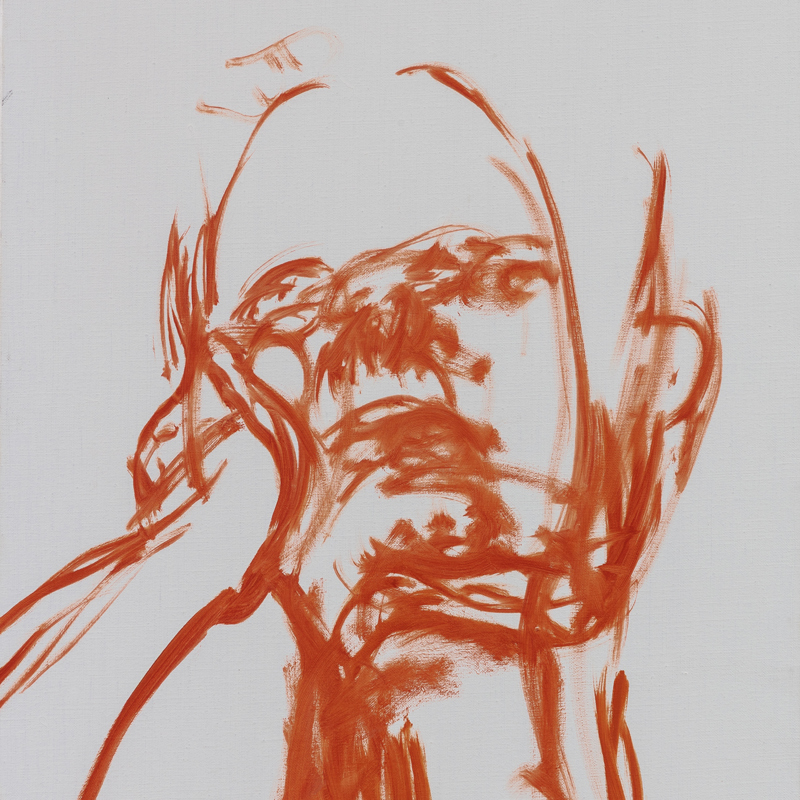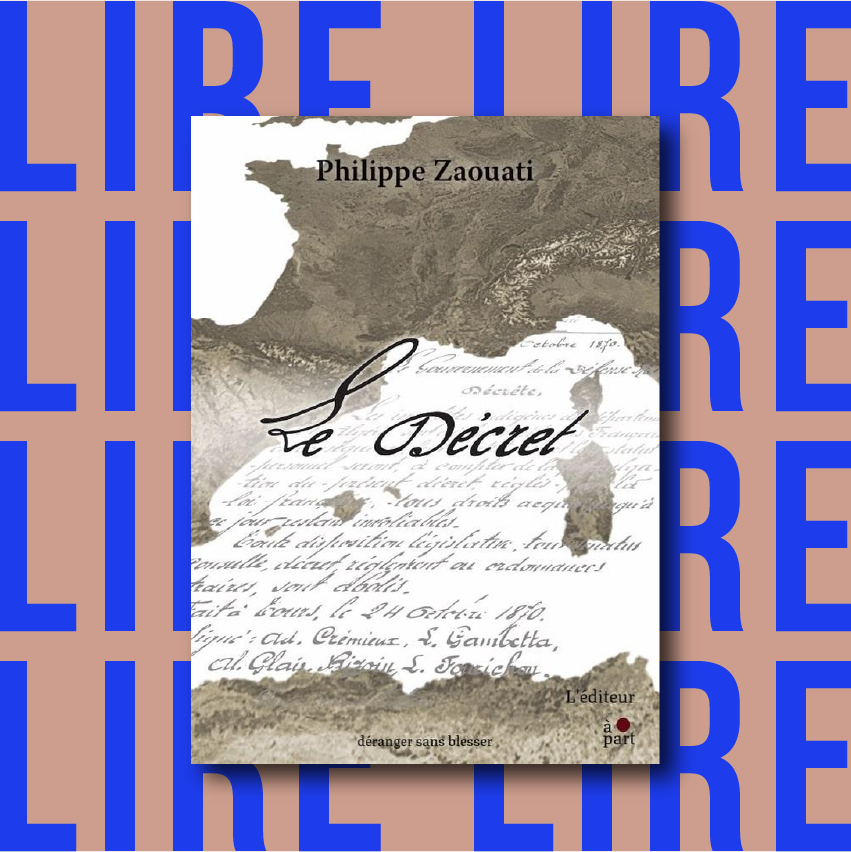Il est là. Même avant que la pièce ne débute. Assis sur un fauteuil, Éric Feldman joue déjà, il réarrange des carnets soigneusement posés sur une table basse, jette un œil au public qui s’installe sans silence. Ne se laisse pas déstabiliser par ceux qui le dévisagent ou le saluent d’un regard complice. “Je donne l’impression que j’accueille les spectateurs dans mon salon, d’ailleurs, le fauteuil sur lequel je suis assis vient de chez moi, tout comme le reste du décor. J’essaie de créer les conditions pour que l’on passe un bon moment ensemble”, nous confie‐t‐il. Même si le sujet de la pièce ne s’y prête pas – au premier abord.
Au départ, il avait en tête de créer un spectacle de stand‐up et, assez rapidement, il s’est rendu compte que cette forme – qui oblige à rechercher la blague (et à rester debout) – n’était pas forcément adaptée à l’histoire qu’il allait raconter. “Je savais que j’allais parler de moi et, au cours d’improvisations, le sujet du traumatisme familial s’est imposé. Sans grande surprise, puisque c’est un sujet qui me constitue, je m’y suis largement frotté avec la psychanalyse.”
La pièce commence, Éric Feldman se met à parler. Il parle comme s’il n’allait jamais cesser, bataille avec les termes employés, propose plusieurs options “écrivain, écrivaine, une femme qui écrivait”, décline un éventail de prononciations. Comme pour insister encore davantage sur la pesanteur du langage, le fracassant des malentendus. C’est vrai ça, on peut effacer l’histoire (juive) d’un patronyme selon la prononciation que l’on choisit : Singer ou Singer comme la machine à coudre.
Sans attendre l’essoufflement, le comédien reprend sa respiration et nous incite à pratiquer un exercice de yoga ou de sophrologie : on ferme les yeux, on inspire le positif et on expire le négatif. La salle s’exécute (on s’étonne de sa docilité) jusqu’à ce que le lapsus surgisse et l’amène à inspirer le négatif… et à aborder le SUJET (le pourquoi nous sommes réunis ce soir) de façon plus frontale.
Après une nuit d’amour, sa partenaire lui pose une question simple : à quoi tu penses ? “Et je lui réponds spontanément à Hitler. Comment ai-je pu penser à Hitler, celui dont le nom est mangé à toutes les sauces ?” D’après les amis d’Éric Feldman et lui‐même, le personnage sur scène est très largement inspiré de sa gestuelle, de ses réflexes, de son ton drolatique. Traduction : cette situation lui est véritablement arrivée. “C’est quand même beaucoup de moi, même si j’exagère mes névroses, le clownesque de la situation”, ajoute‐t‐il.
Sur scène, il décide de mener l’enquête : comment en est‐il arrivé à penser à Hitler, à atteindre le point Godwin de bon matin et après une nuit d’ébats ? Notre personnage ne semble pas capable de répondre à cette question sans digression et mise en abyme de la digression. Après un passage par les écrits d’Isaac Bashevis Singer, prix Nobel de littérature, les dix commandements , nous découvrons mi‐effarée, mi‐amusée, les notes du docteur Bloch, le médecin de la “maman d’Hitler” : “À sa mort [de Klara Hitler], jamais je n'ai vu quiconque aussi terrassé par le chagrin qu'Adolf… Hitler”. Comment interpréter ce témoignage ? Qu’il aurait mieux fait de rencontrer Freud avant de…
Peu nous importe, l’enquête se poursuit avec la même spontanéité, sans paraître pour autant décousue. Désormais, il est question de son père, notre narrateur s’approche d’une possible résolution, il “chauffe”. Enfant, son père a survécu – par miracle – aux rafles et déportations : la police surgit chez lui, il se cache et “se retient de bouger, quasiment même de respirer”. Faire le mort pour continuer à vivre. C’est une phrase (ou une stratégie) qui nous habite encore. Il y a quelque chose d’autre qui nous secoue : la généalogie familiale qui s’interrompt, il ne reste plus qu’un tronc, pas de bourgeons. En raison des disparus. Mais aussi de ceux qui ne sont pas nés. Ses oncles et sa tante n’ont pas donné naissance à une descendance sûrement “parce que leurs ‘parents’ entre guillemets ont été assassinés avant de pouvoir devenir leurs parents”. Le narrateur non plus n’a pas souhaité devenir père. Pour ne pas prendre le risque de perdre ses enfants. Pas d’enfant, pas d’enfant raflé.
La Shoah continue d’abîmer, même après deux décennies de psychanalyse et une pratique assidue du yoga. Elle ne s’arrête pas en 1945 au moment de la libération des camps, elle déploie ses tentacules dans nos cauchemars (et ceux de nos descendants), lorsque nous sommes poursuivis par des “méchants”. Dans nos choix de vie, lorsque le suicide se révèle plus salvateur que la perpétuation d’une existence troublée. Dans nos pensées, lorsque Hitler s’insinue dans nos souvenirs d’enfance (et nos vies amoureuses). Lorsqu’après la guerre, Gérard Blitz, un Juif belge entré en résistance, donne vie au Club Med, des vacances pensées comme un contre‐camp. Là où tout est permis. “Dans le camp, on mourait de faim, dans le contre-camp, on pourra manger à volonté, sans limites. Dans le camp régnait la haine, le contre-camp sera un lieu de rencontres et d'amour. Les GO, les Gentils Organisateurs, remplaceront les kapos ! Dans le camp le mot ‘loisir’ n'avait aucun sens, dans le contre-camp le loisir sera roi.”
Informations pratiques :
Réservations du 9 au 17 mars 2026 aux Bouffes Parisiens