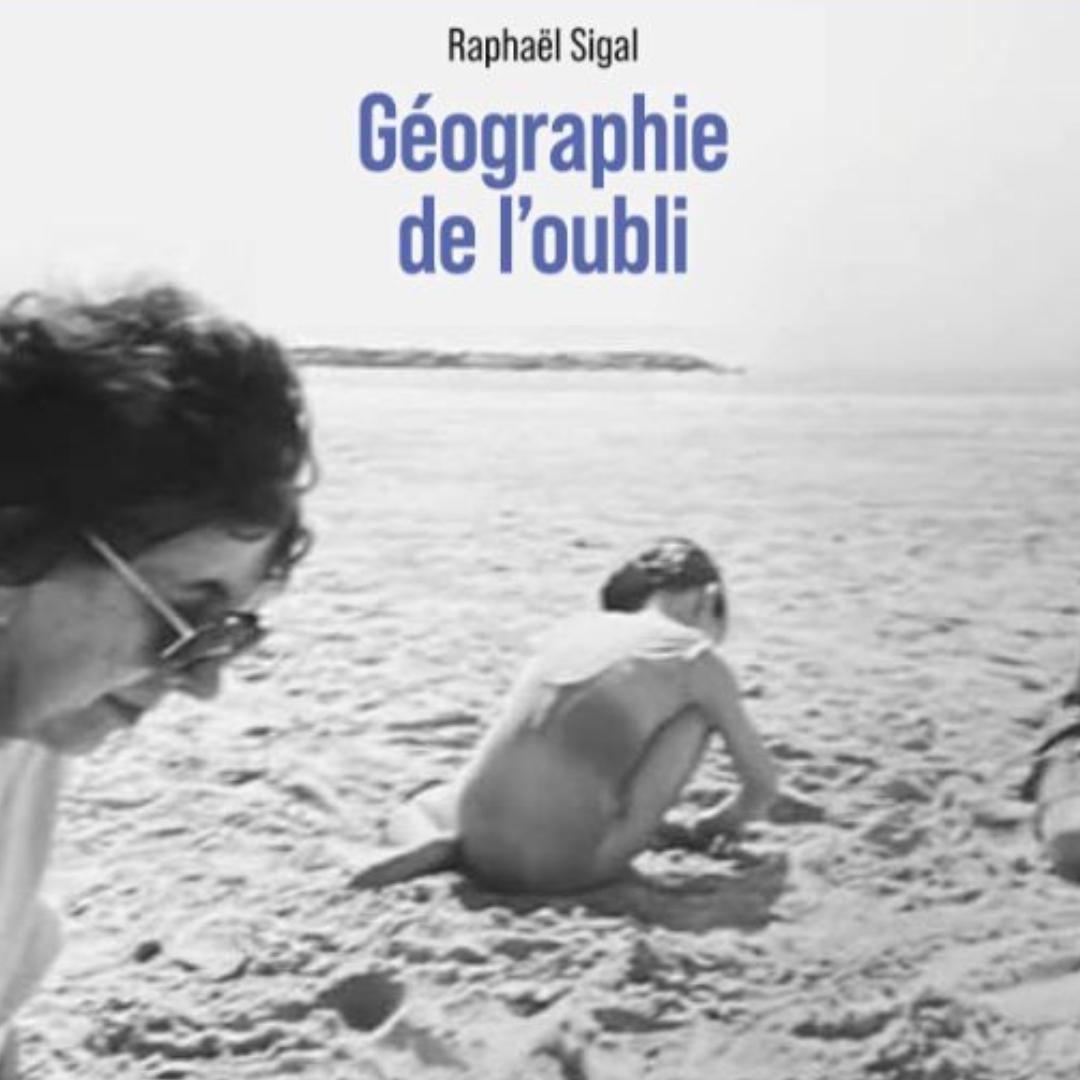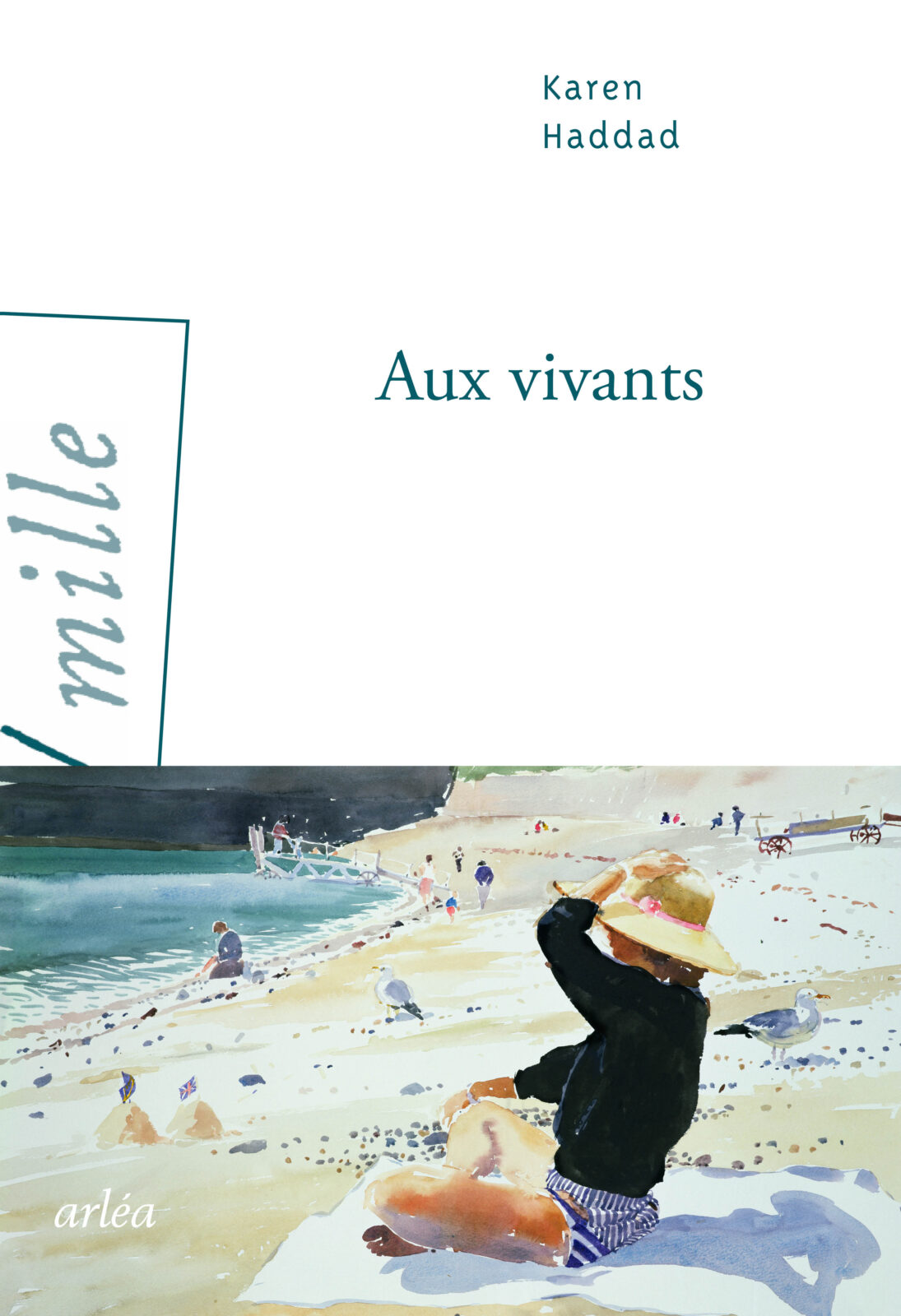
Il y a des livres que l’on ouvre avec pudeur, comme les buffets ou les armoires de famille dans lesquels on craint de trouver ce qui ne nous regarde pas.
Aux vivants déroule cette histoire‐là : celle de l’effacement des aînés, qui ne parlent guère pour ne pas gêner l’élan de la jeunesse ni le déploiement d’une liberté qui n’est pas la leur. Ce subtil roman raconte Mathilde, qui n’est pas encore dotée de parole quand ses parents quittent la Tunisie, et plus précisément Tibera, pour Paris. L’indépendance des pays du Maghreb contraignit les Juifs à quitter ces terres nord‐africaines qui les auront vus naître, dans une atmosphère à la fois lourde d’embarras, de non‐dits, et de menaces à peine voilées : tant bien que mal, parfois discrètement, parfois avec fracas, environ 100.000 Juifs se virent contraints de quitter la Tunisie entre 1956 et les années quatre‐vingt dix.
Dans ce Paris qu’elle n’a pas encore arpenté, les pleurs nocturnes inexpliqués – déchirants, réguliers, implacables – de l’enfant qu’elle était, s’expliquaient-ils par une routine brisée ? Ou plutôt par le refus précoce d’une décision qui n’était pas la sienne ? L’instinct de la petite Mathilde abrite dans sa mémoire le cri qu’on n’ose pousser, celui du départ sans retour, de « la peur ancienne [qui] n’avait pas disparu, celle de ne plus avoir de lieu, ni de terre, ni de maison » – la peur de l’apatride. Adulte, elle repasse dans son esprit ces histoires qu’on racontait et dont on riait, ces histoires de famille qu’on entend immanquablement avec quelques légères variations et qu’on souhaite secrètement voir attestées au fil du temps. Mathilde grandit dans le 18e arrondissement de Paris, qu’elle parcourt à grands pas fermes tout au long de sa vie. Georges et Nina, qui sont devenus pour elle Georges-et-Nina, voulaient qu’elle connaisse Paris, alors qu’elle ignorait tout de sa ville natale, Tibera.
On la voit évoluer à différentes périodes de sa vie, et notamment à des moments fondateurs de rencontres et de ruptures. Son entrée dans l’âge adulte se doit d’être glorieux : elle choisira de franchir cette étape en compagnie de Laurent et d’Adrienne. Ensemble, ils forment le trio qui doit l’affranchir de Georges‐et‐Nina, dont le quotidien ordinaire achève de l’irriter. Avec l’assurance de la jeunesse, elle se laisse happer par un milieu, la grande bourgeoisie française, comme on peut l’être à l’adolescence de manière obsessive, exigeante et exclusive. Le reste n’existe plus, puisque la grande culture, la passion de la lecture, la fréquentation des salles de cinéma, les conversations dans les cafés, la musique classique qu’elle découvre, se trouvent de « l’autre côté » – qui n’est pas sans faire penser à celui des Guermantes.
Laurent et Adrienne sont en couple, et l’invitent en Bourgogne. Leurs voix amplifient l’écho de toutes celles que leur culture charrie, celles de ces contrées françaises dont Mathilde écoute prononcer le nom avec délectation : Thoiry‐le‐Désert, Ormancey, Missery, Gissey‐le‐Vieil, le lac des Settons… Leur poésie tisse le fil de sa nouvelle vie, qu’elle habite sans qu’elle soit entièrement la sienne. Puis à nouveau, et comme malgré elle, Mathilde s’éloigne et s’émancipe. Elle revient vers Laurent devenu le spectre d’un trio disparu mais aussi le père de ses enfants, qui jamais n’a cru bon de faire d’elle l’étrangère qu’elle était avant leur première rencontre. Bien plus tard, elle rencontre Paul, d’une toute autre génération, celle de la jeunesse actuelle qui ne supporte pas le silence des pères et qui exige des dates, des sources, des témoignages, voire, un pèlerinage symbolique : n’a‑t-elle jamais voulu retourner à Tibera ? Il ne comprend pas « cet oubli des origines dont elle lui avait dit un jour en riant qu’il devrait en faire le sujet de son livre ».
Par de subtils allers‐retours mémoriels, Karen Haddad navigue dans la mémoire collective des Juifs tunisiens où, déjà dans les années cinquante, Israël était ce nom honni – l’innommable en public, une destination illégale depuis la Tunisie. Où déjà, après le départ contraint pour la France, tout est évalué à l’aune du pays perdu, Tibera. Tibera n’est pas la Tunisie : elle est à elle seule un microcosme, autrement dit l’univers totalisant d’une des multiples communautés juives tunisiennes d’antan, un lieu qui occupe l’espace mental de Mathilde et l’embarrasse, pressée qu’elle est d’exister loin des siens, qui semblent avoir renoncé à la vie qu’elle, désire et mène avec éclat ; « la vie de château », plaisantera son père. Le temps passant, Mathilde prendra toute la mesure du reniement qui a été le sien, plus jeune. On apprendra aussi que son prénom est celui, francisé, de sa grand‐mère Messaouda.
En décrivant la manière dont les disparus survivent parmi les vivants et celle dont ces derniers se confrontent aux silences et aux énigmes des aînés, Karen Haddad déploie avec subtilité un précis de hantologie, terme forgé par Jacques Derrida. Elle écrit sur ce qu’on ignore. La finesse de la narration réside dans le strict respect d’une perception qui ne se fait pas d’illusion sur les pièges de la mémoire ni sur le fantasme de l’appartenance ou de l’authenticité. Le double ancrage temporel de la vie passée et présente de Mathilde permet un délicat recul ironique, clairvoyant et tendre tout à la fois.
Aux vivants est un roman sur la douleur de découvrir qu’il y a eu un sacrifice, le sacrifice d’une vie où l’on était plus ou moins à sa place, et qui devient une vie où on prend le moins de place possible.
C’est un roman sur les projections des autres quand on est étranger. Sur leur curiosité maladroite, leurs fantasmes d’authenticité.
Aux vivants est aussi un chant doué de riches modulations, toutes aussi paradoxalement douces qu’affirmatives.
Enfin, c’est une plongée dans les méandres d’un esprit hanté par un départ fondateur, perpétré par d’autres que soi, malgré eux, et craignant tout ce qui pourrait ressembler à un sentiment d’appartenance sûr de soi. Mathilde est à elle seule un départ qui n’en finit pas, et s’autorise, avec le temps, à habiter une frontière qui la fait se tenir aux bords – sans nostalgie – et chérir le moment du passage, de l’indéterminé, et d’une liberté toujours à venir.