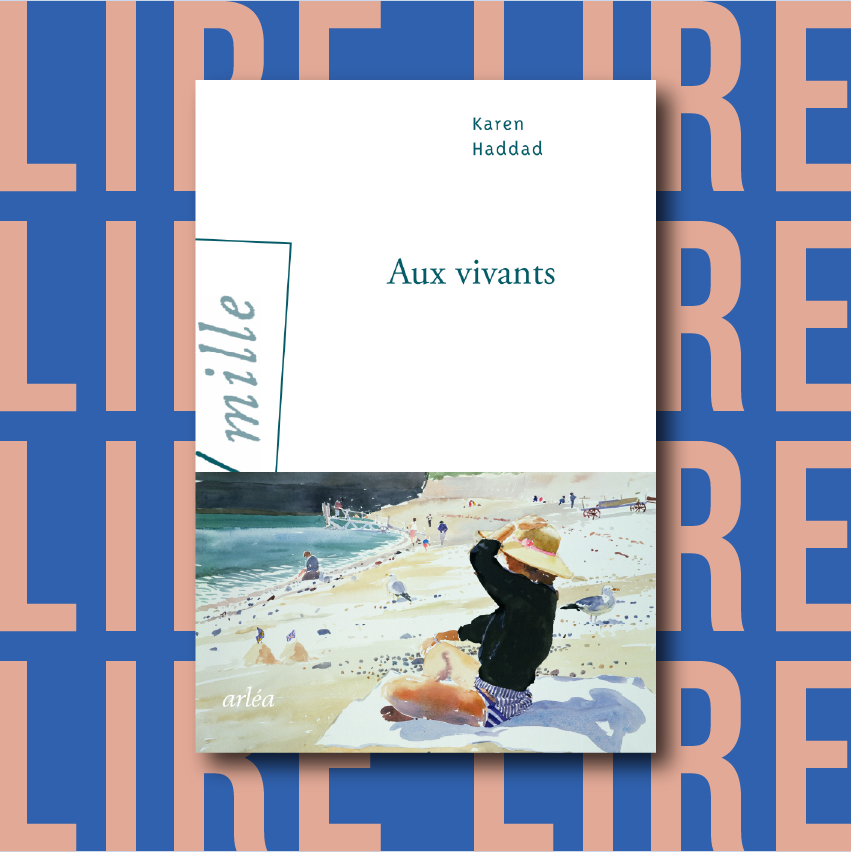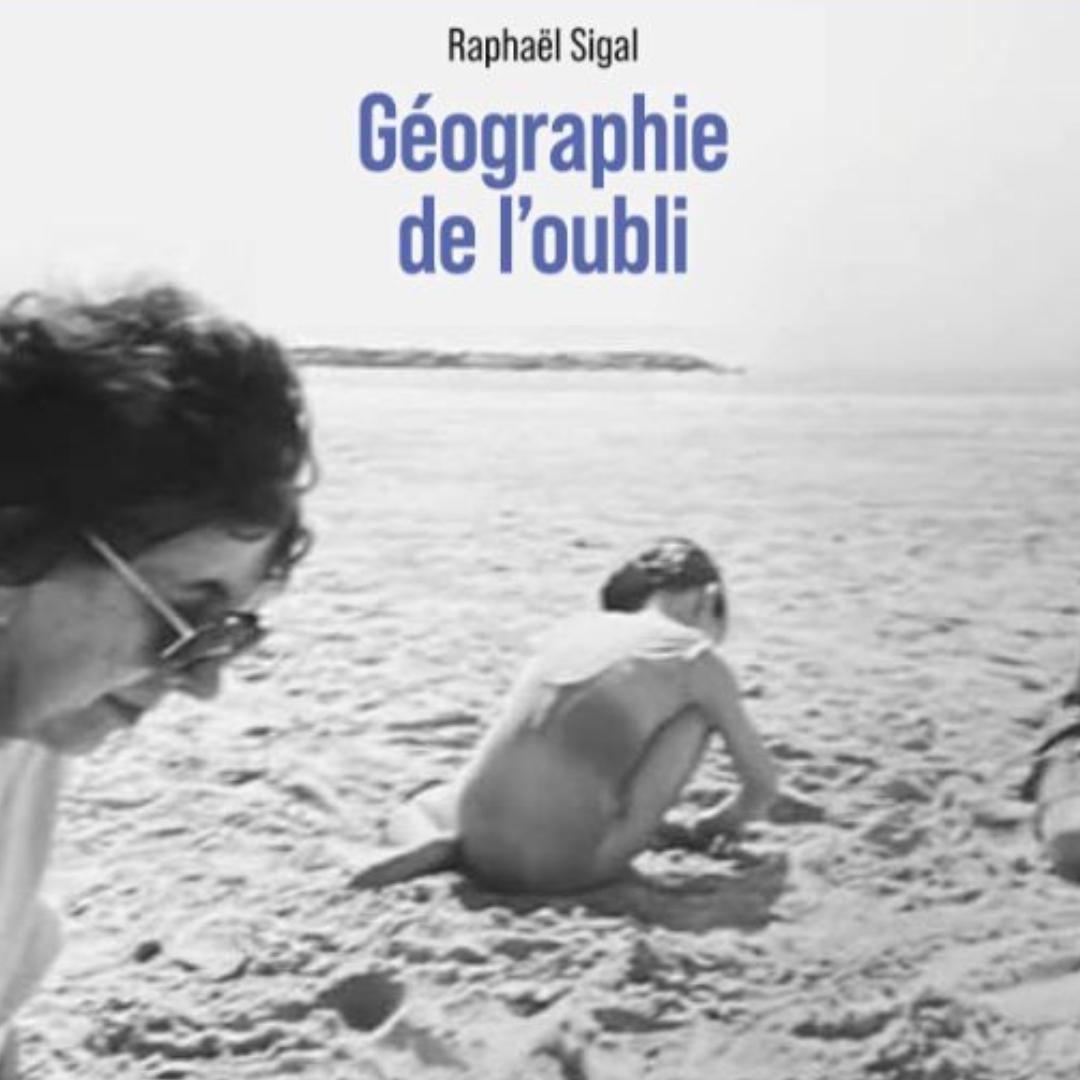Fanny Arama – Votre livre aborde la question des origines et de l’exil, même si elle n’est pas exactement posée dans ces termes. Il raconte l’histoire de Mathilde, arrivée à Paris encore infans – encore dénuée de parole articulée, vers un ou deux ans – de Tunisie, et qui, petit à petit, « oublie ses origines », leur « tourne le dos » puis y revient… Que vous inspire ce mot d’origine ?
Karen Haddad – Dans mon itinéraire personnel, qui n’est pas celui de Mathilde mais qui est le point qui s’en rapproche le plus, pour moi, cela a été longtemps synonyme de prison, d’enfermement. De quelque chose qu’il fallait commencer par éloigner. Et en cela, je pense que je suis proche de beaucoup de gens qui ont eu le même parcours. Il faut commencer par tourner le dos aux origines – non pas pour les rejeter, mais il faut en sortir pour y revenir. J’aurais plutôt une certaine méfiance à l’égard de ce terme et de son usage. J’assume le fait que ce livre se présente comme un « roman des origines », mais j’espère qu’il ne sera pas lu uniquement comme cela.
Mathilde commence par refuser d’être définie par ses origines. Elle comprendra au fur et à mesure ce que ce mot représentait.
FA – Il me semble qu’il s’agit d’un livre sur la liberté. Est-ce le cas ? Sur la manière dont on use de notre liberté pour s’affranchir de ce qui, a priori, est censé déterminer notre existence ?
KH – Exactement. J’aimerais qu’on le lise comme cela. On pourrait imaginer que Mathilde revienne à la religion, ou rencontre un « homme comme elle » qui la ramène à ses origines… Or, je voulais raconter comment on peut rester fidèle à ce que l’on a connu, aux valeurs dans lesquelles on a été élevé, tout en allant voir ailleurs.
C’est aussi un portrait de femme libre. C’est très important à la fois dans mon parcours personnel et pour les jeunes femmes d’aujourd’hui qui se sentent parfois contraintes de rester assignées à leurs origines, quelles qu’elles soient.
FA – Très rapidement, on voit Mathilde se débattre avec ses origines, notamment lorsqu'elle devient adulte, elle se rebelle, s’éloigne des siens pour « aimer et être aimée ailleurs ». Pourquoi la rencontre amoureuse semble-t-elle être l’occasion d’un retour sur soi et sur ses origines ?
KH – J’ai essayé de trouver un lien entre les deux fils narratifs : celui de la mémoire et du passé et celui de l’amour pouvant être une voie vers l’émancipation.
La rencontre est l’occasion d’un retour sur soi parce que, quand on rencontre quelqu’un, on a tendance à lui raconter qui on est.
Il y a deux personnages masculins dans le roman : Laurent et Paul. Paul n’est pas de la même génération que Mathilde, il est plus jeune. Je voulais, avec ce personnage, montrer un changement de regard, d’état d’esprit et de génération. Je viens d’une génération où l’on essayait d’effacer ses particularités. On ne se demandait pas « d’où tu viens ? ». Aujourd’hui, pour le meilleur ou pour le pire, c’est le genre de question qu’on pose lors d’une rencontre. La rencontre avec Paul va faire s’interroger Mathilde sur ce qu’elle avait mis de côté. La liberté de Mathilde, d’aller et de venir, j’ai voulu qu’elle soit incarnée aussi par d’autres personnages. Ce n’est pas la liberté de Mathilde, c’est la liberté de toutes celles et de tous ceux qui veulent sortir de leurs milieux culturels.
FA – Il m’a semblé qu’Adrienne et Laurent étaient un peu les Saint-Loup de votre roman. Dans La Recherche du temps perdu de Marcel Proust mais également dans son œuvre posthume et inachevée Jean Santeuil, la question des origines juives et de la volonté d’assimilation à la « francité » se pose également. Quelle place l’œuvre de Marcel Proust tient-elle dans votre vie ?
KH – C’est un auteur préféré entre tous. J’ai fait une thèse de littérature comparée qui porte en partie sur lui (voir L’illusion qui nous frappe. Proust et Dostoïevski, une esthétique romanesque comparée, Paris, Champion, 1995). J’ai mis très longtemps à percevoir le côté juif dont on parle beaucoup aujourd’hui (voir par exemple Antoine Compagnon, Proust du côté juif, Gallimard, 2022), et à comprendre ce que Proust dit – qui est parfois à la limite de la flagornerie, voir la façon dont il s’adresse à Barrès dans ses lettres par exemple, sur cet amour de la francité.
Les personnages d’Adrienne et Laurent représentent en effet une certaine forme de « francité » (même si Laurent est aussi le beau Lorenzo), quelque chose qui peut paraître inaccessible à Mathilde. Cela veut dire aussi une certaine éducation : la courtoisie et l’hospitalité de Laurent, cette élégance qui consiste à ne pas remarquer les différences, les choses « gênantes », ce qui est un signe de très bonne éducation. Ils condensent certains modèles de ce milieu bourgeois, de gens qui ont une origine, des racines françaises et qui l’accueillent telle qu’elle est, sans se soucier du déchirement qu’elle peut éprouver.
FA – Les parents de Mathilde, Georges et Nina, appartiennent à cette génération ayant dû quitter la Tunisie, le Maroc ou l’Algérie dans les années soixante ; parleriez-vous d’arrachement ? Ou ce mot vous semble-t-il trop fort ?
KH – Ah non, il n’est pas du tout trop fort ! Je précise qu’il s’agit vraiment, ici, de souvenirs personnels dans l’élaboration de la fiction romanesque. Je revendique l’héritage de Claude Simon dans cette perspective, dans la mesure où il explique avoir puisé dans l’histoire de ses parents, si romanesque. Après avoir longtemps hésité, j’ai décidé de la reprendre pour leur rendre hommage. J’ai mis longtemps à le comprendre, mais c’est cela aussi, « s’arracher » à ses origines, et ressentir de l’intérieur cet autre arrachement qui a été le leur. En l’occurrence, pour des gens comme Georges et Nina – même si tout le monde n’a pas eu la même histoire –, c’est aussi l’histoire d’une expulsion. Beaucoup de Juifs sont partis du Maghreb plus ou moins de leur plein gré : parfois dans des conditions satisfaisantes, parfois dans des conditions très difficiles, et là aussi, c’est quelque chose dont on ne parlait pas jusque très récemment. Certains d’entre eux ont tout simplement été « mis dehors ». C’est cet arrachement‐là qui a été vécu par beaucoup de gens au XXe siècle. Derrière le folklore, la joie, il existe une souffrance qui a été passée sous silence.
FA – Comment expliquer la discrétion qui existe chez cette génération, qui envisage la perte du passé comme quelque chose qui doit se faire, comme s’ils avaient renoncé à résister ?
KH – Ils n’avaient pas le choix. C’est un état d’esprit dans lequel je me reconnais également. La discrétion, c’est peut‐être l’héritage de la persécution, de la mise à l’index. Il y a une forme de volonté d’effacement chez certains Juifs, même si je pense que cela se passait relativement bien en Tunisie. C’est un état d’esprit qui est celui de beaucoup d’immigrés en France et ailleurs : il faut commencer par s’intégrer avec cet arrachement. La question ne se posait pas à l’époque.
Le mot « exil » semble écrasant parce que je n’ai jamais entendu mes parents se dire exilés ou réfugiés. Alors que, dans les papiers de ma mère, j’ai trouvé le passeport de l’Ofpra (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides) et je me suis dit : mais moi aussi j’étais une réfugiée ! Ils avaient aussi un amour de la culture et de la vie à la française qui a fait qu’il n’y a pas eu de retour en arrière possible.
FA – Oui, vous l’évoquez en des termes très sensuels… Chez Nina cela se traduit par des allergies implacables à l’air de la campagne ; elle a cette incapacité à vivre là où la mer n’est pas ! Mais Paris semble avoir un statut différent…
KH – Oui, j’ai voulu qu’on sente dans ce livre un amour de Paris qui est une ville où on peut se sentir tout de suite accepté. Paris est un lieu où on ne vous demande pas forcément de rendre compte de vos origines.
FA – Que pouvez-vous nous dire des nouvelles générations qui ont un rapport à l’appartenance et aux origines qui n’est pas du tout celui de vos personnages ?
KH – C’est la génération de mes enfants et de mes étudiants. Ma fille, par exemple, a réalisé un documentaire sur ses origines et leurs traces. Cela m’a interpellée et m’a interrogée sur ce que j’ai transmis et sur la manière dont je l’ai transmis.
Depuis quelques années, on met en avant le droit à la différence – ce qui est légitime et normal – mais cela peut mener à essentialiser les gens en fonction de leur spécificité. Alors certes, comment l’oublier quand vous avez une peau, des cheveux, une voix qui révèlent que vous venez d’ailleurs, que vous n’êtes pas « Français de souche » ? Mais, d’un autre côté, je pense qu’essentialiser la différence est très dangereux. Aujourd’hui il existe une véritable crispation autour de l’identité, qui fait qu’il n’y a plus de commun.
Il me semble normal que les jeunes générations aient voulu rendre hommage aux parents et aux grands‐parents qui ont été arrachés à leurs foyers ou qui sont venus de leur plein gré (je pense aux travailleurs africains et nord‐africains) parce qu’ils n’avaient pas, eux, les mots pour le faire au moment où ils sont venus. Mais c’est aussi une façon de considérer que la notion d’universel ou de nation n’est plus valide. Appartenir, ce sont aussi des injonctions, des règles, un certain repli, une méconnaissance de l’autre… Je pense qu’il ne faut pas idéaliser l’appartenance.
La rencontre amoureuse, c’est aussi une façon pour Mathilde de se rappeler qu’elle a cherché la liberté.
FA – Dans votre récit, quand Paul lui pose des questions sur ses origines, Mathilde lui répond toujours en riant, de manière légère, désinvolte… Que révèle ce rire ?
KH – C’est une forme de distance et de défense. C’est d’une part, il me semble, une distance à soi‐même, par rapport à sa propre histoire. Il y a une façon cocasse, pittoresque, de raconter une histoire qui peut être très lourde. Beaucoup d’exilés peuvent s’y reconnaître.
D’autre part, le milieu que je raconte est chaleureux et joyeux ; ce sont des gens qui ont connu des épreuves terribles, pourtant je les vois toujours en train de rire et de plaisanter, et surtout, de se réjouir d’être ensemble. D’ailleurs, on parlait de Proust tout à l’heure, très humblement, j’ai essayé de faire avec Tibera ce qu’il fait avec Combray, c’est-à-dire un point de repère, une boussole, même si Mathilde s’en est détachée. L’expression « comme on disait à Tibera » ou « dans la langue de Tibera » revient souvent, pour apporter un peu d’humour. Car comme à Combray, « quelqu’un qu’on ne connaît pas » était impensable à Tibera. Et donc j’ai cherché un effet de contraste comique puisque précisément, les gens de Tibera sont jetés hors de leur monde.
FA – Quand la famille de Mathilde est encore à Tibera en Tunisie, son père Georges se rend dans un kibboutz en Israël, Shanim et, déjà à l’époque – on imagine donc dans les années cinquante-soixante – Israël était ce mot honni, « innommable » en public. Que pouvez-vous nous dire du rapport des Juifs d’Afrique du Nord, en l’occurrence, des Juifs tunisiens à Israël ?
KH – Oui, il n’y a pas le nom « Israël » dans mon livre, c’est un choix que j’ai fait pour rendre compte de cet interdit. C’était littéralement interdit de le mentionner, d’y aller encore plus. C’était vraiment le pays interdit. Il me semble que cela vaut aussi pour aujourd’hui, à cause de la terrible situation actuelle : c’est le pays dont on ne peut dire le nom sereinement, au sens où les Juifs de France et d’ailleurs, même lorsqu’ils se désolidarisent totalement, comme c’est mon cas, de la politique d’Israël, se voient confondus avec ce pays et se trouvent sommés, soit de s’expliquer sur leur rapport avec lui, soit de se taire.
Cela me plaisait aussi de jouer sur cette expression, parce qu’il y avait un autre pays interdit, la Tunisie, où il n’était pas question de revenir.
Il me semble, sans pouvoir parler au nom des Juifs d’alors, qu’il y a vraiment eu deux états d’esprit : il y a ceux qui sont partis en Israël avant qu’ils n’y soient contraints, ceux qui sont partis par idéal et par choix. Puis il y a eu ceux qui sont partis quand les Juifs ont été expulsés des pays du Maghreb, parce qu’ils ne souhaitaient pas aller en France par exemple, mais en Israël. Cela me fait penser à une nouvelle d’Amos Oz sur sa grand‐mère (Les deux morts de ma grand-mère), qui en tant qu’Ashkénaze, ne supporte ni la chaleur, ni les odeurs, et qui ne comprend pas pourquoi elle est obligée de vivre dans « ce pays oriental » ! Elle nettoie tout, tout le temps, à l’eau de javel ! Du point de vue des Juifs d’Afrique du Nord, Israël n’était pas exotique au contraire, puisqu’ils pouvaient se définir comme « Juifs arabes » mais, pour beaucoup, ce n’était pas très attirant : la vie était difficile, dangereuse…
FA – Votre écriture est placée sous le signe de l'impression, voire de l’impressionnisme, ce qui fait tout de suite penser à Proust. Mathilde par exemple passe d’une pensée rétrospective à un rêve, à une pensée intérieure alors qu’elle se trouve avec d’autres personnes… L’acte d’écriture qui est le vôtre a-t-il permis de retrouver une forme de mémoire ?
KH – Il n’y a pas que Proust qui m’ait influencée pour ce livre, il y a Henry James (Les Ailes de la colombe), Nerval à qui j’emprunte le prénom désuet d’Adrienne, mais aussi Claude Simon dans le sens du « roman familial ». C’est lui qui m’a appris que la phrase appelle la phrase, sans avoir forcément un sujet en tête, en s’attachant d’abord au travail de la phrase. La lecture approfondie de Claude Simon a beaucoup compté pour moi ces dernières années. En ce sens, je pense aussi que l’écriture convoque une mémoire de la littérature : on ne peut pas écrire sans réécrire et, quand on écrit, même le plus intime, on est amené à passer par cette mémoire des livres qu’on a lus et des films qu’on a vus. L’écriture est un chemin vers la mémoire et, plus on va dans cette direction et plus la mémoire se déploie. Cela dit, je n’ai pas cherché à « imiter Proust » – je pense notamment à son procédé de la mémoire involontaire – mais c’est un thème qui m’est cher.
Il n’y a pas que la littérature d’ailleurs, pour ce qui concerne le rapport à la mémoire : le cinéma de Truffaut – aussi bien pour le trio Mathilde, Adrienne et Laurent – que pour les morts, est une œuvre qui m’accompagne toujours.
FA – Votre livre s’ouvre sur un souvenir de shiva, les 7 jours du deuil qui suivent un décès dans la tradition juive. Pourtant, il s’intitule Aux vivants. Qui sont ces vivants ?
KH – Oui, le titre peut paraître paradoxal alors que le livre s’ouvre sur ce souvenir : mais justement, cette cérémonie rappelle à Mathilde le souvenir d’autres fêtes familiales et joyeuses, et ce que j’ai voulu montrer, c’est cette présence des morts parmi nous, le lien que nous conservons avec eux ; c’est un titre que j’ai trouvé, tout à la fin de l’écriture du livre, parce que j’ai pensé à ce « toast » traditionnel, LeHaïm, qui veut dire « à la vie », plus exactement « aux vies », et qu’il me semblait résumer le parcours très particulier de Mathilde, longtemps paralysée par son passé, et qui finit par le comprendre et l’accepter.