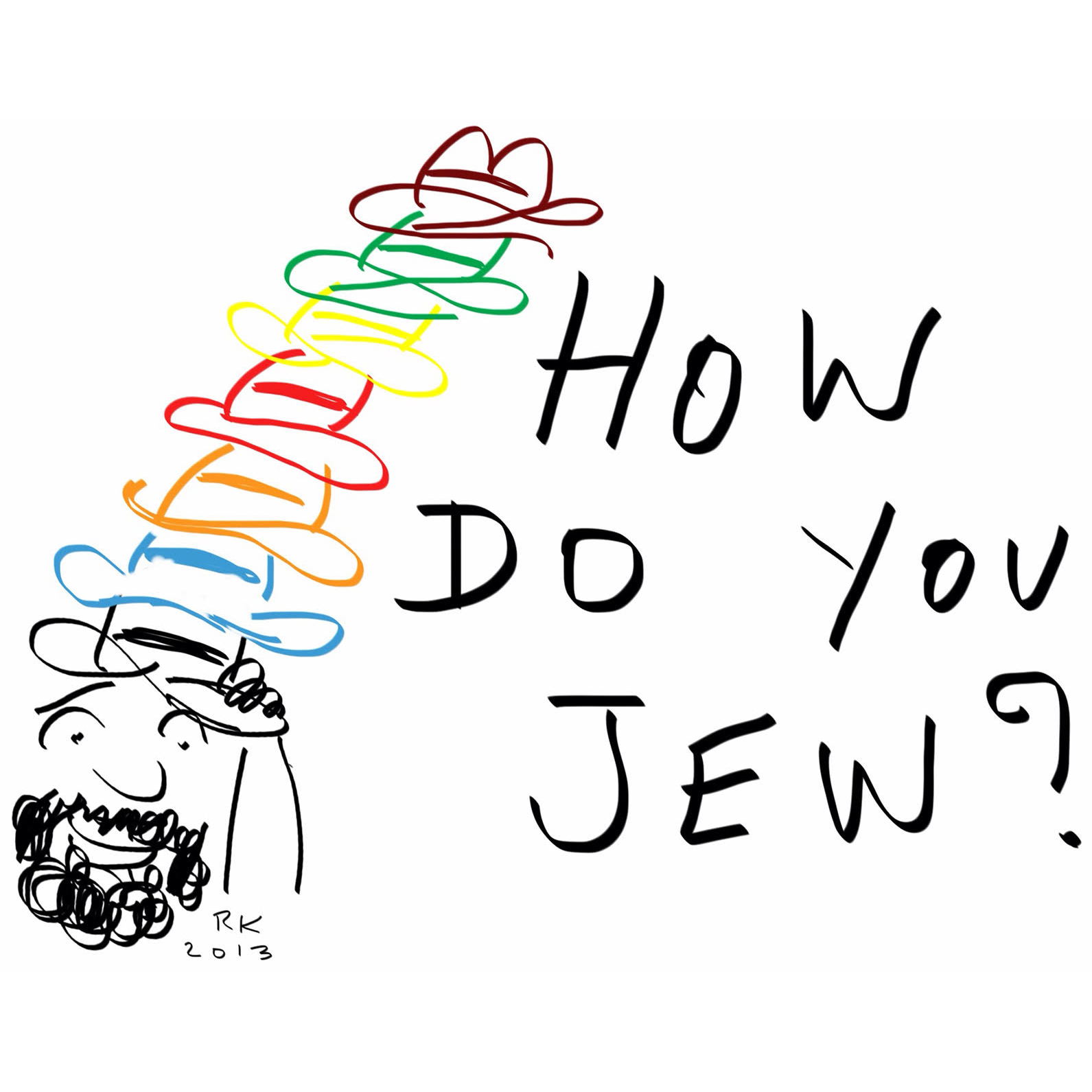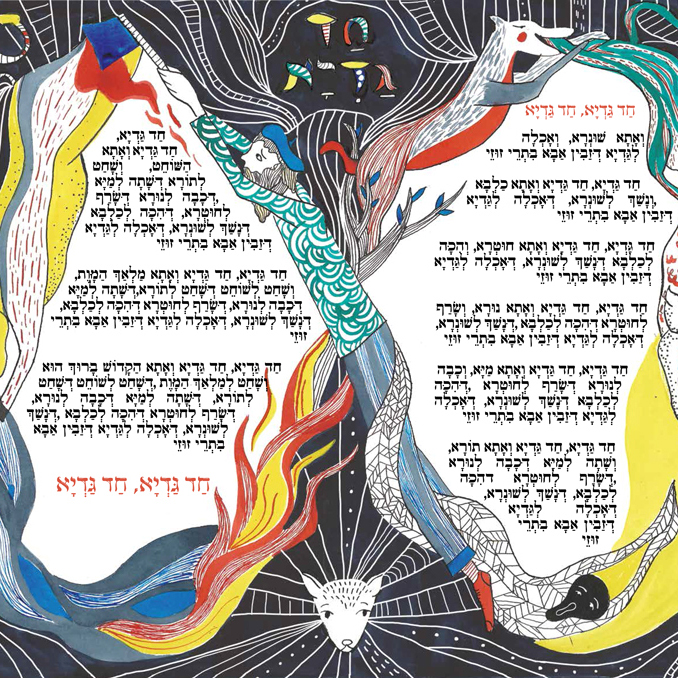Read this text in English / Lire ce texte en anglais
Beaucoup d’entre vous le savent, j’ai l’habitude, chaque année au soir de Kippour, de raconter une blague.
Parfois, j’en cherche pendant des semaines une qui serait pertinente pour le moment que nous vivons : je me demande comment aider les miens à entrer dans ce temps solennel avec un peu de cet humour ancestral et sacré qui nous a sauvés en tant de circonstances.
Cette année, je me suis souvenue d’une histoire que j’ai lue dans un livre de Romain Gary.
C’est l’histoire d’un Juif qui, au cours d'un pogrom, est poignardé près du cœur par un cosaque. Ses proches arrivent à son secours et lui demandent :
« Moishé, est-ce que tu as mal ?«
Et Moishé répond :
« Oh… seulement quand je ris ».
Voilà en quelques mots le plus puissant condensé de ce qu’est l’humour juif, de ce à quoi il sert, et de la façon dont il nous sauve si souvent : cette capacité qu’a notre peuple de mettre le tragique à distance, de tenter de garder la main sur ce qui nous arrive, ou sur ce qui nous assassine.
Rire cette année est un étrange défi. Nous vivons un temps si désespérant, si plein d’inquiétudes et d’appréhensions. Jamais ou presque les yamim noraim, les « jours redoutables », n’avaient si bien porté leur nom.
Il y a autour de nous la montée des haines et l’explosion de l’antisémitisme, de la menace sur nos enfants, des confusions mentales qui nous mettent encore et encore en danger. Et puis, il y a les douleurs immenses qui réverbèrent du Proche‐Orient, et les deuils infinis, et les otages toujours retenus, et tous les innocents qui souffrent, les enfants de Gaza qui meurent, et la crise humanitaire, et une jeunesse sacrifiée au combat, et la douleur de tant de familles, et la dévastation qui nous submerge ….
Et puis il y a ces haines qui nous ravagent, celles qui nous sont adressées et celles qui grandissent parfois en nous. L’impossibilité de se parler ou de se comprendre. Le recours permanent à l’insulte, et aux propos orduriers sur les réseaux sociaux, et aussi les tensions internes à nos familles ou nos groupes d’amis.
Et tandis que nous sommes réunis dans nos lieux de culte, en ce soir où le peuple juif retrouve en principe le chemin des synagogues ou des réunions familiales, là aussi, il est difficile de dialoguer. C’est en réalité de cela, précisément, dont je dois vous parler.
Je sais qu’il y a, ici même, dans nos communautés comme dans tant de familles que j’accompagne, des douleurs et des tensions, des paroles impossibles, des crises indicibles.
J’ai rencontré ces dernières semaines tant de gens qui m’ont dit à peu près la même chose : « Je n’arrive plus à parler aux miens, à mes proches. Je ne supporte plus ce que disent mes parents, je ne comprends plus ce que pensent mes enfants. Je ne parviens plus à parler à mon conjoint ou à mon cousin ».
Voilà que cette crise familiale, cette impossible conversation, y compris dans les cercles très intimes, s’est emparée de nous. Je suis sûre qu’il y a ce soir dans cette salle beaucoup de gens qui voient exactement de quoi je veux parler. Parce qu’ils le vivent.
Le psaume a beau dire : הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד « Comme il est bon d’être assis côte à côte comme des frères et sœurs », nous est‐il donné de le vivre vraiment ?
J’ai donc décidé de partager avec vous ce soir un enseignement sur ce qu’on pourrait appeler la philosophie de la conversation dans le judaïsme. Que faire quand on n’arrive plus à dire ? J’ai choisi deux textes – l’un et l’autre des passages éminemment célèbres du Talmud – qui évoquent très différemment cette même question : comment parler aux siens ?
Le premier texte est un classique du débat rabbinique (traité Erouvin).
La scène se passe au premier siècle avant notre ère, non loin de Jérusalem – il y a près de 2000 ans donc. Y vivent alors deux sages ; l’un s’appelle Hillel et l’autre Shammaï et, comme l’indique le nom de ce dernier, ils se chamaillent.
Partout où les élèves de Hillel disent « blanc », ceux de Shammaï disent « noir ». Ceux‐là disent « c’est autorisé », et les autres disent « c’est interdit ». Ils ne sont d’accord sur rien ou presque.
Voilà qu’au cours d’un célèbre débat qui les oppose, chacun affirme que la halakha, la loi juive, doit suivre son point de vue et surtout pas celui de l’autre.
La situation est banale et pourrait avoir lieu aujourd’hui : deux avis se confrontent et se polarisent de façon extrême « J’ai raison, l’autre a tort ».
Soudain, une voix céleste interrompt les débats et dit : « Les paroles des uns et les paroles des autres sont celles du Dieu vivant ». Traduction : il y a de la vérité dans ce que dit la maison de Hillel et aussi dans le point de vue de celle de Shammaï. Une vérité, après tout, peut être énoncée de bien des manières.
« Mais… poursuit la voix avec beaucoup de houtspa, de culot, dorénavant la loi suivra l’avis de Hillel. »
Là, le lecteur, interloqué, se demande : pourquoi une telle injustice ? Pourquoi Hillel l’emporterait-il dans le débat si « sa » vérité n’est pas plus valable que celle de Shammaï ? Pourquoi aurait‐il ce privilège ?
Réponse du Talmud : parce que, contrairement aux élèves de Shammaï, ceux de Hillel étaient capables de citer les arguments de leurs adversaires, avec respect et humilité, avant de citer les leurs.
Vous percevez là la morale profonde de cet enseignement talmudique. Il arrive que nous soyons en profond désaccord, mais il nous revient de toujours écouter l’autre, de savoir défendre son point de vue, le respecter suffisamment pour pouvoir, non pas y adhérer, mais l’exposer avant même de donner notre opinion.
Cet extrait du Talmud est une leçon d’éthique de la parole qui est évidemment pertinente pour nous aussi aujourd’hui. Sommes‐nous capables d’entendre l’argument de l’autre sans juger immédiatement qu’il est un traître, un lâche ou un salopard ?
Je ne sais pas.
Depuis des mois, chaque fois que je pense à cet extrait du Talmud, surgit immédiatement dans ma tête un autre extrait qui lui fait face. Voici le deuxième texte dont je veux vous parler ce soir (issu du traité Guittin).
La scène se passe au premier siècle de notre ère au même endroit : c’est‐à‐dire précisément 100 ans après le texte que je viens de vous citer.
Cette fois‐ci, à Jérusalem, les Romains ont établi un siège. Jérusalem s’apprête à tomber et, bientôt, le Temple sera détruit. Mais à l’intérieur de la ville, les Zélotes sont alors au pouvoir, des Juifs jusqu’au-boutistes qui refusent tout compromis et sont convaincus que Dieu est avec eux. Ils interdisent à tout autre Juif de penser différemment, de fuir la ville assiégée, ils font taire les voix modérées au sein du peuple et considèrent ceux qui les portent comme des traîtres.
C’est là qu’entre en scène un certain Rabbi Yohanan ben Zakkaï. Voyant qu’il ne parvient plus à parler aux siens, pas même aux membres de sa propre famille, et que les Zélotes au pouvoir ne lui laissent plus d’espoir, il décide alors d’une stratégie étonnante. Il se fait passer pour mort puisque seuls les cercueils peuvent sortir des murailles de la vieille ville. Il s’extrait ainsi de Jérusalem avec quelques élèves.
De l’autre côté de la muraille, il se retrouve face au général romain en charge du siège militaire, un certain Vespasien, à qui il adresse cette demande : « Donne-moi la ville de Yavné et laisse-moi m’y installer avec quelques sages ». Yohanan ben Zakkaï s’apprête à fonder dans cette ville toute proche une école et, ce jour‐là, il crée le judaïsme rabbinique dont nous sommes les héritiers.
Le Temple est détruit mais un judaïsme de vie, centré sur l’étude et non plus sur le sacrifice, vient de naître. Tout en gardant le regard tourné vers Jérusalem, Yavné assurera la continuité. Et comme son nom l’indique – yavné יבנה, c’est le verbe « construire » conjugué au futur –, elle incarnera la possibilité de bâtir au‐delà de la catastrophe et incarnera la possibilité de survivre et d’avoir un avenir.
Depuis des mois ces deux textes tournent simultanément dans ma tête. Un siècle exactement sépare le premier du deuxième. Mais c’est en réalité tout un monde qui les oppose.
Le premier dit : sache, en toute circonstance, dialoguer avec les tiens. Accepte de poursuivre la conversation, car la Loi est du côté de celui qui écoute encore la vérité de son frère. Même s’il n’y adhère pas.
Et le second texte dit : il arrive un moment dans l’Histoire où le dialogue n’est plus possible. Peut‐être parce que les Zélotes sont au pouvoir ou parce que la violence politique ne te permet plus de poursuivre une voie de la mesure. Alors la vie dépend de ta capacité à inventer autre chose, à réinventer ailleurs, à renoncer à un dialogue impossible mais construire un yavné, le lieu d’une autre conversation.
En plaçant ces deux textes côte à côte devant vous ce soir, vous ma communauté bien‐aimée, je réalise que je pose une question à laquelle je n’ai aucune réponse. Cette question peut être résumée en une simple phrase : quelle heure est‐il ?
Quelle heure est‐il ce soir ?
Est‐ce l’heure de la maison de Hillel ou bien l’heure de la pensée de ben Zakkaï ? Est‐ce l’heure de l’écoute de la vérité de l’autre ou l’heure de la construction de yavné hors des murailles ?
Cette question est dramatique mais ne connaît aucune réponse. Personne ne sait à quel moment de l’Histoire nous sommes. Pourtant, nous ne pouvons pas faire l’économie de nous poser cette question douloureuse.
Je sais que je ne suis pas la seule à la poser. Cet été, j’ai entendu, comme vous peut‐être, le célèbre chercheur israélien Yuval Noah Harari, auteur notamment du best seller Sapiens, l’évoquer presque de la même manière.
Dans un entretien donné à des journalistes israéliens, lui aussi se référait à cet épisode de la vie de Yohanan ben Zakkaï. Il affirmait qu’à ses yeux, le judaïsme vit aujourd’hui une des plus grandes crises spirituelles de son histoire depuis la destruction du Temple, et demandait selon les termes de ce passage talmudique : serons‐nous des zélotes jusqu’au-boutistes qui refusent le compromis au nom de leur vérité, serons‐nous des bâtisseurs de Yavné qui inventent un autre avenir, ou serons‐nous des Romains, qui savent parfaitement maîtriser la puissance militaire, pour se défendre, mais qui écrivent pour leur peuple une autre histoire ?
Ne sommes‐nous rien de cela ou un peu de tout cela à la fois ?
Sommes‐nous encore les enfants de Hillel qui se chamaillent mais qui savent tout de même écouter la vérité quand elle résonne chez l’autre ?
Chers amis, quelle heure est‐il ?
C’est avec cette question toute simple, qu’il nous faut entrer dans ce temps solennel du calendrier juif, Yoma, le grand jour de Kippour, tel que le Talmud le nomme.
Pendant 25 heures, nous allons nous livrer à une introspection. Nous allons interroger le pardon, celui que nous attendons ou celui que d’autres attendent de nous. Explorer ou confesser les transgressions commises à l’égard du divin, à l’égard de notre prochain. Regarder en face la violence que nous avons subie et celle que nous avons pu causer.
Et assis côte à côte, nous demander quelle violence frappe parfois au sein de notre propre famille, de notre propre groupe.
Tout est mis en place lors des jours redoutables pour que cette réflexion soit inévitable. Pas juste aujourd’hui mais également tout au long de cette saison solennelle. Prenez l’exemple de la semaine qui vient de s’écouler. Il y a quelques jours a eu lieu un jeûne malheureusement peu connu. Cette journée solennelle a toujours lieu juste avant Kippour, comme un avant‐goût du grand pardon.
Ce soir, je dois vous en dire aussi un mot, parce que cette fête méconnue est totalement liée à ce dont je viens de vous parler.
Jeudi dernier, au troisième jour du mois de Tishri avait lieu, comme chaque année, Tsom Guedalia, le jeûne à la mémoire de Guedalia.
Mais qui fut donc cet homme ?
Guedalia était un Juif, un homme reconnu comme digne et droit par le prophète Jérémie, qui vivait près de Jérusalem à l’époque de la destruction du premier Temple. Après la prise de la Judée par les Babyloniens, la plupart de la population juive partit en exil, en diaspora. Mais subsistait à Jérusalem un petit groupe de Juifs. Nabuchodonosor décida de placer un gouverneur juif, ce fameux Guedalia, pour administrer la population juive, les Judéens restés sur place.
Mais voilà que des Juifs jusqu’au-boutistes considérèrent que Guedalia était un traître, que le compromis qu’il était prêt à faire avec les nations faisait de lui un ennemi de son peuple. Et, la semaine de Rosh haShana, ils fomentèrent contre lui un attentat – Guedalia fut assassiné.
Les rabbins considèrent que cette violence interne au peuple juif, cette division, est une telle catastrophe qu’ils instaurèrent pour toujours un jour de jeûne pour la commémorer, pour ne jamais oublier où la violence politique qui divise nous mène.
Cette semaine, au jour du jeûne de Guedalia, j’ai décidé de relire l’extrait du livre de Jérémie où nous est racontée cette scène. Et c’est là que j’ai découvert qu’au chapitre 40 verset 8 de ce livre, nous est révélé le nom de l’assassin de Guedalia.
J’ai évidemment sursauté en lisant ce verset puisqu’il est écrit :
ויבאו אל גדליה המצפתה « Voici ceux qui frappèrent Guedalia dans la ville de Mitspé » et, parmi eux, ישמעאל בן נתניהו, « Ismaël fils de Nétanyahou ».
Le nom de « Nétanyahou » apparaît dans cet épisode de la Bible et, à part un musicien du Temple au temps du Roi David, à ma connaissance, nulle part ailleurs.
Je sais, c’est étrange et troublant, et certains parmi vous se demanderont peut‐être : et alors ? Que faut‐il en conclure ? Et la réponse est simple : rien du tout. Il ne faut absolument rien en conclure.
Évidemment, le Nétanyahou de la Bible ne dit rien du tout du Nétanyahou de l’actualité. Il n’existe aucune prédétermination ou essence coupable d’un homme par son patronyme. Il faut même se méfier de tous ceux qui croient que l’actualité est annoncée dans la Bible ou que l’Histoire y serait préécrite.
Je crois simplement que, parfois, les clins d’œil du texte nous invitent à méditer notre présent. Dans la Bible, le nom de « Nétanyahou » a quelque chose à voir avec la division du peuple, et avec la violence politique qui naît de l’incapacité à faire de la place à l’autre.
Peut‐être s’agit‐il d’une invitation à penser le combat essentiel contre une lecture fataliste. À réfléchir plus que jamais ensemble à l’heure qu’il est. Se dire que, quelle que soit cette heure, il n’est sans doute jamais trop tard.
Jamais trop tard pour se dire que rien n’est encore écrit, et que tout peut encore changer.
Les jours redoutables ne cessent de le répéter : le livre de la vie est grand ouvert devant nous et il peut encore accueillir des pages inédites de notre histoire, tout ce qu’on pourrait encore se dire, tout ce qu’on pourrait encore éviter de se dire.
L’heure est au pardon. Mais le pardon juif ne consiste jamais à tomber d’accord avec l’autre à tout prix, ni à oublier ce qui a été dit ou fait, mais bien plutôt à tenter de vivre avec, et à chercher comment emprunter à l’avenir d’autre voies.
Rien ne raconte cela mieux que l’humour juif, et sa volonté farouche d’être toujours plus fort que la tragédie qui nous frappe.
Permettez‐moi de finir avec la blague juive la plus adaptée à ces circonstances.
C'est l’histoire de Moishé et de Shloimé qui se détestent et qui, tout au long de l’année, se disputent et se chamaillent, se méprisent et se malmènent.
À l’approche de Kippour, ils décident de faire enfin la paix et de se pardonner. Moishé s’approche de Shloimé et lui dit : « Tu sais quoi ? Faisons la paix. Pour cette nouvelle année, je te souhaite tout ce que tu me souhaites ».
Et Shloimé de lui répondre : « Ah ben voilà, tu recommences !!! »
Puissions‐nous être inscrits dans le livre de la vie, chérir la vie, et protéger les vies. Puissions‐nous apprendre à nous reparler, pour vraiment essayer ensemble de nous réparer. Shana tova.