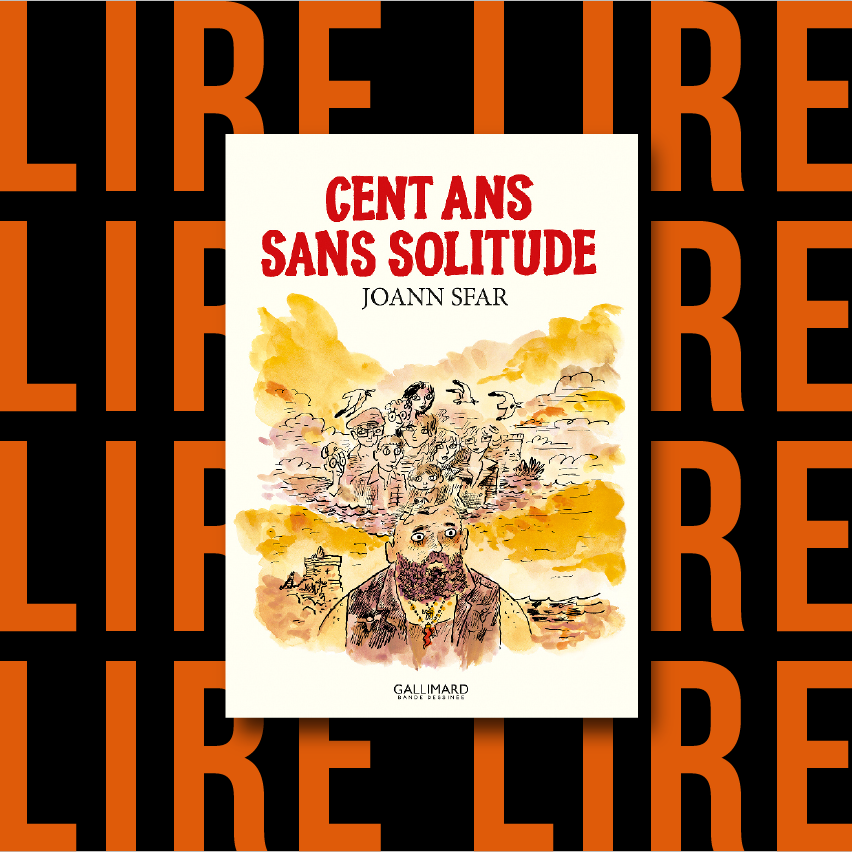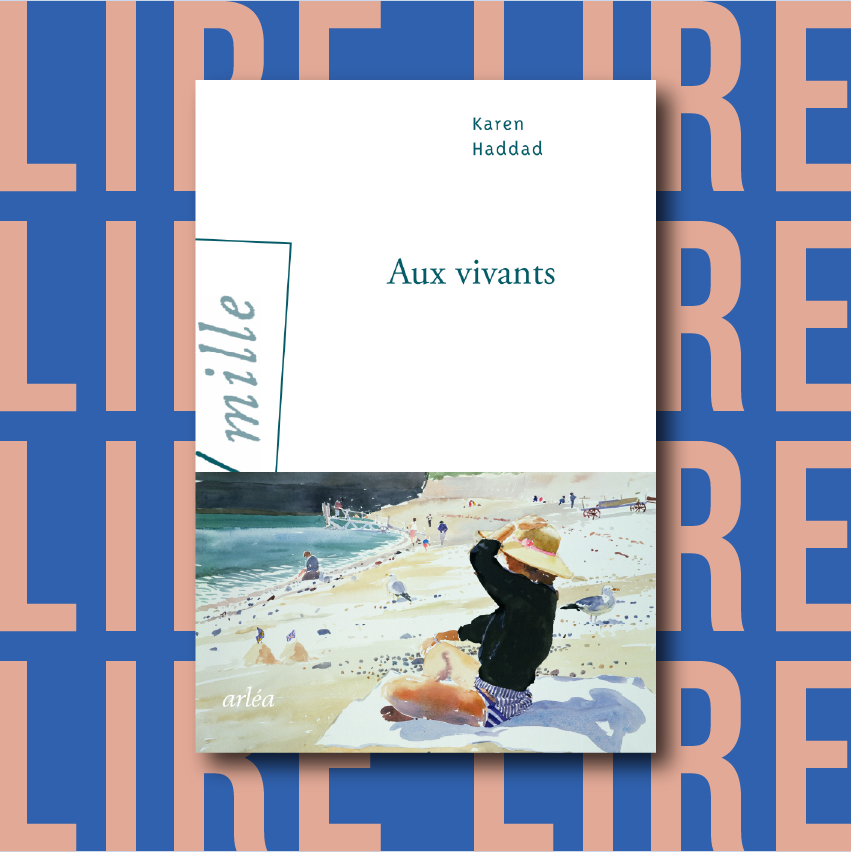Ouman, Ukraine – Le soleil se couche sur Ouman, dans l’oblast de Tcherkassy, à deux heures de Kyiv en bus. Dans la rue Pouchkine, épicentre juif de la ville, des centaines de fidèles entonnent un chant langoureux. Certains dansent, d’autres se frappent la poitrine, les bras levés semblant vouloir toucher le ciel.
C’est le quatrième pèlerinage organisé à Ouman depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le 24 février 2022. Chaque année, à Rosh haShana, cette petite ville de près de 90.000 habitants accueille le plus grand rassemblement juif en dehors d’Israël. Plus de 35.000 pèlerins sont présents cette année, selon Andriy Demtchenko, porte‐parole du Service national des gardes‐frontières d’Ukraine.
En dépit de la guerre, des dizaines de milliers de Juifs venus d’Israël, de France, des États‐Unis et d’ailleurs ont fait le voyage pour se recueillir sur la tombe de Rabbi Nahman de Bratslav, maître hassidique du XVIIIᵉ siècle, connu pour ses enseignements plaçant la joie, la danse et le chant au cœur de la foi.
Des concerts de musique religieuse, des repas communautaires et d’autres événements organisés ponctuent les rassemblements plus spontanés qui éclatent dans les ruelles et les cours de la ville.
Le rabbin Shmuel Levy, de Paris, estime que le message de Rabbi Nahman résonne plus fortement aujourd’hui que jamais : « Même si vous avez la guerre ici, la guerre en Israël et la guerre partout dans le monde, Rabbi Nahman nous enseigne à préserver la joie, explique‐t‐il. C’est pour cela que nous dansons, que nous chantons. C’est notre manière de repousser le désespoir. »
Depuis sa disparition en 1810, le tombeau de Rabbi Nahman de Bratslav est devenu un centre spirituel non seulement pour les hassidim de Bratslav, mais aussi pour des Juifs de tous horizons, en quête d’un lien plus intime avec Dieu.

Contrairement à d’autres courants hassidiques, le mouvement bratslaver n’a pas établi de dynastie héréditaire après sa mort : ce sont ses enseignements qui ont cimenté ses fidèles, avec un accent particulier mis sur la joie personnelle, la prière du cœur et la relation directe, individuelle, avec Dieu. Cette ouverture a fait d’Ouman une destination non seulement pour les Bratslaver, mais aussi pour un large éventail de Juifs qui trouvent dans l’héritage de Rabbi Nahman un chemin de renouveau spirituel.
« À Ouman, on trouve toutes les facettes du judaïsme », souligne Yossef, un disciple de Rabbi Nahman, originaire de Créteil (Val‐de‐Marne). « Il y a des Juifs laïcs, des Séfarades d’Afrique du Nord, des Ashkénazes d’Europe de l’Est, des hassidim, des Bratslaver, des traditionalistes… mais, ici, nous sommes tous unis. »
Le rabbin Shmuel Levy rappelle aussi que Rabbi Nahman avait choisi délibérément Ouman comme lieu de sépulture, afin de reposer auprès des âmes de milliers de Juifs massacrés lors d’un pogrom au XVIIIᵉ siècle. Né en 1772 à Medjybij, à trois heures de route à l’ouest d’Ouman, dans l’oblast de Khmelnytsky, berceau du hassidisme, Rabbi Nahman était l’arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, fondateur du mouvement.
Enfant, raconte la tradition, il disparaissait déjà dans les forêts et les collines alentour, fuyant le monde pour parler à Dieu. De ces retraites solitaires naquit le hitbodedout, une prière intime, libre, prononcée dans ses propres mots, comme une conversation chuchotée avec le ciel.
Lire aussi : Cette année plus que jamais : la joie
Sa vie fut marquée par les voyages. En 1798, un périple décisif en Terre d’Israël renforça ses enseignements mystiques et lui donna une stature particulière au sein du monde hassidique, où ses disciples commencèrent à l’entourer comme un maître à part. Miné par la tuberculose dans ses dernières années, il choisit Ouman pour ultime demeure et y réunit ses fidèles. À la veille de sa mort, en 1810, il fit une promesse qui continue de résonner plus de deux siècles plus tard : quiconque viendrait prier sur sa tombe, donner l’aumône et réciter les dix psaumes du Tikkoun HaKlali serait épargné des tourments de l’enfer. Depuis lors, cette parole agit comme un sceau : elle attire toujours, à Ouman, des dizaines de milliers de pèlerins en quête d’une certitude spirituelle.
« C’est à cause de leur sang que notre maître a souhaité être enterré ici, conclut le rabbin Levy. Ouman est le lieu le plus bas de la terre à cause de cette tragédie, mais Rabbi Nahman nous enseigne qu’à travers la prière et la danse, nous pouvons transformer le plus bas des lieux en un espace si rempli de l’amour de Dieu que même les anges nous envient. Voilà pourquoi, année après année, nous revenons intercéder. »
Sécurité
Devant une petite maison de briques soviétiques, à quelques kilomètres du tombeau de Rabbi Nahman, s’élèvent les chants dissonants d’une dizaine de pèlerins. Sous une tonnelle bleue couverte de poussière grimpe une vigne aux grappes diaphanes. Deux rabbins mènent la prière. Drapés de longues djellabas blanches et coiffés de kufis brodés, leurs intonations trahissent leur ascendance marocaine.

© Louis Lemaire‐Sicre
Originaires de Beer‐Sheva, ces frères jumeaux conduisent leurs disciples, puis portent à leurs lèvres le shofar, corne de bélier symbole de renouveau et de jugement divin.
Ils sont venus avec les élèves de leur yeshiva. Parmi eux, Ador, trente ans, raconte que c’est son deuxième pèlerinage. « Ici, à Ouman, Dieu a promis de bénir ceux qui viennent sur la tombe de Rabbi Nahman et de leur donner la force pour l’année à venir. »
Divorcé depuis un peu moins de trois ans, il confie que sa première venue l’avait aidé à surmonter cette épreuve, et il espère retrouver la même force cette année.
La guerre, elle, ne l’effraie pas. « Nous vivons dans le sud d’Israël, près de Gaza. Nous avons l’habitude d’être pris pour cible. »
Un ami l’interrompt, moqueur : « Est-ce que ce pays est vraiment en guerre ? »
Haïm, l’un des responsables du groupe, corrige aussitôt : « L’Ukraine est beaucoup plus grande qu’Israël. La guerre est loin, mais cela ne veut pas dire qu’elle n’existe pas. Tu n’as pas vu ? Les soldats étaient partout. »
Perdue dans la campagne tcherkassienne, à plus de 500 kilomètres du front, Ouman a jusqu’ici été relativement épargnée. Mais tous les habitants gardent en mémoire la nuit du 28 avril 2023, lorsque, en pleine obscurité, un missile russe éventra un immeuble et tua 23 personnes. La guerre surgit aussi à chaque coin de rue : affiches appelant au recrutement militaire, soldats ukrainiens au visage fatigué, boutiques de surplus et vétérans blessés qui, sous le ciel de septembre, dévoilent des corps marqués et mutilés par le conflit.
Les pèlerins français, eux, se montrent plus anxieux. Yossef, venu pour la première fois, raconte : « Ma mère pleurait quand je suis parti. Elle me disait : pourquoi y aller ? Il y a la guerre. » Recouvert de porte‐bonheurs achetés sur place, coiffé d’une kippa tricotée blanche typique des Bratslaver, il se fend d’une plaisanterie avant d’admettre : « Je ne vais pas mentir, j’avais un peu peur aussi. Mais ici, l’ambiance est magnifique, on sent l’amour d’HaShem. Depuis que je suis à Ouman, je me sens en sécurité. Cela dit, j’envoie un message à ma mère dès que je peux. »
Ouman et la paix
Dans une ronde effrénée, des danseurs entonnent un chant à la mémoire de Rabbi Nahman. Devant sa tombe, des dizaines de fidèles venus du monde entier s’agglutinent, serrés les uns contre les autres, portés par une ferveur qui oscille entre chaos et recueillement, entre exubérance et gravité.
À l’extérieur, certains pèlerins se balancent comme une flamme au cœur de leur prière. D’autres fument, assis sur des chaises en plastique, échangeant des rires ou des bénédictions improvisées. Dans les ruelles voisines, on se croise, on se salue, on se souhaite la bonne année, dans un mélange de langues où se mêlent l’hébreu, le français, le russe et l’anglais.
Plus bas, au bord du lac Sophie, des centaines de croyants se préparent au rituel du tashlikh. Ce rite de Rosh haShana consiste à réciter des psaumes près d’un point d’eau et à y jeter symboliquement ses fautes, souvent en dispersant des morceaux de pain, afin de s’en délester avant d’entrer dans la nouvelle année.
Le prophète Michée l’avait déjà annoncé : « Tu jetteras tous leurs péchés au fond de la mer » (7,19). Rachi, le grand commentateur médiéval de la Bible et du Talmud, explique que Dieu efface les fautes comme on jette une pierre dans les profondeurs, là où nul ne peut la retrouver. Maïmonide, philosophe et codificateur du XIIᵉ siècle, enseigne que le repentir sincère transforme la faute en mérite, car la reconnaître rapproche l’homme de Dieu.
Quant au Rema, le rabbin Moïse Isserlès, grand décisionnaire polonais du XVIᵉ siècle, il rattacha la coutume à Rosh haShana, expliquant que les eaux sont signe de vie et que les poissons qui y nagent rappellent la bénédiction et la continuité d’Israël. Ainsi, sur les rives du lac, les fidèles lisent des psaumes, jettent des morceaux de pain dans le lac, puis forment une ronde. Dans le bruissement des feuillages et le clapotis de l’eau, chacun espère entrer dans l’année neuve purifié, le cœur allégé. « Nous dansons pour la paix », hurle un homme dont la barbe recouvre le visage. Ses mots se perdent dans le tumulte des chants, mais l’intention est claire.

C’est le deuxième Nouvel An juif depuis le 7 octobre, et le sujet de Gaza, de la guerre ou d’Israël reste sensible. « Nous ne sommes ni pour Nétanyahou ni pour Trump, nous sommes seulement pour Dieu », explique Ador, à la fois grave et enjoué. Ses compagnons, eux, se divisent. L’un lâche qu’on ne peut faire confiance aux politiques, un autre s’enthousiasme soudain : « Nétanyahou est le meilleur. Il est bon ».
Moshe, qui revient tout juste de Gaza où il a servi dans la brigade Givati de l’armée israélienne, confie quelque chose d’inattendu : « J’aime la guerre. En Israël ou ici, j’aime ressentir cette atmosphère de guerre. J’aime voir des soldats autour de moi », dit‐il avant de saluer les forces armées ukrainiennes, qu’il juge « plus avancées que les nôtres dans de nombreux domaines, en particulier les drones ».
Shimon, un orthodoxe parisien, prend le contre‐pied. Il soupire : « Mon rêve, c’est de pouvoir danser un jour avec des Arabes. Que nous soyons tous là ensemble, Juifs, Arabes et Chrétiens, unis dans l’amour d’HaShem. Un jour, ça arrivera. Quand le Messie viendra, nous danserons tous ensemble ».

Glossaire :
- HaShem : un des noms utilisés par les Juifs religieux pour parler de Dieu.
- Hassidim : Juifs de ce courant du judaïsme mystique né au XVIIIᵉ siècle en Europe de l’Est, centré sur la ferveur et la joie dans le service de Dieu.
- Hitbodedout : prière intime, libre et spontanée, adressée à Dieu dans ses propres mots, souvent pratiquée dans la solitude. Voir à ce propos la série vidéo de Mira Neshama.
- Mouvement bratslaver : branche du hassidisme fondée par Rabbi Nahman de Bratslav, mettant l’accent sur la prière personnelle et la joie spirituelle.
- Tikkoun HaKlali : « réparation générale », rite kabbalistique de pénitence institué par Rabbi Nahman de Bratslav.
- Yeshiva : école talmudique.