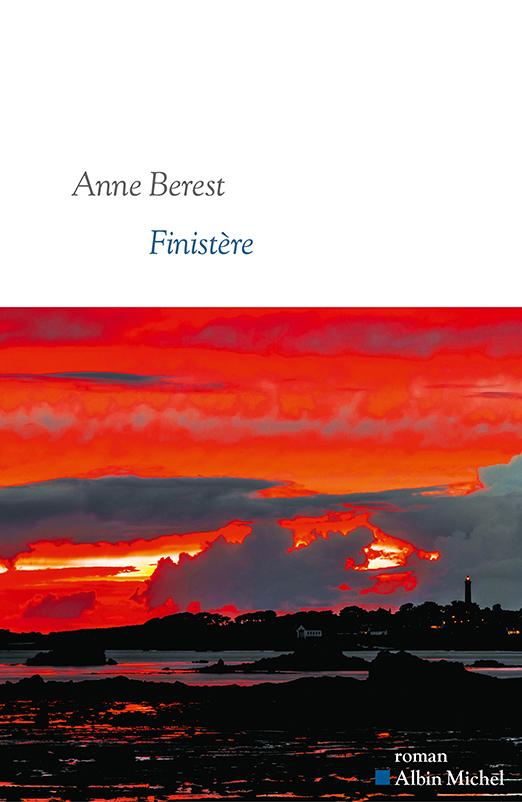Lucie Spindler - Dans Finistère, vous évoquez l’histoire de votre branche paternelle bretonne, originaire de Saint-Pol-de-Léon, après avoir écrit sur vos origines maternelles juives dans La carte postale (Grasset, 2021). Dans Finistère (Albin Michel, août 2025) vous écrivez : "Contrairement à mon histoire maternelle, volontairement ensevelie dans le silence, cette histoire bretonne s’était simplement évanouie dans les méandres de la mémoire. Ce n’était pas un refus de transmission, mais le travail naturel du temps". Pourquoi considérez-vous que, dans un cas, c’est une silenciation volontaire et, dans l’autre, une usure du temps ? Est-ce que vous avez écrit différemment, en suivant un autre chemin intérieur ?
Anne Berest – Merci d’ouvrir la conversation avec cette question, qui me tient profondément à cœur. En écrivant Finistère, je me suis interrogée sur la mémoire transgénérationnelle : quels récits circulent dans un arbre généalogique, et quels chemins empruntent‐ils pour parvenir jusqu’à nous ?
Du côté maternel, la mémoire des Rabinovitch a connu un double effacement, comme tant de familles juives. D’abord, la volonté nazie d’anéantir toute trace. Puis, après la guerre, un silence à la fois choisi et subi : choisi, pour se reconstruire ; subi, parce que, comme le rappelait Simone Veil, la société française n’était pas prête à entendre les récits des camps. C’est ce que j’appelle une mémoire volontairement ensevelie dans le silence.
En explorant ma lignée paternelle – des Bretons enracinés dans une terre et des traditions catholiques – j’ai constaté un phénomène semblable : je ne savais presque rien de mes ancêtres. Non par refus de transmission, mais par érosion du temps. J’ai observé que je n’étais pas la seule. Très peu de gens connaissent les prénoms de leurs arrières‐grands‐parents en France ! Notre société ne se construit pas sur la mémoire des ancêtres mais, au contraire, sur l’idée qu’il ne faut pas trop s’attarder sur le passé… que ce serait presque ringard… C’est étonnant quand on y pense.
LS - Dans le livre, vous vous appuyez sur les écrits laissés par votre grand-père, Eugène Bérest, pour reconstruire son histoire et celle de votre père. Une grande partie de votre travail d’écriture se nourrit de ce lien que vous entretenez avec vos ancêtres et votre arbre généalogique. Dans Finistère, vous évoquez d’ailleurs la figure du dibbouk [fantôme] juif. Pouvez-vous nous expliquer ce que le dibbouk signifie pour vous ?
AB – Dans Finistère, quand j’explore mon arbre généalogique, je me rends compte que je suis habitée par des voix anciennes, des silences, des tensions, qu’on n’a pas toujours formulées mais qui « se logent » en moi. La science contemporaine, à travers l’épigénétique, parle de « mémoire cellulaire » : cette idée que les traumatismes et les émotions laissent une empreinte dans notre corps, sur trois générations. Ce que je trouve passionnant, c’est que cette intuition n’est pas neuve. Il y a plus de cinq mille ans, la tradition kabbalistique évoquait le dibbouk : un esprit qui entre dans un vivant, et le possède, suite à un manquement ou à une dette non réglée. (Je tiens à signaler que mes connaissances ont été enrichies par la belle exposition du musée d’art et d’histoire du Judaïsme, Le Dibbouk. Fantôme du monde disparu présentée en janvier dernier… que je salue au passage ! ). Pour moi, le dibbouk représente cette idée d’héritage qui ne s’achève jamais : la transmission invisible des ancêtres, les non‐dits familiaux, la dette morale ou affective qu’on porte. Ainsi, j’utilise cette figure pour dire que je suis, en quelque sorte, possédée dans un sens émotionnel et existentiel : je porte quelque chose de leurs vies passées.
LS - Ce livre vous a-t-il permis de construire des ponts entre vos deux histoires familiales ? Je pense notamment à la Seconde Guerre mondiale, qui est cette fois-ci abordée sous l’angle breton, avec la destruction de la ville de Brest.
AB – Oui, Finistère m’a permis de construire des ponts entre mes deux lignées, entre deux mémoires : celle, juive, marquée par l’exil et la destruction, que j’ai explorée dans La Carte Postale, et celle, bretonne, enracinée dans une terre battue par le vent, et dans une histoire d’engagement politique très fort.
En écrivant ce nouveau livre, et en discutant avec des lecteurs qui ont ce même héritage « mixte », j’ai compris que, venir de deux histoires très différentes, crée des personnalités particulières, des gens qui cherchent à réunir les fragments, à faire dialoguer des choses qui, sur le papier, sont irréconciliables. C’est beau d’avoir plusieurs cultures. Cela nous agrandit le cœur, je crois.
Mais, comme vous le soulevez, et je vous en remercie, la Seconde Guerre mondiale traverse Finistère. Et ce qui était passionnant, c’est de changer de point de vue sur des événements très précis que j’avais travaillés dans La Carte Postale. Par exemple, j’avais écrit sur l’exode, du point du vue des Rabinovitch : les parents comprennent qu’ils doivent quitter Paris à cause des bombes, et vont trouver refuge quelques semaines en Bretagne. C’est très exotique pour eux : les enfants n’ont jamais vu de marée ! Là, le point de vue est inversé. La famille Bérest voit des centaines de familles débarquer à Saint‐Pol‐de‐Léon, c’est une marrée humaine, qu’ils découvrent !
LS : Une dernière question, d’actualité. Les actes antisémites se sont multipliés ces deux dernières années en France. De nombreux intellectuels juifs ont exprimé leur inquiétude et leur sentiment de solitude (dont vous, en signant une tribune dans Le Monde en mars dernier). Comment vivez-vous cette période ? Votre branche bretonne vous apaise–t-elle intérieurement ?
AB – Oh non ! Pas du tout ! Je ne suis pas apaisée, bien au contraire. Je n’ai jamais été aussi inquiète, en particulier pour mes enfants. Ces actes antisémites récents réveillent un sentiment de vulnérabilité et d’inquiétude qui me bouleverse. Signer cette tribune dans Le Monde en mars dernier était une façon de dire que nous ne pouvons pas rester silencieux, que le silence lui‐même serait dangereux. L’histoire se répète, et la menace antisémite n’a pas disparu. Je ressens plutôt un mélange d’alerte et de responsabilité, comme si ces racines me rappelaient que la vigilance, la mémoire et le témoignage sont plus nécessaires que jamais. Nous devons transmettre. Et de ce point de vue, je suis heureuse de tous les déplacements que j’ai faits dans les collèges et les lycées, au moment de La Carte Postale. J’ai sillonné la France, j’ai rencontré des centaines d’élèves. Il faut continuer…