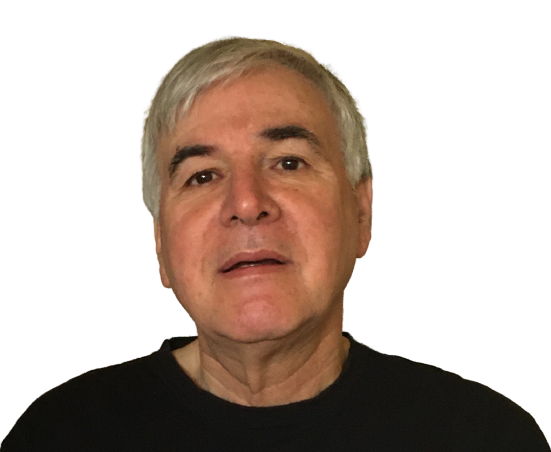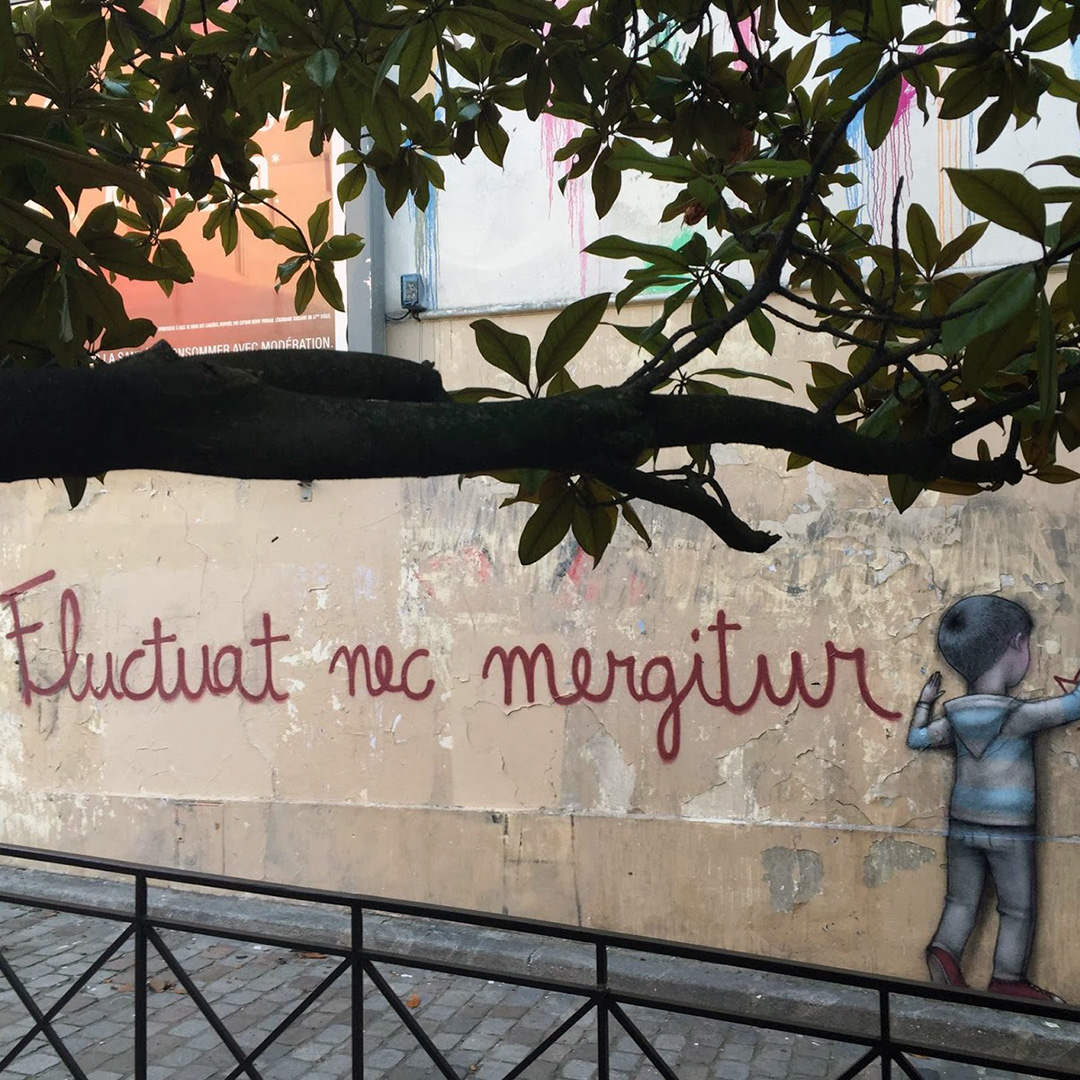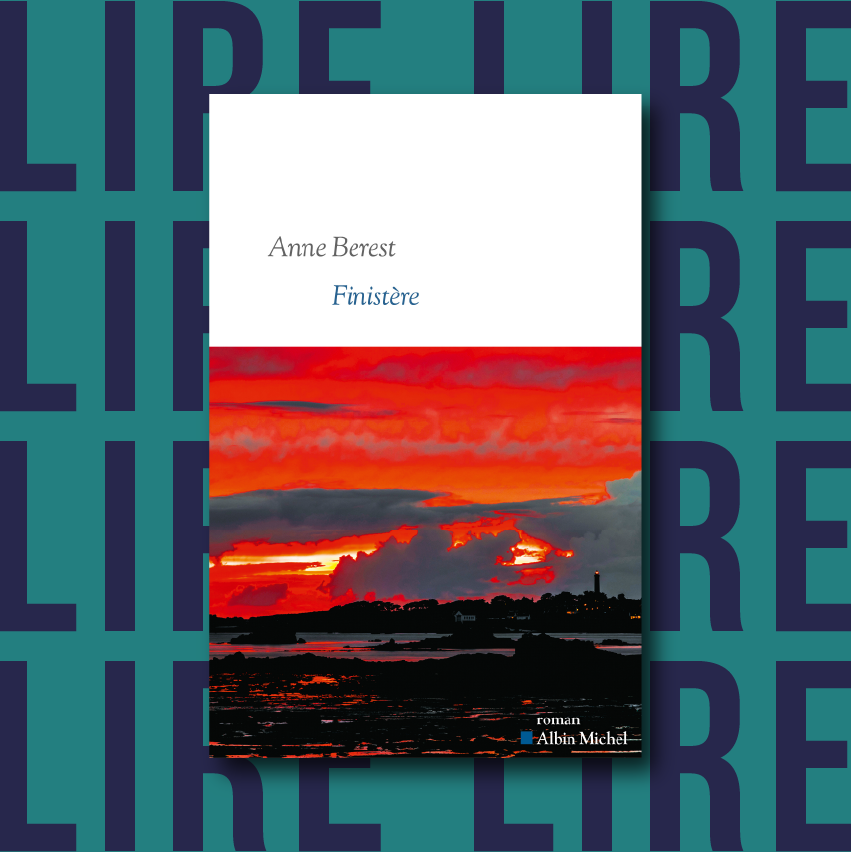La commémoration des 30 ans de l’assassinat d’Itzhak Rabin aurait dû susciter dans la société israélienne une réflexion sur les dangers du fanatisme nationaliste et religieux, sur les limites du débat démocratique, sur les lignes rouges qui doivent séparer vivacité des propos – on parle après tout ici d’enjeux existentiels – et incitation à la haine et à la violence. Cela ne s’est malheureusement pas produit, la division au sein de la majorité juive en Israël est extrêmement profonde, certains la craignent même irréductible, et l’atmosphère ici reste aujourd’hui chargée de lourds dangers de passage à la violence physique. L’actualité quotidienne se charge de nous le rappeler.
Ce qu’on a largement oublié, par contre, c’est que le déchaînement de violence verbale et physique qui a marqué en Israël les deux années qui ont précédé le drame du 4 novembre 1995 n’a pas marqué que la société israélienne. Les deux plus grandes communautés juives de la diaspora, l’américaine et la française, l’ont connu également. Revenons sur cette période au cours de laquelle certains en France, s’autoproclamant dépositaires exclusifs des « valeurs juives », du « vrai sionisme », ont agi avec violence contre leurs adversaires idéologiques, et s’en sont glorifiés. Comme on le verra, même le sang versé en bout de parcours n’a pas calmé ces éléments fanatiques.
Il ne s’agit pas ici, bien évidemment, de rouvrir d’anciennes plaies. Le nécessaire rappel de ces mois de chaos et de brutalité dans la rue juive française a seulement pour but de mettre en garde la génération qui a grandi depuis lors, et qui a rarement conscience de ces faits, afin qu’elle sache contrer tout signe avant‐coureur de ces errements, s’ils venaient à réapparaître un jour ou l’autre, par exemple au cas où quelque chose de significatif se débloquerait sur la question israélo‐palestinienne et l’avenir des Territoires de Cisjordanie/Judée‐Samarie. Scénario aujourd’hui difficilement envisageable, certes, mais au Moyen‐Orient tout reste toujours possible, et l’intense activité diplomatique de l’administration Trump semble indiquer sa détermination à briser le cycle de la violence dans lequel cette malheureuse région se débat depuis des décennies.
Revenons donc en juin 1992. Itzhak Rabin, le parti travailliste et Meretz viennent de remporter les élections, battant le Likoud d’Itzhak Shamir, et accèdent au pouvoir. Assez rapidement, le discours sur les implantations juives dans les Territoires et sur la question palestinienne commence à changer ; on entend parler de « gel », de changements d’attributions de budget, on voit réapparaître un discours sur l” »autonomie » des Palestiniens. La première réaction des partisans de ces implantations et de la droite en général ne se fait pas attendre : la première campagne contre les nouvelles orientations du gouvernement Rabin date de novembre 1992, et inclut déjà une claire menace de refuser d’obéir à d’éventuelles nouvelles lois et décisions gouvernementales qui iraient dans le sens d’un compromis historique avec les Palestiniens. Très rapidement, les droites se mobilisent et pour ce qui nous concerne ici, mobilisent leurs sections en diaspora.
À partir de ce moment, un vaste réseau se met en place, en France et aux USA particulièrement, qui traquera littéralement tous les partisans du gouvernement Rabin, locaux ou venus d’Israël pour expliquer son action. Dès le printemps 1993, six mois donc avant la signature des accords d’Oslo à Washington, le leader en France de la droite juive de l’époque, Jacques Kupfer (1946−2021), est « heureux de pouvoir féliciter chaleureusement les militants du sionisme national et de les remercier » d’avoir perturbé une conférence de Yaël Dayan, alors députée travailliste et infatigable militante de la paix (Tribune juive, 20/05/1993). Il avertit : « Nous respectons toutes les idées respectables », faisant comprendre que c’est lui qui décidera pour tous les juifs de France de ce qui est « respectable », ou pas. Le ton est donné.
Témoin inquiet des événements et comprenant le processus qui s’est mis en marche, l’ambassadeur d’Israël, Yehouda Lancry, alerte : « La contestation, légitime, ne saurait dépasser certaines limites » (Tribune juive, 09/12/1993). Hélas, il n’est pas entendu. Le 1 mars 1994, le secrétaire général du parti travailliste (et futur ambassadeur d’Israël en France de 2003 à 2005) Nissim Zvili, est empêché de parler à une conférence à Sarcelles. Des militants du Tagar (Betar), qui l’avaient déjà insulté le matin‐même à la faculté de Tolbiac et avaient perturbé sa rencontre avec des étudiants, font le coup de poing et usent même de bombes lacrymogènes (L'Arche, avril 1994). Interrogé à ce propos, Jacques Kupfer salue les auteurs de ces faits : « Les deux opérations menées par le Tagar représentent une action salutaire contre le défaitisme et la démoralisation de cette communauté » (Actualité juive, 17/03/1994).
Le Herout [parti israélien de droite] de France accentue la pression et s’en prend aux autorités communautaires, « coupables » de soutenir les efforts de paix d’Israël, comme le président du CRIF, Jean Kahn (certainement pas marqué à gauche, comme s’en souviendront les anciens), conspué lors de la manifestation du Yom Haatsmaout (Actualité juive, 21/04/1994). Fait sans précédent, il organise peu après une manifestation de protestation devant l’ambassade d’Israël (Actualité juive, 07/07/1994). Ses militants vont continuer à perturber chaque apparition publique en France – de ministres ou autres élus israéliens en faveur du processus de paix de l’époque. La place manque ici pour faire le détail de tous ces incidents, que la presse juive de l’époque rapporte et pour sa grande majorité, condamne.
Nous arrivons ainsi à ce soir fatal du 4 novembre 1995. Sur RCJ, Jacques Kupfer réagit à l’assassinat d’Itzhak Rabin. Il exprime une « réaction de tristesse devant cet acte et de condamnation devant ce crime », mais ajoute une phrase profondément révélatrice : « Je regrette que Monsieur Rabin ait terminé de cette manière, je pense qu’il méritait certainement le tribunal pour ce qu’il a fait, après les prochaines élections ». Shlomo Malka, écœuré, clôt la séance : « On va y mettre fin parce que vous comprendrez que l’on n’a pas le cœur ce soir à entendre ce genre de choses… ».
La « tristesse » et la « condamnation » seront de courte durée. Le 31 janvier 1996, au cours d’un dîner organisé par le CRIF, une intervention de Yossi Beilin, proche de Shimon Peres et ministre dans son gouvernement, est constamment interrompue par Jacques Kupfer et ses militants (« Va à Gaza », « Tu as du sang juif sur les mains » (Actualité juive, 08/02/1996) et aussi « Arabe », « pire qu’Arabe », « Doriot », « traître » (Tribune juive, 15/02/1996). Le leader de la droite juive justifie pleinement par la suite ce refus de tout dialogue (Actualité juive, 08/02/1996). L’ambassadeur d’Israël Avi Pazner exprime alors sa stupéfaction : « Je comprends qu’au sein de la communauté il y ait des gens de sensibilités différentes, mais je ne comprends pas que les gens ne puissent pas discuter de façon civilisée et démocratique. C’est unique au monde. Je n’ai jamais vu cela ailleurs » (Actualité juive, 15/02/1996). Pour sa part, Jacques Kupfer assume sans problème. À la question « Etait‐il démocratique d’empêcher Yossi Beilin de parler lors de sa récente venue à Paris ? », il répond un peu plus tard : « C’était non seulement démocratique, mais c’était juif et c’était obligatoire » (Actualité juive, 28/03/1996).
On touche ensuite le fond de l’abjection, quand le journal des étudiants membres du Betar de France, Cactus, publie en février 1996 les théories conspirationnistes prisées dans les milieux de la droite israélienne, surtout religieuse : l’assassinat de Rabin aurait été en fait le « dérapage » d’un faux attentat contre lui planifié par Shimon Perès, sur une idée de François Mitterrand, pour rétablir le soutien populaire déclinant, selon eux, de l’opinion publique israélienne au processus de paix. Même le Likoud est dans l’embarras : interrogés par le grand quotidien israélien Yediot Aharonot (17÷03÷1996), des responsables du parti déclarent qu’il s’agit d’une « absurdité » et que le Betar est « un mouvement indépendant, qui doit s’assurer que de telles personnes n’écrivent pas dans ses bulletins ».
La victoire de Benyamin Netanyahou en juin 1996 et son arrivée au pouvoir donnent des ailes à la droite juive française, et Jacques Kupfer s’écrie : « C’est Dieu qui a voté » (Tribune juive, 13/06/1996). Au « Yizkor » de Yom Kippour, le 23 septembre 1996, il lit en public une longue série de noms à commémorer, dans laquelle figure celui de Baruch Goldstein, l’auteur du massacre du Caveau des Patriarches en 1994, mais pas celui de Rabin. À une dame qui proteste, il dit : « Allez prier ailleurs » (Nouvel Observateur, 3−9÷10÷1996). Benyamin Netanyahou effectue alors son premier voyage en France comme Premier ministre ; surprise‐surprise, il préfère dîner avec son clan, le Herout de France, qu’avec le CRIF, et conforte ainsi son chef, qui avait comparé Itzhak Rabin et Shimon Perès aux chefs du gouvernement de Vichy (Jerusalem Post, 24/09/1996).
La spirale de cette violence ne s’arrêtera pas. Le 27 novembre 1997, les mêmes éléments perturbent violemment une conférence de Bernard‐Henri Lévy, « coupable » lui aussi de continuer à soutenir les efforts de paix (L'Arche, janvier 1998) et peu après, une rencontre sur la paix au Moyen‐Orient à la Sorbonne est elle aussi le théâtre de violences, bombes lacrymogènes à l’appui. Dix‐sept personnes doivent être soignées (Yediot Aharonot, 08/12/1997).
On en restera là de cet indispensable regard en arrière, qui répétons‐le, n’a pas pour but de rouvrir d’anciennes polémiques ; il permet cependant de tirer les indispensables enseignements de ce que la rue juive a connu dans un passé récent, quand certains se sont arrogé le droit de décider qui pourra parler et qui devra être réduit au silence, par la force s’il le faut, quelle vision du sionisme et du judaïsme est la seule légitime, et laquelle condamne ses partisans à se taire, par crainte de la violence.
Nous partageons tous l’espoir que de tels événements ne se reproduiront plus, mais peut‐on formuler cette attente de façon confiante ? À entendre et lire les excommunications, imprécations et malédictions lancées par certains contre toutes celles et ceux qui professent aujourd’hui un judaïsme ouvert et humaniste, le rabbin Horvilleur et le rabbin Krygier pour ne citer qu’eux, ou qui « osent » contester l’action d’un Premier ministre israélien de plus en plus perçu par ses fidèles comme un Grand Leader intouchable, on peut formuler de légitimes craintes. La grande communauté juive de France mérite bien mieux que les scènes de violence et d’intolérance que nous avons évoquées dans ce pénible rappel. À chacun et chacune, à sa place, dans son entourage immédiat, dans son centre communautaire et en toute autre circonstance, d’empêcher leur retour. Personne ne le fera à votre place.