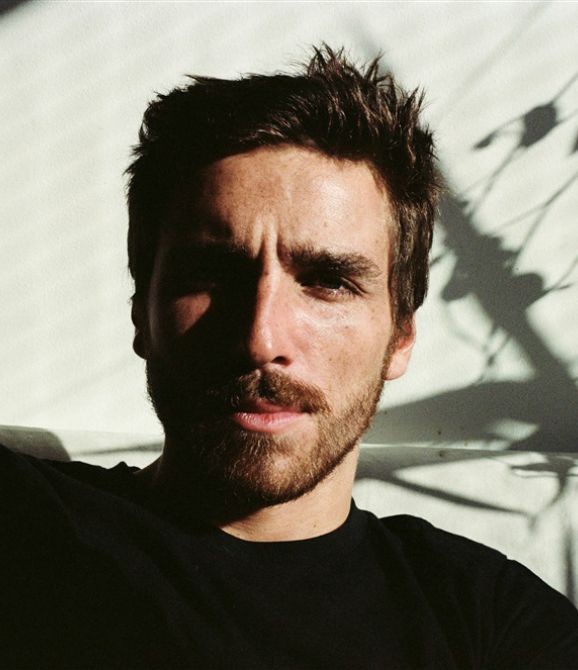Après les derniers survivants de la Shoah, qui va transmettre cette histoire ? Comment surmontera‐t‐on leur disparition ? Depuis des décennies (l’âge des témoins avançant), ces questions se posent et des réponses partielles se trouvent. Spielberg, à travers sa fondation, a engagé la collecte de dizaines de milliers de témoignages à l’échelle internationale. Le Mémorial de la Shoah en France accueille chaque jour des centaines de collégiens et lycéens et les aide à mieux appréhender cette histoire qui ne s’entend pas. Et, depuis quelques années, la troisième génération, “la vengeance contre les antisémites” (d’après les mots de Julia Wallach, survivante) s’empare de cette histoire qui la constitue. C’est de cela que parle Après eux, qui va raconter l’histoire ?, le documentaire réalisé par Joseph Romano et Jonathan Safir, disponible sur Francetv Slash. Rencontre.
Votre documentaire Après eux, qui va raconter l’histoire ? réunit des grands-parents déportés pendant la Seconde Guerre mondiale et leurs petits-enfants. Nous sommes témoins de leurs échanges, témoins de ce qui les lie. Comment est née l’idée du documentaire ? Celle de donner la parole à la troisième génération, de lui faire presque comprendre son rôle de “passeur de mémoire” ?
Jonathan Safir - Nous avions le projet de réaliser un documentaire à l’occasion de la commémoration de la libération du camp d’Auschwitz pour le public de Slash, soit un public jeune de 18 à 25 ans.
Joseph Romano - Très rapidement, il a été question de créer un dialogue entre des jeunes et leurs grands‐parents, d’anciens déportés. Nous avions aussi prévu de montrer que la déportation n’a pas seulement concerné les Juifs, sans pour autant relativiser le génocide juif. Rappelons que 76.000 Juifs ont été déportés de France. Pierre Jobard, résistant, relate donc sa déportation pour la première fois à sa petite‐fille, Camille. C’est rare d’avoir accès à d’autres récits, d’autres paroles, d’autres accents aussi.
Le principe du film consiste à créer un dialogue entre un petit-enfant et son grand-parent. Pour certains, c’était presque la première fois qu’ils abordaient cette histoire ensemble. Les quatre survivants avaient l’habitude de confier leur témoignage à un public d’anonymes, à des classes d’élèves, pas toujours à leurs proches. Comment avez-vous guidé vos “personnages” et les échanges ?
JS - Chaque relation est singulière, chaque petit‐enfant l’est aussi. Frankie Wallach est réalisatrice et comédienne, elle est à l’aise avec la caméra et elle sait comment parler à sa grand‐mère de ce sujet. En plus de ça, nous l’avons filmée alors qu’elle vivait un tournant, elle attendait un enfant, un événement qui a aussi orienté la discussion. Nous avons également filmé Camille Jobard, une jeune femme qui n’a jamais posé de question à son grand‐père, elle l’accompagnait à des événements commémoratifs, mais la déportation de son grand‐père restait quelque chose de tabou, de pas interrogé. Nous avons donc aidé Camille à amener son grand‐père à se remémorer, à lui faire comprendre que cette histoire, que ces souvenirs étaient aussi les siens.
Pendant que l’on tournait, Ginette Kolinka a passé le relais en disant à son petit‐fils, Mathis, que maintenant, il était prêt à témoigner pour elle. On a donc vu la grand‐mère “coacher” son petit‐fils, lui dire ce qu’il fallait dire, comment le dire, ce qu’il importait de souligner, de ne pas oublier. Elle lui a montré comment on fait, comme un artisan de la mémoire.
JR - D’ailleurs, c’était intéressant de voir, d’un côté, Ginette Kolinka qui demande à son petit‐fils de porter sa mémoire, et de l’autre, Evelyn Askolovitch qui préfère que l’on se rappelle d’elle comme cette “baba” (son surnom de grand‐mère), qui ne voit pas ce qu’il se passe dans la rue parce que trop distraite, qui met une chaussure rouge et une chaussure noire. Elle dit à son petit‐fils, Théo, que le plus important est qu’il soit en bonne santé, pas que l’on transmette son histoire de déportée.
Avant de tourner, nous ne savions pas ce qui pourrait se passer, comment chaque personne pourrait réagir, face à son interlocuteur, face à la caméra. Et, à chaque fois, nous avons été surpris par les histoires qui se déployaient sous nos yeux. Chaque duo inventait son histoire, sa dialectique, ses enjeux.
À un moment dans le film, Julia Wallach interrompt sa petite-fille et lui demande à propos des conditions de sa déportation : “Comment tu sais tout ça ?” Ce à quoi Frankie répond : “T’as écrit un livre et t’as beaucoup parlé”. On comprend que la mémoire de Julia Wallach s’égare pour peut-être ne plus se retrouver. Comment avez-vous géré l’oubli, la perte de mémoire ?
JS - Nous avons assez vite observé que la mémoire de Julia Wallach allait et venait. Parfois, nous la trouvions en grande forme, très précise dans ses souvenirs, parfois, son histoire se faisait plus chaotique, plus anarchique dans ce qu’elle rapportait. On a donc décidé de rendre compte de cela, de sa mémoire qui s’effrite, de partir du principe que l’on n’aurait jamais plus un discours sans trous, fidèle à ce que Julia avait traversé. C’est la raison pour laquelle nous avons aussi organisé une rencontre entre Frankie, en quête de précisions, dans un besoin de comprendre, et Sarah Gensburger, sociologue spécialiste de l’histoire de la Shoah.
JR - Certains survivants, habitués à témoigner, peuvent proposer un discours assez figé, un discours pas toujours fidèle à la gravité de ce qu’ils ont vécu, de ce qu’ils ont ressenti. Il y a des émotions que ces personnes ne peuvent pas revisiter. Leurs descendants se retrouvent alors à rechercher des réponses qu’ils ne peuvent pas toujours obtenir. Ce qui était le cas de Frankie qui se demandait comment elle pourrait inscrire l’histoire de sa grand‐mère, dans son histoire familiale, comment la lier à l’histoire de son enfant. Nous sommes donc allés chercher des hypothèses ailleurs. Sarah Gensburger lui montre comment sa grand‐mère s’est battue à la Libération pour récupérer son appartement, les biens qui lui ont été spoliés. 20.000 Juifs se retrouvaient dans cette même situation à leur retour des camps. À travers une série de faits, elle va déduire un comportement et combler un peu les manques.
À plusieurs reprises dans le film, vous mettez en scène l’archive. Des photographies d’avant-guerre, des médailles, des coupures de journaux, des souvenirs après la déportation... Mais aussi, des films plus récents de réunions familiales, traces de la relation entre le petit-enfant et son grand-parent, de tout ce qui est né après la guerre. Comment avez-vous pensé ces moments ?
JS - Nous cherchions à proposer un documentaire dont la forme n’était pas figée et inspirée par une exigence de cinéma. Et nous nous posions la question de la place de l’archive. Nous ne voulions pas particulièrement insérer des images des camps, celles que nous connaissons, qui appartiennent presque à la mémoire collective, qui imprègnent encore notre inconscient. Nous avons aussi cherché à montrer ce qui a survécu à ces images atroces et, ce qui a survécu, c’est la descendance, la famille. Nous avons donc choisi de projeter des archives familiales, numérisées, parfois pour la première fois, aux petits‐enfants. Parfois, ils les découvraient avec candeur, ce qui produisait sur le plateau de nouvelles émotions.
Nous avons aussi filmé Frankie Wallach découvrant le témoignages de sa grand‐mère Julia Wallach lorsqu’elle a été interviewée par la Fondation Spielberg dans les années quatre‐vingt‐dix. C’était la première fois qu’elle écoutait ce récit de sa grand‐mère, qu’elle y avait accès autrement.
JR - Nous tenions à ce que le documentaire intègre des images qui mettent en scène ces jeunes alors enfants et leurs grands‐parents. On voit par exemple Mathis Kolinka à la cérémonie de légion d’honneur de sa grand‐mère, Ginette Kolinka. En observant ces images, on remarque que ce petit garçon ne comprend pas vraiment ce qui se passe, qu’il est là pour se réjouir, qu’il est là pour sa grand‐mère.
Selon vous et après avoir réalisé ce film, comment continuer à transmettre la mémoire de nos “anciens”, comment continuer à enseigner l’histoire de la Shoah dans le contexte que l’on connaît : 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et avec une explosion des violences antisémites depuis le 7 octobre 2023 ?
JS - Je suis convaincu qu’il faut continuer à collecter la parole des témoins même si certains pensent que l’on a trop parlé de la Shoah et qu’il faudrait moins le faire. À travers ce film, nous avons à nouveau raconté cette histoire, nous avons ajouté une couche à la construction de cette mémoire pour que ça continue d’exister. Je pense aussi que l’on ne devrait pas agir selon un devoir de mémoire, une expression qui me paraît erronée parce qu’elle impose l’injonction de… On devrait agir en “responsabilité”, se poser la question : est‐ce que je réponds de cette histoire et est‐ce que j’en fais quelque chose ou pas ?
JR - Je remarque que face à la virulence de l’antisémitisme, on peut avoir tendance à plus raconter l’histoire de la Shoah, plus revenir sur l’histoire de l’antisémitisme. Or, il est possible que ce soit contre‐productif et que certains aient l’impression d’une centralité de la Shoah au détriment d’autres tragédies. Dans ce documentaire, l’histoire de la Shoah se déroule non pas à travers un rappel historique, non pas à travers des témoignages linéaires, mais à travers une relation aussi intime qu’universelle, celle d’un grand‐parent et de son petit‐enfant. C’est l’intimité de la famille qui permet de rentrer dans l’Histoire.
JS - Et d’ailleurs, c’est un pari. Nous parlons d’un des drames les plus grands du XXe siècle sans vraiment recontextualiser. Parce qu’on part du principe que ce n’est pas possible de ne pas savoir, de ne pas maîtriser les bases. Et d’ailleurs, la chaîne, nous recommandait d’ajouter des précisions dans un bandeau, lorsque des survivants évoquaient, par exemple, la marche de la mort. Nous avons préféré ne pas le faire pour inciter le public à approfondir par lui‐même, à se renseigner pour aller plus loin.
JR - Le spectateur non averti entre dans cette histoire en passant par la porte de la famille. Peut‐être aussi que certains saisiront l’opportunité de poser des questions à leurs propres grands‐parents, d’adopter une posture d’historien amateur. Il y a des témoins vivants de cette période, donnons‐leur la parole.
Vous appartenez tous les deux à une génération qui n’a pas connu la guerre mais dont les parents ou les grands-parents en ont été témoins. Joseph, votre grand-père a échappé à la déportation malgré un internement à Drancy et un transfert. Jonathan, votre père né en Roumanie, n’a pas cessé de s’interroger sur pourquoi il avait survécu et pas les autres. Est-ce que votre histoire familiale a motivé la réalisation de ce documentaire, votre sensibilité pour le sujet ?
JR - Même si je n’avais pas été concerné par le sujet, j’aurais sûrement réalisé ce film. Je travaille sur d’autres projets en lien avec “ce que les anciens nous transmettent”.
JS - Je pense que notre documentaire porte en lui quelque chose d’universel, c’est un film sur la transmission d’une histoire familiale, sur ce qui peut s’évanouir. Aujourd’hui, la troisième génération, celle dont les grands‐parents ont vécu la guerre, prend de plus en plus l’habitude de les interroger sur ce qu’ils ont vécu à ce moment‐là. La question de l’origine est de plus en plus prégnante : nous avons besoin de savoir d’où l’on vient. En ce qui concerne, mes projets en cours, je travaille sur le premier procès en France après le génocide des Tutsi et sur l’histoire d’un enfant caché. Il y a donc des thématiques qui reviennent…
Propos recueillis par Léa Taieb
Pour aller plus loin :
Le podcast “Itinéraire d’un enfant caché” de Lucie Spindler produit par Tenoua sur son grand‐père, enfant caché.
Le podcast “Générations d'Après” de Léah Boukobza qui donne la parole à celles et ceux dont les grands‐parents ont vécu la Seconde Guerre mondiale.