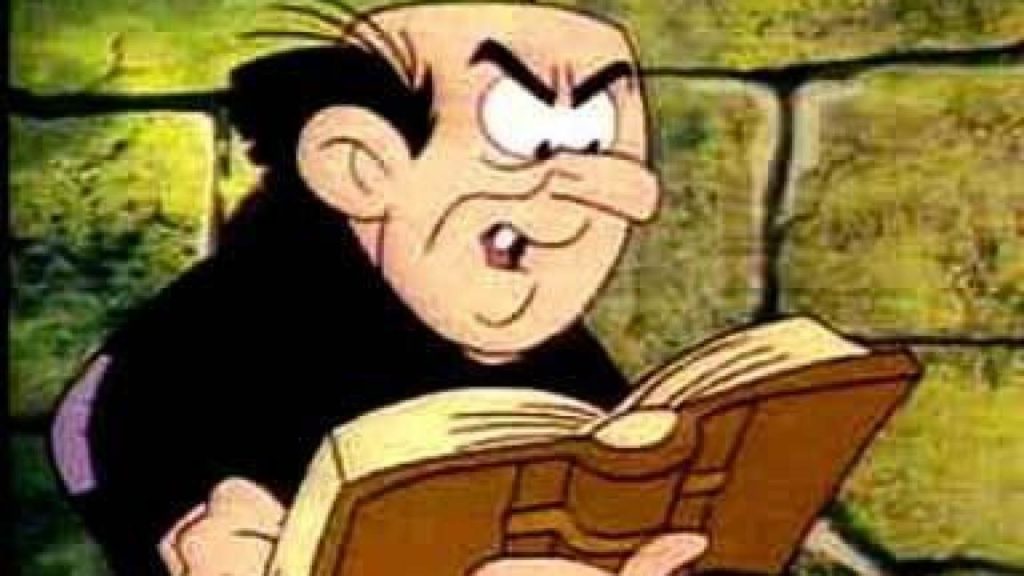L’an prochain à Paris. Pour ceux de nos lecteurs qui y vivent, ce vœu peut sembler bien étrange, vous qui avez rêvé de vous échapper, d’oublier l’enfermement, le confinement, l’étroitesse parfois du huis clos solitaire ou familial. Pour d’autres, qui aimez arpenter les rues, les places et les musées de la capitale, en visiteurs, il sera probablement plus audible. Et pour qui, comme moi, a fait le choix de vivre à plusieurs milliers de kilomètres, il prendra un sens autre : celui d’un ailleurs enfin possible.
Lorsque nous avons publié, il y a un an, un numéro sur le confinement, celui‐ci voulait déjà, en surtitre, penser la possibilité d’un recommencement. Par‐delà l’Atlantique, je vivais cette expérience étrange de préparer puis de finaliser un numéro de Tenou’a sans contact réel, ni face à face avec ceux avec qui j’aime tant travailler. Nous n’étions avant cela, jamais vraiment séparés, nos distances temporaires se résorbaient en quelques heures d’avion et un peu de jetlag juste avant le bouclage.
Le confinement a fait la place à une géographie dont la réalité ne faisait plus de doute : ce virus avait remis un océan entre mes deux mondes, celui d’où je viens, celui où j’ai choisi d’aller vivre, il y a maintenant quelques années. Il fut alors tout simplement interdit, illégal, de franchir la mer et les frontières sans une raison si essentielle qu’elle se résumait peu ou prou à la mort.
À l’ouest de l’Atlantique aussi, d’autres océans, immenses, infranchissables, se formaient, qui empêchaient d’atteindre l’école, le cinéma et même, et surtout, la synagogue. Après avoir passé Pessah chacun chez soi, après nous être souvenus des victimes de la Shoah chacun derrière son écran, après avoir vu mon fils aîné lire sa parasha et sa haftara de bar mitsva chez nous, à l’abri de la maison, devant ses seuls frères et parents, il fallait consentir à faire Kippour depuis le salon, à sonner le shoffar sans personne pour l’entendre, à lire la meguila sans les cris de l’assemblée…
Certains se sont accommodés, à leur manière, de cet enfermement. Certains ont su écrire, aimer, mener à bien des projets depuis longtemps repoussés, profiter autrement de leurs proches… D’autres y ont tant perdu qu’ils regardent, sidérés, leur vie, avec l’impression de l’avoir vue filer entre les doigts. Beaucoup, la plupart je crois, comme moi, reconnaissent volontiers qu’ils sont chanceux dans cette affaire : ni leur famille ni leur travail ni leur maison ne leur ont échappé. Mais ils ressentent une lassitude, une amertume même face à la morosité de ces mois passés entre quelques murs trop familiers, voudraient s’éloigner ou au contraire se rapprocher, et renouer avec une vie où cacher son visage et aseptiser ses mains dans un mouvement perpétuel et répétitif ne serait pas la seule règle qui vaille.
Lorsque se parlent ces mots à la fin du séder, L’an prochain à Jérusalem, peut‐être sommes‐nous nombreux à ne pas y avoir prêté attention. Je ne me souviens pas les avoir jamais prononcés en pensant réellement me trouver là‐bas un an plus tard. Ce que j’entends de ces mots, aujourd’hui, c’est un possible, un peut-être qui fait du bien. Non pas une douleur de n’y être pas mais la douceur d’une perspective d’avenir. Une conscience aiguë qu’aussi formidables que ce soient ici et maintenant, c’était mieux demain, du moins c’est possible.
Ce numéro que vous lisez, nous l’avons finalisé ensemble du côté européen de l’Atlantique. L’océan est redevenu, au moins un peu, franchissable. Comme une promesse, comme un fantasme, un avenir, à nouveau. Alors oui, L’an prochain par-dessus les océans, les grands et les petits, qu’on les franchisse vraiment ou non mais qu’à nouveau il nous soit possible de l’imaginer, de nous y projeter, de le penser, de le rêver.