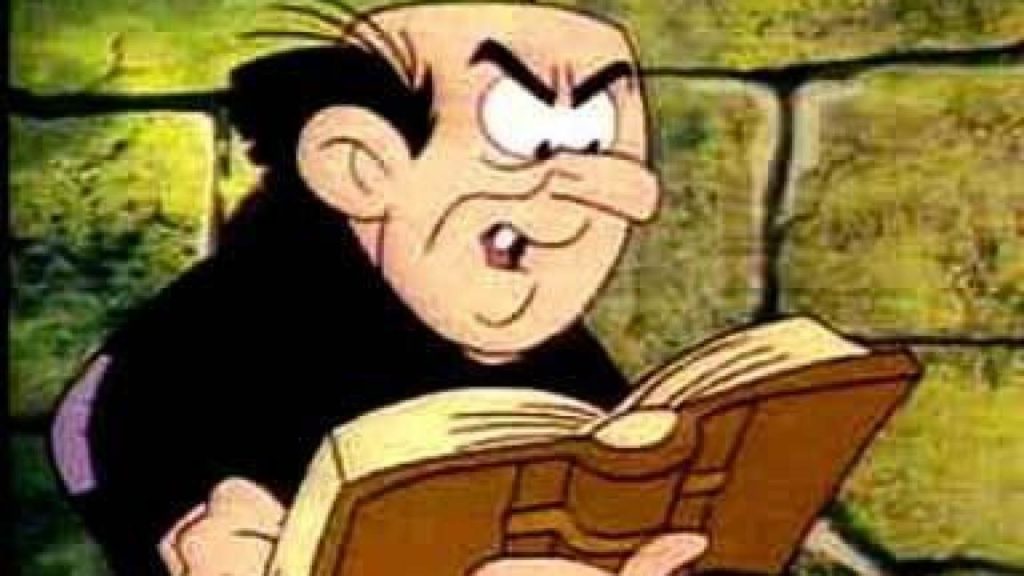“Je n’étais pas la seule à vivre ce que je vivais. Je n’étais pas folle, je n’étais plus seule à avoir un parent survivant.”
Un livre, deux voix. La première est celle de l’auteure, Danièle Laufer, enfant à Casablanca. Petite fille, elle manque de sommeil, d’enfance, de soleil, d’amour, d’évidences. La deuxième est celle de sa mère, une femme d’origine juive allemande qui a cessé de ressentir au moment où elle a été déportée. Une mère étrangère réunit deux générations, l’une a traversé la Shoah et l’autre s’est construite dans ses traumatismes, ses culpabilités, ses violences. Comment être une enfant de survivante ? Comment résister à la maltraitance d’une mère mal aimante ? Comment grandir sans racines, sans branches auxquelles se raccrocher ?
Danièle Laufer a choisi l’écriture comme espace de guérison, comme outil pour “immoler l’enfance”. Dans son livre précédent, Venir après : Nos parents étaient déportés, la journaliste et auteure avait recueilli le témoignage d’une vingtaine d’enfants de déportés, comme elle. Comme un écho, les paroles des uns complétaient celles des autres, dans leur sentiment de solitude, ils se retrouvaient. Cette fois‐ci, Danièle Laufer consacre son récit à la relation mère‐fille, “un rendez‐vous manqué”, un échange qu’elle provoque plus de trente ans après la disparition de sa mère.
Vous êtes née dans les années cinquante, quelques années après la fin de la guerre. Vous écrivez d’ailleurs “ma mère m’a fabriquée trop tôt après sa sortie de l’enfer”. Ce livre semble vous habiter depuis des décennies, pourquoi l’écrire maintenant ?
En réalité, une première version de ce livre avait été publiée en 1996 sous le titre La vie empêchée. À l’époque, je l’avais écrit à la troisième personne. J’avais appelé la petite fille que j’étais Mathilde et laissé le « je » à ma mère que j’avais appelée Hilda. Nos deux récits se croisaient. Dans Une mère étrangère (Bayard Récits), j’ai conservé la même construction mais je me suis autorisée à parler moi aussi à la première personne. Il y a deux ans, j’ai publié Venir après : Nos parents étaient déportés (Éditions du Faubourg), un essai littéraire dans lequel j’ai entrelacé une vingtaine de récits d’enfants de déportés avec le mien. Son succès m’a incitée à faire sortir de l’oubli le texte de La vie empêchée. Mon éditrice m’a demandé de le réécrire à la première personne, ce que je n’avais sans doute pas osé faire dans la première version pour laisser toute sa place au récit de ma mère. Et c’est ainsi que j’ai trouvé la mienne, de place, dans une judéité adulte et assumée.
Depuis petite, vous ressentez l’horreur de la Shoah, la nuit, vous percevez la présence “d’enfants arrachés aux bras de leur mère” ou “d’étoiles jaunes dont personne ne parle jamais”. Vos parents y font régulièrement allusion, à propos de vos insistances, ils osent : “elle marcherait sur un cadavre pour obtenir ce qu’elle veut”. Sans raison, votre mère vous compare à des nazis. Comment avez-vous compris que votre mère avait survécu aux camps ?
Je ne sais pas quand et comment j’ai compris que ma mère avait été déportée. Très tôt, j’ai remarqué une dissonance entre ce qu’elle disait avoir rêvé être avant la guerre en Allemagne, une comédienne (son père était metteur en scène de théâtre et d’opéra), et ce que je voyais d’elle à Casablanca où je suis née et où j’ai grandi, une femme au foyer hyper maniaque qui assortissait toujours ses chaussures à talons à son sac‐à‐main.
J’ai toujours ressenti une sorte de gravité. Enfant, j’étais asthmatique, je tombais tout le temps malade, j’avais toujours peur de mourir. Au Maroc, je me sentais emprisonnée derrière la moustiquaire de ma chambre, je ne pouvais pas dormir dans le noir, je ne peux d’ailleurs toujours pas. En 1984, je suis allée pour la première fois en Israël. Là‐bas, j’ai rencontré une psychanalyste qui m’a fait comprendre que je n’étais pas la seule à vivre ce que je vivais. Je n’étais pas folle, je n’étais plus seule à avoir un parent survivant. Cette transmission inconsciente que la psychanalyste Yolanda Gampel assimile à une sorte de « déchet radioactif », traverse tous les enfants de déportés. C’est là, c’est en nous.
Dans quel contexte votre mère s’est-elle confiée à vous il y a une trentaine d’années ? Comment expliquez-vous qu’elle ait cédé à votre “harcèlement” ?
J’ai essayé de l’interviewer : j’étais allée chez elle avec un magnétophone et ça ne fonctionnait pas, elle racontait toujours la même histoire, en boucle. Je lui ai alors demandé si elle voulait bien écrire pour ma soeur et moi. Elle ne comprenait pas pourquoi j’insistais autant, et pourquoi son témoignage nous tenait tant à cœur. Nous avions besoin de savoir ce qu’elle avait vécu, pourquoi elle était comme ça, si froide et distante, si peu maternelle. À un moment donné, elle a accepté, je crois qu’elle a compris que ça pourrait me permettre d’aller mieux, c’était un acte d’amour en quelque sorte. Chaque semaine, elle nous livrait un bout de son récit, un texte écrit de façon chronologique, dénué d’affect. Ce travail d’écriture a dû lui coûter, chaque semaine, elle devait s’y replonger.
Une fois son texte terminé, je l’ai retravaillé sans bousculer la construction, le sens. Mais, il me fallait traduire ses sentiments, les retranscrire. J’ai souhaité créer un écho entre nos deux expériences : ses parents se séparent et elle va vivre chez son père à quinze ans ; quand mes parents divorcent, j’ai quinze ans et je suis confiée à la garde de mon père…
Deux fois dans votre récit, vous écrivez "immoler l’enfance" pour vous reconstruire, qu’entendez-vous par là ?
Matériellement, je n’ai manqué de rien mais je n’ai pas été une enfant insouciante et heureuse. La psychanalyse m’a aidée à comprendre cette mère empêchée et à dépasser les souvenirs douloureux, à vivre avec. Autrement, je n’aurais jamais pu en “faire quelque chose”. J’ai remarqué en interviewant des dizaines d’enfants de déportés que beaucoup se sont réparés de la même façon : ils sont devenus psychologues ou psychanalystes, conteurs, réalisateurs de films, militants. Moi, avec ces livres, je me sens enfin là où je dois être, à la juste place.
Quel est l’objectif de ce livre ? Est-ce une façon de retrouver votre mère, de la rendre plus accessible, moins étrangère ?
Je voulais avant tout lui redonner l’existence qu’elle n’a pas eue, dont les nazis l’ont privée. Comme c’est sans doute le cas pour beaucoup d’enfants de déportés, ma mère n’a jamais cessé de m’être étrangère. Elle était étrangère à elle‐même, au Maroc, à ses enfants. Elle ne savait pas ce que l’on ressentait et ne cherchait pas à le ressentir. Pour survivre dans les camps, elle a sans doute dû se « cliver », mettre ses émotions et ses affects à distance et elle a continué à vivre comme ça. Avec d’autres enfants de déportés, nous avons souvent en commun la violence de nos parents, eux‐mêmes victimes d’une toute autre violence.
La Shoah aura détruit des familles sur plusieurs générations.
Peut-on aimer après avoir survécu aux camps? c’est une question fil rouge dans votre écriture. Vous avez une piste de réponse?
Je ne pense pas qu’il y ait une seule réponse, je crois plutôt qu’il y a plusieurs questions. Ma mère n’a pas su aimer ses enfants, elle n’a pas été maternelle comme ma sœur et moi aurions eu besoin qu’elle le soit. Elle n’a pas été capable de nous assurer une protection, de nous donner une sécurité intérieure. De faire en sorte que l’on puisse se sentir aimée. Après la guerre, elle a continué à vivre dans un monde parallèle dans lequel son expérience n’avait pas vraiment existé, comme si sa souffrance n’avait pas été réelle. De mon côté, comme je ne m’étais pas sentie aimée, enfant, je pensais que je ne serais pas capable d’être une bonne mère. Et puis, en 1990, j’ai donné naissance à ma fille, Lou, que j’aime plus que tout au monde. J’ai dépassé ma peur d’être une mauvaise mère, je fais de mon mieux !