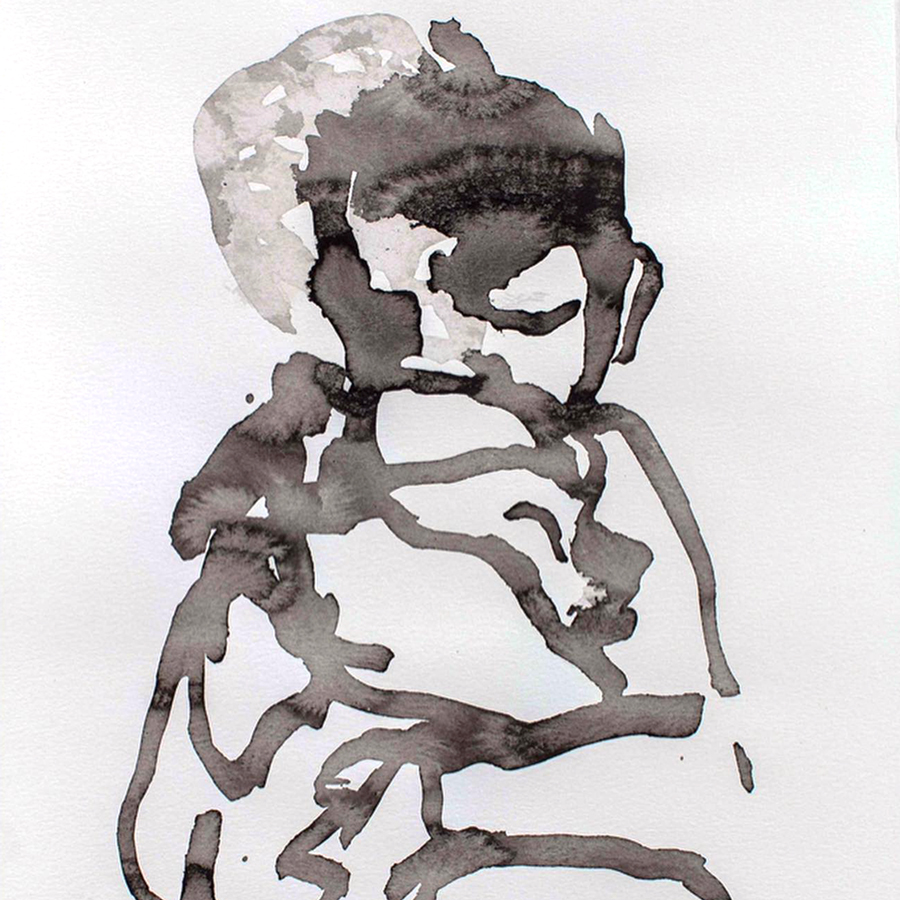La télévision peut‐elle tout montrer ? Avec 5 septembre, le réalisateur suisse Tim Fehlbaum explore l’un des moments les plus tragiques des Jeux olympiques : l’attentat contre les athlètes israéliens en 1972 à Munich. Ce drame poignant, condensé en 1h37, nous plonge dans la salle de rédaction d’ABC Sports, où les journalistes, appelés à couvrir l’événement en direct, jonglent entre éthique journalistique et quête d’images choc.
Le film suit les 48 heures intenses du 5 au 6 septembre 1972, lorsque l’organisation terroriste palestinienne Septembre noir prend en otage les membres de l’équipe israélienne, jusqu’à l’assaut final de la police allemande. À travers le personnage de Geoff Mason (John Magaro), producteur au tempérament bouillonnant, Tim Fehlbaum met en lumière les tensions qui agitent une rédaction prise au piège entre le devoir d’informer, les impératifs d’audience et les questions éthiques.
Le prix de l’image
« Peut-on montrer un homme se faire tuer à la télévision ? », questionne le personnage de Marvin Bader (Ben Chaplin), journaliste mesuré qui incarne la conscience morale de l’équipe. Contrairement à Geoff Mason, dont la priorité est d’obtenir des images à tout prix, Marvin Bader met en doute les choix éditoriaux et les implications éthiques de la couverture en direct d’un tel événement. Il appelle à la prudence pour préserver la dignité des victimes et éviter de fournir des informations qui pourraient être utilisées par les terroristes.
Car, le film soulève des questions cruciales sur la responsabilité des médias. En diffusant en direct une tentative de l’assaut de la police allemande pour secourir des otages israéliens, ABC Sports commet une erreur majeure : les terroristes suivent les images à la télévision et anticipent ainsi les mouvements des forces de l’ordre. Cette erreur fait écho à des événements récents, comme la couverture médiatique de l’attentat de l’Hyper Cacher en 2015. À l’époque, les terroristes suivaient l’évolution des opérations en direct à la télévision, et la diffusion par BFM TV de détails sensibles a également mis en danger la vie des otages.
Tim Fehlbaum parvient à restituer avec sobriété l’atmosphère d’une époque où la technologie était encore balbutiante, révélant les nombreuses improvisations nécessaires pour couvrir une crise mondiale. Un journaliste n’hésite d’ailleurs pas à se faire passer pour un athlète olympique afin de récupérer les bobines contenant des images cruciales. Les caméras avaient pu entrer dans le village olympique avant qu’il ne soit bouclé par les forces de l’ordre, mais il fallait établir un lien avec la salle de rédaction pour exploiter ces précieuses séquences.
Le réalisateur suisse se distingue également par l’usage d’archives, mêlées à des reconstitutions soignées, qui capturent l’esthétique télévisuelle des années 70 tout en renforçant le poids dramatique des événements. La tension est maintenue par une bande‐son discrète mais anxiogène, qui accompagne chaque nouvelle révélation et plonge spectateurs et personnages dans une incertitude partagée.
Avec 5 septembre, Tim Fehlbaum signe un film captivant et essentiel. Il capture l’émotion du moment tout en ouvrant un débat sur le rôle du journalisme face aux tragédies. Ce premier grand événement couvert en direct à la télévision et suivi par 900 millions de téléspectateurs dans le monde marque un tournant pour les médias et la conscience collective mondiale. Produit par Sean Penn, le film sortira le 5 février au cinéma.

Entretien avec Tim Fehlbaum
Tim Fehlbaum, réalisateur suisse‐allemand, s’est fait connaître avec ses films Hell (2011) et Tides (2021), mêlant science‐fiction et thriller dramatique. Avec son nouveau film 5 septembre, il explore la tragédie des Jeux olympiques de Munich, en 1972, à travers le prisme des journalistes, questionnant l’éthique médiatique et l’impact des images sur notre perception des drames internationaux. Nous l’avons rencontré à Paris.
Qu’est-ce qui vous a motivé à réaliser un film sur les attentats de Munich en 1972 ?
La première fois que j’ai entendu parler de cet attentat, c’était en 1999 lorsque j’ai vu le documentaire Un jour en septembre, réalisé par Kevin MacDonald, qui relate la prise d’otages des athlètes israéliens. Puis, j’ai étudié dans une école de cinéma à Munich, et même après toutes ces années, la tragédie de Munich, en 1972, reste très présente là‐bas.
Alors que le 50ᵉ anniversaire approchait, je me suis senti prêt à aborder ce sujet après mes deux premiers films. Avant d’écrire le scénario, nous avons effectué de nombreuses recherches et découvert le rôle crucial des médias ce jour‐là. Un moment décisif a été notre entretien avec Geoffrey Mason, le véritable commentateur sportif joué par John Magaro dans le film. Il nous a raconté comment lui et son équipe sont passés de la couverture des Jeux olympiques à celle de la crise. Cela nous a tellement fascinés que nous avons décidé de raconter l’histoire uniquement de leur point de vue.
Pourquoi avez‐vous choisi de limiter l’action à un studio de télévision ?
Nous voulions nous concentrer sur la perspective des médias. Le film explore également l’éthique journalistique et la tension entre information et sensationnalisme. Aujourd’hui, nous vivons dans un paysage médiatique en évolution rapide qui influence profondément notre perception des événements mondiaux, souvent sans que nous en soyons conscients. La tragédie de Munich a marqué la première fois qu’un tel acte était diffusé en direct à la télévision. Ce moment historique incite à réfléchir sur notre consommation des médias actuels et sur la puissance de la couverture en direct.
Vous avez utilisé beaucoup d’images d’archives dans le film. Était‐ce difficile de les obtenir ?
Ce n’était pas simple au début ; nous n’avions accès qu’à des extraits en ligne ou à ceux présentés dans des documentaires. Cependant, avec l’aide de Geoffrey Mason, nous avons approché ABC Sports et obtenu des enregistrements originaux. Une rencontre fortuite avec Sean McManus de CBS Sports, dont le père était le célèbre présentateur Jim McKay, nous a également permis d’accéder à d’autres images.
Le film sort dans un contexte de tensions accrues autour du conflit israélo‐palestinien. Êtes‐vous inquiet quant à sa réception ?
Nous avons terminé le montage du film avant l’escalade actuelle. Bien sûr, l’état du monde influencera la façon dont le film sera perçu, mais notre objectif est de pousser le public à réfléchir à la consommation des médias et à l’impact des technologies sur notre compréhension des événements mondiaux.
Propos recueillis par Paloma Auzéau