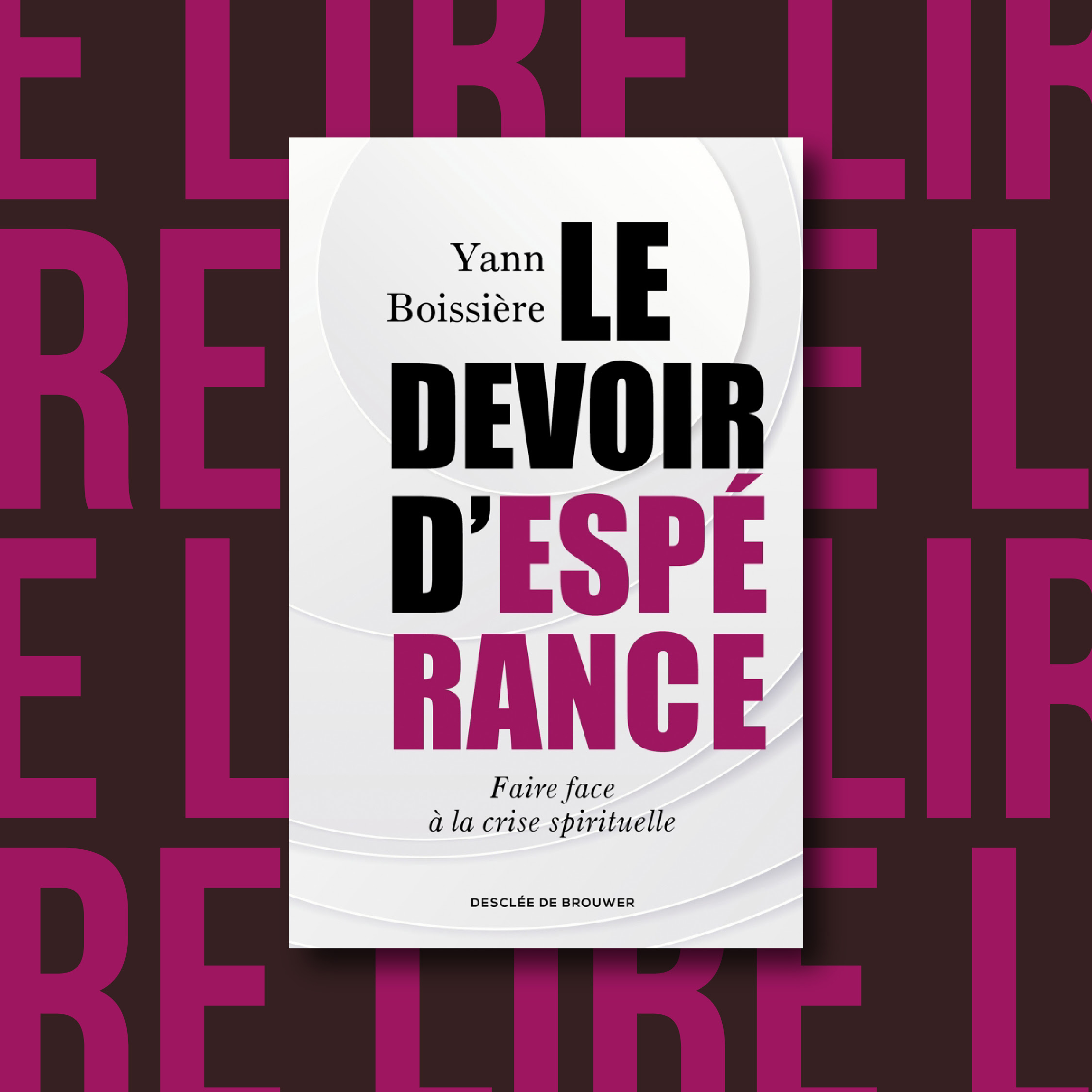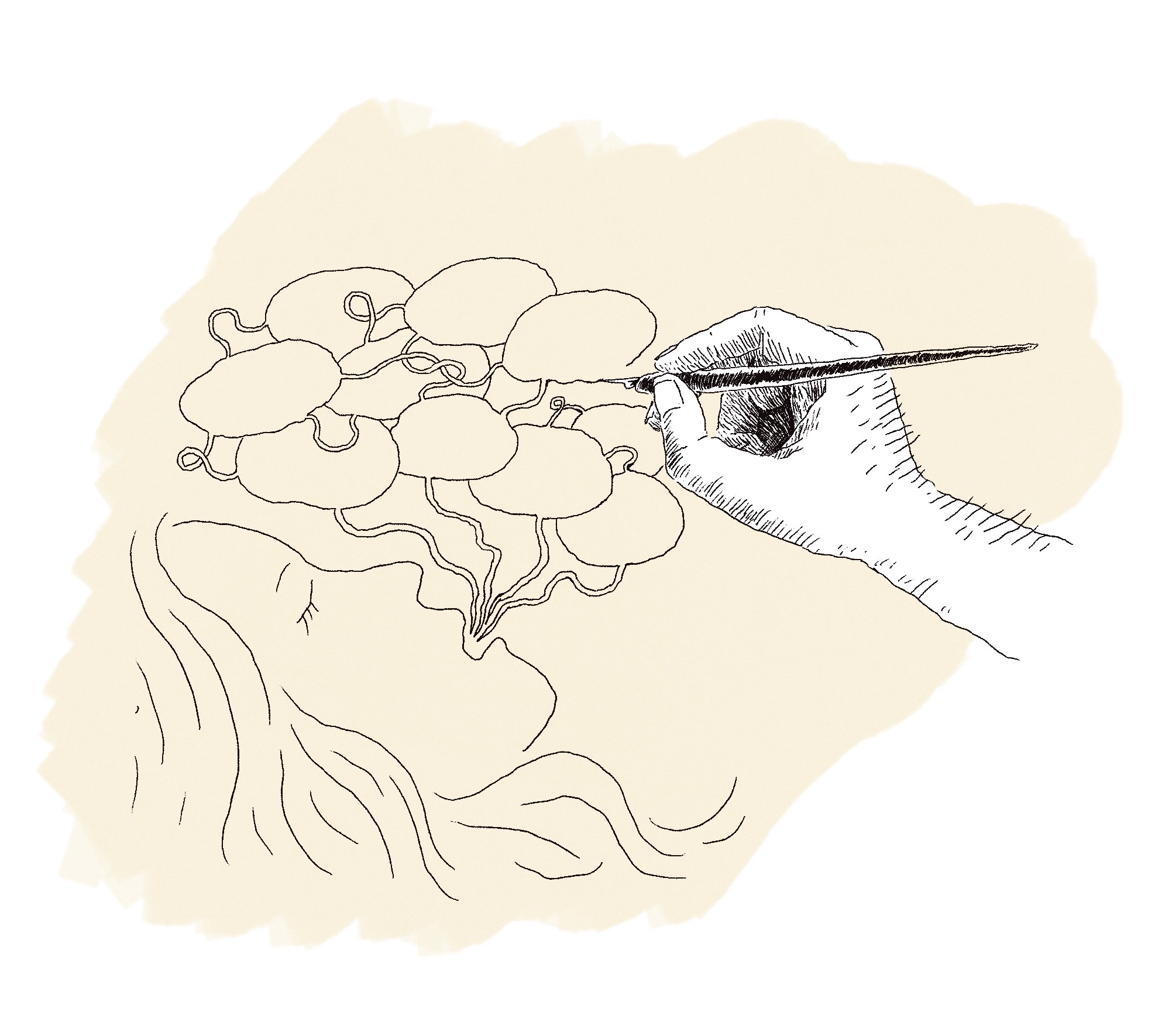Comment ? Eikha ? איכה
C’est aujourd’hui Tisha beAv, le 9 du mois hébraïque d’Av, date traditionnellement considérée comme la plus triste du calendrier juif. Une journée de jeûne et de deuil, au cours de laquelle les Juifs du monde entier commémorent les deux destructions du Temple de Jérusalem : celle du premier, en 586 avant notre ère, et du second, en 70.
Ce jour prend cette année une dimension tout particulière. Nombreuses sont les voix qui en effet s’élèvent pour souligner que la réforme judiciaire adoptée lundi par la Knesset (parlement israélien) pourrait être une forme de « troisième destruction du Temple », au sens où elle marquerait le début de la fin de l’État d’Israël comme état juif et démocratique – voire, pour les plus pessimistes, le début de la fin de l’État d’Israël tout court.
Le parallèle entre la situation actuelle et les tragédies de l’histoire ancienne est de fait troublant, et d’autant plus troublant que la tradition nous enseigne (Talmud de Babylone, traité Yoma) que la destruction du Temple aurait été causée par la sinat ‘hinam, la « haine gratuite » entre Juifs. Difficile de ne pas faire le rapprochement avec les profondes divisions qui, plus que jamais, minent le peuple d’Israël.
À Tisha beAv, la tradition veut que nous lisions le Livre des Lamentations, longue et déchirante élégie décrivant les ravages de la ville de Jérusalem et la souffrance de ses habitants à la suite de la première destruction du Temple. Le titre du livre est en hébreu אֵיכָ֣ה, eikha, mot souvent traduit par « hélas » mais qui signifie littéralement : « comment ? ».
Cette question, qui ouvre le poème, fait écho à celles que l’on pouvait lire sur les visages sidérés des manifestants suite au vote de lundi.
Eikha, comment ?
Comment en est‐on arrivés là ?
Comment le rêve sioniste d’un État juif et démocratique a‑t‐il pu ainsi laisser place à la perspective cauchemardesque d’un État illibéral et suprémaciste ?
Comment se peut‐il que le pays soit désormais gouverné par des leaders foulant aussi ouvertement au pied les valeurs qui étaient si chères à ses pères fondateurs ?
Comment la société israélienne a‑t‐elle pu se fracturer au point qu’entre ses différentes composantes, l’injure et le mépris soient désormais monnaie courante ?
Mais aussi :
Comment le pays se relèvera‐t‐il de cette épreuve ?
Comment les Juifs du monde entier pourront‐ils continuer à voir en cet État le leur si ses fondements mêmes vont à l’encontre de leurs valeurs ?
Comment pourra‐t‐on encore chanter que « notre espoir n’est pas vain d’être un peuple libre sur notre terre » si le régime devient autoritaire ?
Ces questions restent aujourd’hui en suspens et les mots des Lamentations résonnent bien tristement :
La ville au peuple multiple est comme veuve.
Elle qui était grande parmi les nations, princesse parmi les cités, la voici vouée à la servitude.
Elle pleure, elle pleure dans la nuit ; ses larmes sur la joue, elle est sans consolateur parmi tous ses amants. Tous ses compagnons l’ont trahie, devenus pour elle des ennemis.
Et, plus loin :
Que témoignerai-je pour toi ?
À qui te comparerai-je, belle Jérusalem ?
À qui t’égalerai-je pour te réconforter, jeune fille, belle Sion ?
Oui, ta brisure est grande comme la mer. Qui te guérira ?
Qui, en effet, guérira Sion ? Et comment ? Eikha ?
Selon la tradition, ce mot d’eikha peut aussi se lire, en le vocalisant différemment, ayeka, terme que Dieu emploie pour interpeller Adam après qu’il a consommé le fruit défendu et qui veut dire « où es‐tu ? ». Ou plutôt, « où en es‐tu », moralement ? « Es‐tu capable de faire face à tes erreurs et d’avancer ? » C’est à cette introspection que l’ensemble du monde juif doit aujourd’hui se livrer, pour extirper d’en son sein la haine et le mépris, et que, selon les derniers mots des Lamentations, « nos jours se renouvellent comme jadis ».