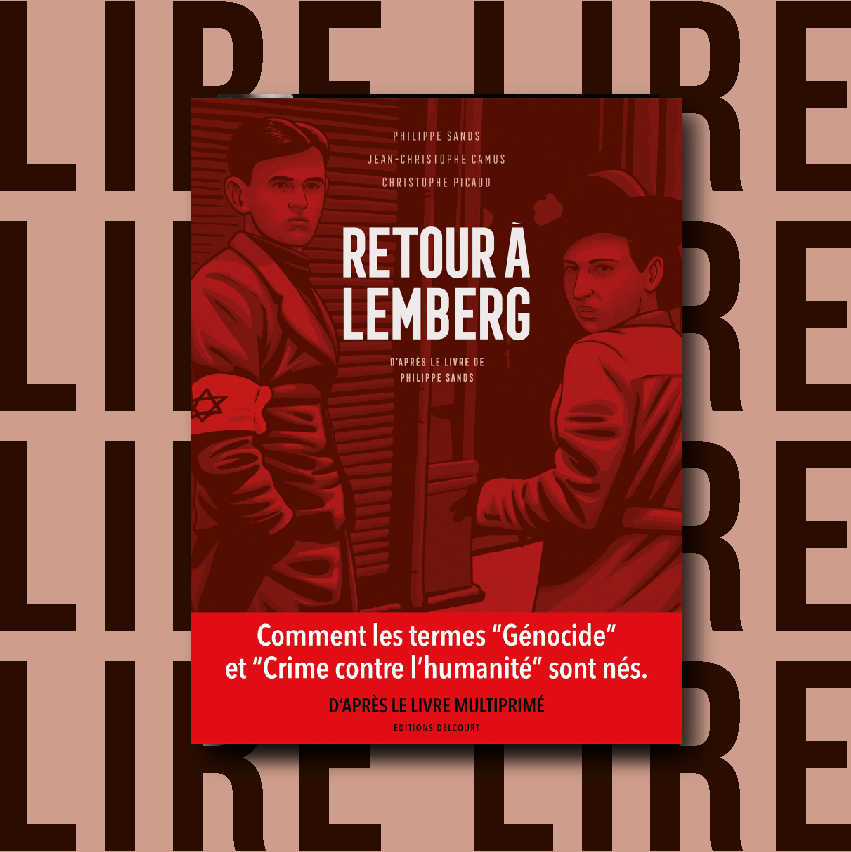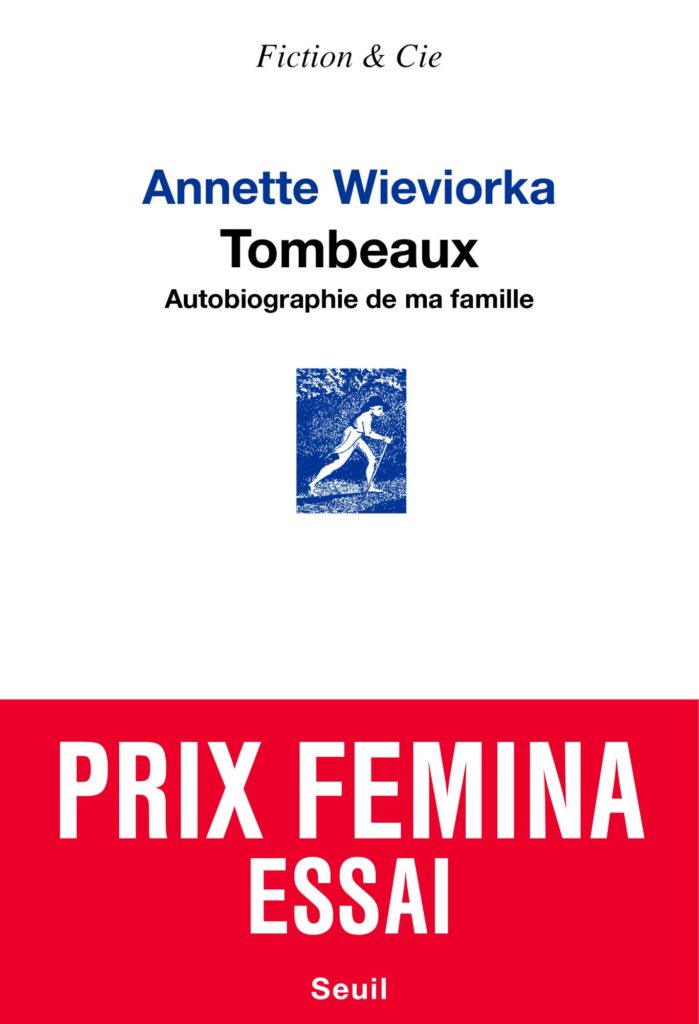
Paris, Seuil , coll. « Fiction & Cie », 2022, 21€
D’Annette Wievorka, on a toujours admiré la détermination qui est celle de tout
historien en quête de vérité, la finesse d’analyse et le génie de l’écoute qui ont permis
l’écriture d’ouvrages majeurs tels que L’Ère du témoin (2002) et Déportation et génocide.
Entre la mémoire et l’oubli (2003), ou encore la capacité à faire naître le récit collectif et
l’histoire politique du récit individuel. Tous ses ouvrages font preuve d’un souci éthique
supérieur, inatteignable sans le déploiement d’une réflexion approfondie, permanente et
renouvelée sur le rôle de la discipline « Histoire » et de son pouvoir/devoir d’édification d’un
présent et d’un avenir souhaitables. Dans Auschwitz expliqué à ma fille (1999), l’historienne
fait preuve d’une justesse de ton inégalée dans l’enseignement de la Shoah. Elle y relève le
défi de décrire avec précision l’indicible et de s’adresser dans un même élan à toutes les
générations, de manière directe, sans jamais être indélicate ni brutale.
Rencontrer Annette Wievorka, c’est rencontrer une grande‐petite‐fille, souvent grave –
comme tous les rêveurs – et parfois étonnement allègre et sémillante, comme tous ceux
conservant vivace leur âme d’enfant. La vie des siens et ses recherches insufflent une
profondeur inouïe à une phrase qui peut sembler anodine : « Si vous sortez à droite, vous
prenez la première à gauche, il y a la rue Pétrelle, et on voit les fenêtres de mon grand‐père ».
À travers l’énumération de noms de rues et de villes arpentées, des adresses de fortune
et celles plus fixes, de noms et de prénoms de membres de sa famille, en yiddish, puis
francisés, souvent changeants et parfois piégés, biffés, dissimulés pendant la guerre, combien
de poésie tragique et de correspondances involontaires, de rêverie poétique émanant d’un
passé aux contours énigmatiques, et d’un présent à la fois familier et irréel ! Quand l’œuvre de
mémoire rejoint la poésie des noms, cela donne Tombeaux. Autobiographie de ma famille.
Annette Wievorka y télescope avec délicatesse la recherche de la vérité et celle de l’hommage
aux siens – si bien rendu.
Fanny Arama
Entretien avec Annette Wieviorka

Fanny Arama : Vous souvenez-vous à quand remontent vos premières questions à vos parents sur leur jeunesse et la manière dont ils ont traversé la guerre ?
Annette Wieviorka : Je n’en ai pas de souvenir. J’ai le sentiment que ça m’a très vite intéressée, en tous cas dès mes années de lycée (à l’époque il n’y avait pas de collège, donc en 6e, 5e, 4e), j’ai dû poser des questions et je pense avoir toujours su que trois grands‐parents sur quatre étaient morts pendant la guerre. Il n’y avait pas de mot. On ne disait pas « Shoah » à l’époque, on disait « pendant la guerre ». Précisément, c’était vague.
Fanny Arama : Quand avez-vous appris que vos parents, Aby Wievorka et Rachel Perelman s’étaient rencontrés à la Libération au Bund, l’organisation des socialistes Juifs de France, située à l’époque au 110 rue Vieille-du-Temple ?
Annette Wieviorka : Je l’ai su très vite.
La recherche du temps perdu de Proust rend perceptible la transformation continuelle de la mémoire. Même aujourd’hui, après avoir écrit ce livre, après avoir beaucoup cherché, questionné, réfléchi, mon récit de leur rencontre peut encore beaucoup bouger. À chaque période de sa vie, on a un type de récit qui correspond à la façon dont sa propre curiosité bouge et à ce qu’on est soi‐même au moment où l’on réfléchit.
Fanny Arama : Leur rencontre est très romanesque…
Annette Wieviorka : Peut‐être que le récit que j’en fais est romanesque, oui. On n’arrive jamais à s’imaginer vraiment nos parents jeunes, nos parents amoureux… C’est un effort très grand. On peut dire autre chose de cette rencontre : c’est leur rencontre mais c’est beaucoup de rencontres, cette rencontre entre des gens très jeunes – ma mère n’avait pas vingt ans – au lendemain de la guerre dans des familles qui avaient été soit très amputées (c’était le cas de la famille de mon père), soit moins amputées, mais très bousculées (c’était le cas de la famille de ma mère). Dans une famille il y a toujours une sorte de pivot qui tient ensemble la famille. Dans ma famille maternelle, c’est le décès de la mère de ma mère qui a désarticulé la famille, même si le lien et la solidarité entre ma mère, son frère et sa sœur n’ont jamais posé de question.
Fanny Arama : Pouvez-vous nous parler du Bund, ce lieu d’utopie, de jeunesse, d’espoir sans cesse renaissant ?
Annette Wieviorka : La lecture du Réveil des jeunes (la publication du Bund, chacun peut aller le consulter au Mémorial de la Shoah ou à la BNF) est très intéressante à cet égard. Ceux qui y écrivent restent dans l’utopie : le socialisme fera disparaître l’antisémitisme, on peut aller vers un monde meilleur. Alors que ces jeunes sortent d’une tragédie globale qui a affecté le destin de pratiquement tous ceux qui écrivent dans le journal !
En écrivant et en réfléchissant, je crois que la question de l’âge est déterminante. Ma mère, pendant la rafle du Vél d’Hiv, est en train de terminer sa lecture des Thibault (de Roger Martin du Gard), qui l’intéresse beaucoup plus que la présence dans la rue des policiers en train de rafler des Juifs… Mes parents vivent l’exode de juin 1940 comme un moment très exaltant, de grandes vacances, d’aventure. Je n’ai pas de témoignage direct de la manière dont leurs parents l’ont vécue mais je suppose qu’eux, les parents, l’ont vécue dans l’anxiété pour leurs enfants. À certains âges, on est jeune, on a la vie devant soi, on a une force vitale. C’est ça aussi qui se voit après la guerre. Cette envie de vivre, on la rencontre y compris chez ceux qui, très jeunes, rentrent d’Auschwitz.
Fanny Arama : Vous dites : « Dans ma famille, comme dans celle de mes cousins, même si nous étions de toute évidence Juifs, rien ne nous a été transmis. » (p. 170). Comment avez-vous fait face à ce défaut de transmission ?
Annette Wieviorka : Peut‐être que nous a été transmis plus que je ne le crois. Je ne dirais pas qu’il y a eu défaut de transmission, mais ce qui est certain, c’est qu’il y a eu une rupture. En mai 1945, quand Aby, mon père, prend conscience que son père ne reviendra pas, alors qu’il avait écrit beaucoup dans Le Réveil des jeunes (c’était un véritable journal avec une diffusion nationale et un dépôt légal), il cesse totalement d’écrire. Quand nous étions loin, c’est ma mère qui écrivait et mon père ajoutait « Baisers, papa ». Certes, il a repris une forme d’écriture à la retraite quand il s’est mis à traduire les auteurs yiddishs. La rupture a aussi été géographique. Mes parents ont trouvé un tout petit appartement de 25 m2 à Vanves. Ensuite, nous sommes allés habiter à Ermont. Si je regarde ce qu’ont été notre enfance et notre adolescence, elles se sont faites dans un monde où la sociabilité de voisinage, la sociabilité de l’école n’était pas juive. Je suis allée regarder le recensement de l’ensemble où nous habitions qui s’appelait le canton de Vanves : mon père était le seul étranger. Vanves était une municipalité très catholique. L’environnement immédiat n’a jamais été un environnement qui nous ressemblait. Je vois la différence avec des amis qui sont allés par exemple à Jules Ferry, où toute une partie des élèves avaient la même histoire … Je pense que cela a joué aussi.
Fanny Arama : Vous portez un regard et une attention particulière à la mémoire des lieux. Vous restituez l’intégralité des adresses des chambres et des appartements dans lesquels ont vécu les familles respectives de vos parents à leur arrivée à Paris. Pourquoi est-ce si important pour vous ?
Annette Wieviorka : Pour moi les lieux sont vraiment importants. Si vous sortez à droite, vous prenez la première à gauche, il y a la rue Pétrelle, et on voit les fenêtres de mon grand‐père.
Il y a un art de la mémoire qui est un art des lieux.
Je n’ai pas de rapport avec les cimetières, mais quand je me promène dans Paris, à chaque adresse, à chaque station de métro de gens que j’ai aimés et qui ne sont plus, je pense à eux.
J’habite le quartier de mes grands‐parents, où ma mère a grandi. Samedi je faisais des courses avec mon petit‐fils, le plus jeune qui va avoir 7 ans. Nous sommes passés devant le 67 rue de Rochechouart. Je lui ai expliqué que mon grand‐père habitait là. On est allés acheter un ballon au bazar pakistanais et je lui ai expliqué que, dans mon enfance, c’était la confiserie Thillet. Ce n’est pas une question de transmission.
Je préfère le terme de lien. Le fait que j’établis pour moi et j’espère pour ma descendance des liens est important parce qu’on est nés sans liens. Quand je suis rentrée de Chine, j’ai eu le sentiment d’êtreBodenlos – j’utilise le titre d’un recueil de nouvelles de Wolf Wievorka, traduit par les « déracinés ». Bodenlos en réalité, c’est « sans sol », « sans plancher ». Nous n’avons pas eu de grands‐parents, sinon un grand‐père qui était un vrai taiseux. Pas de famille, pas de génération d’avant. Ce sentiment a induit ce besoin de savoir où je suis, de voir les lieux, il y a peut‐être aussi une influence littéraire inconsciente. Chez Perec, cette importance des lieux vient peut‐être du fait qu’il n’y a pas de lieux avant, on n’a pas de maison de famille, de maisons de campagne, de grenier.
Fanny Arama : Vous écrivez avoir voulu, pendant longtemps, consigner « l’histoire de tous plutôt que celle des miens ; l’évitement du « je » au profit du « nous » » (p. 304). Pourquoi mettre autant à distance le « je » ?
Annette Wieviorka : C’est une question un peu compliquée. J’ai toujours voulu faire des livres. Je ne dis pas écrire, je dis faire des livres. Quand j’ai commencé à écrire l’histoire de Wolf Wievorka à la fin des années soixante‐dix (c’est lui seul qui m’intéressait à l’époque), j’ai rassemblé une documentation, j’ai commencé à écrire et j’avais suffisamment de regard sur ce que je faisais pour voir que c’était vraiment mauvais. Je n’avais pas « trouvé ». Peut‐être que j’ai été plus à l’aise dans l’écriture de livres d’histoire. Mais j’ai toujours eu la préoccupation du collectif, même en écrivant mes « tombeaux ». C’est une histoire familiale, mais j’ai aussi le souci que d’autres se retrouvent dans cette histoire.
La première histoire qui m’ait intéressée, c’est l’histoire du mouvement ouvrier, que je n’ai pas totalement abandonnée. Dans ma bibliographie, Auschwitz écrase tout ! On ne voit pas le reste. Mais j’ai quand même écrit Maurice et Jeannette (Biographie du couple Thorez, 2010), sept cent pages, cinq années de travail, sur le couple qui était à la tête du Parti Communiste. J’ai continué à m’intéresser au mouvement ouvrier, au communisme, à l’Union soviétique, à la Chine.
Puis quand j’ai découvert le Livre du souvenir de la ville natale de mon grand‐père, mon premier réflexe – mon père ne connaissait pas son existence, il avait abandonné ce monde, suspendu ce monde après la guerre – je me suis dit « C’est extraordinaire ! ».
Si je regarde l’ensemble de ce que j’ai écrit, y compris ma thèse, le récit collectif passe toujours par le récit individuel, par le témoignage. Le livre du souvenir, c’est ça, Déportation et génocide, tout une partie sur le témoignage, c’est ça. Je pourrais citer tous les autres livres où je fais toujours usage du récit individuel. La façon dont l’histoire a été vécue et perçue par des gens ordinaires.
Dans ce sens, il y a toujours un va‐et‐vient entre la grande histoire, les mécanismes d’ordre général, et la façon dont cette grande histoire est vécue. Il y a toujours des « je », même si ce ne sont pas les miens.
Fanny Arama : Pendant l’Occupation allemande, la rumeur est un acteur décisif de l’histoire des Juifs de France. Comment la prenez-vous en compte dans votre travail d’historienne ?
Annette Wieviorka : Un des premiers historiens à avoir étudié la rumeur était Georges Lefebvre dans La Grande peur de 1789 (Paris, Armand Colin, 1932). Marc Bloch a aussi écrit un texte majeur sur la rumeur : Réflexions d’un historien sur les fausses nouvelles de la guerre, extrait de Souvenirs de guerre, 1914-1918 (Paris, Armand Colin, 1969).
Ce que les gens croient peut être un acteur collectif et individuel.
Je vais donner un exemple : le 6 février 1934, tous les historiens montrent que les manifestations parisiennes d’extrême droite n’étaient pas une tentative de coup d’État. Mais c’est la croyance en cela qui a suscité le Front Populaire.
La rumeur est toujours accentuée quand il n’y a pas de liberté d’expression. On a du mal à faire comprendre, notamment aux jeunes, que pendant la guerre, il n’y a pas de presse libre ni de radio, que les gens sont contraints à aller chercher l’information et soumis à la rumeur. Certains sont plus lucides, plus pessimistes que d’autres. Je cite cette boutade qu’on attribue à Billy Wilder : « Les optimistes ont fini à Auschwitz, les pessimistes à Hollywood ».
La lucidité, contrairement à ce qu’on entend souvent dans les débats publics, n’implique pas la possibilité d’être sauvé.
Dans ma famille, je prends l’exemple de Wolf Wievorka. C’était un journaliste « sociologue » : il allait, comme il disait im gas, dans la rue – il passait beaucoup de temps à parler dans les cafés, avec les Juifs (son milieu et son centre d’intérêt, c’était la population juive). Quand commencent à arriver les réfugiés allemands, autrichiens, tchèques, il est très attentif à ce qu’ils racontent du nazisme. Il fait une série de portraits dans le Parizer Haynt (le grand quotidien yiddish de l’époque) et dit, au début de l’occupation allemande, avec une grande lucidité : « Je ne serai jamais là où sont les Allemands ». À partir de 1940, il écrit aux États‐Unis pour essayer d’obtenir un visa, sans succès. En 1942 il écrit une lettre désespérée au directeur du journal yiddish de New York, le Forward, dans lequel il avait écrit, disant « Si je ne viens pas, je meurs ». Il le savait. Il a été arrêté dans la souricière qu’était Nice parce qu’il n’a pas pu partir, pas parce qu’il ne le voulait pas. La connaissance n’empêche pas l’impuissance, et je pense que c’est bon de le rappeler, parce qu’une sorte de lieu commun circule selon lequel : « Ils savaient tout ».
Fanny Arama : Vous avez souhaité refaire le trajet effectué par votre père Aby Wievorka et par son frère Méni quand ils passent le col de Coux en octobre 1942 pour se réfugier en Suisse. Vous dites avoir voulu mettre vos pas dans les leurs. Qu’est-ce que cette expérience sensible apporte à l’historienne ?
Annette Wieviorka : Les lieux permettent de mieux décrire, et d’écrire soi‐même. J’ai fait ça pour d’autres livres. Pour Auschwitz, 60 ans après (2005), je suis beaucoup allée sur les lieux. Pour 1945. La découverte (2015), j’ai mis mes pas dans ceux du journaliste Meyer Lewin et du photograhe Eric Schwab dans leur découverte des camps. Le désir de mettre mes pas dans les leurs me permet de mieux imaginer et d’écrire. Et peut‐être. Si, y compris dans ce livre, je suis restée historienne (j’ai cherché à être exacte), il y a aussi une part de construction et de mise en récit, à laquelle l’imagination participe. La technologique d’aujourd’hui permet de connaître des détails : le temps qu’il faisait au moment d’une action, le passage du col de Coux par exemple, s’il y avait la lune, etc. Ce sont des moyens de décrire plus justement.
Fanny Arama : Vous dites, lors d’un passage sur Henri Kunstlinger qui a fait passer Aby et Méni en Suisse puis qui a été déporté dans le dernier convoi en direction d’Auschwitz en août 1944 qu’« il ne faut pas toujours croire les archives » (p. 269) : comment fonctionne votre rapport à l’archive et éventuellement aux inexactitudes qu’elle peut parfois charrier ?
Annette Wieviorka : Vieillir a beaucoup d’inconvénients mais quelques avantages : après quarante années de recherche, tout le monde vous connaît !
Je bénéficie de beaucoup d’efficacité de la part des centres d’archives. Pour mes recherches sur Henri Kunstlinger, qui fait l’objet d’une excellente notice dans le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier qu’on appelle le Maitron du nom de son créateur), j’ai interrogé les spécialistes lyonnais. Ils m’ont fourni les documents de son internement à Montluc. Mais, dans un premier temps, ils ont suggéré qu’il avait fait partie de ceux qui ont été massacrés dans les derniers temps de l’Occupation où les prisons ont été vidées et les internés massacrés et inhumés anonymement dans des fosses communes. Si je m’étais arrêtée là, j’aurais écrit : « On ne sait pas comment il est mort ». Il a en fait été déporté dans le convoi du 11 août 1944 que j’appelle dans mon langage à moi « le convoi Barbie », puisque c’est le convoi qui a été beaucoup évoqué lors du procès de Klaus Barbie. Il était composé de déportés Juifs et de déportés résistants. C’est un convoi qui est parti et arrivé sans liste. La reconstitution a été difficile : d’ailleurs, dans le premier Mémorial de Klarsfeld, il n’y a pas Kunstlinger. Et puis j’ai trouvé la trace de sa mort au Revier, à l’hôpital d’Auschwitz, sur une archive du musée d’Auschwitz qui est sur Internet. Soudain, il y a eu une certitude.
Souvent, les archives enregistrent la version du témoin. Je vais donner mon exemple préféré. Wolf Wievorka, dans Le Mémorial de la déportation des Juifs de France de Serge Klarsfeld, est né à Minsk. Je dis à mon père : tu ne m’avais jamais dit qu’il était né à Minsk ! Il me répond : Penses‐tu, il n’est jamais né à Minsk, la preuve : je peux te montrer les vrais‐faux papiers ! Jai (ici même) le magnifique passeport russe avec le sceau en cire, le vrai passeport. Qu’est-ce qu’il y a de faux ? Les données que Wolf Wievorka a déclarées. Il déclare qu’il est né à Minsk ; avec les révolutions russes, on ne peut pas vérifier les identités. Il est facile d’être réfugié russe à l’époque. Vous trouvez donc dans l’archive des données dues à l’intention du témoin.
L’idéal, pour un historien, c’est d’avoir le témoignage et l’archive, ce qui permet de recouper l’information.
Un autre exemple que je n’ai pas cité dans le livre : dans l’interrogatoire de police de Chaskiel Perelman, mon grand‐père maternel, il déclare avoir fait son service militaire pendant la guerre de 1914 en Pologne. Je m’en suis étonnée auprès de ma mère qui m’a raconté que, quand il s’est présenté au conseil de révision, on lui aurait dit qu’il ferait honte à l’armée polonaise ! Il était tout petit : 1m50. Il n’a jamais été intégré dans l’armée.
L’archive n’est pas un document à part. Elle demande une critique, plusieurs vérifications sont nécessaires.
Le minimum pour être historien, c’est de recherche la vérité, l’exactitude. Il y a aussi une sorte de flair de l’archive, d’ordre quasi policier que, personnellement, j’aime énormément. Le temps perdu n’est jamais perdu : on trouve parfois ce qu’on ne cherche pas. On ouvre un carton d’archive et on tombe sur un document dont on ne soupçonnait pas l’existence.
Fanny Arama : Vous n’avez pas souhaité faire figurer des photographies de votre famille, de Wolf, de Guitele et de leurs enfants, ou celle du mariage de Berthe dans votre ouvrage, que pourtant vous décrivez. Pourquoi ?
Annette Wieviorka : C’est un exercice littéraire. En décrivant la photographie, je permets aux lecteurs de l’imaginer.
J’ai mis en circulation deux photos. Une, de portée générale, est cette photo incroyable de mon grand‐père et de ma grand‐mère allant se faire photographier, habillés comme des princes (ils étaient pauvres mais ils étaient tailleurs), avec l’étoile, avec une sorte d’arrogance. Ce sont mes grands‐parents, mais elle dit aussi quelque chose de la réaction des Juifs au port de l’étoile.
Une autre, est la photo de cette famille un peu baroque, celle de mes grands‐parents du côté paternel, qui s’installent avec cinq enfants dans Paris en vivant comme ils pouvaient, avec pour mon grand‐père, Wolf, une seule passion, celle de la littérature et de la culture. Je pense que cela nous a été transmis. Je ne sais pas comment, mais ça nous a été transmis !
Fanny Arama : Vous dites, au chapitre intitulé « Errances », « des pans de notre histoire sombrent dans un irrémédiable oubli qui n’est ni refoulement ni occultation et que nous cherchons en vain à retrouver » (p. 183). En tant qu’historienne, quel est votre rapport à l’oubli ?
Annette Wieviorka : L’oubli est probablement nécessaire, parce que si tout était rempli, on ne pourrait pas faire d’histoire. Mais chacun de nous oublie une partie de ce qu’il a vécu ou qui lui a été raconté, enseigné, sans qu’il n’y ait nécessairement refoulement ou occultation. J’ai pensé que personne d’entre nous n’avait jamais entendu évoquer le nom d’Henri Kustlinger qui a fait passer Aby et Méni Wieviorka en Suisse en 1942. Alors que je cherchais des renseignements sur les deux camps camps de réfugiés en Suisse où Aby et Méni avaient été internés, Girenbad et Arisdorf, le second surtout qui n’a laissé aucune trace, j’ai eu l’idée de rechercher parmi les très nombreux témoignages vidéo qui ont été collectés ces trente dernières années et qui ont été indexés. L’historienne Constance Paris de Bollardière qui, à l’American University of Paris, gère toutes les collectes, retrouve deux témoignages qui évoquent ces camps, ceux de Méni Wieviorka et d’un de ses amis. Or c’est moi qui avais procédé à ces entretiens en en 1992, il y a presque trente ans ! Je l’avais totalement oublié.
La nouvelle de Borges Funes ou la mémoire montre que les hyper‐mnésiques ne peuvent pas penser. De même, quand vous écrivez un livre, vous devez « oublier » de nombreuses histoires latérales : combien le lecteur peut‐il en intégrer ?
Peu après la disparition de Chantal Akerman, j’ai entendu sa monteuse Claire Atherton raconter : « Quand avec Chantal on était en salle de montage et qu’on regardait un un magnifique plan, on se posait la question de le garder ou de le couper. Chantal disait : « Qui perd gagne ». Le film gagnait en coupant certains plans. De même, l’histoire gagne à ne pas tout raconter.
Fanny Arama : Vous avez été professeure d’histoire dans le secondaire pendant vingt ans. Que retenez-vous de votre enseignement de la Shoah et de sa réception à cette époque ?
Annette Wieviorka : Quand je suis rentrée de Chine en 1976, l’enseignement de la Shoah n’était pas au programme. J’ai été mutée en 1981 au lycée Voltaire, où il y a une tradition de présence juive. À partir des années quatre‐vingts, j’ai enseigné la Shoah « normalement ». C’est toujours ma conviction que cela appartient à l’histoire et que ce ne doit pas être enseigné comme une morale. Dans ces années, j’ai passé à mes élèves deux films, La mémoire meurtrie, qui montait des images de la libération de Bergen Belsen par les Britanniques et des témoignages de survivants, et la partie de Jan Karski de Shoah. Si je les avais choisis, c’est parce que, dans les deux cas, un tiers (Karski ou les survivants) introduisait en quelque sorte les élèves. Je ne voulais pas qu’ils soient confrontés directement à la violence des images. Jan Karski raconte le ghetto ; en quelque sorte, il y conduit les élèves. En 1987, au moment du procès Barbie, nous avons reçu la directive de l’éducation nationale d’en parler à nos élèves, hors du programme. Les miens m’ont dit « Encore ?! ». Je leur ai proposé de commencer, et d’arrêter s’ils avaient le sentiment qu’ils savaient déjà tout. Il n’y a pas eu de problème. Car leur sentiment de saturation s’accompagne d’une grande ignorance, et il est possible de les intéresser. Je continue à aller dans les collèges et lycées dans la mesure de mes disponibilités et de mon énergie. Je ne recherche jamais le pathos, mais à mettre un peu d’intelligence jusqu’où on peut en mettre. Libres à d’autres d’envisager les choses autrement. On peut passer par des œuvres en les choisissant bien : Si c’est un homme de Primo Levi a été au programme du bac de français en 2002.
Fanny Arama : Vous avez recueilli le témoignage de votre oncle en 1992, Roger Perelman, revenu d’Auschwitz après la guerre. Comment avez-vous appréhendé le moment du questionnement ?
Annette Wieviorka : Mon oncle Roger était un immense médecin, un homme très impressionnant. Ce qui m’a aussi intéressé dans les récits qu’il a faits (dans Le Monde du 20 mars 2005) et ses mémoires (Une vie de juif sans importance, Robert Laffon, 2008), c’est le fait que j’en connaissais les grandes lignes. Il est rentré en août 1945. On connaissait l’épisode le plus « romanesque », il a été fusillé et s’est extrait d’un tas de cadavre.
Fanny Arama : Avez-vous déjà rencontré des résistances au cours de témoignages ?
Annette Wieviorka : Très peu.
Les gens parlent. S’ils se sentent écoutés, questionnés, ils parlent.
Simone Veil la première a dit : « On voulait parler mais on ne voulait pas nous écouter ». Ce sont nos propres barrages qui font qu’il y a des questions qu’on n’ose pas poser. Les gens parlent plus qu’on ne veut bien le dire.
À chaque fois que j’ai posé des questions, y compris sur des épisodes très douloureux, on m’a répondu.
Fanny Arama : Quel est votre rapport à Israël aujourd’hui ?
Annette Wieviorka : J’y vais ou j’y allais souvent avant le COVID, je suis très attachée à ce pays. Attachée et inquiète. Une inquiétude qui n’est pas simplement morale, c’est une inquiétude pour le devenir de l’État. Parfois, je suis saisie par un sentiment d’aporie : l’assimilation n’a pas empêché le nazisme. Wolf Wievorka écrit en 1938 qu’« il est si difficile d’être Juif et impossible de ne pas l’être ». En effet le nazisme et Vichy ont rendu impossible le fait de ne pas être juif : vous pouviez être converti depuis X générations, vous restiez juif. Les théories racistes ont désigné comme Juifs même ceux qui ne voulaient pas l’être. Je pense qu’on peut être légitimement inquiet pour un État qui n’a que 75 ans, et dont on peut craindre aujourd’hui qu’il ne sombre dans la guerre civile. La montée des Haredim est aussi inquiétante. Quand je veux être un peu cynique, je pense que Ben Gourion voulait qu’Israël soit un État comme un autre. Dans un sens, il l’est, avec une partie de la classe politique corrompue, des radicalismes religieux. On aimerait qu’Israël soit encore celui des pionniers, de la génération qui a créé l’État. Mais c’est une nostalgie inutile.