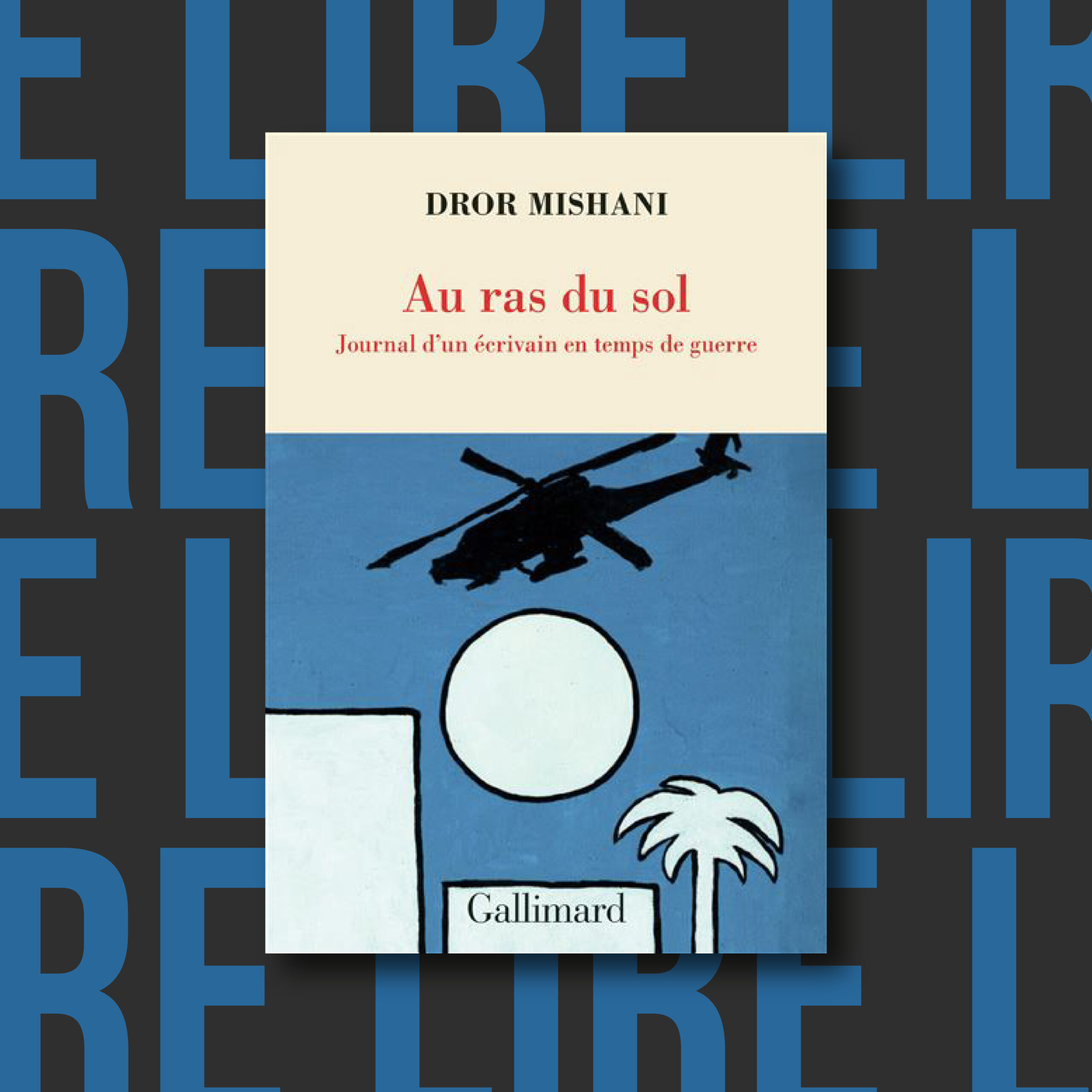Aujourd’hui, je suis un peu bloquée.
Je n’ai envie de raconter que des choses joyeuses, des anecdotes amusantes du quotidien Telavivi.
Le come‐back du soleil, Tou Bishvat (on a planté des aromates à l’oulpan, le cours d’hébreu), le compte insta d’un Japonais en Israël, les chocolats pour la Saint‐Valentin à Sheinkin chez Cardinal, le boucher qui tape comme un fou sur un morceau de viande pour vous en faire le meilleur carpaccio, un verre chez ma voisine en chaussons et surtout la prof de pilates qui connaît mon nom comme les vraies habituées.
Trop‐plein de la cruauté et de la folie, je n’en peux plus d’en parler, d’y penser. Je n’en peux plus de voir chaque jour les récits des otages sortis de captivité, notamment sur les conditions de détention de ceux qui sont restés derrière. Je n’en peux plus d’apprendre la mort de jeunes soldats, d’un grand‐père, Shlomo Mansour, qui a survécu à un pogrom en Irak, fondé un kibboutz ici, s’est fait kidnapper chez lui le 7 octobre et tué en captivité dans un tunnel à Gaza. Je n’en peux plus de penser à toute une génération de jeunes, ici, en post‐trauma d’avoir passé plus d’un an à la guerre, d’avoir vu mourir leurs amis les plus proches, d’avoir été blessés, d’avoir perdu un bras, une jambe, leur santé mentale. Je n’en peux plus de penser aux familles des otages qui souffrent dans leur chair et au monde qui leur tourne le dos. D’entendre les récits de mes amis qui s’occupent des délégations de ces dernières à Washington. “À partir de maintenant, les libérations seront probablement de pire en pire”, prédisent certains. On en attend trois samedi : le Hamas avait décidé en début de semaine que les otages ne seraient pas libérés et a changé d’avis à la suite des déclarations de Trump. Sagui Dekel, Sasha Alexander et Yaïr Horn devraient être libérés.
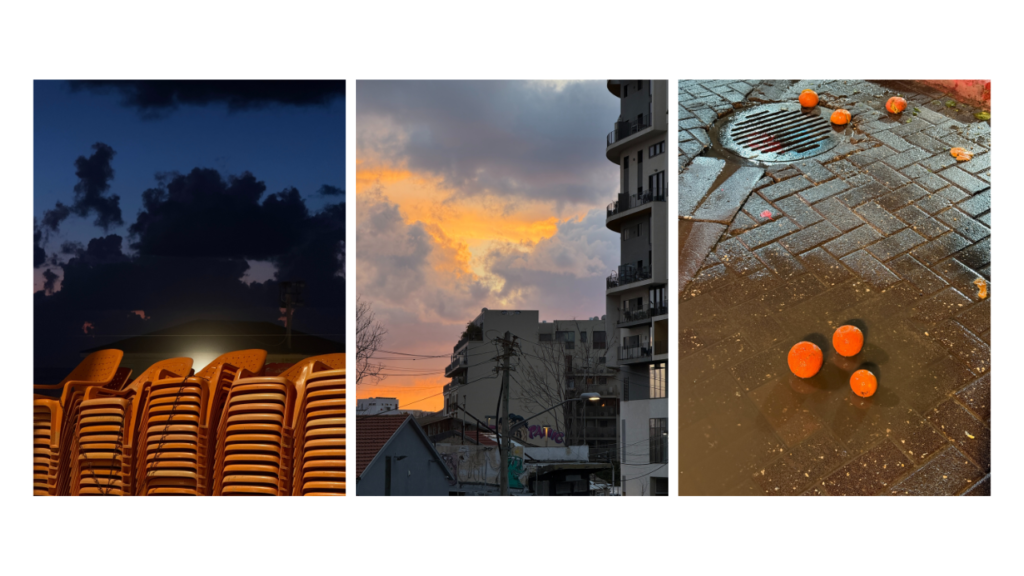
Je n’en peux plus et à la fois, ceux qui y sont confrontés en direct, eux n’ont pas le choix de ne plus en pouvoir. Ils se battent pour survivre, ramener les leurs à la maison, reconstruire leur vie pour ceux qui le peuvent. Par moments, je me dis que la chose “juste” à faire, c’est de souffrir avec eux. De quel droit je me plains de ressentir un trop‐plein ?
Je suis plus que privilégiée, c’est une certitude. Souvent, je pense à mes grands‐parents qui ont traversé des périodes sombres de l’Histoire, vécu des moments plus difficiles qu’il est possible d’imaginer, en Europe de l’Est ou en Afrique du Nord. Ils nous ont toujours enseigné que le plus important c’est la vie et “kiffer”. Mon grand‐père, rescapé d’Auschwitz et des marches de la mort, se serait lui‐même défini comme un “kiffeur” s’il avait connu le mot. Peut‐être qu’il se moquerait de ma “bobo‐itude telavivi”, comme l’a bien souligné un commentateur de l’article de la semaine dernière. Peut‐être qu’il se réjouirait aussi que je partage avec vous des expériences banales et gaies de mon quotidien ici.
Alors “juste” ou pas, je crois qu’aujourd’hui, je vais choisir de vous raconter la vie du côté positif : haïm toutim comme on dirait ici et dont la traduction littérale donnerait “la vie fraises”.

Cette semaine, c’était Tou Bishvat, le nouvel an des arbres. Traditionnellement, les enfants de toutes les écoles sont mobilisés pour planter des arbres et chanter des chansons des pionniers de l’État d’Israël. C’est exactement ce qu’on a fait à l’oulpan. Pour information, j’ai planté de la mélisse. Cette fête a une résonance particulière en Israël car elle célèbre le fait d’avoir fait naître d’un désert une terre agricole fertile. Même à Tel Aviv, il y a plein de rues où poussent des orangers, qui regorgent en ce moment de fruits. Cette fête, c’est aussi un joli clin d’œil aux milliers de bénévoles des quatre coins du monde qui se sont mobilisés depuis un an et demi pour aider les agriculteurs, en manque de main d’œuvre après le 7 octobre. Parmi eux, on compte une majorité de Français réunis autour de l’association “Sauvons notre Terre”, créée par David Djian. Porter des kilos d’avocats durs comme du bois dans des sacs en bandoulières, passer la journée à quatre pattes pour ramasser des fraises ou encore grimper dans les arbres pour attraper citrons, oranges ou pamplemousses, toutes les générations y passent.

Alors, joyeux nouvel an des arbres. Et si vous n’avez pas la main verte, plantez d’autres types de graines. Peut‐être des pensées joyeuses, des idées nouvelles, des actions qui créent du lien. Qui sait, peut‐être qu’on arrivera, nous aussi, à faire d’un désert, une terre fertile ?