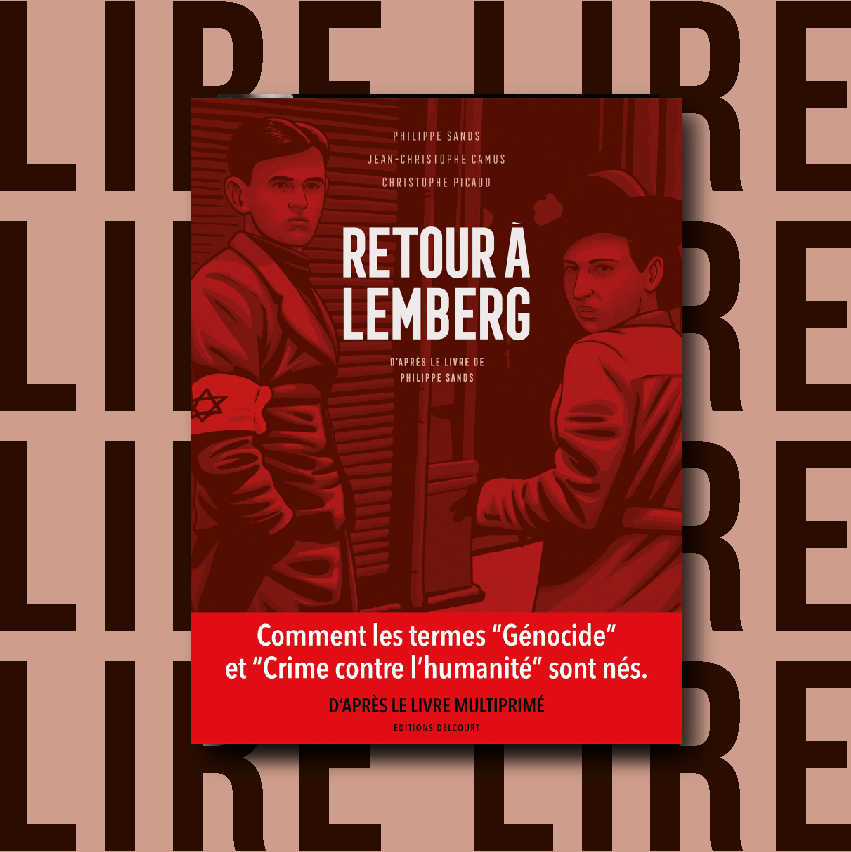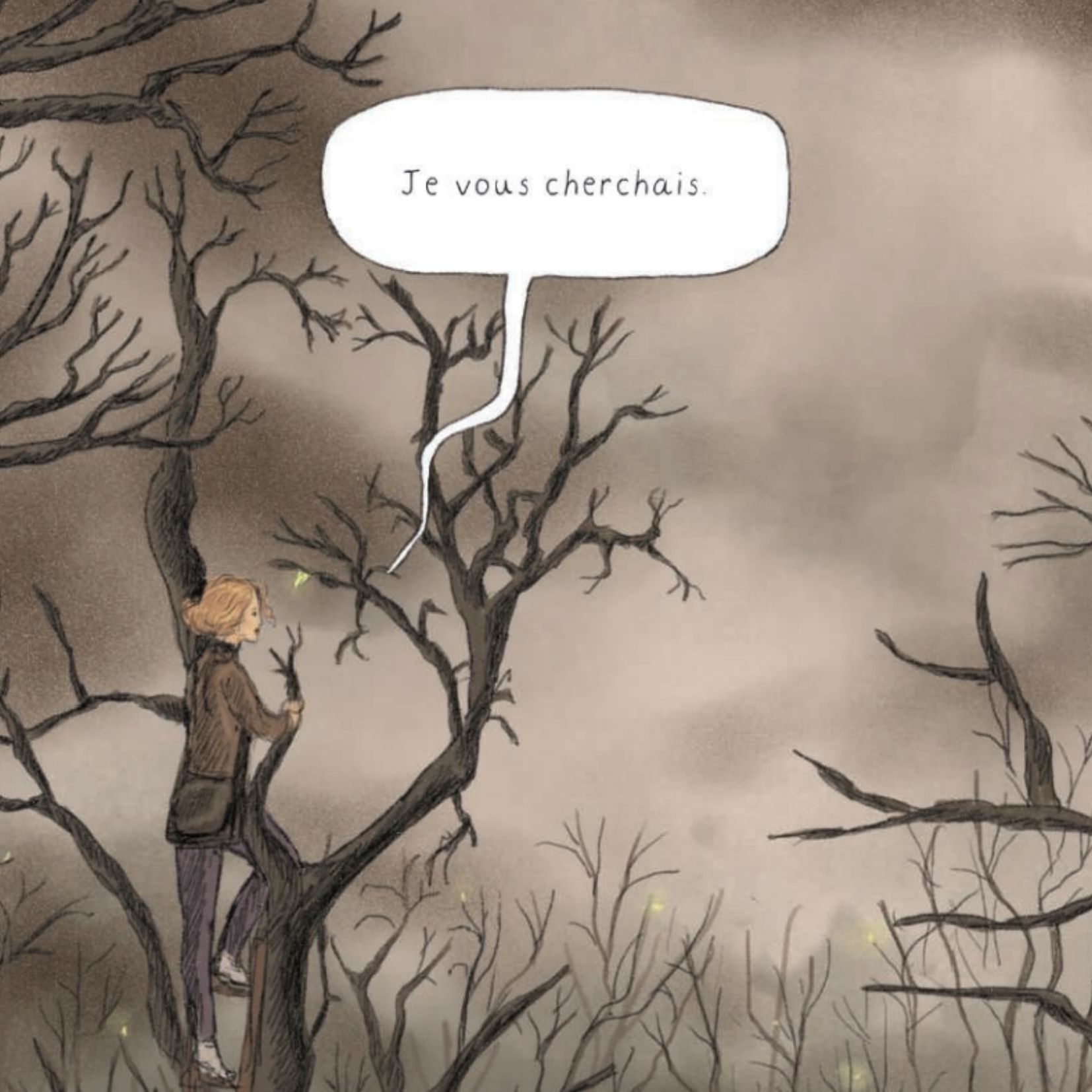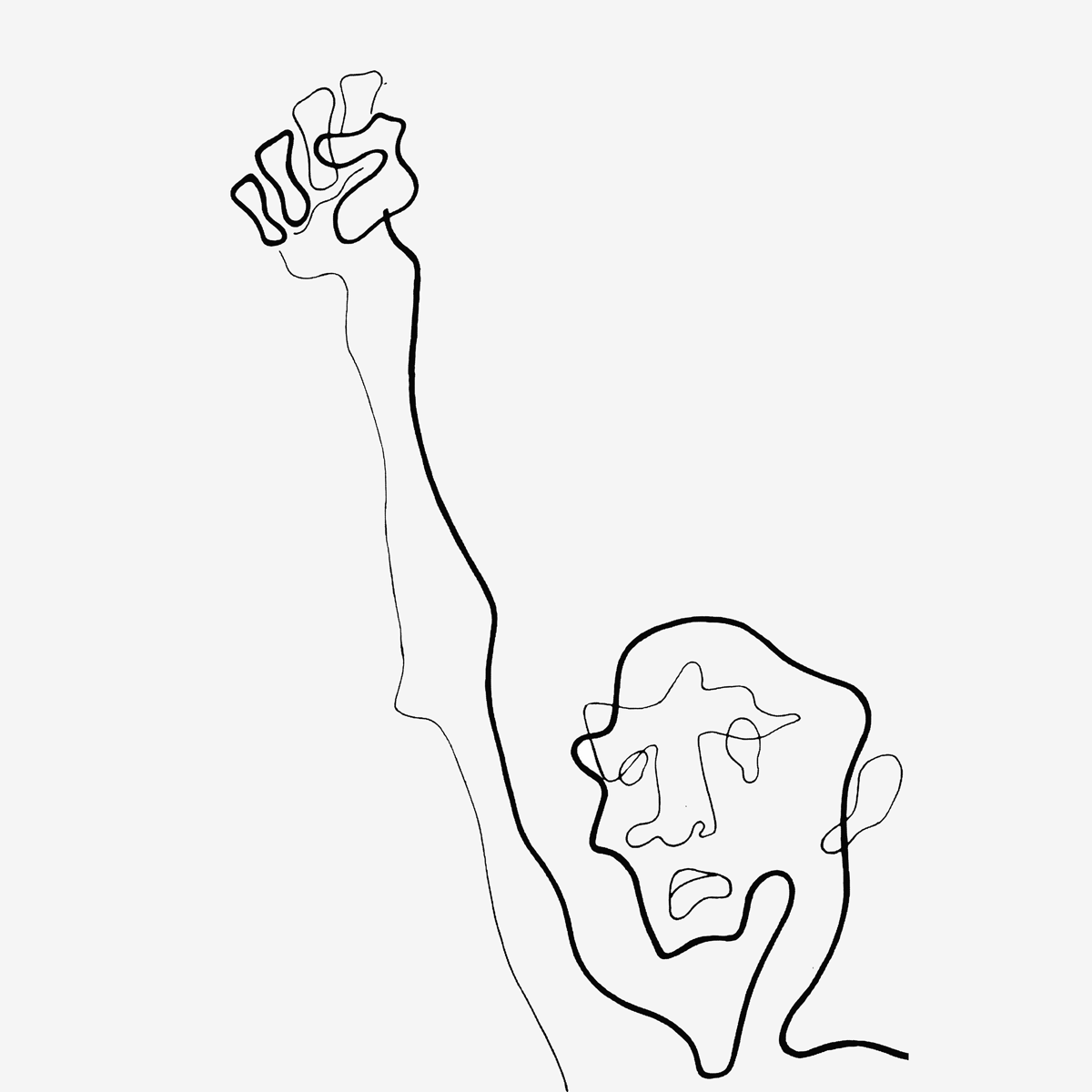Tache rouge écarlate, noir étalé, filet de lave, carrés ou rectangles, nuances de bleus, forme noire recouverte d’une fine couche de paillettes dorées. Nous tentons de décrire une œuvre de l’artiste-peintre de 87 ans Charles Goldstein. Que ressent‐on ? Un trouble, d’une part, les couleurs jaillissent comme si elles étaient encore en mouvement, de l’autre, nous savons. Nous savons qu’ici, c’est la disparition qui rôde.
Nous sommes dans la maison‐atelier du peintre et de sa femme Clara Goldstein à Maincy, une ancienne métairie du Château de Vaux‐le‐Vicomte, un patrimoine, en plus de centaines de toiles, qu’il a choisi de léguer au département de Seine‐et‐Marne en 2024. Pour que son histoire subsiste. Pour que sa propriété puisse devenir un lieu d’histoire, de mémoire et de culture.
Depuis la fin des années quatre‐vingt‐dix, “depuis la mort de mon frère”, Charles Goldstein peint sur la Shoah, une catastrophe dont il a été témoin enfant. Un manque de famille dont il continue à témoigner. “Mes parents avaient en tout dix-huit frères et sœurs en Pologne”. Comme beaucoup de Polonais dans les années trente, ses parents s’exilent en France, “pays des Droits de l’Homme, pays béni des dieux”, ils s’installent dans le 11e arrondissement et “travaillent comme des damnés” sur les marchés. En 1937, Charles Goldstein naît et grandit sans connaître ses innombrables cousins restés pour la plupart à Lublin. “Dans le shtetl de mes parents, 60% des habitants étaient juifs. Ce nombre, il faut s’en souvenir, parce qu’après la guerre, les Polonais n’ont cessé de le nier”.
Au moment de la déclaration de guerre, comme d’autres Juifs étrangers, son père s’engage dans la main‐d’œuvre immigrée (MOI). En mai‐juin, sa mère, son frère et lui se frayent un chemin sur les routes de l’exode, ils posent leurs valises dans la commune de Gramat (dans le Lot), sur les conseils de leur concierge parisienne. De cet épisode, le peintre ne se souvient pas. Son père et d’autres membres de la famille finissent par les rejoindre.
“Tout se passait à peu près normalement jusqu’en mai 1944”. À ce moment‐là, la division Das Reich, une des divisions de la Waffen SS passe par le village de Gramat avant de remonter vers la Normandie. Les Allemands, en plus de passer, encerclent les 3.000 habitants, bien décidés à arrêter les Juifs : “ils disposaient d’une liste de Juifs, nos noms y figuraient (...) Mon frère, qui faisait partie de la Résistance, a eu connaissance de leurs intentions et, à 4 heures du matin, il a prévenu ma mère. Parce qu’on connaissait bien les sentiers et les petits murets, nous avons échappé miraculeusement aux deux side-cars qui nous pourchassaient avec une mitrailleuse”. Sur plusieurs kilomètres et jusqu’au petit matin, sa mère et lui risquent leur vie. “Ma mère frappe à la porte d’une ferme, elle dit avec un fort accent yiddish : sauvez-nous. La voix d’un homme nous parvient : si ces gens risquent leur vie, nous la risquerons avec eux”. Le couple de fermiers sera désigné des années plus tard « Justes parmi les nations ». “Pendant des heures, nous nous sommes cachés dans des meules de foin un peu creuses”.
Charles Goldstein relate cet épisode comme si chaque scène était restée gravée en lui. On lui demande d’où lui vient cette extrême précision ? On le lui a raconté, après, après la guerre. Mais, il se souvient de la présence des Allemands alors qu’il était caché dans la meule. Il se souvient de la peur (le mot est faible), de la terreur dans sa chair. Après cette énième survie, ils s’arrêtent quelques jours dans une “grangette” abandonnée. Et après ? “Le patron de mon père, Robert Ruscassie [qui porte aujourd’hui le titre de « Juste parmi les nations »] a organisé le déplacement des enfants vers un couvent. Nous y sommes restés jusqu’à la fin de la guerre”. Il se souvient du trajet vers le couvent, de la couverture qui le recouvrait intégralement pour que sa présence dans le camion passe inaperçue : “Je ne sais pas si j’avais conscience du danger”.
Après la guerre, est‐ce que la vie a repris ? “Nous n’avions aucune nouvelle des 80 personnes de la famille restées en Pologne, nous ne savions pas ce qu’elles étaient devenues”. On ne sait pas si ses parents ont essayé de savoir, on ne sait pas s’il a posé des questions. Est‐ce que l’on parlait de ça ? Souvent, on ne parlait pas de ça, ça faisait trop mal.
On sait qu’après la guerre, il fallait vivre donc ils ont vécu. Ses parents ont recommencé à travailler sans se ménager. Son frère a poursuivi ses études et lui a commencé le dessin. “Je reproduisais les grands maîtres : Matisse, Cézanne, Rouault, Buffet”. Dès l’adolescence, il déambule dans des musées de France comme de pays du Nord de l’Europe, son regard se construit, s’oriente, se détache de ses cours. Son cœur bat à la chamade lorsqu’il s’arrête sur un Vermeer. Quel apprenti peintre peut y résister ? Un été, il se trouve dans le Sud de la France et, un matin, il décide de partir à la rencontre de Marc Chagall dans sa maison de Saint‐Paul‐de‐Vence. Comment trouve‐t‐il son adresse ? “Je sonne, on me demande si j’ai un rendez-vous avec le maître, je réponds que je viens faire part de mon admiration, j’attends, le petit portillon s’ouvre, Chagall apparaît. Pendant des heures, je reste à l’observer, j’étais fasciné”. C’est un moment qu’il juge fondateur.
Il ne sait pas bien comment l’expliquer mais il ressent quelque chose, une filiation entre lui, “petit Juif issue d’une immigration d’Europe centrale” et des peintres juifs comme Chagall, Guston ou Rothko. “Parce que je me retrouve dans leurs œuvres, dans les shtetl de Chagall, ses amoureux, ses musiciens, ses poules qui volent. Parce que je me retrouve dans la sensibilité de Rothko, j’entre sans ses toiles, je les visite”. Charles Goldstein pourrait nous parler pendant des heures des artistes qu’il admire, de ces artistes qui imprègnent encore chaque jour ses pupilles. “Pourquoi Rothko s’est-il suicidé, lui qui n’avait pas connu la guerre, lui qui a grandi aux États-Unis ?, s’interroge-t-il. Peut-être, parce qu’il était allé au bout de son œuvre”.

Pourquoi a‑t‐il choisi le langage de la peinture et comment l’abstraction s’est-elle imposée ? C’est après la guerre d’Algérie qu’il n’a plus été capable de reproduire, de représenter. Impossible de reprendre le réel. Pendant cette guerre, à laquelle il était opposé, “ce n’était pas ma guerre, pas la nôtre”, il prend des responsabilités, pensant qu’il pourra échapper à la violence des hommes, à la sienne de violence. Là‐bas, il n’est plus lui‐même. “C’est pas moi, c’est pas moi, c’est pas moi”, c’est ce qu’il nous répète, c’est ce qu’il se répète. “Je suis passé de victime de la Shoah à bourreau pendant la guerre d’Algérie”, parvient‐il à articuler. “Ce que j’ai pu faire était tellement loin de l’humanisme qui me constitue, j’étais si loin des valeurs que l’on m’avait transmises”. Il est traumatisé parce qu’il ne se reconnaît pas, comment a‑t‐il pu, était‐il sorti de lui‐même ?
De retour, il peint des toiles, “bercé par un sentiment de lâcheté, par le remords permanent”. Nous ne savons pas quand et comment cette période artistique s’interrompt et si elle s’interrompt vraiment. Le figuratif ne revient plus. Des années 1975 aux années quatre‐vingt‐dix, il se rend plusieurs fois en Inde, il le reconnaît, il représente l’Inde des touristes, celle qu’il peut aisément fantasmer, pas la réalité des habitants, pas la brutalité du quotidien.
À la fin des années quatre‐vingt‐dix, il revient à son enfance, à d’où il vient, à ce manque de réponses. “J’ai ressenti la nécessité de retrouver les miens, j’avais perdu des être chers, y compris des personnes que je n’avais jamais connues”. Il a le sentiment qu’il n’a pas assez posé de questions, qu’il n’a pas suffisamment cherché ce que sa grande famille était devenue pendant la Shoah. Comment faire son deuil si l’on ne retrouve pas leur corps ? “Peut-être que chacune de mes toiles peut faire office de pierre tombale, celles que les miens n’ont jamais eues, la trace qu’ils n’ont jamais eu le temps de laisser”. Michèle Fournier, d’abord admiratrice de l’œuvre du peintre et désormais sa biographe, précise qu’avant 2019, sa peinture était très mémorielle. “Je lui ai dit qu’avant, ils avaient été vivants. Leur mémoire ne repose pas que sur leur disparition, c’est aussi leur vie qu’il lui faut traduire”.
Depuis 2024, une personne du département engagée dans la gestion de sa donation, s’est lancée dans des recherches sur les Juifs de Wichowicze, le shtetl de ses parents. Elle a découvert qu’en novembre 1942, une centaine de Juifs ont été massacrés sur la place centrale du village, qu’un ghetto réunissant 2.000 Juifs a été érigé et que les Juifs de ce ghetto ont été déportés en deux temps vers le centre de mise à mort de Treblinka. Une partie de sa famille a été immédiatement gazée, d’autres personnes dont les métiers pouvaient servir aux Allemands n’ont pas été assassinées à leur arrivée dans le camp. Les recherches se poursuivent encore.
Pendant des années, Charles Goldstein a peint sur ce qu’il appelle “les tombeaux de papiers”, ces petits mots que les déportés écrivaient et qu’ils glissaient du train en espérant que quelqu’un les réceptionne, que quelqu’un en fasse quelque chose. “Mon oncle a écrit à sa femme, ce morceau de papier, cette bouteille à la mer a été récupérée et envoyée à ma tante”.
Nous nous dirigeons désormais vers l’atelier du peintre qui se trouve à l’étage. On croise des dizaines de toiles, des pinceaux, des livres, des chevalets, des couleurs vives, violentes, des jets de peinture qui dégoulinent et parfois coulent. On lui demande de nous guider, de nous initier : que cherche‐t‐il à nous transmettre ? Il préfère nous répondre par une question : “Pourquoi je crée du relief ?” On donne sa langue au chat. “Ils avaient de la terre en eux”, répond‐il en référence à un vers du poète Paul Celan. Il poursuit en reprenant une célèbre phrase de Soulage (dont il aurait aimé être l’auteur) : “C’est ce que je fais qui m’apprend ce que je recherche”. Autrement dit, “chaque famille juive est une histoire et je veux que chaque toile soit une histoire. Je ne sais pas si ces histoires sont racontables et si elles valent la peine de l’être.”
Le 7 octobre 2023, le kibboutz de Kfar Aza, qui avait été fondé par un cousin de Charles Goldstein et survivant de la Shoah, a été attaqué. Son petit‐cousin et sa fille aînée, Nadav Goldstein et Yam Almog‐Goldstein, ont été assassinés, le reste de sa famille a été pris en otage et libéré en novembre 2023. Nous ne savons pas encore comment la tragédie marquera la trajectoire (artistique) de Charles Goldstein. Aujourd’hui, sa mémoire bascule du traumatisme de la Shoah à celui du 7 octobre, d’une réminiscence tragique à une autre.