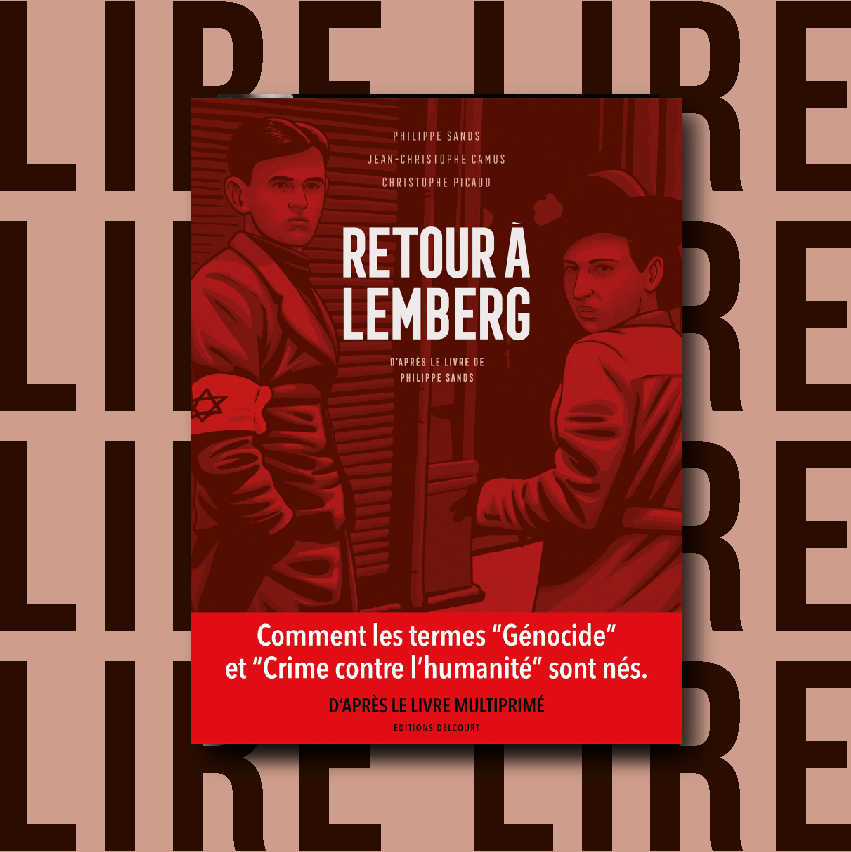Vous vous attachez à décrire l’histoire singulière des Juifs d’Argentine, les différentes vagues migratoires depuis le XIXe siècle. Comme dans d’autres diasporas, les Juifs ne constituent pas un groupe monolithique mais une pluralité de voix et de contradictions religieuses, politiques et culturelles. Comment saisir ce morcellement?
Mon travail consiste à essayer de trouver une manière de comprendre l’objet “judaïsme, judaïcité” sans l’essentialiser, sans le dissoudre non plus. Dans ce livre, j’essaie de montrer qu’il n’y a pas une communauté juive argentine homogène, mais des Juifs argentins qui construisent leur identité juive (qui ne cesse d’évoluer) et affirment leurs divergences politiques comme n’importe quel autre Argentin peut le faire.
Dans ce pays, l’essentiel des Juifs viennent d’Europe de l’Est, de Russie, d’Ukraine, de Pologne. Seuls 10 à 20% sont originaires du Maroc et de Syrie. Ces communautés sépharades possèdent leurs propres rites, leurs cimetières et leurs espaces communautaires. À l’inverse du modèle français, qui a en grande partie été organisé par l’État sur le modèle catholique à travers le Consistoire central de France, le judaïsme argentin s’est organisé depuis la base, permettant l’expression d’une grande variété d’expressions de l’identité juive, souvent plus culturelles que religieuses. Après le judaïsme de notables des premiers arrivants, les années 1890 ont donné naissance à de nouvelles figures, incarnées notamment par celle du militant bundiste, communiste, ou anarchiste, mais aussi par celle du “gaucho judio” régénéré par le travail de la terre dans les colonies de peuplement du Baron Hirsch. C’est cette grande pluralité qui fait l’originalité du modèle argentin, notamment par rapport au modèle français.
Après l’attentat du 18 juillet 1994, j’ai souhaité interroger la recomposition des différentes identités juives à travers le clivage péronistes /antipéronistes. Comment les tensions préexistantes remontent à la surface – entre les institutions traditionnelles qui veulent assurer leur pérennité (et leur place aux côtés du pouvoir) et les collectifs autour des familles des victimes qui exigent que justice soit rendue.
Pourquoi l’attentat qui a visé le siège historique de l’Amia a-t-il été votre “point d’entrée pour saisir la trajectoire historique” des Juifs argentins ? Comment cet événement a-t-il redéfini leur place ?
C’est ce que, dans mon livre (chapitre 5), j’appelle le “passage des marges au centre”. À la fin des années quatre‐vingt, la sociologue Dominique Schnapper constate la relativement bonne intégration économique et culturelle des Juifs argentins (ce qui ne veut pas dire que tous les Juifs le sont). Mais, cette intégration ne s’accompagne pas d’une plus grande présence dans le champ politique. Les Juifs étaient maintenus aux marges de l’État et c’est à partir du traumatisme de l’attentat (et du fiasco de l’enquête) que certains Juifs et institutions (dont la Daia, l’équivalent du Crif, et Memoria Activa, un collectif réunissant des familles de victimes) se politisent. De mon point de vue de chercheur français, la mobilisation de Memoria Activa retient mon attention. Elle m’étonne puisqu’elle tisse des liens de “solidarité horizontale” (expression de l’historien Yosef Hayim Yerushalmi) avec d’autres collectifs militant pour la démocratie, pour les droits humains.
À partir de 2015, on assiste ainsi à l’émergence de nouvelles figures politiques, comme celle du rabbin libéral Sergio Bergman, qui s’engage politiquement aux côtés de Mauricio Macri (président de l’Argentine de 2015 à 2019) non pas malgré le fait d'être juif, mais bien en tant que Juif ayant construit sa carrière au sein d’institutions juives. Il deviendra même ministre de l’environnement et sera connu pour porter en toute occasion sa kippa multicolore. Il faut mesurer le chemin parcouru. Jusqu’au milieu des années quatre‐vingt, très peu de Juifs accédaient à des postes à responsabilité au sein de l’administration ou de l’État. Et quand ils y accédaient (comme ce fut notamment le cas sous les différents gouvernements de Juan Perón), leur judéité restait une affaire essentiellement privée.
Vous l’écrivez à plusieurs reprises : après l’attentat de 1994, une partie de la société argentine a considéré que les personnes visées étaient étrangères voire israéliennes (alors qu’aucune des victimes ne l'était). Ce sentiment a pu être renforcé par les institutions juives traditionnelles qui organisaient des hommages en présence de personnalités politiques israéliennes. Trente ans plus tard, qu’en est-il ?
Aujourd’hui, j’ai le sentiment que l’ensemble du spectre politique argentin participe d’une manière ou d’une autre à ces commémorations – même si c’est en ordre dispersé et de manière conflictuelle. Mais les Juifs argentins reviennent de loin. Ils ont longtemps été perçus comme des acteurs – voir comme les principaux responsables – du mouvement ouvrier (certains étaient en effet très mobilisés dans les milieux communistes ou anarchistes). Ils ont, à ce titre, été la cible de la droite nationaliste qui les percevait comme des éléments étrangers à la nation argentine et les accusait de fomenter un complot (une mythologie fidèle aux “protocoles des sages de Sion”).
Il ne faut cependant pas idéaliser la situation actuelle. S’il apparaît aujourd’hui relativement normal que des Juifs puissent participer pleinement à la vie politique, cela n’empêche pas la circulation de certains motifs antisémites.
Héctor Timerman, le ministre péroniste des affaires étrangères de 2010 à 2015, dont la judéité est connue, a par exemple été accusé par l’opposition politique et par certaines figures centrales des institutions juives elles‐mêmes de « double trahison » (à l’Argentine et aux Juifs) pour avoir négocié un accord de coopération avec l’Iran dans le but de pouvoir interroger les responsables iraniens soupçonnés d’être à l’origine de l’attentat de 1994. Accord que les opposants politiques suspectaient d’être une manœuvre pour enterrer définitivement l’enquête sur l’attentat. Les Juifs ne constituent de ce point de vue pas tout à fait encore des acteurs politiques comme les autres.
L’attentat a aussi largement divisé les Juifs argentins. Trente ans après la tragédie, ils ne peuvent pas commémorer ensemble, ils ne peuvent pas mettre leurs divergences politiques de côté. Au contraire, leur conflictualité s’affiche publiquement. En conséquence, plusieurs commémorations sont organisées de façon simultanée, d’une part celle des institutions officielles dont la Daia qui, pour des raisons de sécurité, crée une frontière avec le reste de la ville ; d’autre part celle de Memoria Activa qui se lie avec d’autres collectifs pro‐démocratie et participe à l’argentinisation de l’attentat.
Dans votre livre, vous remarquez que seul cet événement antijuif est commémoré (tous les autres sont inexistants dans la mémoire des Juifs comme des non Juifs). Pourquoi oublier les 1.000 victimes du pogrom de 1919 (“La semaine tragique”), les Juifs assassinés pendant la dictature (1976-1983) surreprésentés dans la répression ?
Déjà, rappelons que beaucoup des victimes juives de la dictature n’étaient pas reconnues comme juives par les institutions juives de l’époque, comme l’a montré l’historien Emmanuel Kahan. Aujourd’hui, il est reproché à la Daia (dont la mission est de lutter contre l’antisémitisme depuis les années trente) de ne pas avoir défendu les Juifs arrêtés (et assassinés) pendant la dictature. La Daia aurait accusé les parents des victimes de ne pas avoir empêché l’engagement de leurs enfants, elle les aurait presque rendus coupables.
J’ai découvert assez tardivement l’oubli de “La semaine tragique” alors que ce pogrom avait eu lieu au même endroit que l’attentat. Comment expliquer la sur‐mémorialisation de l’attentat et la disparition du souvenir des victimes de 1919 ? À l’époque des faits, les élites juives se sont désolidarisées des victimes expliquant qu’elles n’auraient pas dû être là, qu’elles n’auraient pas dû s’allier au mouvement ouvrier, révolutionnaire ou anarchiste. Le mouvement ouvrier, de son côté, a éprouvé des difficultés à reconnaître la dimension antisémite de ces massacres.
Autrement dit, régulièrement dans l’Histoire, les institutions officielles préfèrent faire profil bas, ne pas manifester leur opposition au pouvoir. Le sociologue Danny Trom, que vous sollicitez, explique que les élites institutionnelles adoptent une politique de la survie, elles cherchent une protection afin d’assurer la pérennité du collectif, de contourner la menace…
Après les attentats, certains représentants de la Daia ont estimé que les questions devaient se régler dans l’intimité des salons de la République, en prenant en compte les enjeux internationaux qui dépassaient largement les revendications des familles des victimes. Cette position explique le conflit qui l’oppose aujourd’hui encore au collectif Memoria Activa qui, depuis les débuts, cherche à mobiliser l’ensemble de la société argentine et du mouvement social mobilisé depuis la fin de la dictature autour du combat pour la justice, pour l’État de droit et contre la corruption.
La Daia a, quant à elle, noué des alliances politiques avec le mouvement anti‐péroniste incarné par Mauricio Macri. Pendant sa campagne électorale, ce dernier a largement instrumentalisé l’enquête au sujet des attentats de l’Amia. La mort suspecte du procureur Nisman (en charge de l’enquête) en 2015 engendrera deux thèses : celle du suicide, largement soutenu par le mouvement péroniste et Cristina Kirchner (accusée par le procureur d’avoir fait obstruction à l’enquête), et celle de l’assassinat (dans ce cas, Cristina Kirchner serait potentiellement coupable) soutenue par les anti‐péronistes. Ce nouvel événement redonnera du carburant au clivage.
Depuis le 7 octobre 2023, le RN intrumentalise la lutte contre l’antisémitisme et se revendique comme le seul parti capable de protéger les Juifs en France. Un paradoxe quand on sait que dans ses rangs, l’antisémitisme et le négationnisme prospèrent. En Argentine, le président Javier Milei cultive une sorte de fascination-obsession pour un judaïsme conservateur et ultra-orthodoxe. Et, dans le même temps, sa vice-présidente est issue de la droite ultra-nationaliste traditionnellement antisémite. Comment comprendre ces contradictions ?
Javier Milei est à la fois soutenu par des Juifs et à la fois largement critiqué par d’autres Juifs. Comme tous les Argentins, ils subissent sa politique ou en bénéficient. Par ailleurs, Milei a annoncé qu’il serait le premier président juif argentin, puis il a déclaré qu’il se convertirait après son mandat (ses fonctions présidentielles étant incompatibles avec ses obligations de Juif). Comment ce président élu grâce à la droite argentine peut‐il autant miser sur sa proximité avec les Juifs ? Comment son ministre des affaires étrangères a‑t‐il pu prêter serment sur la Torah ? Comment est‐ce possible que les commentaires politiques soient presque des commentaires rabbiniques (les journalistes ont dû étudier les textes de la tradition juive pour comprendre certains messages de Milei). Je pense que cela est possible parce que cela fait trente ans que des collectifs juifs se mobilisent en tant que juifs dans la vie politique argentine. Je pense aussi que les références de Milei appartiennent à un judaïsme conservateur (Israël occupant la place de gardien contre les forces du mal). Cela lui permet aussi de tisser des liens avec les courants évangéliques, très puissants en Amérique latine, tout en s’alignant sur la politique étrangère des États‐Unis. Mais ce philosémitisme affiché n’est pas exempt de contradiction. C’est le Juif guerrier qui est valorisé contre la figure du Juif cosmopolite de la diaspora.
Trump cautionne lui aussi cette contradiction quand il accuse les Juifs américains d’être à l’origine de sa possible défaite pendant sa campagne tout en soutenant le gouvernement de Nétanyahou.
Votre conclusion porte sur la situation des Juifs de France qui “ont sans doute besoin de solidarité, de pluralisme et d’autonomie. Pas d’un gardien ni d’un protecteur”. Que voulez-vous dire par là ?
Les Juifs de France peuvent s’inspirer de la pluralité des voix qui s’expriment en Argentine sur le terrain politique. Le collectif Memoria Activa a réussi à tisser des liens avec d’autres mouvements sociaux, à créer une forme de convergence des luttes et à faire de la mémoire des victimes de l’attentat, une mémoire argentine.
Propos recueillis par Léa Taieb
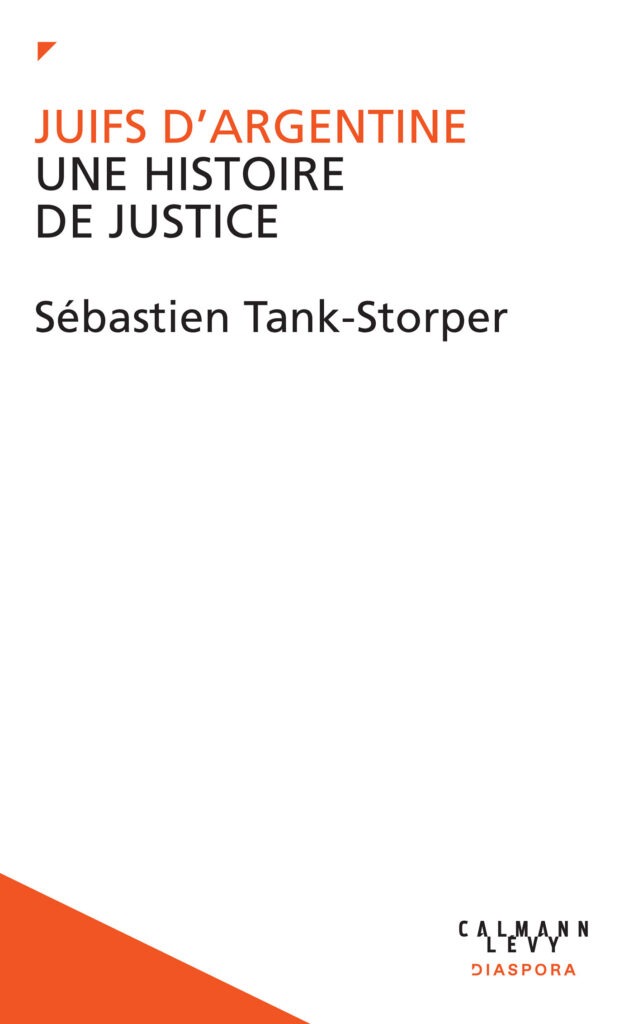
Une rencontre avec l'auteur aura lieu lundi 5 mai à la Maison de l’Amérique latine à Paris