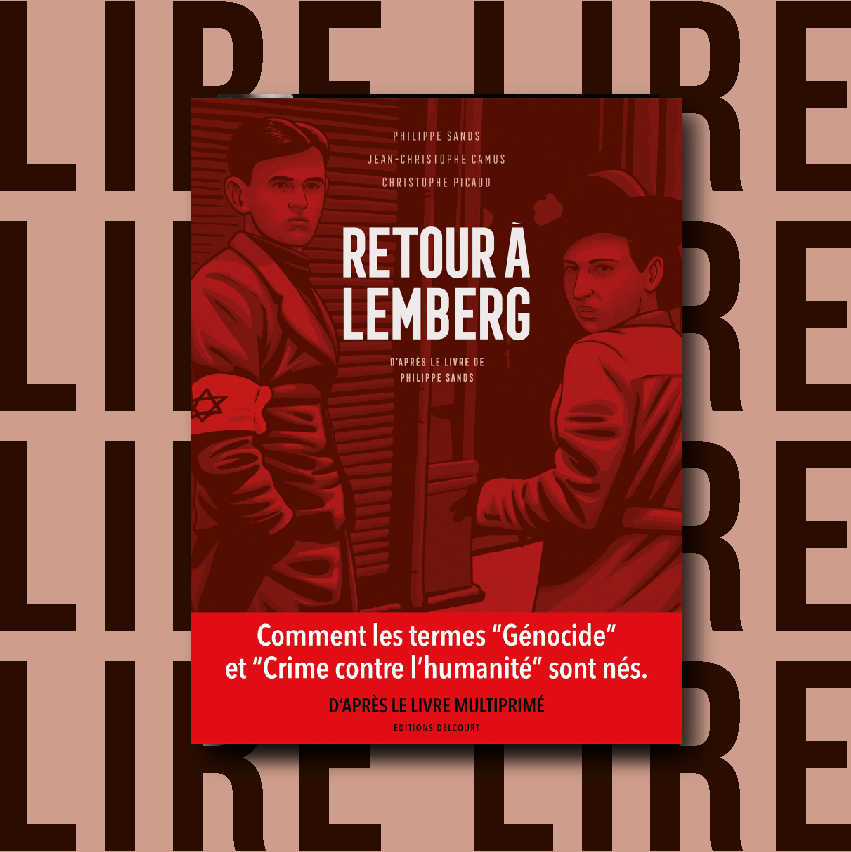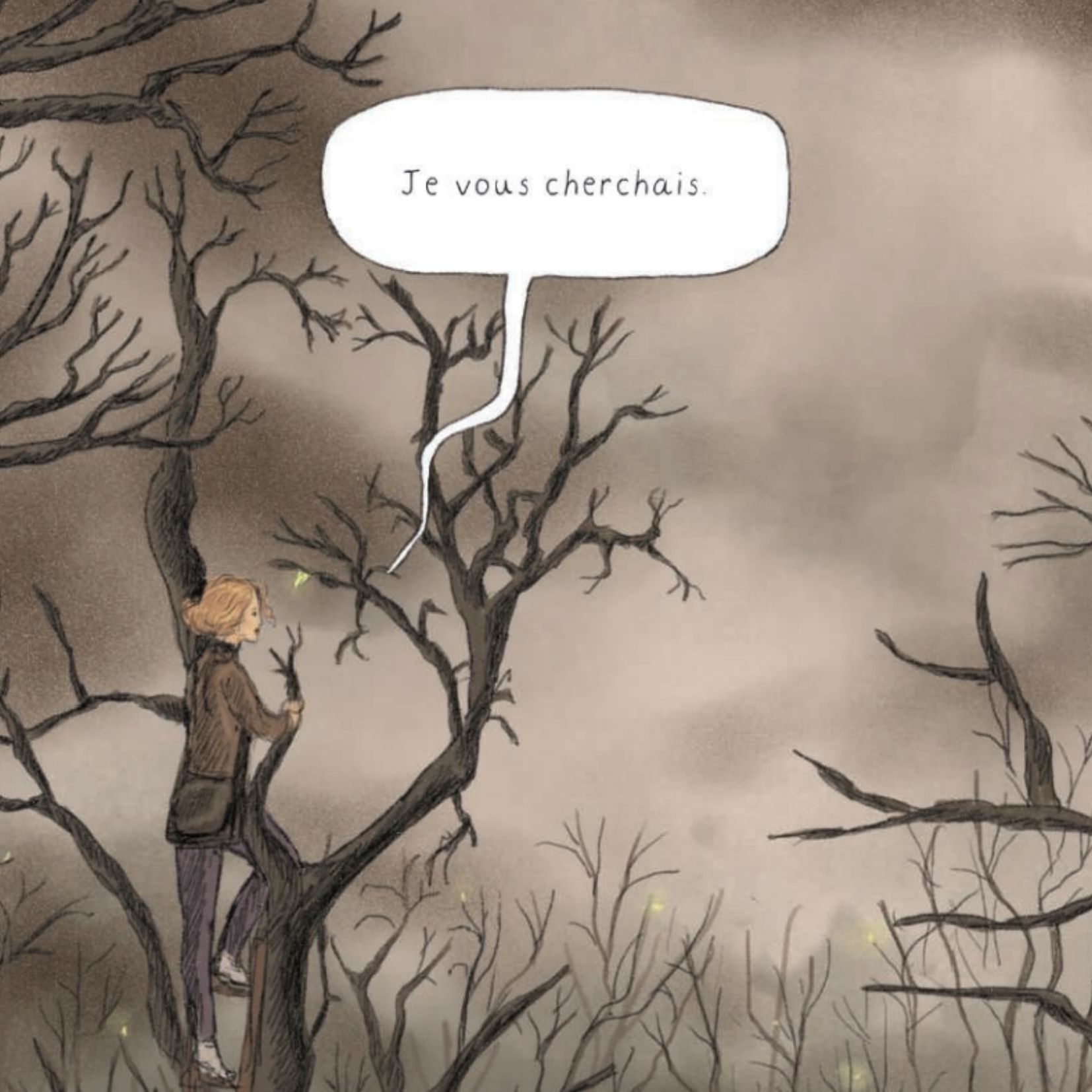Vous êtes née en Irak. Comment pourriez-vous décrire votre jeunesse à Bagdad en tant que juive ?
Je suis née à Bagdad en 1957. Lorsque j’étais encore très jeune, la monarchie a été renversée en 1958 et la République proclamée, plongeant le pays dans une période d’instabilité. Le roi Fayçal II a été assassiné par le général Abdel Karim Kassem, et l’ancien Premier ministre, d’abord en fuite, a fini par être retrouvé et tué en pleine rue.
Quand j’avais six ans, Abdel Karim Kassem a été assassiné par le parti Baas, auquel appartenait Saddam Hussein. Pendant mon enfance, les présidents se succédaient dans un climat de violence : chaque nouveau régime éliminait le précédent et ses partisans. L’atmosphère devenait de plus en plus lourde, particulièrement pour les communautés minoritaires comme les Juifs.
L’Irak a commencé à adopter des lois discriminatoires envers les Juifs, à les marginaliser. C’était un environnement très tendu, nous n’avions pas le droit d’avoir un passeport par exemple. On disait que les minorités, y compris les Juifs, pouvaient pratiquer librement leur religion, comme tous les citoyens irakiens mais, en réalité, il valait mieux ne pas trop le montrer. Nous faisions très attention à ne pas provoquer, à ne pas attirer l’attention. Ma famille vivait juste en face de la grande synagogue de Bagdad. Nous y allions surtout pendant les grandes fêtes comme Yom Kippour. Mais toujours discrètement. Nous baissions la tête dans la rue pour ne pas être identifiés comme Juifs. Nous étions prudents, constamment sur nos gardes.
Nous allions dans des écoles juives où il y avait aussi des enfants chrétiens et musulmans, car tout le monde souhaitait offrir une bonne éducation à ses enfants. Mais avec les années, le climat s’est fortement dégradé. Au fur et à mesure, des camarades disparaissaient sans prévenir. On apprenait peu de temps après que leurs familles avaient fui. Toujours dans le secret. La peur d’être arrêté était très prégnante.
Qu’est-ce qui a poussé votre famille à quitter l’Irak au début des années soixante-dix, assez tard, finalement ?
Mes parents n’avaient pas de passeport et ils considéraient qu’il était trop dangereux de fuir avec des enfants en bas‐âge. Après la guerre des Six Jours en 1967, la situation a pris un tournant dramatique. L’Irak, qui avait perdu face à Israël, a commencé à voir les Juifs comme des ennemis de l’intérieur. Les tensions se sont accentuées brutalement : on a accusé les Juifs d’être des espions pour Israël, et les arrestations arbitraires ont commencé à se multiplier. En janvier 1969, neuf Juifs ont été publiquement pendus à Bagdad, accusés d’espionnage. Leurs corps sont restés suspendus pendant plusieurs jours sur la place principale, et des centaines de milliers de personnes sont venues célébrer leur mort. Je me souviens de cette image terrifiante. Cela a été un choc énorme pour toute la communauté juive. À partir de là, on a compris que notre vie en Irak n’était plus possible.
La répression était féroce. De nombreux Juifs ont été emprisonnés, torturés, parfois même tués. Des femmes juives, y compris des femmes âgées, ont été emmenées en prison. Mon propre père et mon oncle ont été arrêtés pour « espionnage », mais heureusement relâchés peu après, sous la pression exercée par Israël et les Nations Unies. Ma mère avait une partie de sa famille qui était déjà partie vivre en Israël en 1948. Mon père, quant à lui, était le seul de sa famille resté en Irak. Sa mère, ses trois frères, ses deux sœurs et tous ses cousins avaient quitté le pays dès 1951 pour s’installer en Israël. Tout cela a pesé dans notre décision. L’atmosphère était devenue irrespirable. Après les pendaisons publiques, mes parents ont compris que nous devions fuir si nous voulions survivre. Quitter l’Irak est devenu une question de vie ou de mort.

Comment votre départ s’est-il organisé ?
En 1971, à la suite de l’accord de paix entre le gouvernement irakien et les Kurdes, la route vers le nord de l’Irak est devenue accessible. Cela a ouvert une opportunité unique pour les Juifs qui souhaitaient fuir. Grâce à l’aide du Mossad et de l’Agence juive, nous avons pu organiser notre départ dans la plus grande discrétion. Nous avons simplement fermé la porte de notre maison, sans dire un mot à personne, et nous nous sommes enfuis en pleine nuit. J’avais 14 ans et, encore aujourd’hui, ce traumatisme qu’a été la fuite n’a pas totalement guéri. J’ai du mal à en parler.
Nous étions un groupe d’environ vingt personnes, composé de plusieurs familles. Nous avons quitté Bagdad en car mais, à un moment donné, le passeur qui nous accompagnait nous a laissés dans les montagnes, dans un endroit désert. C’était un moment extrêmement angoissant : il faisait noir, les enfants pleuraient, et personne ne savait si le passeur allait revenir ou nous abandonner là. J’ai passé ce moment à consoler mon petit frère de 11 ans et ma petite sœur de 6 ans, qui étaient terrorisés. Cette attente n’a duré qu’une heure, mais elle nous a semblé interminable.
Finalement, une voiture est arrivée, et nous avons pu traverser la frontière vers l’Iran, avec l’aide des Kurdes. C’est dans une petite ville iranienne que, pour la première fois, nous avons ressenti un sentiment de liberté. Le lendemain matin, un bus nous a emmenés à Téhéran, où nous avons été logés dans un hôtel qui accueillait de nombreux Juifs fuyant l’Irak. C’était l’un des deux principaux hôtels utilisés pour abriter les réfugiés juifs. L’atmosphère y était particulière : il y avait des bébés qui pleuraient, des enfants apeurés, et un sentiment général d’épuisement mêlé à un immense soulagement. Par la suite, l’Agence juive nous a aidés à organiser notre départ vers Israël. Ce fut un processus complexe, mais c’était la promesse d’un avenir libre et plus sûr.
Comment avez-vous vécu votre arrivée en Israël et quels ont été les défis que vous avez rencontrés pour vous y intégrer ?
L’arrivée en Israël a été un mélange d’émotions intenses. Pour la première fois de notre vie, nous nous sommes sentis libres — un peu comme des otages enfin libérés. Il n’y avait plus cette peur constante d’être arrêtés, surveillés, ou accusés à tort. C’était une libération immense.
Nous avons été réunis avec une partie de notre famille qui vivait en Israël. Ce moment de retrouvailles a été très fort mais aussi un peu étrange car, en Irak, il était tellement dangereux de parler d’Israël que nos parents ne nous avaient jamais rien dit à propos de cette famille. Le simple fait de prononcer le mot « Israël » était interdit ; cela pouvait nous mettre en danger. En arrivant ici, nous avons découvert une autre vie, un autre monde.
Nous avons d’abord vécu à Beer Sheva, près de la famille de mon père, ce qui a facilité notre installation. Mais cela n’a pas été simple pour autant. Il fallait tout reconstruire : apprendre l’hébreu — nous ne connaissions à l’époque que quelques mots comme shalom —, s’adapter à une culture nouvelle, à un rythme de vie différent. La société irakienne était plus traditionnelle et valorisait beaucoup le respect des anciens. En Israël, la culture était plus directe, parfois brusque, et largement marquée par un esprit laïc. Heureusement, nous parlions anglais et français, ce qui a aidé au début. L’un des aspects les plus douloureux a été de réaliser que certains de nos amis restés en Irak avaient totalement disparu. Beaucoup fuyaient sans prévenir, dans le plus grand secret. Et ceux qui restaient vivaient dans une terreur constante, sous la menace d’être accusés de trahison.
À l’école, les débuts ont été difficiles. Je me sentais étrangère, sans repères, avec une certaine nostalgie du passé. Mais peu à peu, nous avons trouvé notre place. Les Israéliens ont été accueillants, et nous avons pu commencer à construire une nouvelle vie. Ce qui m’a marquée, c’est que, pour la première fois, nous pouvions marcher la tête haute.

Comment avez-vous vécu la séparation avec l’Irak et qu’en est-il de vos liens avec ce pays aujourd’hui ?
Quitter l’Irak a été une rupture très douloureuse. Comme toute immigration forcée, c’est un moment de crise. C’est un tournant dans une vie : on laisse tout derrière soi — ses amis, ses souvenirs, sa maison. Je suis partie sans que personne ne le sache, pas même mes amies proches. C’était trop dangereux. Nous avons simplement fermé la porte à clé et abandonné notre maison. Tout ce que nous possédions est resté là‐bas.
Après notre fuite, il n’a jamais été question de retour. Ce pays nous a détestés. Les autorités irakiennes ont même publié dans les journaux des appels aux exilés pour qu’ils reviennent se signaler, sous peine de perdre leurs droits. Mais nous savions que nous n’avions plus aucun droit et, pour être franche, cela ne nous affectait pas vraiment. Revenir aurait été un risque énorme, personne dans ma famille n’a envisagé de le faire. Nous savions que nous n’en reviendrions peut‐être pas vivants.
Même si je ne suis jamais retournée en Irak, d’une certaine manière, ce pays ne m’a jamais quittée. Travailler au Babylonian Jewish Heritage Center en Israël m’est apparu comme une évidence, une façon de renouer avec cet héritage. C’est un travail profondément personnel, un acte de guérison. Le musée organise des expositions, des conférences, des projections de films, sur l’histoire des Juifs d’Irak. Pour moi, c’est une manière de transformer la douleur en transmission. Je raconte mon histoire, j’encourage mes amis à faire de même, même ceux qui hésitent encore à parler de leur passé. Il est essentiel que nos récits ne se perdent pas, que les générations futures sachent ce que nous avons vécu.
Les photos partagées par Lily Shor ont une valeur particulière : sa famille ayant tout laissé derrière elle en fuyant l’Irak, elle les a peu à peu rassemblées grâce à des proches restés en Irak, reconstruisant ainsi, morceau par morceau, la mémoire d’une vie perdue.
Propos recueillis par Paloma Auzéau
Dates à retenir :
Juin 1941 : Le Farhoud (qui signifie “pogrom” en arabe), entraîne la mort de 150 à 180 Juifs de Bagdad, des viols, des spoliations et 500 blessés. Après ces massacres, près de mille Juifs quittent l’Irak pour l’Inde.
Avant 1948 : 150.000 Juifs vivent en Irak dont 90.000 à Bagdad.
1951 : L’opération « E« zra et Néhémie » se met en place pour accueillir 110.000 réfugiés irakiens en Israël.
1970 : Les derniers Juifs irakiens sont forcés à l’exil.