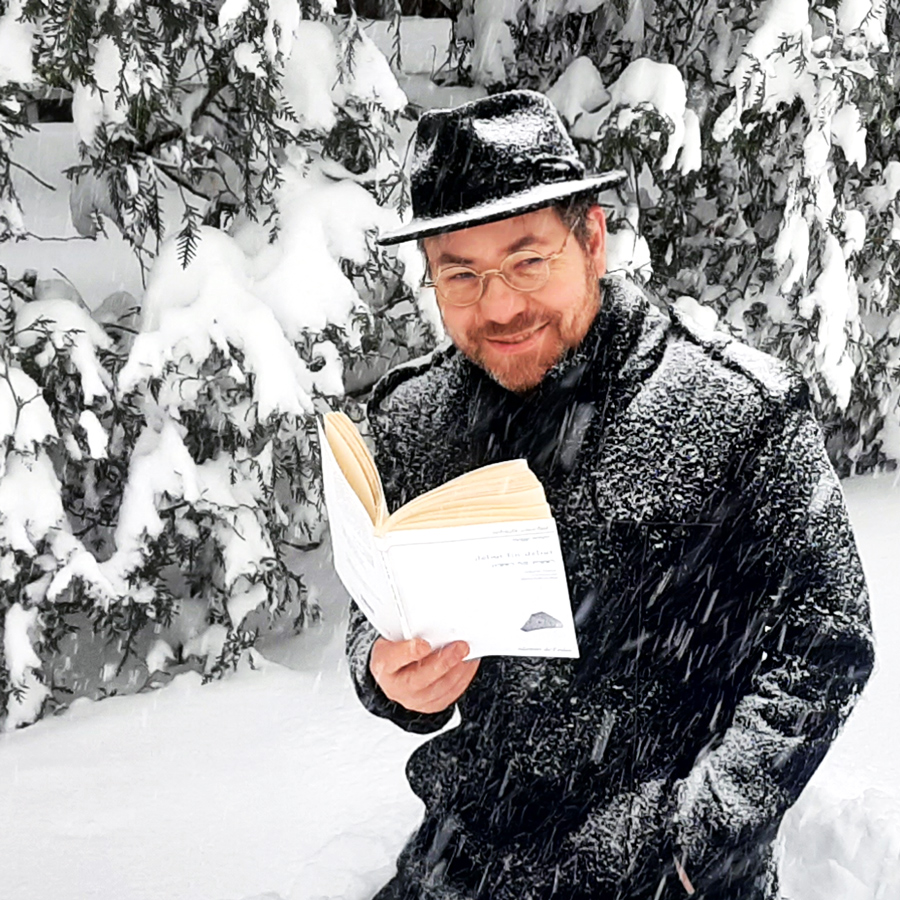Concrètement, ça changera quoi ?
Réponse simple : rien ou presque.
Dans le journal israélien en ligne +972, le journaliste Alaa Salama le résumait en ces termes fin août : « Si des pays souhaitent reconnaître un État palestinien, qu'il en soit ainsi, mais qu'ils ne prétendent pas que cela change la réalité ». En d’autres termes, la reconnaissance de l’État palestinien par la France ou par quelque autre pays est un acte symboliques aux portées concrètes et juridiques quasiment nulles. Certes, à terme, la Mission de Palestine à Paris (qui tient lieu de représentation diplomatique) pourrait devenir une ambassade et la France pourrait installer un ambassadeur à Ramallah (actuellement, c’est le Consulat général de France à Jérusalem qui agit de facto comme une sorte d’ambassade de France auprès de l’Autorité palestinienne). Mais tout cela ne change pas la situation sur le terrain.
Pourquoi faire cette déclaration à l'ONU ?
Fondamentalement, l’acte de reconnaissance est unilatéral et ne nécessite pas d’être prononcé devant l’ONU, mais ce choix peut s’expliquer par une portée symbolique et diplomatique. Cela veut probablement servir d’exemple à d’autres États et appuyer la volonté palestinienne de passer du statut d’État‐observateur à une adhésion pleine aux Nations Unies. Par ailleurs, en prononçant cette déclaration unilatérale devant une institution multilatérale, le président français cherche probablement à contrer l’argument d’une décision purement symbolique et à diluer la tension vis‐à‐vis d’Israël.
Quels sont les pays qui reconnaissent aujourd'hui l'État palestinien ?
Outre les 7 pays qui ont annoncé leur intention de le reconnaître prochainement mais ne l’ont pas encore fait (Australie, Belgique, Canada, France, Malte, Portugal et Royaume‐Uni, certains sous conditions de démilitarisation, retour des otages et exclusion du Hamas), 147 pays reconnaissent actuellement l'État palestinien. Notons que les dix pays des BRICS+ en font tous partie et que l’année 2024 a vu 9 pays des Caraïbes et d’Europe se joindre à la reconnaissance. Le dernier pays en date à avoir fait cette reconnaissance officielle est le Mexique en janvier 2025. Par ailleurs, l’intégralité des pays d’Amérique latine (sauf le Panama), et d’Afrique (sauf le Cameroun et l’Érythrée), reconnaissent l’État de Palestine.
Quels sont les arguments en faveur de cette reconnaissance ?
- Sauver l'idée de la solution à deux États – C’est l’argument qu’avait avancé le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre en mai 2024 lorsque son gouvernement a reconnu l'État palestinien : « maintenir en vie la seule alternative qui offre une solution politique aux Israéliens et aux Palestiniens : deux États, vivant côte à côte, en paix et en sécurité ».
- S'inscrire dans une volonté européenne de créer une dynamique favorable à l’émergence d’un État palestinien, comme le soulignait, toujours en mai 2024, après la reconnaissance par la Norvège, l’Espagne et l’Irlande, le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Josep Borrel : « C'est un acte symbolique de nature politique. Plus que la reconnaissance d'un État, cela affirme la volonté que cet État existe ».
- Défendre le droit à l'autodétermination des peuples, comme l’affirmait le Premier ministre slovène Robert Golob en juin 2024 : "Il y a un an, l'Assemblée nationale (...) a reconnu le droit fondamental du peuple palestinien à l'auto-détermination. La reconnaissance de la Palestine comme État indépendant et souverain fut un acte politique et symbolique puissant ».
- Accroître la pression sur les États-Unis, comme le souhaitait en juin 2024 Riyad Mansour, observateur permanent de la Palestine à l’ONU alors que 147 pays reconnaissent actuellement l’État palestinien : « Cela rendra les choses plus difficiles pour le pays qui a posé son véto pour nous dénier notre droit naturel et légal à être admis comme un État membre » des Nations unies.
- Accroître la pression sur Israël dans le cadre de la crise humanitaire à Gaza, comme le revendiquait début août le Premier ministre australien Anthony Albanese : « Une solution à deux États est le meilleur espoir qu'a l'humanité de briser le cycle de la violence au Moyen-Orient et de mettre fin au conflit, aux souffrance et à la famine à Gaza ». Le chef du gouvernement précisait que « le gouvernement israélien continue à défier le droit international et à refuser l'aide, la nourriture et l'eau suffisantes à un peuple désespéré, y compris des enfants ».
Quels sont les arguments contre cette reconnaissance ?
- Trop précoce – Plusieurs acteurs internationaux soulignent que, si l’idée est potentiellement vertueuse, il est trop tôt pour reconnaître cet État et ce pour différentes raisons. Le 11 septembre, le porte-parole du gouvernement allemand déclarait que son pays soutiendra une résolution pour la solution à deux États « qui inscrit simplement le statu quo dans le droit international » tout en précisant que le chancelier Friedrich Merz « ne considère pas le moment venu de reconnaître l'État palestinien ». De la même façon, en mai 2024, un porte‐parole de l’administration américaine insistait sur le fait que le président Joe Biden "pense qu'un État palestinien devrait voir le jour à travers des négociations directes entre les parties et non à travers des reconnaissances unilatérales ».
Certains pays posent des conditions à cette reconnaissance. Ces conditions sont posées vis‐à‐vis d’Israël, comme le Premier ministre britannique Keir Starmer qui annonçait fin juillet son intention de reconnaissance « à moins que le gouvernement israélien ne prenne des mesures substantielles pour mettre fin à la situation épouvantable à Gaza, accepter un cessez-le-feu et s’engager en faveur d’une paix durable à long-terme, ravivant la perspective d’une solution à deux États ». Elles peuvent aussi être posées aux Palestiniens comme l'Australie qui assure que les Palestiniens se sont engagés notamment à « réformer la gouvernance, mettre fin aux versements aux prisonniers, instaurer une réforme de l’éducation, se démilitariser et organiser des élections générales. L’Autorité palestinienne a également réaffirmé sa reconnaissance du droit d’Israël à exister ». - Récompense au terrorisme et compromission des espoirs de paix – Reconnaître l’État palestinien à la suite des attaques terroristes du 7 octobre et alors que plusieurs dizaines d’otages sont encore retenus à Gaza serait une « prime au terrorisme » et oblitérerait les possibilité d’une paix entre Israël et Gaza, avancent le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou en mai 2024, ou le secrétaire d'État américain Marco Rubio le 7 août : « Les pourparlers avec le Hamas se sont effondrés le jour où Macron a pris la décision unilatérale de reconnaître l’État palestinien. Ensuite, d’autres personnes, d’autres pays sont venus dire : eh bien, s’il n’y a pas de cessez-le-feu d’ici septembre, nous allons reconnaître un État palestinien. Alors, si je suis le Hamas, j’en conclus essentiellement qu’il vaut mieux ne pas faire de cessez-le-feu ».
- Manque d'institutions palestiniennes fiables – D’autres observateurs pointent l’absence d’insitutions gouvernementales fiables côté palestinien, comme le ministre des Affaires étrangères de Singapour, Vivian Balakrishnan qui, en novembre 2024, qui considère que, pour que le moment de la reconnaissance soit « approprié », « il faudra un gouvernement palestinien effectif qui accepte le droit d'Israël à exister et rejette catégoriquement le terrorisme ».
- Incohérence juridique – Le think tank néoconservateur américain Foundation for Defense of Democracies remarque que la Palestine ne remplit pas les conditions minimales posées par la Convention de Montevideo (1933) qui définit un État souverain comme respectant ces quatre critères : « être peuplé en permanence, contrôler un territoire défini, être doté d’un gouvernement, et être apte à entrer en relation avec les autres États ». Le think tank précise que le gouvernement palestinien n’a plus le contrôle de la bande de Gaza – soit 40% de la population palestinienne – depuis la guerre civile de 2007, et que « si la Palestine peut être qualifiée d'État indépendant, alors le peuvent aussi l'Écosse, la Corse et la Catalogne. Comme nombre d'autres régions aux velléités d'indépendance en Europe comme la Région flamande ou le Pays basque ».
- Contre-productivité – Plus surprenant, l’argument du risque contre‐productif de la reconnaissance vient parfois de partisans de la Palestine, comme le journaliste Alaa Salama cité au début de ce décryptage. Dans le même article, il explique que « les gesticulations symboliques sont pires qu'inutiles, en ce qu'elles font gagner du temps au régime qui commet ces crimes et capte l'urgence des seuls remèdes qui comptent (...) Une “solution” qui n'est ni juste ni réalisable n'est pas un plan de paix, mais un alibi à l'inaction qui permettra à Israël de poursuivre ses massacres, d'accélérer son expansion et de renforcer le régime d'apartheid ».
C’est une question que posait également, début septembre, le ministre de la sécurité intérieure de Singapour, K Shanmugam, en ces termes : « Quelles contre-mesures attendez-vous, et comment pensez-vous que cela va réellement changer les faits sur le terrain ? Mon sentiment, c’est que cela ne va pas les changer en faveur des Palestiniens. Cela risque même de leur nuire encore davantage ».