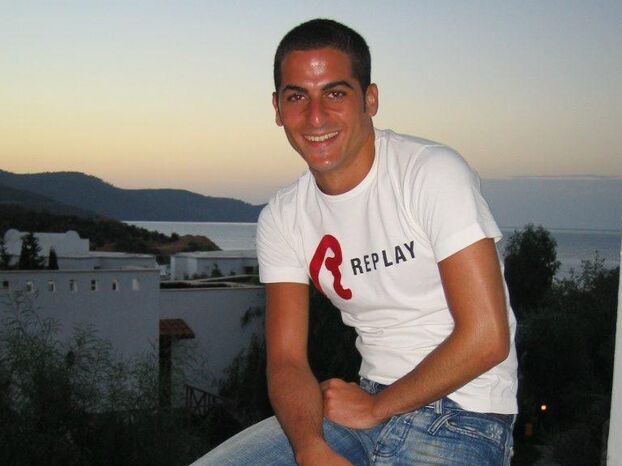Drasha de Delphine Horvilleur prononcée vendredi soir 17 octobre 2025, pour l'office de kabbalat shabbat de la synagogue de JEM à Paris.
Sheheheyanou, vekiyemanou, vehigiyanu lazman hazé…
שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה
Ces mots célèbres sont tirés de la bénédiction qu’on récite à chaque moment attendu de l’existence : « Béni sois‐Tu, Éternel, qui nous a maintenus en vie, nous a permis d’exister et d’atteindre ce jour ».
Ce sont bien sûr des mots que beaucoup d’entre nous ont prononcé cette semaine face au soulagement immense de voir des familles retrouver leurs enfants, des enfants, retrouver leurs parents – sans oublier aucunement toutes ces familles qui attendent encore les leur, ceux qui doivent encore revenir pour trouver une sépulture digne en Israël et pour lesquels nous prierons encore.
Mais il semblerait – et pourvu que cela soit vrai – que vient de s’achever une guerre, la guerre de Simhat Torah. Je l’appelle ainsi parce que c’est bel et bien le nom qu’elle devrait porter.
Cette guerre a débuté le 7 octobre 2023, au jour de cette fête du calendrier juif, et s’est terminée très précisément le même jour du calendrier hébraïque deux ans plus tard. Elle a débuté un jour de fête et s’achève au moment de la même célébration. Voilà qui est étrange et troublant.
D’autant plus troublant que Simhat Torah n’est pas n’importe quelle fête. C’est ce qu’on pourrait appeler la fête juive de la lecture, ou la fête de la lecture juive des textes, ou bien de la lecture juive du monde ou de la lecture juive de l’Histoire.
Laissez‐moi m’expliquer.
Ce jour‐là, chaque année, les Juifs se racontent comment ils sont censés lire, ni plus ni moins, comment se lisent à la fois leurs textes sacrés mais aussi tout texte ou tout événement.
Et voilà quelle est cette philosophie de lecture, telle qu’elle est mise en pratique à Simhat Torah. Au lieu de lire un texte comme on lit généralement un livre, de A à Z, de la première à la dernière page, du premier au dernier mot, du « Il était un fois », jusqu’au mot « Fin », la lecture juive exige de faire l’inverse. À la seconde où on lit le dernier mot du livre, c’est-à-dire le dernier chapitre du Deutéronome, la toute fin de la Torah, immédiatement et dans un même souffle, dans un même geste, voilà qu’on ré‐enroule le livre et qu’on débute immédiatement la lecture de la Genèse, avec les premiers mots de Bereshit, « Au commencement… »
Pour le dire autrement, la lecture juive n’a ni commencement, ni fin…
Ou, plus exactement, le début du livre n’est lu qu’à la suite de la fin. On ne peut raconter la création d’un monde que lorsqu’on est capable de raconter ce qui lui a donné naissance, ce dont on est les héritiers, c’est-à-dire qu’on débute le récit dans la conscience qu’il y a eu quelque chose avant, quelque chose dont personne ne peut faire table rase.
Et si cette idée n’est pas assez claire, regardez quel est le premier mot de la Torah. Nos sages insistent beaucoup là‐dessus. Ils nous disent qu’il aurait été logique que la Torah commence par un alef א, la première lettre de l’alphabet. Mais pas du tout : elle commence par un beth ב, la deuxième lettre de l’alphabet hebraïque. Au commencement, il y a la conscience qu’il y a quelque chose avant notre conscience du commencement.
Il y a l’humilité pour chaque lecteur de savoir que sa lecture, son interprétation du monde, viennent d’un ailleurs, d’un alef dont il n’est pas nécessairement conscient. Et ce lecteur doit composer avec ce qui s’est passé avant lui, ce qui a contribué à le construire sans qu’il ne le sache.
Tout cela peut vous sembler être du bla‐bla philosophique sans pertinence… Pourtant, cette réflexion spirituelle ou littéraire est en réalité liée à une réflexion géopolitique qui a beaucoup à voir avec ce qui a hanté nos jours nos nuits ces deux dernières années – tant de certitudes qui ont mené à beaucoup de catastrophes.
Dans ce conflit terrible au Proche‐Orient, s’énoncent constamment des affirmations des uns et des autres : il y a ceux qui disent « Au commencement, j’étais là, j’étais là avant, avant toi, avant ton histoire, avant ton installation, avant tes certitudes. Je suis le Alef de l’histoire. Je suis l’origine… »
Ou alors, au contraire, il y a ceux qui disent : « C’est lui qui a commencé, c’est de lui que viennent les problèmes, il est, lui, l’origine de la violence, la catastrophe. Il porte, lui, la responsabilité Alpha, il est le Alef de tous nos problèmes… »
Et c’est comme si la philosophie de Bereshit, la sagesse de la lettre beth, nous disaient, elles, qu’il faut avec humilité accepter que tout alef nous échappe, qu’il ne nous est jamais donné de lire l’origine de ce qui fut. Car nous arrivons toujours après. Le alef est dans la brume, dans le flou, dans ce qui nous échappe toujours un peu.
La philosophie de Bereshit nous demande, au contraire, de savoir qu’on arrive toujours « après » et que, plutôt que d’être obsédé par ce qui fut « avant », il nous revient d’apprendre à nous demander comment, à partir de cet instant, il faut regarder vers le futur, vers la suite du récit, vers la possibilité d’un autre avenir, d’une autre genèse.
C’est comme si Simhat Torah disait : « Arrête d’être obsédé par ce Alef, intéresse‐toi au Beth pour être un peu moins bête. Tourne ton regard vers ce qui pourrait encore être plutôt que vers ce qui fut et qui restera toujours, pour toi, mystérieux… »
Nous sommes bel et bien au début d’un autre monde, dans la possibilité d’une genèse qui nous apporterait, enfin, un peu d’apaisement et d’espoir.
Quand je regarde en arrière, ces deux dernières années, ce que furent la violence, la souffrance, le deuil infini, je réalise qu’en bien des occasions, ce qui m’a sauvée, c’est la lecture. Pas forcément la lecture des textes sacrés, mais parfois la lecture de textes profanes, particulièrement de poésie.
Vous savez combien j’aime en citer ici et particulièrement combien, parmi mes auteurs fétiches, il y en a un vers lequel je reviens souvent.
Il s’agit d’un auteur israélien mort il y a longtemps mais dont les mots, ces dernières années, m’ont permis de rester en vie, d’une certaine manière. Je veux parler de Yehuda Amichaï.
Et parmi tous ses poèmes extraordinaires, il en est un qui était à mon sens un des plus profond qui soit. D’apparence complètement triviale, il est peut‐être le plus beau poème écrit sur Bereshit. Il s’appelle « Instruction à la serveuse ». En voici un extrait :
Instruction à la serveuse
Ne débarrasse pas les verres et les assiettes
N'efface pas
La tache sur la nappe ! il est bon que je le sache:
On a vécu avant moi dans ce monde.
(….) Dans les marges de mon livre, des notes ont été écrites par des autres.
Sur les plans de la maison dans laquelle je veux vivre,
L'architecte a dessiné des étrangers devant l'entrée.
Sur mon lit il y a un oreiller avec le creux
D'une tête absente.
Aussi, ne débarrasse pas
La table.
Il est bon que je le sache:
On a vécu avant moi dans ce monde.
….
Il est sans doute l’heure de nous souvenir qu’on a vécu avant nous dans ce monde. Nous souvenir des traces que laissent toutes les vies du passé dans nos vies. Avoir l’humilité de reconnaître que nous arrivons après et allons devoir apprendre à vivre avec ce qui fut. Il y eut avant nous des nuits et elles nous ont changé à tout jamais
Et n’est-ce pas très exactement ce que dit la parasha que nous lirons demain matin à la synagogue ? Encore et encore nous allons répéter cette phrase.
Vayehi erev vayehi boker yom, ויהי ערב ויהי בוקר יום…
Il fut soir, il fut matin… et vint le jour… Ce leitmotiv de la Genèse le répète.
Le jour ne vient que pour celui qui sait que ce qui fut avant lui reste dans le noir, celui qui sait ce qu’il doit à la nuit. L’histoire ne se poursuit et ne connaît une aube et de la lumière que si nous sommes capables d’accepter tout ce qui nous a transformés dans cette obscurité. Aucun de nous n’est le même que celui qu’il était il y a deux ans.
Vayehi erev, vayehi boker. Il fut soir et vient le matin… Ce verset est, à mon sens, un des plus beaux de la Torah. Il peut être lu de bien des manières mais laissez‐moi l’interpréter autrement et lui donner un autre sens si pertinent pour aujourd’hui.
En hébreu, tous les mots ont un double sens.
Erev ערב signifie « soir » mais c’est aussi la racine hébraique du mot arevout ערבות, la capacité à se porter caution les uns des autres, à se soucier vraiment les uns les autres, à se soutenir les uns les autres.
Boker בוקר signifie « matin » mais, en hébreu, c’est la racine du mot bikoret ביקורת, la critique, le fait de faire remarquer à un autre qu’il se trompe, qu’il s’égare ou qu’il existe d’autres vérités ou lectures du monde.
Soudain, ce verset de la Genèse prend une autre dimension, il résonne autrement, et dit : Vayehi erev vayehi boker, yom, il fut solidarité, il fut sens critique, et vint le jour.
Depuis deux ans, en tant d’occasions, nous avons été tiraillés entre ces deux termes de l’équation. Comment exprimer notre solidarité ? Comment concilier cette solidarité sans pour autant faire taire la critique ?
Comment traverser la nuit avec l’autre, se souvenir qu’on est pleinement à ses côtés, sans renoncer au regard critique qui est la lecture la plus juive qui soit ? Tel fut notre défi. Tels restent nos défis, à l’aube de ce nouveau monde, cette genèse dans laquelle nous plaçons tant d’espoir.