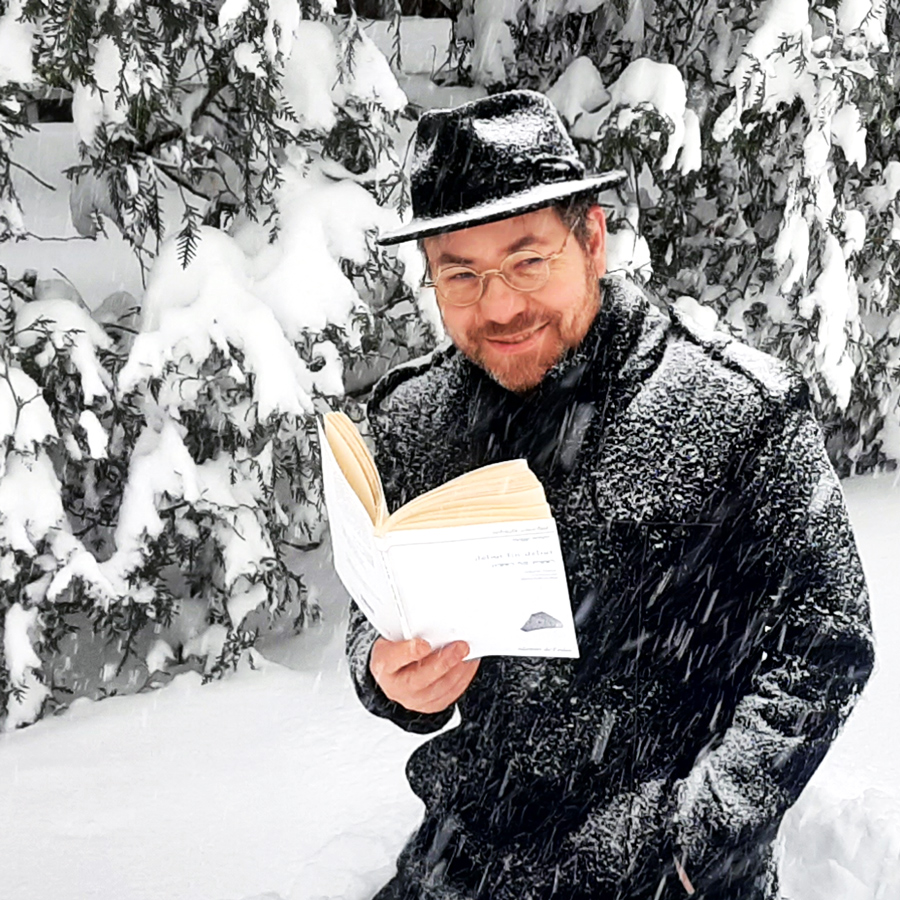Read this interview in English / Lire cet entretien en anglais

Antoine Strobel-Dahan - Dix ans après votre film et trente ans après l’assassinat, comment Israël se souvient-il – ou ne se souvient-il pas – d’Yitzhak Rabin aujourd’hui?
Amos Gitai – C’est une grande question – car évidemment, le gouvernement actuel, le pouvoir en place, préfère ne pas se souvenir. Je dirais même qu’ils aimeraient effacer la mémoire de cet événement. Mais nous pensons, en tant que citoyens israéliens, qu’il est important de garder une trace – une mémoire – de ce moment, il y a trente ans, où il y eut un véritable effort pour réconcilier Israéliens et Palestiniens. Ce que nous faisons, c’est, en quelque sorte, un geste contre l’oubli – contre la disparition du souvenir.
ASD - Le 7 octobre 2023 a été vécu comme un choc, une cassure, un traumatisme collectif. Mais lorsqu’on revoit votre film, on peut avoir le sentiment que la première rupture – celle qui a fissuré l’utopie du projet collectif qu’est l’État d’Israël – s’est en réalité produite le 4 novembre 1995, lorsqu’un citoyen israélien juif a assassiné le Premier ministre de l'État d'Israël. Diriez-vous que ce moment a marqué le début d’un autre Israël ?
AG – Absolument. Il existe même une déclaration du président de la commission – le président de la Cour suprême, Meir Shamgar. La majeure partie de l’enquête de la commission s’est concentrée sur les défaillances opérationnelles. Mais à la fin de son rapport, il a écrit qu’Israël ne sera plus jamais le même pays après cet assassinat. Il s’extrait alors de son registre de langue très rigide, très juridique, et je pense qu’il a raison. Israël a subi une décapitation de la possibilité de dialogue – et nous vivons encore aujourd’hui avec les conséquences, jusqu’au 7 octobre, et sans doute au‐delà.
ASD - À la fin de votre film, Leah Rabin – l’épouse d’Yitzhak Rabin – raconte comment son mari n'envisageait pas d'être pris pour cible, pas vraiment, comment il aurait refusé de porter un gilet pare-balles, tant il avait confiance. Pensez-vous qu’Israël, comme société, faisait preuve d’excès de confiance – ou peut-être d’une certaine naïveté – avant 1995 ?
AG – Je ne crois pas que ce soit une question de confiance. Je pense qu’il y avait deux visions différentes – et déjà des conflits internes. Les mêmes forces qui ont tué Rabin existaient déjà des deux côtés. Quand Rabin a donné l’ordre à l’armée de se retirer des villes palestiniennes, cela a déclenché la pire vague d’attentats suicides du Jihad islamique et du Hamas à Tel‐Aviv. Ces attaques, à leur tour, ont renforcé les éléments de l’extrême droite juive, et cela s’est terminé par un Juif israélien qui assassine Rabin. Cette coalition, ce groupe de personnes qui n’ont jamais voulu d’aucun accord avec les Palestiniens, existe toujours. Et les gens plus modérés, ceux qui veulent continuer à chercher des solutions de coexistence, se retrouvent coincés entre ces deux forces, pris en étau.
ASD - Difficile, en revoyant ce film aujourd’hui en 2025, de ne pas voir un écho direct entre les figures que vous montriez à l’époque et les dirigeants actuels d’Israël. Beaucoup de ceux qui étaient à la marge en 1995 – rabbins extrémistes, colons, voix nationalistes-religieuses – sont aujourd’hui au cœur du pouvoir. Diriez-vous que, politiquement parlant, l’assassinat de Rabin a, d’une certaine manière, triomphé dans l’Israël d’aujourd’hui ?
AG – Je ne sais pas si l’on peut parler de triomphe, mais nous sommes dirigés par un Premier ministre qui est un très grand manipulateur. Il manie la communication comme s’il suivait à la lettre le manuel de Machiavel sur l’art de manipuler. Et il a intégré ces éléments d’extrême droite, très radicaux, au cœur même du pouvoir – au sein du Shin Bet, de la police, des grandes institutions de sécurité, et même du ministère de la Sécurité nationale, dirigé par Itamar Ben Gvir. C’est une période très dangereuse.
ASD - À propos d’Itamar Ben Gvir, dans le film, on le voit brandir l’emblème Cadillac de la voiture de Rabin en disant : "On a atteint sa voiture, on l’atteindra lui aussi". Des années plus tard, lorsqu’il est devenu ministre de Nétanyahou, une photo a refait surface : on le voit poser chez lui avec un de ses enfants devant un portrait de Baruch Goldstein [le terroriste israélien qui a assassiné 29 Palestiniens à Hébron en 1994]. Aujourd’hui qu’il est l’un des ministres – et pas des moindres, puisqu’il est ministre de la Sécurité nationale – qu’est-ce que cela nous dit de la trajectoire morale et politique d’Israël depuis l’assassinat d’Yitzhak Rabin ?
AG – Je resterais sur Nétanyahou, parce que c’est lui l’architecte de tout ce dispositif. Pour moi, tous ces gens – Itamar Ben Gvir, Bezalel Smotrich, Orit Strook – font partie de l’architecture de Nétanyahou : un système conçu pour créer le chaos, l’instabilité, la peur. C’est le grand architecte machiavélique de tout cela, il en est au centre. Tous les autres ne sont que des pions, déplacés par le grand chef. Et le fait est que, bien sûr, Nétanyahou est un homme politique très talentueux qui fait face à une opposition très faible. C’est là, je crois, le cœur du problème.
ASD - Dans votre film, la colonisation en Cisjordanie n’est pas seulement un contexte : c’est une clé d’explication du climat qui a conduit à l’assassinat de Rabin. Aujourd’hui, toute l’attention est tournée vers Gaza, mais en Cisjordanie, la situation s’aggrave : attaques de colons, expulsions, impunité, volonté d’annexion de facto. La colonisation est-elle devenue, selon vous, le véritable moteur du déclin moral et politique d’Israël ?
AG – Cela a toujours été là. Vous savez, des deux côtés, il y a des gens qui revendiquent « Du fleuve à la mer » – parmi les Palestiniens et parmi les Israéliens. Tant que ces deux forces seront celles qui détiennent le pouvoir, ce sera une guerre permanente et sans fin. Les modérés perdent des deux côtés et tout ce que nous pouvons faire, c’est espérer que la situation finira par changer.
ASD - En 1995, une atmosphère de haine politique, de délégitimation et de discours religieux extrême a précédé l’assassinat de Rabin. En 2026, Israël entre dans une nouvelle année électorale, dans un contexte encore plus tendu, après deux ans de guerre. Craignez-vous que la campagne à venir puisse raviver une violence idéologique, voire politique, comparable à celle de 1995 ?
AG – La droite prétend que tout cela est valable des deux côtés, mais nous savons que tous les assassinats – pas seulement celui de Rabin, mais aussi celui d’Emil Grunzweig [militant pacifiste israélien tué par une grenade lancée par Yona Avrushmi lors d’une manifestation de Shalom Akhshav à Jérusalem, en 1983] – sont venus de la droite. Il nous faut donc rester prudents, et observer ce que Nétanyahou est en train de mijoter, ce qu’il veut nous faire avaler lors de la prochaine élection – s’il y en a une. Il faut se méfier de cet homme. Attendons de voir.
ASD - Vous dites "la prochaine élection – s’il y en a une"...
AG – Parce qu’avec des gens comme Nétanyahou – ou son principal complice, M. Trump – qui n’ont aucune règle et ne respectent aucune des normes de la société, il faut toujours rester prudents et sur ses gardes.
ASD - J’aimerais finir sur une note un peu plus optimiste.
À un moment du film, Rabin dit : "J’ai combattu en soldat tant que la paix n’était pas possible". Sommes-nous en train d'atteindre un moment où la guerre elle-même n’est plus possible ?
AG – Je vous rejoins dans votre désir d’espoir. Espérons que ce sera le cas.
En tant que vétéran de la guerre du Kippour [en 1973], je sais que l’histoire est dialectique – parfois, une grande catastrophe peut ouvrir une brèche. Vous savez, la guerre du Kippour a conduit aux premiers accords de paix avec des pays arabes.
Mais la question reste ouverte : qui l’emportera ?
Malgré tout, je suis d’accord avec vous : l’espoir est moteur de changement. Gardons donc un petit grain d’espoir.