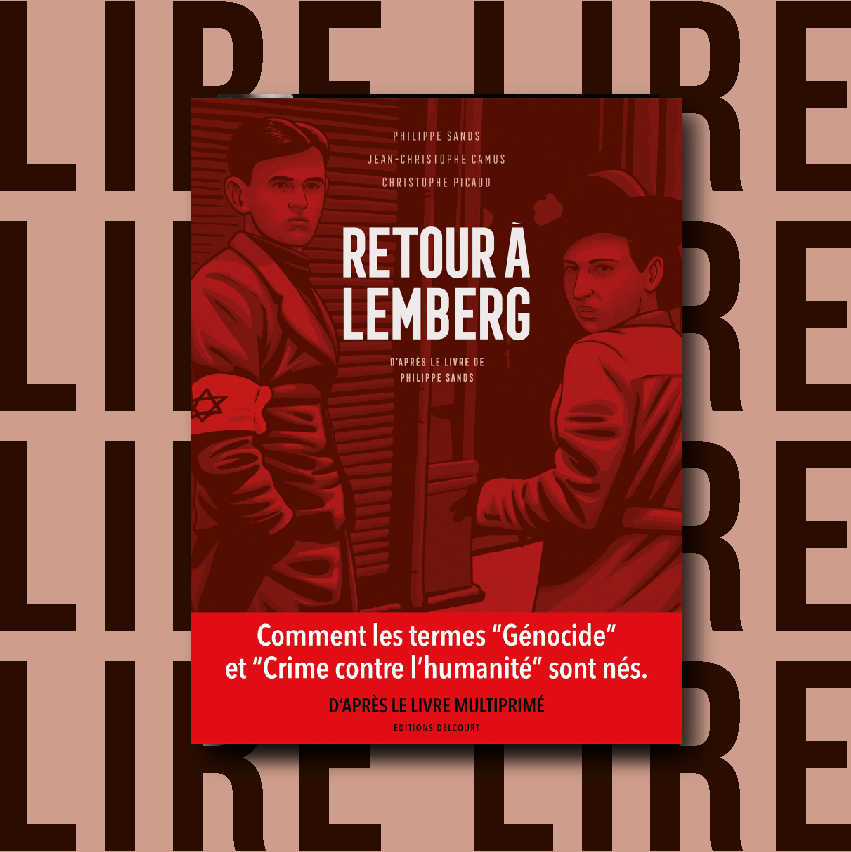Il y a, dans la langue, plus d’un mot que nous utilisons avec une sérénité qui, lorsqu’on s’y arrête, ne laisse pas d’étonner. À vrai dire, c’est le cas de presque tous. La psychanalyse en aura eu l’intuition, sans doute, dès sa naissance. En effet, dans la seule et unique règle incombant à celle ou à celui qui décide d’aller parler avec un.e psychanalyste, il s’agit de dire. Et c’est tout. Mais de dire de cette manière singulière que l’on appelle, en français, d’un terme passé dans la langue courante : « association libre ».
Tout le monde connaît ce jeu : jeu de mots, jeu de la langue, jeu sérieux donc : dire tout ce qui passe par la tête. Oui, et c’est vertigineux justement, dire tout, absolument tout ce qui vient à l’esprit. Et alors ? Alors les vocables se cognent, se rencontrent, se contaminent, s’appellent et se répondent, se combinent, se montent les uns avec les autres, s’enchaînent par les sons et déchaînent les sens.
Comment parvenir à cela ? Freud nous donne le mode d’emploi de ce qui est la condition de toute analyse possible :
« Votre récit doit différer, sur un point, d’une conversation ordinaire. Tandis que vous cherchez généralement, comme il se doit à ne pas perdre le fil de votre récit et à éliminer toutes les pensées, toutes les idées secondaires qui gêneraient votre exposé et qui vous feraient remonter au déluge, en analyse vous procédez autrement. Vous allez observer que, pendant votre récit, diverses idées vont surgir, des idées que vous voudriez bien rejeter parce qu’elles sont passées par le crible de votre critique. Vous serez alors tenté de vous dire: « ceci ou cela n’a rien à voir ici » ou bien : « telle chose n’a aucune importance » ou encore : « c’est insensé et il n’y a pas lieu d’en parler ». Ne cédez pas à cette critique et parlez malgré tout, même quand vous répugnez à le faire ou justement à cause de cela. Vous verrez et comprendrez plus tard pourquoi je vous impose cette règle, la seule d’ailleurs que vous deviez suivre. Donc, dites tout ce qui vous passe par l’esprit. »
« Sur l’engagement du traitement », in La technique psychanalytique, P.U.F., Quadrige, pp. 105–106.
Et si nous demandions à une autrice de romans et d’essais, à un historien et à un philosophe, afin de nous aider à penser ce qui arrive, de jouer ainsi avec ces deux mots tant utilisés ces derniers temps : Avant/Après. Mais si, vous savez bien, cette histoire de monde d’avant et de monde d’après tellement ressassée qu’on ne peut manquer de sentir le fétiche, la prière, la promesse, le bouchon, la réponse magique à tout ce qui inquiète.
Alors, qu’est-ce que c’est que ça « avant » « après » ? Qu’est-ce qui, à les évoquer, vient à l’esprit de Tiphaine Samoyault, de Patrick Boucheron et de Mathieu Potte‐Bonneville ?
*
APRÈS, PENDANT, AVANT
1. APRÈS
C’est plus fort que moi : à chaque fois que j’entends ou lis l’expression « le monde d’après », et les occasions ne manquent pas ces temps‐ci, je ne peux m’empêcher d’ajouter mentalement un codicille ironique – le monde d’après qui, au juste ? Dans cet ajout ou cette complication (cette amphibologie, aurait dit Jacques Lacan) je reconnais une pointe de scepticisme, envers l’idée selon laquelle nous aurions traversé en commun l’épreuve d’une crise et pourrions de ce fait, rejetés sur ses rives après le naufrage, communier dans l’évidence d’un nouvel âge du monde capable de mettre fin à la divergence des agendas, à la partialité des points de vue et à la confrontation des bifurcations possibles. Mon sentiment est que la communauté de destin dont cette expression s’autorise lorsqu’elle se dispense, avec une retenue pleine de pathos, de nommer l’événement auquel l’après succède (le monde d’après, d’après tout court, vous savez bien, dit‐elle), cette communauté de destin est zébrée d’expériences incomparables – entre les confinés et ceux fermés dehors, fracture à la fois personnelle, sociale, salariale, territoriale dont on devrait prendre le temps de mesurer la profondeur ; de sorte que le sens du « pendant » auquel l’après serait censé faire suite demeure, c’est le cas de le dire, pendant, sa signification promise à un conflit des interprétations peut‐être interminable, et peut‐être violent.
2. PENDANT
J’ai compris quelque chose, pendant le confinement. À l’énigme soulevée par Saint‐Augustin quant à l’impossibilité de définir le temps (dès lors que le présent, le passé, le futur brillent sitôt qu’on s’y arrête par leur inexistence), Husserl répond comme on sait par une vie subjective allant se divisant sans cesse en directions divergentes, en protentions et rétentions par où se distribue, depuis la conscience présente, l’attention au réel. La centralité du présent qui s’ensuit peut paraître hégémonique, puisque sans présent d’où ils se trouvent visés, il ne saurait y avoir de passé ni de futur ; et le diagnostic de « présentisme » que l’historien François Hartog a posé concernant la conscience historique contemporaine semble tirer toutes les conséquences de cette centralité, voyant la référence au passé ou au futur progressivement érodée, ou résorbée, dans l’attention exclusive à ce qui se déroule ici et maintenant.
Mais la vérité est aussi bien inverse : comme le savent les prisonniers sans espoir de remise de peine, ou les relégués dans l’attente indéfinie d’une décision administrative, s’il n’y a ni passé ni futur il n’y a pas non plus de présent, assignable ; non seulement on y perd le décompte des jours, mais le maintenant n’y maintient rien du tout. J’ai compris cela, donc. Mais je ne saurais dire quand.
3. AVANT
Dans un livre publié en 2012 avec l’artiste François Matton, et intitulé Dictionnerfs, je m’étais appliqué à proposer quelques définitions de mots-chimères, comme on tenterait de dresser la nomenclature de ses affects. J’y retrouve une définition quichottesque à laquelle je ne trouve rien à changer ni à retrancher, parce qu’elle me paraît encore saisir exactement le battement entre tendresse et exaspération que suscite toujours pour moi l’évocation des temps anciens (on l’oublie trop souvent, tant la silhouette du chevalier à la triste figure a pris sur ses frêles épaules l’amour envers et contre tout des livres et de l’enfance, la beauté des causes et des trésors perdus : souvent, Don Quichotte est aussi exaspérant).
Cette définition, donc :
Moulincolie, n.f. : c’était mieux à vent.
*
Il n’y a de poètes que de l’après
Avant, “après” est une promesse. Après, c’est un désastre. Je vois ces immuables doubles portraits, aux dernières pages des magazines de mon enfance que l’on retrouve à l’identique dans les publicités d’internet faisant la réclame d’un produit ou d’une méthode pour maigrir. Avant (une femme grosse) /Après (une femme mince). L’envers du désastre ? Rien n’est moins sûr et la persistance publicitaire nous le rappelle : l’après connaît lui‐même un après qui redevient l’avant de ce même après et ainsi de suite. Que l’après signale une perte (de poids) ou un gain (de cheveux dans le cas des produits contre la calvitie précoce), il a dans tous les cas une valeur : celle de la renaissance et surtout des vertus consolantes de l’illusion.
Je vois le cabinet de débarras où la mère a caché l’enfant un jour de juillet 1942 dans l’œuvre de Raymond Federman. Avant, il avait des parents et il parlait français. Après il n’a plus de famille et commencera à écrire en anglais, pour retrouver des souvenirs et pour tenter de donner corps à ce qu’a été pour eux, l’après, après qu’ils ont été emmenés, après leur départ et pour lequel il n’y a rien. Avant parle une autre langue.
Entre ces deux exemples, je vois la différence entre ce qui change et ce qui ne change pas. L’avant/ après spectaculaire et publicitaire est un mouvement pendulaire et réversible. Il n’est pas une transformation véritable dans l’ordre du temps. Quelque chose change provisoirement pour que rien ne change. C’est un temps confiné. C’est aussi ce à quoi a ressemblé le temps du confinement. Il a inventé sa langue, avec des mots qu’on n’entendait jamais avant, comme « confinement » justement, et puis « distanciation sociale », « gestes barrières », « avoir de la toux », toutes les déclinaisons du « corona » : un dictionnaire à usage unique, une langue morte.
L’après, c’est l’avant qui dure. Plus il est tenace, plus l’après dure. Il est d’usage de penser que l’événement coupe le temps en deux. Mais c’est bien cet événement qui est constitué en avant qui dure. L’avant de l’événement est perdu. Dans l’Après-guerre, c’est la guerre qui dure. Dans le postcolonial, c’est la colonisation qui perdure. Imre Kertesz à Stockholm : « À propos d’Auschwitz, on ne peut écrire qu’un roman noir ou, sauf votre respect, un roman-feuilleton dont l’action commence à Auschwitz et dure jusqu’à nos jours. Je veux dire par là qu’il ne s’est rien passé depuis Auschwitz qui n’ait annulé Auschwitz, qui ait réfuté Auschwitz. Dans mes écrits, l’Holocauste n’a jamais pu apparaître au passé. » 1
L’avant avant n’est plus dans le temps. Il est devenu mythique. Le temps d’après est toujours le temps de la fin, même si celle‐ci est suspendue. C’est aussi comme cela qu’on peut définir la mort : la perte du passé. Et toujours manque « pendant ». Il y a la langue d’avant, la langue pendante. Mais sait‐on à quoi ressemblera la langue d’après ? Pourquoi n’y a‑t‐il de poètes que de l’après ? Sans doute parce que c’est le temps dont la langue manque et qu’il faut l’inventer. Après ? le temps de la langue redevenue vivante.
1. Voir à ce propos Tenou’a hors‐série Yom HaShoah 2016, De génération en génération
Retour au texte
*
Avant /Après
Les conservateurs veulent conserver. Ils veulent conserver le monde d’avant, mais peinent à placer le couperet de l’après. Car il faut bien le situer quelque part sur la frise du temps, ce pli, pour que l’on puisse le rabattre bord à bord. On compte sur les historiens, experts en commencements fragiles et en césures indescriptibles, pour déplacer ce pli et nous dire : l’événement n’est pas où vous croyez. Il est encore à venir ou, bien plus fréquemment, il est déjà advenu.
Les historiens, dis‐je, oui mais lesquels ? Il y en a de deux sortes. La première, espèce commune et toute désespérante, ne cesse de refroidir nos ardeurs présentistes : non, disent‐ils, le temps n’est pas encore venu, vous trimbalez avec vous le lourd fardeau du passé, voyez comme il pèse, flairez son parfum d’archaïsme. À ces apôtres de la permanence, massés en rangs serrés derrière le crédit qu’on leur accorde, on peut préférer la petite troupe dissidente des rajeunisseurs de traditions. Eux disent aux conservateurs : ce que vous aimez n’est pas si ancien que vous le prétendez, et pour le préserver de cet après qui vous effraie, vous être prêts à saccager un avant plus vénérable encore.
Pourtant, il faudrait avoir le courage de congédier pareillement, et d’un cœur léger, ces deux sortes d’historiens, ou du moins de leur demander de renoncer plus radicalement à l’idée même qu’il puisse y avoir un pli. Dès que quelque chose arrive, ne leur demande‐t‐on pas de fouiller dans le passé à la recherche d’un précédent consolateur ou d’une comparaison possible, selon la formule plaisante mais paresseuse de la concordance des temps ? Je préfère pour ma part l’expression plus désuète de « parallèles historiques », qui fleure bon le tableau noir. Vous vous souvenez ? Les parallèles ne se croisent jamais – nulle concordance ici, mais le geste qui consiste à casser le cours du temps pour mettre en regard deux lignes brisées.
Continuons ainsi, par association libre, puisque l’on nous y invite amicalement. Il m’arrive parfois de repérer dans un livre un passage dont je sais immédiatement, mais sans le comprendre tout de suite, qu’il s’adresse à mon métier d’historien. Je le lis, je le relis, en tâchant de ne pas aller plus loin, de le laisser en suspens, vaguement, de ne surtout rien expliciter, pratiquant cet art délicat qui consiste à ne surtout jamais aller au bout de ces idées. Puis, un jour, prenant de vitesse ce désir de laisser les choses dans leur pli, je décide par inadvertance de les coucher par écrit (drôle d’expression quand on y pense) et attends que quelqu’un – cela peut être moi, ou un autre – les lise pour les comprendre.
Par exemple, ici : dans Intervalles de Loire, son dernier livre publié en 2020 aux éditions Verdier, Michel Jullien raconte cette chose vue, lors d’un voyage en barque sur le fleuve. C’est une de ces échelles de crues qu’on voit dans les villages. Elles sont « des tablettes d’innocence, des reposoirs à l’irresponsabilité de nos malheurs. Contrairement aux listes de soldats fauchés au cours des deux guerres, elles disent à peu près “...ce n’est pas nous sur ce coup-là, c’est le fleuve”. » Michel Jullien décide de les voir à hauteur d’enfants. « Elles ressemblent aux montants de porte sur lesquels les parents ont tracé des marques au crayon, au passage de la cuisine, avec sur le chambranle des traits de différentes couleurs, une par enfant (trois enfants, on s’y perd en hachures), des dates ou un âge, les tailles d’une fratrie ». Sauf qu’ici, on s’y retrouve : plus c’est haut, plus c’est tard. Alors que sur une échelle de crue, quel désordre, c’est à n’y rien comprendre : « 1882 coincé entre 1856 et 1846, 1924 bien plus bas et 1973 au ras du sol, aucune proportionnelle, encore une méthode des adultes, ou bien une blague ».
Ce n’est pas une blague, non, mais peut‐être la chronologie rêvée de nos débordements et de nos décrues, une manière bien plus ressemblante que la parade ordonnée des avants et des après pour dire ce que fait le temps lorsqu’il s’accumule en nous. Voici pourquoi ce passage me touche, et pourquoi il me touche aujourd’hui. J’attends qu’on me l’explique. Une petite fille de 10 ans, me racontant son rêve, a commencé à le faire. Elle disait ce que pourrait être le monde d’après, puisqu’elle était, par le songe, transportée à la rentrée prochaine. Mais cet après ressemblait furieusement à l’avant : les élèves étaient repartis dans les mêmes classes que l’année précédente, sans même avoir changé de niveau. « Du coup ben ça nous énervait un peu. Alors on a commencé à jouer, et à se disputer. Les surveillants nous ont demandé de nous taire. Alors, on a vu un mammouth grand comme un immeuble qui s’avançait vers nous ».
On comprendra plus tard que ce mammouth n’était qu’un pantin mécanique destiné à faire peur aux enfants pour qu’ils aillent se cacher. Je vous passe la fin du rêve – la petite fille s’engouffre dans le métro, voit un youtubeur célèbre qui trébuche, il est au bord de tomber sur la voie, s’accroche à la moustache d’un voyageur non masqué qui se transforme en moustache de chat, enfin la routine onirique, quoi. Dans ces métamorphoses et ces machineries se dit un temps proprement shakespearien – le nôtre aujourd’hui. Il déborde. Impossible de le discipliner en échelonnant sagement des âges et des tailles au chambranle des portes d’enfants. The time is out of joint 2 . Une fois dégondée, une porte ne peut être ni ouverte ni fermée. Plus de pli, ni d’avant ni d’après. Seulement un bâillement où se faufilent des monstres bien archaïques, venus du fond des âges pour nous faire peur et nous ramener chez nous. Ce ne sont que des simulacres, mais on n’a pas le cœur à rire. On est au bord de trébucher sur cette évidence atroce : le monde d’après risque d’être terriblement répétitif, comme des longues vacances sans été, interminablement ennuyeuses.
2. “The time is out of joint” est une phrase issue du premier acte de Hamlet de Shakespeare. Intraduisible s’il en est, cette expression pourrait s’interpréter comme « Le temps est désarticulé », « Le temps est disloqué » ou encore « L’époque est chaotique » [N.D.L.R.]
Retour au texte