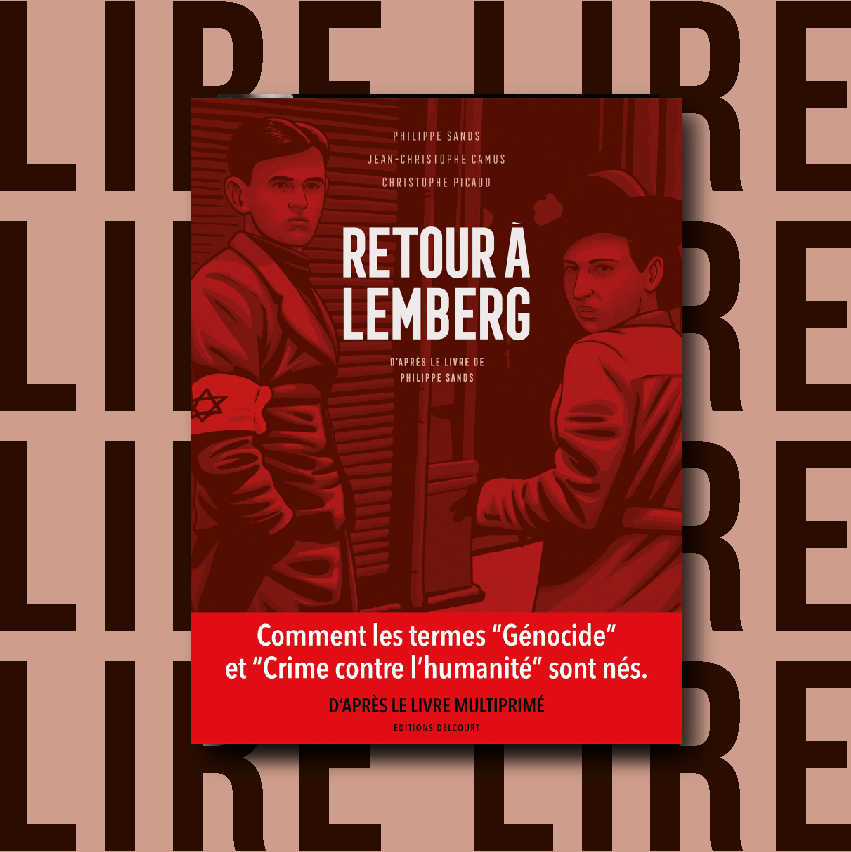Vous avez remarqué que je ne me suis pas suicidé », s’amusait Imre Kertész au Monde.
On le lira, partout, que Kertész aimait la vie, qu’il l’avait choisie ; fadaises. La vie avait choisi Kertész, la vie l’avait élu, et le talent aussi. « Vivre est aussi une façon de se suicider : l’inconvénient, c’est que cela prend énormément de temps », se rétorquait‐il dans Roman Policier.
Kertész c’est Kafka après Auschwitz ; non, c’est Kafka avec Auschwitz. C’est l’Ecclésiaste avec Auschwitz. Kertész, en d’autres temps, eut été prophète. Mais il a été en son temps, un temps de chiens, de moins‐que‐rien, un temps ignoble et dégueulasse qui l’a nommé en chien, en moins‐que‐rien.
Lisez Kertész, et n’y cherchez ni cynisme ni sarcasme, ni grandeur ni génie : Kertész est en deçà et au‐delà, parce qu’il est certainement l’un des seuls qui ait eu simultanément la clair‐voyance et la démence de nous faire entrevoir ce que fut Auschwitz, ce qu’est Auschwitz, ce que pourra être Auschwitz.
« Je ne supporte pas l’expression “On ne peut pas penser Auschwitz”. On peut très bien penser Auschwitz. Mettez un fou à la tête d’un État de droit, et vous aurez Auschwitz », gueule Kertész dans Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas.
« Écoutez‐moi bien, ce qui est réellement irrationnel et qui n’a vraiment pas d’explication, ce n’est pas le mal, au contraire : c’est le bien », écrit‐il encore.
Soit. Dans ce cas, Kertész est prophète de l’irrationnel. Kertész est mort, vive Kertész.