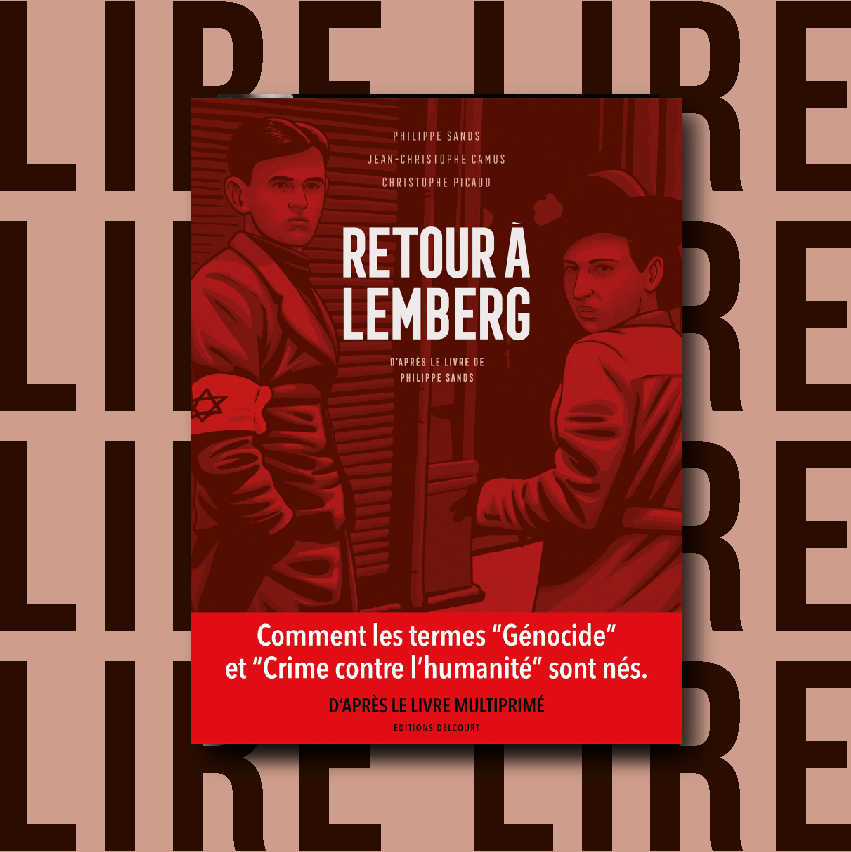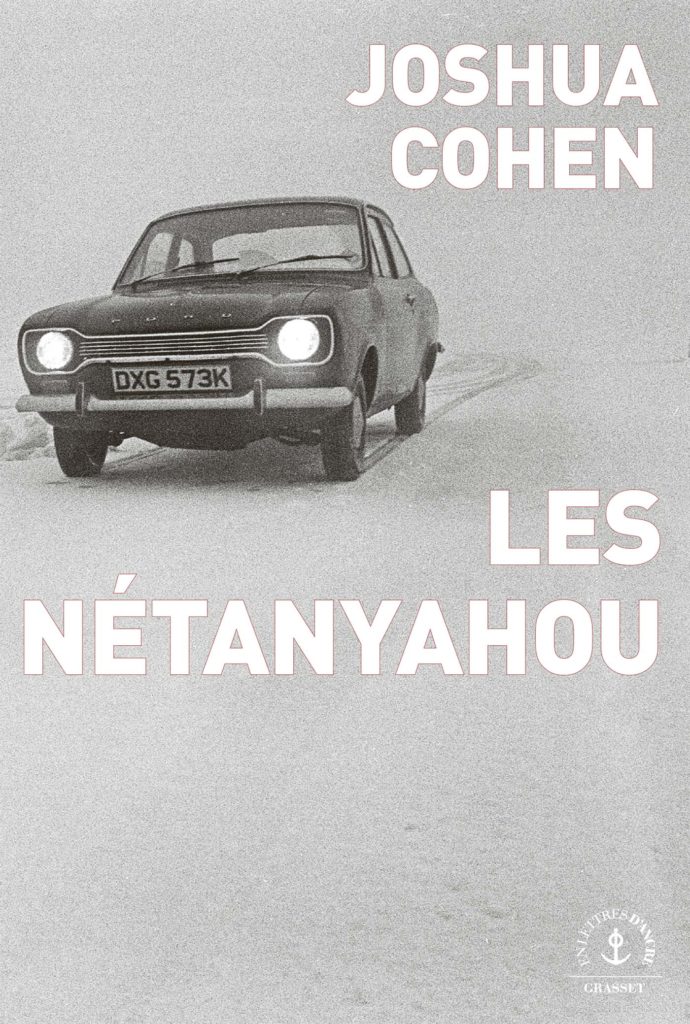
Dans Les Nétanyahou, Joshua Cohen, jeune romancier américain tout récemment récompensé par le prestigieux Prix Pulitzer de la fiction, fait le portrait de deux professeurs d’université juifs américains dans les années soixante, dont l’un, Ben‐Zion Nétanyahou, fut le père de Benjamin Nétanyahou. Très rythmé, le récit se déploie tel une fugue impétueuse développant alternativement le parcours du narrateur Ruben Blum et celui de Ben‐Zion Nétanyahou, dont il est censé évaluer le profil afin que l’université où Blum enseigne, Corbindale, lui octroie un poste.
Nous ne saurions dire quel est l’aspect le plus réussi du livre : l’imposante maîtrise de Joshua Cohen des enjeux politiques et philosophiques du sionisme, dont on survole l’histoire depuis les années vingt jusqu’à nos jours ? Le désopilant portrait de deux intellectuels juifs des années soixante, si proches et si lointains, aussi intraitables l’un envers l’autre que peuvent l’être un frère et une sœur à l’adolescence ? Le fait de rendre accessibles – et drôles – des controverses propres à l’histoire des Juifs, tout en reliant brillamment cette histoire à l’émergence de la démocratie en Amérique ? À la fois page turner, roman policier facétieux, Les Nétanyahou se révèle aussi être un hymne poétique adressé aux douleurs de la diaspora, bien plus profond qu’il n’y paraît.
Fanny Arama Le personnage de Ben-Zion Nétanyahou dans votre roman est passablement odieux : vous décrivez un historien en quête d’un poste dans une université américaine, dans les années soixante, sans-gêne et souvent grossier, plein de lui-même. Pourquoi les personnages antipathiques attirent-ils davantage l’intérêt des romanciers que les personnages vertueux ?
Joshua Cohen Je ne conçois pas la vertu comme un personnage. La plupart des héros sont vertueux. Et la vertu que j’observe dans la vie dépend de la situation. Des gens qui sont compliqués – ou antipathiques – agissent parfois avec honneur contre toute attente. Je ne pourrais pas être plus en désaccord avec les choix politiques de Ben‐Zion Nétanyahou, ce ne sont pas mes choix mais j’aime l’idée que, comme les marxistes qu’il haïssait, son but n’était pas de décrire le monde, mais de le changer. Il ne se contentait pas de produire des recherches, il voulait changer le monde. On parle ici d’un quasi‐terroriste placé dans une université et – même si cela peut sembler narcissique – je crois que cela décrit la position de l’écrivain. Je ne veux pas être un écrivain en poste à l’université, je veux tuer tout le monde ! je veux changer les choses !
Ben‐Zion Nétanyahou était un Juif qui, au xxe siècle, fût expulsé de l’Histoire elle‐même : il était militant du Mouvement sioniste révisionniste et il a dû quitter la Palestine. À la fin des années cinquante, il veut être utile. Selon moi, Ben‐Zion Nétanyahou était quelqu’un d’extrêmement frustré qui, d’une certaine façon, n’était pas autorisé à avoir un destin. Il a quasiment été forcé de tenir cette position d’Américain exclu de l’Histoire et il en conçut tant de ressentiment, de jalousie, d’envie, d’orgueil et de rage. L’idée que Ben‐Zion est un homme mauvais vient uniquement de la personne publique qu’est devenu son fils cadet [Benjamin Nétanyahou]. S’il n’avait pas eu un deuxième enfant appelé à devenir Premier ministre d’Israël, je crois que nous pourrions mieux le cerner.
FA Votre roman fait la satire de la vie universitaire dans les années soixante aux États-Unis, de manière très réaliste. Avez-vous vous-même un parcours universitaire et qu’en retenez-vous ?
JC Mon vrai problème avec le monde académique c’est qu’il me semble n’avoir aucune connexion avec le monde réel : on y étudie tels poèmes, telle science politique, on étudie l’Histoire mais, à l’abri des murs de l’université, on a parfois le sentiment de ne pas être connecté à la vie réelle. J’enseigne bien un peu mais j’ai tenté durant des années de me faire virer, et on refuse de me virer.
Votre question m’amène à vous parler de mon amitié avec Harold Blum, l’un des critiques littéraires les plus respectés des États‐Unis. Ayant été professeur durant cinquante ans, Harold Blum a été impliqué dans tous les débats universitaires. Dans les années quatre‐vingt, il se retrouva au cœur d’une polémique pour avoir écrit The Western Canon, auquel on reprocha de ne pas inclure suffisamment de femmes ou de gens de couleur. Il fut accusé de harcèlement… Il avait tout vu et était coupable de bien des choses et, pourtant, à mes yeux il était quelqu’un de fascinant, un génie. Et une personne bizarre. La vie de Harold fut, en grande partie, une superbe blague. Il était cet enfant né dans le Bronx de deux parents yiddishophones qui deviendrait l’immense critique littéraire de l’Amérique, expert de Shakespeare et de la poésie romantique britannique, comme Shelley et Byron. Il ne commença à parler anglais qu’à l’âge de six ou sept ans, sa langue maternelle était le yiddish. Et l’ironie, c’est aussi à l’université qu’on la trouve : il s’agit de quelqu’un que l’on n’autorisait pas à étudier à l’université, parce qu’il était juif, avant de devenir le premier Juif à enseigner à la faculté d’anglais de Yale. Puis il fut accusé de trop appartenir à l’establishment, donc il passa d’un extrême à l’autre.
Mon expérience est tout autre : je n’ai pas l’esprit d’équipe, je me tiens loin des organisations et des institutions, je ne coopère pas.
FA Avez-vous toujours eu un regard hypercritique sur le monde ? Vous souvenez-vous comment ce regard est né, à quelle occasion ?
JC Je ne me souviens de rien de ma vie, il me semble que je n’existe pas.
J’essaye de ne pas trop penser à moi, je n’écris pas d’autofiction, ce qui me plaît, c’est de me glisser dans la peau et la tête d’autres personnes et de parvenir à la métamorphose du point de vue de quelqu’un d’autre. Ce qui me sert comme écrivain est ce qui me dessert dans la vie : je ne crois vraiment en rien, j’ai une capacité empathique extraordinaire, n’importe qui peut me convaincre de n’importe quoi. Si quelqu’un est en colère contre quelque chose, je veux partager cette colère, si quelqu’un pleure, je veux pleurer avec lui. Je veux avoir accès à l’esprit des autres et comprendre ce qu’ils pensent. C’est dur pour un humain mais très utile à l’écrivain.
FA Il est délicat de réunir la littérature juive sous un même drapeau, de mêmes qualificatifs, elle est très variée et tend à l’être de plus en plus. Ce qui place votre roman dans l’héritage du roman juif américain, c’est indubitablement l’humour. Mais qu’est-ce qui vous distingue de cet héritage ?
JC Un écrivain n’est que le produit de son époque, on ne peut pas éviter cela. Il existe une conception ancienne et profondément ancrée de la Diaspora et de Sion qui mobilise quasiment tous les textes juifs, de la Torah à la fiction.
Mon livre parle de cette idée selon laquelle il existe en diaspora une solitude et un sens de la dispersion ; et puis, il y a Sion, un idéal poétique. Cela ne fait que soixante‐dix ans que la Shoah a eu lieu, que soixante‐dix ans que Sion est devenu un État, avec électricité et eau courante à tous les étages. C’est un phénomène unique dans l’histoire du monde. Ce n’est pas Yehuda Halevy qui rêve à Sion, ce n’est pas le peuple qui a écrit le Talmud à Babylone, eux n’avaient pas de taxis ni de Boeing 747, et cette terre était pour eux impitoyable. Alors ce qui me différencie, moi et tout écrivain juif de ma génération qui regarde le présent de façon sincère, c’est que cette idée de diaspora s’est évaporée, elle a disparu. Il n’est qu’à parler aux Israéliens qui vivent à Berlin, à Miami ou à Los Angeles… La maison, c’est où ? Sion, c’est quoi ? Tout ceci est devenu vraiment compliqué. Nous vivons nos vies de façon très mondialisée. Les Juifs forment le tout premier peuple mondialisé mais, aujourd’hui, nous avons atteint l’étape ultime de la mondialisation. Et la fiction fait partie des choses qui nous permettent de le comprendre.
FA La tonalité de la critique désabusée, très présente dans Les Nétanyahou, est-elle une tonalité qui vous est familière, ou est-elle particulière à ce roman ?
JC Eh bien… je suis assez désabusé. Chaque livre invente sa propre voix. Mais les différentes voix sont liées par quelque chose : ce que je ne peux inventer, c’est l’esprit qui leur préexiste. Les voix changent mais l’esprit demeure le même. Dans Les Nétanyahou, je ne voulais pas dépeindre les années soixante telles qu’on les voit dans Mad Men : c’est un idéal platonique de ce que c’était. Ce qui m’intéressait, c’était de convoquer une critique de la représentation de cette époque. Je me suis servi de nombreuses parodies et versions de la littérature juive des années cinquante et soixante. Le livre débute en 1959, l’année où Philip Roth a écrit son premier livre, Goodbye Columbus. Je voulais revisiter ce qui s’apparente à la naissance de la littérature juive américaine, emprunter certains de ces célèbres clichés pour les renverser et les repolitiser. Je voulais leur donner un nouveau sens politique.
FA Lisez-vous des romanciers israéliens ? Quels sont les romans israéliens qui vous ont le plus marqué ces dernières années ?
JC Bien sûr, j’ai vécu en Israël à différentes périodes de ma vie, je traduis de l’hébreu. J’aime Hanock Levin, Yoram Kaniuk, Orly Castel‐Bloom, Yoel Hoffman, parmi tant d’autres.
FA Votre roman semble habité par une inquiétude profonde quant à l’avenir d’Israël. À quel point êtes-vous inquiet ?
JC Aussi inquiet que pour les Juifs aux États‐Unis. Tout m’inquiète.
Propos recueillis par Fanny Arama
et traduits par Antoine Strobel-Dahan