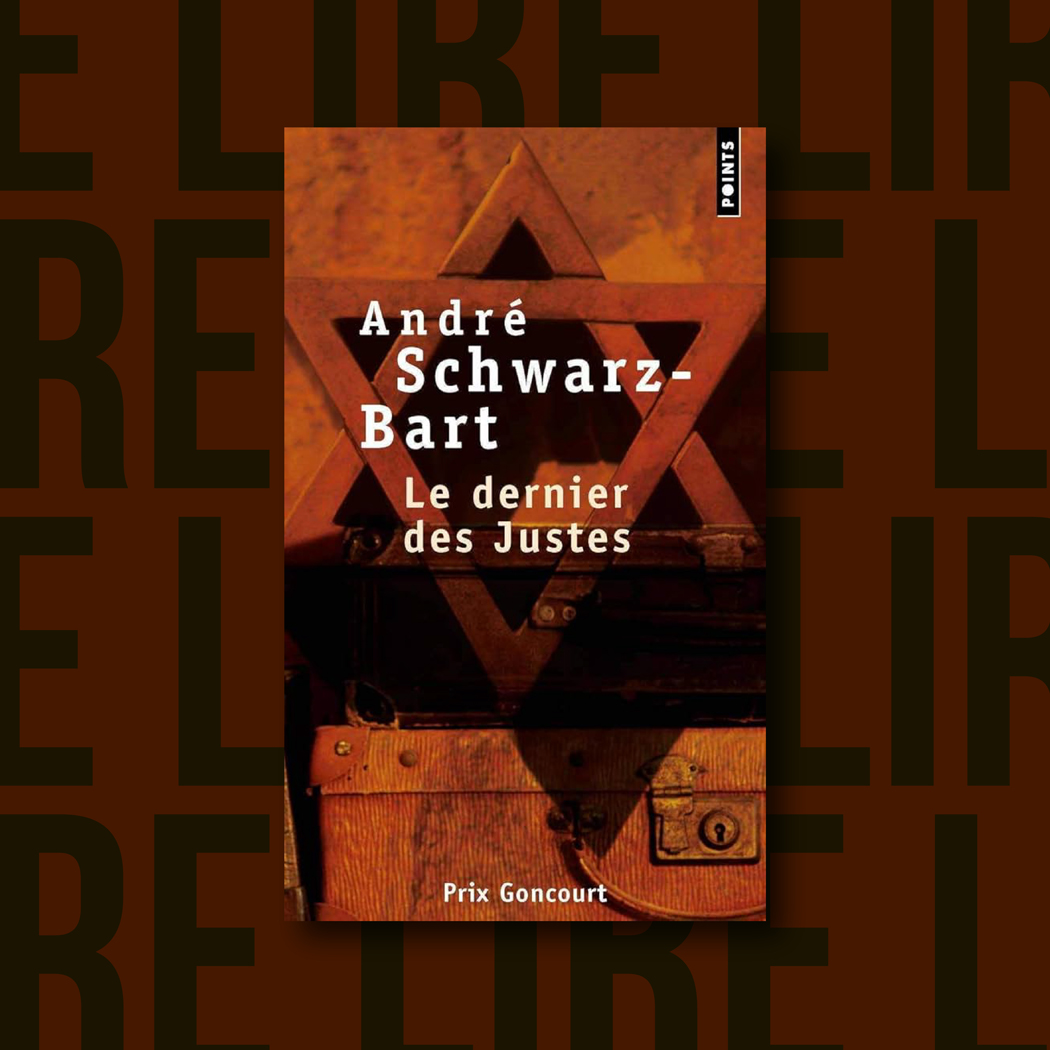C’est sans doute un peu comme les séances de psychanalyse. Au début, rien de remarquable. Puis, au bout de la troisième tentative, une petite voix nous dit de continuer, malgré tout. C’est un mot, une hésitation, une respiration qui rompt le rythme égal de la confidence quelque peu triviale d’une patiente quelque peu banale et vient indiquer que quelque chose veut sortir… mais quoi ?
Au départ, une jeune fille vit sa vie ordinaire dans les années post‐Covid à Paris, scandée de « crises » apparues à l’adolescence, qui s’emparent d’elle à des moments de vie en société et la rendent agressive, violente, parfois dangereuse pour son entourage. Son discours est un peu lassant : Mona Roze est donc une jeune femme banale. Elle écrit dans un magazine féminin sur des phénomènes de société, a un ami qui l’encourage à consulter, et des conjoints à la pelle, homme ou femme, qui finissent fatalement par la quitter. Banale, vous dis‐je : elle est entière, passablement impulsive, narcissique, veut que son père accepte ses choix de femme émancipée. Tandis qu’elle cherche laborieusement le bonheur, deux jeunes Juifs tentent de survivre dans la Pologne des années 1930. Après un énième Noël progromiste auquel ils échappent de justesse, Avrum Finkelstein et Moyshé Rozenberg quittent Rojak en 1932. Leur amitié est scellée par de pénibles épreuves. Leur passage par Varsovie, leur arrivée à Paris après le vol de tous leurs biens dans le train, leur goût des défis et leur détermination à s’émanciper du shtetl par la connaissance de la grande ville se lisent comme autant de marches devant mener à la liberté. Mariés et pères de famille comblés, se croyant à l’abri dans la capitale française, ils seront toutefois déportés tous les deux à Auschwitz. Avrum survivra à Moyshé atteint du typhus, mais succombera à son tour lors de la marche de la mort, après avoir survécu au martyre de voir le corps de son propre père pendre plus de vingt jours durant et après avoir été contraint de le saluer sur la consigne de ses assassins sadiques.
Ce qui distingue ce récit de n’importe quel autre récit de la Shoah, c’est qu’il est ici mis en scène à travers le parcours erratique de l’arrière-petite fille de Moyshé Rozenberg, qui n’est autre que Mona Roze. Éreintée par des crises d’angoisse inopinées, par des hallucinations répétées la contraignant à revivre le passé de Juifs persécutés, elle découvre à travers un parcours psychanalytique non dénué d’embûches qu’elle est la descendante directe de Moyshé Rozenberg par son père. Assistée par de bonnes volontés rompues aux groupes de parole de descendants de victimes de la Shoah, elle est progressivement menée aux révélations successives du passé de ses aînés, censées l’affranchir de ses angoisses existentielles. C’est sans compter sur le Dibbouk qui la possède, et c’est cette partie du roman qui est selon nous la plus réussie. Subrepticement, l’intrigue bascule dans le fantastique, mais celui‐ci ne débarque pas avec ses ficelles habituelles, non. Nathalie Zadje en fait quelque chose de plus macabre et de plus sinistre, parce que ponctué de spectres intériorisés ou projetés, hallucinés et racontés : ceux des survivants des rafles, des camps de concentration et d’extermination et des marches de la mort.
C’est en 2003, dans la revue francophone d’ethnopsychiatrie, que Nathalie Zajde publie pour la première fois le résultat de ses recherches sur le Dibbouk. Elle revient sur cet épisode dans Guérir de la Shoah. Psychothérapie des survivants et de leurs descendants (Odile Jacob, 2005) où elle retrace le parcours de Rachel Lévy, une femme d’une soixantaine d’années souffrant d’une grave dépression. Lors d’une séance réunissant un groupe de parole d’enfants cachés et de descendants de victimes de la Shoah, à la mention du camp de Dachau, Rachel Lévy se mit à émettre des sons et à râler contre sa propre volonté, comme si elle était possédée par un « Dibbouk », l’âme d’un mort hantant le corps d’un vivant et réclamant sa « libération ». Profondément marquée par la mythologie du Dibbouk et par ses prolongements ethnopsychiatriques, Nathalie Zadje offre dans La Patiente du jeudi une incarnation fictionnelle de l’impossible affranchissement de la mémoire des familles martyrisées par la Shoah. À travers le télescopage de souffrances vécues ou intériorisées, elle parvient à faire basculer une situation presque banale – une jeune femme d’aujourd’hui hantée par une tragédie refoulée – dans la dimension surnaturelle des romans gothiques d’antan, où la frontière entre le fou et le sain d’esprit est brouillée par l’indicible passé qui refuse de passer, qui veut qu’on l’accueille et qu’on l’écoute, qu’on l’honore. C’est avec une certaine virtuosité du genre fantastique que Nathalie Zadje nous apprend à poser un regard autre sur tous ces patients débordant de spectres et réclamant d’être libérés de la violence que constitue leur rétention génération après génération. La Patiente du jeudi, contre toute attente, et grâce à une deuxième partie du roman qui ose la noirceur de son sujet, évoque les scènes les plus inégalées de L’Exorciste de William Friedkin (1973), grâce au regard clinique posé sur le patient aliéné, grâce à l’accueil fait aux épisodes qui dépassent l’ordre naturel des choses et permet à la littérature de peindre ce que le thérapeute poursuit : la rupture des digues, la violence de l’accès aux ténèbres, l’apaisement des esprits suppliciés. Nathalie Zadje fait du Dibbouk la voix de la sagesse mémorielle, exigeant de rendre aux morts leur singularité, car ils sont « tout aussi uniques que les vivants ». Roman à la beauté blanchâtre et inquiétante des Ophélies modernes, déployant le malaise d’une mémoire injuriée parce qu’étouffée, La Patiente du jeudi témoigne de la place sans pareille de la parole dans la métamorphose du deuil et de la mort.