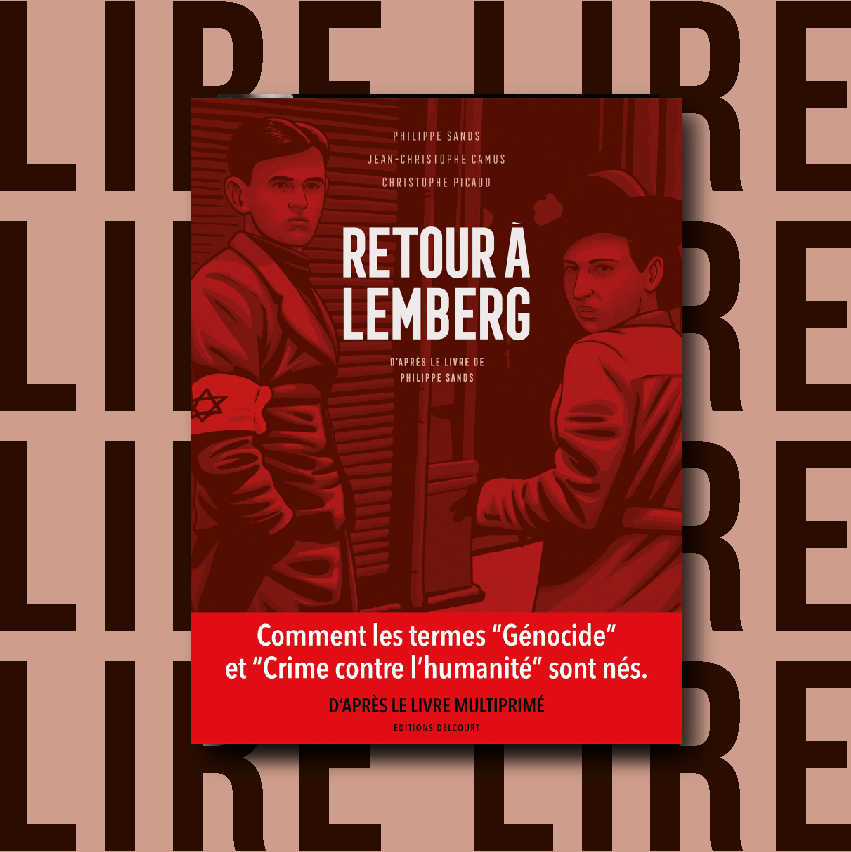Entretien avec Dominique Vidaud,
directeur DU MÉMORIAL D’IZIEU
La maison d’Izieu est un lieu de vie qui raconte aussi une histoire qui se termine mal. Comment conjuguer les deux ?
La Maison d’Izieu est d’abord un lieu de vie, où vécut un groupe d’enfants en colonie, avec toutes les relations qui peuvent se former entre des enfants d’âges différents, entre les enfants et les adultes qui les encadrent, ainsi qu’avec l’environnement. La colonie a été protégée par le voisinage très bienveillant, qui fournissait tout ce qui manquait pour l’approvisionnement d’un groupe de plus de 50 personnes. Nous avons des témoignages d’anciens enfants de la colonie qui nous confirment qu’ils ont relativement bien vécu ici. Beaucoup d’entre eux avaient auparavant connu des situations très difficiles : l’internement dans les camps, des cachettes infinies pour échapper aux persécutions de la police de Vichy, des déplacements constants, la dispersion et l’éclatement des familles, puis, pour plusieurs d’entre eux, le départ avec Sabine Zlatin du camp de Rivesaltes et du Camp d’Agde, sans parler du stress, des maladies et des traumatismes.
Ces enfants arrivent à Izieu – orphelins pour la plupart – et sont encadrés par des adultes bienveillants, ils ont de quoi se vêtir, se nourrir, se protéger du froid, et ils trouvent de la chaleur humaine. Izieu a été pour la plupart une parenthèse heureuse dans un processus terrible qui reprend son cours tragique le 6 avril 1944 pour les 44 enfants raflés. Mais Izieu a aussi joué son rôle de protection pour 61 enfants qui sont passés par là et qui, partis avant le printemps 44, ont été sauvés.
Ces traces de vie existent encore à Izieu à travers les mots et les dessins des enfants qui sont chargés d’émotion même s’ils sont très simples. Ils témoignent de cette vie heureuse. Et si on juxtapose ces dessins au télex glacial de Klaus Barbie qui ordonne la rafle (voir p. 21), on voit cette contradiction absolue : Comment ne pas reconnaître des enfants dans des enfants ?
La maison d’Izieu possède à la fois une forte dimension émotionnelle et une vocation pédagogique. Comment sont-elles complémentaires ?
La dimension émotionnelle c’est la tension entre ce qu’on imagine avoir été la vie de ces enfants et ce qui leur arrive après. Les jeunes visiteurs sont extrêmement émus par les dessins et les lettres, qui les concernent vraiment. Quand on arrive dans les anciens dortoirs avec toutes les photos des enfants, leur nom, leur origine et leur âge à leur décès, les adultes sont bouleversés, parce que cela les renvoie à leur propre expérience et que, parents eux‐mêmes, ils imaginent ce qui est arrivé aux enfants. C’est dans la maison, ou juste en sortant, que l’on ressent un choc. Dans la maison, on est éloigné de tout, on est hors du temps, dans un lieu qui permet de voir très loin, mais très isolé. Lorsque l’on sort, on est livré à soi‐même, dans le silence, dans ce paysage magnifique, et on réfléchit. C’est d’autant plus bouleversant.
Le choc émotionnel qui se produit dans la maison ouvre les visiteurs – surtout les jeunes – sur quelque chose qui les désarme et qui évite qu’ils reproduisent des comportements de groupes. À Izieu, comme à Auschwitz, on entre en groupe, on ressort en individu.
En quoi l’histoire des enfants d’Izieu et le lieu sont-ils un formidable vecteur pédagogique ?
La visite se déroule en trois parties : Dans la maison, on est vraiment dans l’émotion, on entre dans l’intimité de la colonie. Ensuite, il y a un moment de transition, de décompression avant la visite de l’exposition permanente, qui est suivie d’un atelier d’approfondissement sur une thématique particulière. Ces trois moments sont forts et sont complémentaires. C’est ce qui nous distingue des autres lieux : Izieu parle aux enfants parce qu’il s’agit d’enfants. On peut suivre l’itinéraire détaillé de chacun des 105 enfants, entrer dans l’intimité des familles, et pour cela, rester une journée entière sur le site.
Ce lieu me fait souvent penser à la situation des monastères qui, au Moyen Âge, veillaient à conserver la mémoire d’une époque passée, dans un environnement social et culturel nouveau. L’équipe qui travaille ici est très investie, comme si elle avait quelque chose de très précieux, de très fort à garder. Les visiteurs viennent à nous, ils font l’effort de monter jusqu’à la Maison située sur un belvédère à 400 mètres au‐dessus du Rhône. Nous les accueillons de manière sobre et simple, sans décorum. C’est la volonté originelle des concepteurs du mémorial, en 1994, de conserver l’austérité et l’authenticité du lieu. Pour venir à la Maison, il faut marcher un peu le long du chemin. Il faut une intention.

Le musée-mémorial raconte l’histoire individuelle des 44 enfants et des 7 adultes raflés, mais tire aussi des leçons plus universelles, en particulier autour des procès de criminels de guerre. Pourquoi ?
C’était l’un des débats pour agrandir le mémorial : doit‐on rester un mausolée pour les 44 enfants martyrs ou l’élargir à tous les enfants accueillis ici, y compris les 61 qui ont été sauvés ? En évoquant les 105 enfants, notre voix porte plus loin car nous pouvons parler du passé et de la vie après, la reconstruction de ceux qui ont dû composer avec l’absence et le deuil.
L’ouverture sur l’universel est aussi consubstantielle à Izieu, la première raison étant que le Mémorial n’existerait pas sans le procès de Nuremberg. Edgar Faure, procureur français au tribunal militaire international de Nuremberg, y a produit en février 1946 le télex de Klaus Barbie dans lequel celui‐ci écrit à ses supérieurs que les enfants d’Izieu seront traités après Drancy où ils seront envoyés dès le lendemain de la rafle « selon la procédure habituelle ». Edgar Faure a compris l’intérêt de ce document, qui fut l’une des rares pièces retenues par la délégation française pour constituer le crime contre l’humanité. C’est aussi grâce à cette pièce que Serge Klarsfeld s’intéressera aux enfants d’Izieu. La justice de Nuremberg a permis de constituer le crime contre l’humanité qui a ensuite permis de juger Klaus Barbie et de rendre visible les enfants d’Izieu, puis de construire la mémoire de la Maison.
Outre le rôle des procès, nous mettons en valeur le rôle des acteurs : d’abord Sabine Zlatin bien sûr, qui dès 1944 a gardé les dessins et photos des enfants et qui en 1946 réussit le tour de force de réunir 300 personnes pour une commémoration devant la Maison ; puis Serge et Beate Klarsfeld à partir des années soixante‐dix qui vont retrouver Klaus Barbie en Bolivie et militer avec des mères d’enfants déportés depuis Izieu pour obtenir l’arrestation et le procès de Barbie.
La deuxième raison, c’est que Sabine Zlatin a toujours plaidé que ce qui s’était passé à Izieu était dû au fait que ces enfants étaient juifs, mais que le lieu devait aussi prendre en compte d’autres crimes contre l’humanité. Il ne fallait pas que l’horloge d’Izieu s’arrête en 44. Au mémorial, cela se traduit par la conception de la nouvelle exposition permanente qui a vu le jour en 2015.
Elle distingue trois parties : la première, « Pourquoi des enfants juifs à Izieu » ? traite du contexte, du processus menant de l’identification à l’extermination, en passant par l’arrestation, l’internement et la déportation. La deuxième examine le rôle de la justice, de Nuremberg à La Haye, et la construction d’une justice internationale de 1945 à nos jours. La troisième présente la construction de la mémoire d’Izieu, dès avril 1946 avec la pose d’une stèle devant la maison lors d’une cérémonie en présence de 300 personnes dont des maires, le préfet, le sous‐secrétaire d’État aux victimes de guerre, et d’autres officiels. Sabine Zlatin pensait que l’on oublierait plus. Mais comme l’a rappelé Théo Klein, président du CRIF, le 8 avril 1984 : « Nous avons, comme les autres, commis un péché d’oubli envers ces enfants. » Il faudra attendre 1993 pour que François Mitterrand nomme Izieu « l’un des trois lieux officiels de la mémoire nationale des crimes racistes et antisémites commis par l’occupant nazi avec la complicité du gouvernement de Vichy » et 1994 pour qu’il inaugure la Maison comme « un lieu de mémoire, d’éducation et de vie ».
Combien recevez-vous de visiteurs chaque année ? Pouvez-vous évaluer l’impact de la visite et de la médiation sur les élèves ?
Le plus grand nombre de visiteurs sont des scolaires, soit 13000 sur les 30000 visiteurs annuels. Outre les 150 scolaires qui viennent chaque jour, nous recevons des séminaires d’adultes : des étudiants, comme les 250 étudiants du Collège de droit de l’Université Lyon 3, toute la promotion (140 fonctionnaires) de l’Institut Régional d’Administration de Lyon, toute la promotion des commissaires et officiers de police de l’École Nationale Supérieure de la Police (150 personnes), une vingtaine d’enseignants qui vont sortir de l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation à Lyon et qui viennent se former pendant quinze jours à Izieu. Nous essayons de mesurer l’impact des visites en envoyant un questionnaire aux enseignants, qui sont en général très satisfaits du contenu. Comme plus des trois quarts des groupes font des ateliers, nous observons les élèves faire des recherches sur documents, travailler consciencieusement et restituer leur analyse au reste du groupe. Nous pouvons mesurer leur engagement. Parfois, les élèves ne sont pas préparés ou sont mal préparés. Il est essentiel de travailler en amont pour obtenir des résultats solides, en particulier avec les écoles dans des zones sensibles.
Les médias s’émeuvent de l’ignorance de la jeunesse actuelle au sujet de la Shoah. Avez-vous déployé de nouvelles stratégies pour contrer l’oubli ?
À Izieu, comme dans tous les lieux de mémoire, nous sommes mal placés, car nous recevons des classes qui sont encadrées par des enseignants formidables, impliqués dans la transmission de cette histoire et qui entraînent leurs élèves sans difficulté. Le défi, c’est de faire venir les jeunes qui n’ont pas envie de venir. Depuis 2015, nous visons la jeunesse qui est dans une stratégie d’évitement, qui s’arrange pour échapper à la visite d’Izieu. Dans les quartiers sensibles, cela peut représenter 20 à 25 % de l’effectif. Nous sommes donc engagés dans un gros travail avec le rectorat pour toucher les chefs d’établissement qui doivent cesser la politique de l’autruche face au taux d’absentéisme. Ils doivent lancer un message fort aux proviseurs et aux enseignants : il faut aller au‐devant des élèves et des parents. Nous savons que l’antisémitisme des banlieues n’est pas en régression. Si nous voulons avoir une utilité sociale aujourd’hui, nous devons beaucoup travailler. Nous comptons déjà de belles réussites, par exemple à Vaulx‐en‐Velin, qui mène une politique volontariste dans la lutte contre le racisme et l’antisémitisme avec de très bons résultats. Nous allons signer une convention avec d’autres communes de la périphérie lyonnaise où l’on rencontre les mêmes difficultés. Cela fait aussi partie de notre mission.
Propos recueillis par Brigitte Sion