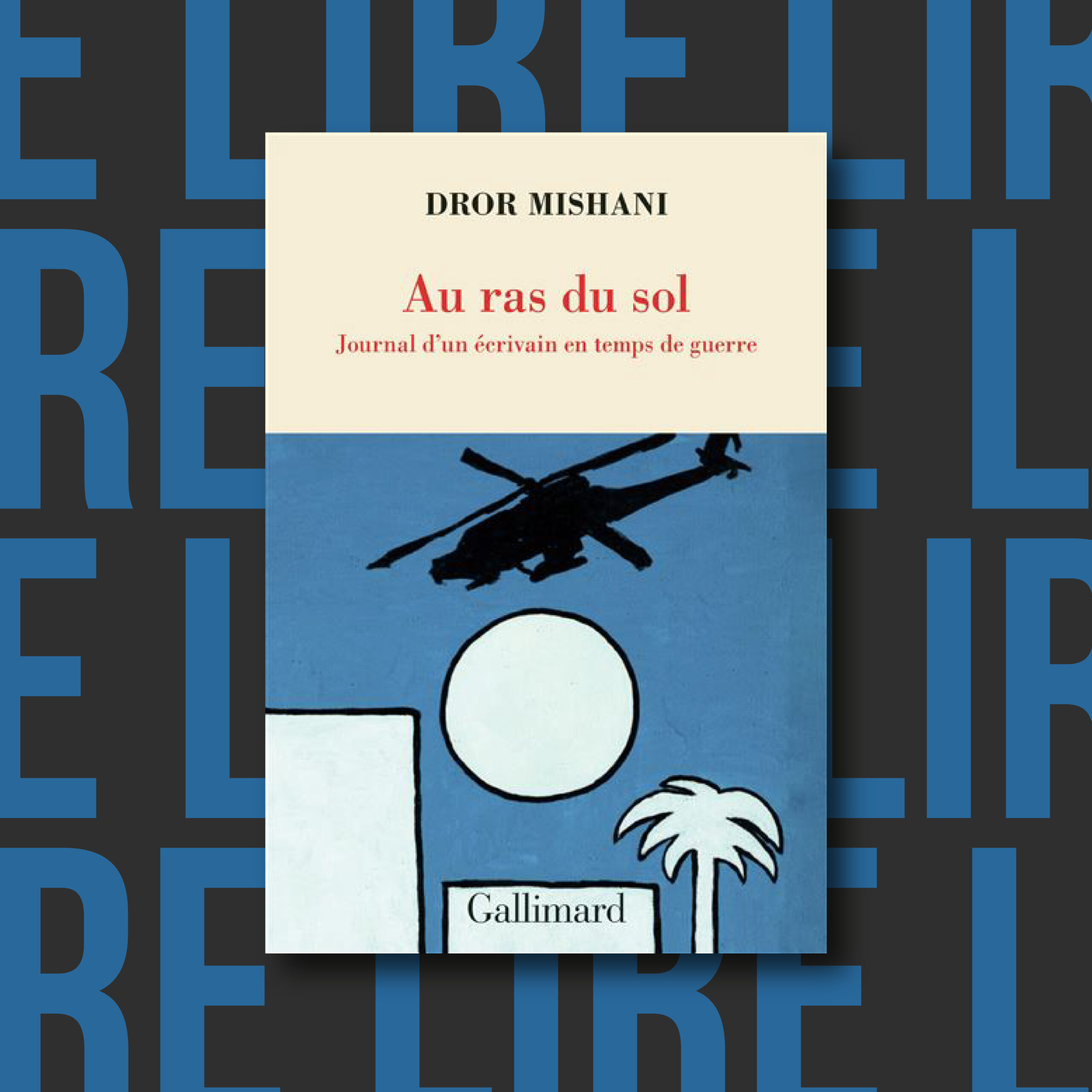Les semaines redoutables
Chaque année à l’automne, les juifs traversent des Yamim Noraïm, les “jours redoutables”.
Entre Rosh haShana (où l’on célèbre la naissance du monde en trempant la pomme dans le miel), et Yom Kippour (où l’on jeûne en vue de la renaissance de soi), les Juifs se tiennent droits pendant que leur âme passe devant le “roi du monde”, en espérant être inscrit dans le livre de la vie.
Depuis octobre 2023, les jours redoutables sont restés figés dans le temps.
Et depuis mi‐janvier 2025, alors qu’Israël a enfin signé avec le Hamas un accord cessez le feu contre une libération tant attendue de ses otages, nous voilà entrés dans une autre période suspendue hors du temps, d’autres jours autrement redoutables.
Les captifs seront rendus au compte‐gouttes. Qui vivant et qui dans un sac. Qui, quand et comment. Qui dans quel état, visible ou invisible. Qui, et même si.
Et on paie tout cela au prix fort : contre la libération des otages israéliens enlevés lors du pogrom du 7 octobre, la remise en liberté d’un millier de prisonniers palestiniens condamnés pour terrorisme. On est bien entrés dans six semaines redoutables.
Lire le texte de la première semaine : Dimanche 19 janvier, 6h30 du matin, on attend
Sur le même sujet, lire le « Journal photo de l'attente » de Sarah Ohayon dont la photo en tête de cet article est extraite
Le temps arrêté
Dimanche matin, on attendait encore les noms.
J’ai écrit le matin à l’aube. C’était le jour annoncé de la libération des trois premières.
Et soudain, alors qu’on attendait de savoir qui, un début de concrétisation, le Hamas était silencieux.
Alors ce matin là on attendait, on attendait.
J’étais paralysée ;
J’ai écrit.
J’ai rangé un peu chez moi, et pendant ce temps j’ai essayé d’écouter celui qui me calme toujours, l’un de mes maîtres, un enseignant spirituel américain de non‐dualité.
Mais ce matin‐là, pour la première fois, la voix calme d’Adyashanti m’a semblé hors de propos. J’ai arrêté la vidéo au bout de quelques minutes.
J’avais besoin que l’on me parle de ce que l’on vit, ici, maintenant.
J’ai allumé la télé israélienne. Pour me sentir connectée.
Ça tournait en boucle.
Sur le plateau, le fils de l’un des otages dont on n’a pas de nouvelles. Il est invité par le présentateur à commenter ce que l’on voit, et à répondre à toute une partie de l’opinion israélienne pour qui cet accord est catastrophique : 33 innocents pour 1000 condamnés, dont beaucoup pour des attentats notoires qui ont coûté la vie à de nombreux Juifs ? La sombre promesse de futures récidives, d’un nouveau Sinwar, d’un nouveau 7 octobre ? Pour beaucoup d’Israéliens, malgré la joie de voir rentrer leurs concitoyens tenus en otage, l’accord signifie, plus qu’un aveu d’échec au bout de quinze mois de guerre, la mise en danger de tout le pays, et la promesse qu’il devra envoyer ses enfants à nouveau, on ne sait pas quand, au front, lorsque la nouvelle attaque interviendra. Double‐bind impossible dans lequel Hamas a mis Israël, et l’a mis à genoux. Et pour le meilleur et pour le pire, on a accepté de payer le prix.
Mais l’émotion continue. En Une, la “bonne nouvelle” du jour : en parallèle à l’attente agonistique du nom des otages, on apprend que Tsahal vient d’en retrouver un.
Un que l’on attendait depuis 11 ans.
Oron Shaul avait été tué lors de l’opération Tsuk Etan [l’opération Bordure protectrice, littéralement “Roc inébranlable”] à Gaza, lors de l’été 2014. Son cadavre avait été pris en otage à Gaza.
C’est arrivé aussi depuis le 7 octobre. Des cadavres de soldats traînés pour être, même morts, utilisés comme monnaie d’échange avec Israël – ou, pour certains Gazaoui, comme monnaie tout court : je me souviens, au début de la guerre, de l’interview de David Tahar, dont la dépouille du fils Adir, tombé au combat le 7 octobre, avait été trouvé par deux citoyens gazaouis, qui lui avaient, à deux mains, tirant qui en avant et qui en arrière, arraché la tête. Ils avaient ensuite amené le trophée dans un sac en plastique au Hamas pour tenter de le vendre.
Quinze mois plus tard, quelle triste célébration. On a retrouvé le cadavre, vieux de onze ans.
Sa mère est heureuse.
Elle a enfin récupéré la dépouille de son fils.
Voilà les miettes qui nous restent quand on nous a tout pris.
L’émission se poursuit en direct.
En reportage, des images.
Des images du nord de Gaza où, à l’annonce du cessez‐le‐feu, les populations civiles rentrent chez elles, en liesse.
La foule chante et danse autour des voitures garnies de tous côtés par combattants du Hamas qui paradent en uniforme, comme s’ils avaient gagné la guerre.
Peut‐être, d’un certain côté, l’ont-ils gagnée, me dis‐je en frissonnant.
Une adorable petite de deux‐trois ans sur les épaules de son père qui ne comprend rien, affublée du drapeau palestinien, tape des mains en rythme avec la foule qui chante.
À part la minuscule petite, aucune trace de féminin dans la foule massée dans la rue.
Je regarde ces images avec stupéfaction.
Chez eux, la fête de rue. On célèbre un cessez‐le‐feu qui, pourtant, comme le rappelle Tsahal à tout instant, n’est pas de mise tant que le Hamas n’a pas communiqué les noms des trois qu’il doit libérer aujourd’hui.
Chez nous, le silence, la consternation, l’angoisse qui monte.
On attend, glacés par l’attente, devant nos postes de télévision.
On continue d’attendre les noms.
Les noms que le Hamas s’était engagé à communiquer la veille, et ne donnera que quatre heures avant l’échange.
La nouvelle guerre
À 9 heures du matin, on n’a toujours pas les noms.
Tsahal s’impatiente, et dit que le cessez‐le‐feu ne commencera pas tant que le Hamas n’a pas respecté les termes de son engagement.
Israël commence à accuser le Hamas de trahir, dès le début, l’accord qu’ils ont eu tant de mal à conclure, après 15 mois de négociations sur le fil du rasoir.
Le Hamas répond dans les heures qui suivent en parlant de “problème technique” et en dénonçant des “reproches infondés”
Je finis par éteindre la télé, cela tourne en boucle et à l’obsession, et ne fait que m’enfoncer dans l’agonie de l’attente.
Oui le terrorisme a ce pouvoir. Il vous rentre dans les veines, de façon insidieuse, même sans avoir besoin de vous toucher directement.
C’est bien la définition du terrorisme : une violence qui s’attaque aux civils.
Cette violence ne touche pas seulement les corps.
Le 13 novembre, à Paris, elle a touché les âmes de tout le monde. On s’en souvient encore.
Le Hamas est rentré dans mon âme depuis le 7 octobre, il ronge mes os.
Ils ont réussi à me toucher.
C’est la guerre du XXIe siècle : plus de confrontation entre armées, mais des combattants sans éthique de combat, seulement ivres d’une idéologie qui leur donne bonne conscience pour s’en prendre aux populations civiles afin de les terroriser – jusqu’à les éliminer comme en Israël, ou jusqu’à les soumettre comme en Syrie, en Iran, ou à Gaza.
Quand je pense par contraste aux gamins nantis des campus américains qui, enivrés par la cause de la “résistance”, réclament le goûter et les bouteilles d’eau au titre “d’aide humanitaire de base…”
Oui c’est facile la révolution gratuite.
En attendant, les héros des jeunes woke exaltés vont jouer et jouir de leur pouvoir jusqu’au bout, le seul qu’ils ont sur nous, sur nous tous : nous tenir en haleine, nous garder, tous, en otage.
J’ai éteint la télé et j’ai fait la seule chose qui me semblait pertinente à ce moment‐là : une prière.
Gam qi elekh b’gei tsalmavet
Lo ira rah
Ki atah imadi
“Même lorsque je marcherai dans la vallée des ombres de la mort
Je ne craindrai pas le mal,
Car tu es avec moi.” (Psaume 23,4)
J’ai mis la version chantée par Ishay Ribo. En boucle.
Je suis sortie au soleil ; un rendez‐vous, un autre. On parle d’autre chose ; on revient à ça.
Soudain au moment du déjeuner, assise à la terrasse d’un café avec une copine, un peu de soleil pour respirer, je demande à l’homme assis à la table d’à côté où on en est.
C’est l’un des avantages de vivre en Israël.
On est tous dans le même bateau. On sait de quoi l’on parle.
Mon cœur qui saigne ne se butera pas sur l’indifférence, le retournement de la victimisation, l’agression, ou d’autres manifestations de la malveillance multimillénaire portée au Juif que l’on appelle antisémitisme.
Ouf un peu de connection humaine, au moins, dans cette agonie de l’attente.
Les noms sont sortis, nous confirme t‑il.
Doron, Romi, Emily.
Romi était partout dans le quartier où j’habitais à Tel Aviv.
Elle y travaillait comme serveuse. L’un des cafés avait placé en terrasse une petite table dressée, avec sur la chaise vide, la photo “On t’attend”. Un restaurant branché avait ajouté à sa carte “le plat préféré de Romi”. Dans un restaurant japonisant de luxe, un simple plat de pâtes à la sauce tomates. Ajouté en‐dessous, sur la carte bien designée : “Il sera à la carte jusqu’à ce qu’elle revienne”.
Je me réjouis, et puis ma joie se voile.
Tristesse que Naama ne soit pas dans la liste. En écrivant cela je pense aux listes nazies, simplement inversées.
On a peut‐être fait un peu de progrès.
Je pense à sa mère.
Je pense à Shiri Bibas aussi, qui était sur la liste mais ne sortira pas aujourd’hui, avec ses deux petits rouquins au sujet desquels on n’a pas entendu un traître mot.
Enfin, au moins, maintenant, on a des noms. Trois. Un début. Un monde.
Elles sont là
Je n’ai pas trop suivi l’actualité cette semaine.
D’abord parce qu’il n’y en n’a pas vraiment. C’est l’une des choses que j’ai apprises durant cette guerre : il n’y a plus d’information.
Il n’y a plus que de l’opinion, du sensationnalisme, et de la propagande. Ailleurs comme chez moi. Mais chez moi au moins on ne retourne pas les faits, comme le font les Unes des médias occidentaux.
Et puis je ne regarde pas, parce que mon système a déjà assez à absorber avec le peu que je vois passer au hasard des réseaux ou des conversations.
L’après-midi de leur libération, la foule était amassée au Kikar haHatoufim [la place des otages] à Tel Aviv.
Ils suivaient tout en direct, les yeux rivés sur l’écran.
D’en face on aurait pu croire, l’espace d’un instant, à une foule devant un match de foot. Mais l’atmosphère n’est pas à la fête.
Les visages sont graves, l’attente est anxieuse, le silence tendu.
Soudain, quand la Croix‐Rouge ouvre les portes de sa voiture et qu’elles sortent pour être prises dans les bras par Tsahal, la foule exulte.
Elles sont revenues.
Tout l’après-midi, pendant des réunions sur Zoom, je suivais en direct sur Y-net. Sans les images, juste les faits. “Otages en route vers le point de rencontre entre le Hamas et la Croix-Rouge.”
“Otages transférées à la Croix-Rouge.”
Et enfin “otages remises à l’armée israélienne.”
Leur calvaire est fini, à ces trois là. Du moins celui‐ci.
On ne sait pas la route qui les attend.
Je me souviens d’une série israélienne, encore une que je n’ai pu regarder : Hatoufim, “Les otages”.
Ça ne s’invente pas. Oui, malheureusement le thème n’est pas nouveau dans la société israélienne.
Ce qui est nouveau, c’est que les captifs aujourd’hui ne sont plus des militaires. Les cibles du Hamas étaient des civils, kidnappés de chez eux ou d’une fête dans le désert.
Hatoufim était devenue en 2019, selon le New York Times, la série étrangère préférée des Américains. Elle a donné lieu au show connu à l’époque, Homeland, que je n’ai pas regardé non plus. Je n’ai aucun plaisir à voir des histoires de drames de vies humains brisées par la prise d’otage et la torture. Et ce n’est pas seulement parce que c’est too close to home.
Ce type de culture du divertissement m’est étranger, et m’étonne. Le frisson devant la douleur d’autrui. Ce n’est pourtant pas nouveau. Il y avait bien hier les jeux du cirque.
Le Hamas, avec ses vidéos en Gopro, a un peu remis cela sur la scène du monde. Le spectacle est redevenu réalité.
La scène d’ouverture de Hatoufim montre le retour de deux otages israéliens chez eux.
Le retour, c’est le début de l’histoire.
Comment un homme brisé retrouve‐t‐il ses enfants qui ont grandi sans lui, et qui voient en lui un étranger renfermé et qui fait peur ?
Comment un otage libéré retrouve son ex‐fiancée qui, entre temps, a bien dû avancer dans la vie, et a épousé, son frère – ou son ami, peu importe – et fait des enfants ?
Leur mine sombre, leur violence, leurs cauchemars la nuit. Ils savent qu’ils ne pourront pas les comprendre. La plus grande des solitudes.
Le soir et le lendemain de leur libération j’ai vu quelques images, les mêmes que tout le monde, qui tournent en boucle sur toutes les chaînes de télé.
Les petites en survêt coloré que l’on conduit gentiment dans les couloirs d’un hôpital israélien, où les attendent leur famille. Les pleurs. Ils se ruent dans les bras.
Romi assises sur un lit collée à sa mère, on lui tend un téléphone
“Aba khazarti baHaïm!” “Papa, je suis revenue en vie!!”
Emily qui crie aussi, à son père, au téléphone :
“Aba saradeti et zeh! Saradeti et zeh!” “Papa j’ai survécu à ça ! J’ai survécu!”
Le frère d’Emily, collée à elle, qui la bénit de la prière que l’on dit après n’avoir pas vu quelqu’un depuis très longtemps
Béni sois tu, notre Dieu Roi du Monde
De nous avoir mis en vie
Et de nous avoir maintenu en existence
Et de nous avoir amenés
Jusqu’à ce jour.
Et puis le lendemain, j’ai appris pour les deux doigts d’Emily.
Elle était si souriante, si “chill”, sur les courts extraits vidéo que j’ai vu d’elle. Je ne pouvais pas imaginer qu’elle revenait amputée.
J’ai vu passer sur Instagram un dessin magnifique. Quelqu’un qui a sublimé la main mutilée.
La nouvelle main d’Emily, dont le geste connu était celui des doigts brandis, signe de ralliement des rockers, est devenue, sous la plume de l’artiste, une nouvelle birkat kohanim, la “bénédictions des prêtres” dans laquelle les kohanim brandissent leurs bras levés vers la foule, collant index et majeur d’une part, annulaire et petit doigt d’autre part, pour former un moudra kabbalistique de trois ensembles de doigts dans chaque main, un espace entre les deux.
Le vide créé par les deux doigts en moins dans la main d’Emily est devenu, sous la plume de l’artiste, l’incarnation de la bénédiction ultime selon la mystique juive.
On aura beaucoup de sublimations à faire, dans les semaines qui viennent.
Détournements de langage
En attendant, si moi je tourne en rond comme un animal en cage, je ne peux imaginer l’attente agonistique des familles, la torture du suspense qu’on leur fait vivre, jusqu’au dernier moment.
Oui le temps semble s’ être arrêté aux Yamim Noraïm depuis le 7 octobre 2023.
Bien sûr on se lève et on va au travail, on célèbre les bar mitsva et on met au monde des enfants, on enterre et on se marie.
Mais quelque chose en nous, et surtout pour ceux qui ont quelqu’un là‐bas, est resté là, bloqué dans ces jours redoutables, qui s’étirent sans pitié depuis un an et demie.
Avec 250 des nôtres pris en otages, 99 aujourd’hui, entre les libérés et les morts rapatriés, on vit un peu en apnée, en attente, attendant de voir si eux, si nous, serons scellés dans le livre de la vie.
J’ai vu passer sur Facebook le post triste d’un rabbin Américain, Shy Held. Il y montre la photo de deux jeunes souriants. Un homme et une femme. Photo prise certainement vers la fin des années quatre‐vingt dix, début deux mille.
Il rappelle leur nom. Et que leur meurtrier vient d’être libéré, aux termes de l’accord que l’on vient de passer pour la libération de nos otages.
Des posts similaires circulent sur les réseaux sociaux : à gauche, la photo d’un des gamins Bibas. Crime : être né juif. À droite, la photo d’un prisonnier palestinien libéré en échange du retour espéré du bébé rouquin. Crime : tel attentat à tel endroit, tant de morts.
Pourtant, la dissonance cognitive cruelle à laquelle devrait conclure l’observation d’un tel accord n’émeut pas l’opinion internationale anti‐israélienne.
Sans surprise, les commentaires des pro‐palestiniens retournent les faits : justice est faite, les “otages palestiniens” sont enfin libérés.
J’avais vu un tag avec une telle phrase sur une façade d’immeuble dans un quartier populaire de Marseille, l’été dernier. “Libérez les otages palestiniens.” J’avais été stupéfaite. De quoi parlent‐ils, m’étais‐je demandée ?
Maintenant, j’ai compris.
De même que le nazi était la victime du Juif, le terroriste palestinien emprisonné se voit affublé de l’étiquette d’otage, afin de se réapproprier le statut de fait des réels otages actuels.
Pendant ce temps, les Israéliens enlevés sont des vrais otages : des humains détenus arbitrairement et sans raison, comme monnaie contre rançon : un cessez‐le‐feu, et la libération de nombreux terroristes palestiniens.
Et les posts misérabilistes des bons Français pro‐palestiniens qui ne savent rien de l’histoire récente des violence en Israël et dans les territoires, qui n’avaient jamais entendu les noms des terroristes avant de les déclarer victimes.
Je ne doute pas, malheureusement, qu’il y a des bavures dans le système d’incarcération israélien. Il n’existe pas de système sans bavure. Il n’existe pas de pouvoir sans abus. C’est d’ailleurs l’un des défis les plus importants que doit relever la société israélienne dans son ensemble, depuis qu’elle a retrouvé une souveraineté en 1948.
Mais au moins, Israël a une ligne éthique. Les bavures sont des bavures, et elles sont, en principe, jugées, et punies. On a vu plus d’un cas comme cela, depuis le 7 octobre, contre ceux parmi nos soldats qui ont dérogé à la ligne éthique de Tsahal.
Et cela m’a un peu rassurée sur la bonne santé de notre société, même si certains extrémistes au pouvoir actuellement menacent cette éthique si précieuse.
Oui en Israël, il y a des abus, dans le système, et il faut les dénoncer.
Mais chez le Hamas, c’est le système qui est abusif par définition.
Et chez ses supporters enthousiastes, la cécité est de mise.
Au royaume de la mauvaise foi, tous les moyens sont bons. L’essentiel est d’utiliser des mots forts, comme “génocide” et “otage”, des mots qui appellent à l’émotionnel, quel que soit leur rapport avec la réalité. L’essentiel, dans la stratégie perverse du Hamas, est de continuer à cultiver une image de victime pour pouvoir continuer à s’attirer les sympathies des foules pour mieux continuer à attaquer en toute impunité.
L’agresseur qui se réclame victime, c’est la rhétorique classique des vrais abuseurs.
Et dans l’art de ce type de détournement de langage, le Hamas, et ceux qui les soutiennent, sont passés maîtres.
La libération des prisonniers palestiniens auto‐requalifiés en otages, c’est bien, au‐delà de la perversité du jeu de langage, la sombre perspective qui fait trembler Israël aujourd’hui.
J’en parlais avec Maya lundi. Maya ne va pas bien.
Je l’avais rencontrée à la retraite de yoga, dans le Kerala, en novembre.
Elle avait commencé à prendre des cours de yoga avec la même enseignante que moi, à Tel Aviv, après le 7 octobre. Maya n’était pas prédisposée au yoga. Mais sa vie a basculé, il y a quinze mois, après que son petit frère Yoni, âgé de 21 ans, a été tué.
Yoni a été tué le 7 octobre, en défendant l’une des bases militaires du Sud prise d’assaut.
Yoni était commandant de tank. Il jouait de la guitare, et s’apprêtait à commencer ses études. Il n’était pas censé être de garde ce jour‐là. Il y était allé plutôt que d’aller passer shabbat chez son père car, avait‐il dit, il avait pressenti qu’on aurait besoin de lui.
Il avait raison. Il a sauvé des dizaines de personnes, comme Maya l’a appris par la suite du témoignage des nombreux survivants.
Maya est retombée en dépression depuis quelques semaines.
“Déja, tout le monde reparle du 7 octobre”, dit‐elle le visage serré. “Je ne peux plus entendre ce mot.”
“Et puis il y a l’accord. D’un côté, je suis heureuse pour elles, pour leurs familles, vraiment.
Et ne te trompe pas, s’il s’agissait de mon frère, là-bas, le pays peut brûler, hein. Je m’en serais foutue. J’aurais tout fait pour le récupérer.”
Mais le nombre et l’identité de ceux qui ressortent en échange de ces quelques précieuses vies – et cadavres, sortis au compte‐goutte, la rendent sombre.
Elle ne me le dit pas, mais je sais. Yoni est mort à cause de cela. Sinwar, le grand chef d’orchestre du 7 octobre, qui purgeait une condamnation à vie dans les prisons israéliennes, est sorti en échange d’un seul otage, en 2011. Aux côtés de 1026 autres.
On retrouve un des nôtres. Ils retrouvent leurs forces par milliers, et leurs terroristes les plus actifs sont de nouveau en liberté.
Et ceux qui paient, ce ne sont pas seulement les populations civiles attaquées.
Ce sont les petits frères de Maya, que l’on enverra au front pour nous défendre, et dont une partie ne reviendra pas. Ou dans quel état.
L’essentiel est invisible
Car, pour les soldats comme pour les otages, revenir en entier n’est jamais revenir entièrement.
La libération est prévue au compte goutte durant six semaines ;
Cela n’a pas commencé si bien.
Et les connaissant, sachant qu’ils n’ont structurellement que faire de l’idée d’éthique ou de de tenir leur parole, que seul le pragmatisme du plus fort modèle son action, on ne sait pas si le Hamas tiendra son engagement jusqu’au bout.
Et puis celles‐ci sont revenues en “bon état” – on passera sur les deux doigts en moins. Debout sur leur jambes. Pâles certes, mais parlant, et souriant ;
On ne sait pas qui va revenir, ni comment.
Dans un cercueil, ou vivant.
Et si vivant, comment. Comment surtout, à l’intérieur.
“L’essentiel est invisible pour les yeux”, disait Saint‐Exupéry.
Cette semaine, l’essentiel de l’expérience d’Assaf Ben David depuis le 7 octobre, s’est révélé.
L’oncle de Mia Schem, l’une des otages libérée en novembre 2023, était parti ce jour‐là à sa recherche dans le carnage de Nova. Il a vu ce qu’il a vu.
Rien n’est apparu pendant un an et demi. Et puis cette semaine, en silence, il s’est suicidé.
Au printemps, Shirel Golan, une survivante du même festival, s’était suicidée, le jour de ses vingt‐deux ans.
On ne voit pas la détresse.
Tout ce qu’on peut faire, c’est l’écouter, quand elle accepte de parler.
En novembre, à Goa, j’ai rencontré Levy. On attendait que le repas de shabbat commence. J’étais assise sur la terrasse du Beit haYehudi avec un livre. Il est venu s’asseoir en face de moi. Un jeune calme, petite barbe, lunettes, t‑shirt hippie.
Je me dis “encore un gamin en tiyul”.
Et puis on s’est mis à parler. Levy a été blessé au combat gravement à la jambe trois jours après le début de la guerre. Il était dans la division des tanks. Son commandant, je l’apprendrai quelques heures plus tard, n’était autre que Yoni, le frère de Maya.
Yoni est mort. Levy est devant moi. La jambe encore blessée, mais debout.
En l’honneur de Yoni, qui leur a sauvé la vie en les couvrant pendant qu’ils couraient se mettre à l’abri, Levy s’est fait tatouer sur le mollet un énorme dessin : un sablier, le symbole des otages que l’on attend, un tank renversé, une silhouette qui en tombe.
Levy ne va pas bien. Et l’une des choses les plus difficiles pour lui, c’est que ce n’est pas accepté par son entourage.
“Mes parents, tu sais, c’est une autre génération. Ils ne comprennent pas le concept de dépression. Tant que tu peux te lever, tu te lèves, et tu fais ta vie, c’est tout.”
Il me dit comme c’est difficile de se lever le matin. Comme tous les jours, quelque chose lui pèse. Comme c’est devenu difficile à vivre. Comme ceux qui étaient ses proches hier, ses amis, sa famille, ne savent pas d’où il revient. Ne peuvent pas comprendre. Ne veulent pas entendre.
“Ça leur casse le moral, alors ils me font comprendre qu’ils n’ont pas envie que j’en parle.”
Et puis la dépression, ça ne se voit pas. Ils te voient sourire, alors ils disent, “Tu vois, il va bien”.
À la fin, il me dit “Merci de m’avoir écouté”.
Cela me brise le cœur.
Yehouda a passé, lui, quatre mois à Gaza.
Il a vu un copain de son unité exploser. Il s’était jeté sur une grenade, la couvrant de son corps, afin de sauver les autres. Yehouda a vu le corps exploser. Les membres qui se détachent et giclent de partout.
Il a vu d’autres choses, qu’il ne m’a pas racontées.
Yehouda a 33 ans. Il ne va pas bien.
Je l’ai invité chez ma copine Sarah pour le déjeuner de shabbat.
On partage chacun quelque chose de notre semaine – “quelque chose de difficile”, et “quelque chose pour lequel on a de la gratitude”. C’est l’exercice auquel j’aime bien inviter les gens à la table de shabbat. Nous, les filles, on parle de nos doutes, de nos défis, de nos problèmes relationnels. Pour lui, le “quelque chose de difficile”, c’était autre chose.
Il hésite à parler.
“J’ai un ami qui est mort.
Il était à l’hôpital depuis des mois, en matsav anoush (inconscient).
Ça y est, il est parti.”
Yehouda, en parlant, torture la petite serviette en papier qu’il tient entre ses mains, sous la table.
Les ongles sont rongés autant qu’ils le peuvent. Le beau visage souriant est au‐dessus, les mains un peu tremblantes sous la table. J’ai envie de les prendre pour les calmer. Je n’ose pas.
Et puis, alors que la conversation continue sur la guerre et le post‐trauma, il devient nerveux, il dit qu’il se fait tard.
Je suggère à ma copine que l’on fasse le birkat hamazon en vitesse. Je le raccompagne dehors.
Je lui prends les mains avant de le quitter.
Ses mains qui sont encore entières.
Ça ne sert pas à grand‐chose, je voulais lui communiquer un peu de mon énergie de vie.
Je me sens un peu ridicule.
Il se laisse faire sans rien dire. Je ne sais pas si ça lui fait du bien, ou si c’est par politesse.
Ses mains tremblent un peu. Quand j’ouvre les yeux, les siens sont posés sur ailleurs. Peut‐être qu’il attendait patiemment que j’aie fait ma bonne action.
Il s’éloignera rapidement. Il a besoin de s’éloigner : d’arrêter le jeu social.
Voilà un aperçu de ce qui nous attend peut‐être avec nos otages, après les embrassades du retour.
Comme pour ceux qui sont revenus de camps de concentration, il n’y a pas si longtemps que cela, avec toute notre bonne volonté, on ne pourra jamais vraiment les comprendre.
Et pourtant, il faut bien continuer à vivre.
Alors nous, les impuissants de l’attente, les épargnés coupables, on fait la seule chose que l’on puisse faire : on se tourne vers la télé, et on attend.
Reality show
J’ai toujours détesté la télé‐réalité ; le voyeurisme qui prétend montrer le “vrai”, le suspense cruel de savoir qui sera rejeté et qui “choisi”, le sadisme de l’exclusion, les mises en scène grotesques et les mauvais motifs de l’élection.
Ici le jeu est inversé : on ne s’émeut pas de savoir qui sortira, mais de qui reviendra.
On attend les noms, et le jury est invisible.
Invisible, et en même temps surexposé : voici la parade des hommes cagoulés, en uniforme camouflage impeccable, les lunettes et les gants noirs, cagoule noir et bandeau vert qui fait fantasmer les gamins des campus occidentaux qui pourtant se disent en pleins processus de deconstructions des idées classiques de la virilité.
L’uniforme n’est, bien sûr, que pour le spectacle. Lorsque le Hamas combat, il le fait en civil.
Cela fait partie de sa stratégie militaire : mieux confondre les soldats de Tsahal, dont les règles d’engagement leur interdisent de tirer sur des civils. Et cela fait partie de sa stratégie de communication : faire gonfler le chiffre de morts “civils” à Gaza sous le feu israélien afin de cultiver la sympathie de la communauté internationale, qui en retourne l’arrose de dons, avec lequel il pourra s’acheter d’autres armes pour continuer à harceler le petit État hébreu.
Le 19 janvier dernier, le nouveau “Hamas show” a commencé.
Elles passent d’une voiture à l’autre au milieu de la foule surexcitée. Une foule d’hommes uniquement, massés autour des terroristes cagoulés.
La seule femme que l’on aperçoit, c’est la triste héroïne de la photo. Une otage israélienne, un quart de seconde, entre sa sortie de la voiture des ravisseurs et son entrée dans celle de la Croix‐Rouge, qui se réveille à ce moment‐là pour jouer un rôle de circonstances.
Elle fend la foule un instant, la tête baissée, vers l’autre voiture blanche qui va la sortir de là. La photo de la tresse africaine serrée sur la tête brune, l’ensemble de jogging rose avec le collier aux couleurs de drapeau de la palestine qu’on l’a forcée à porter, l’un des cagoulés qui la tient presque par le cou pour la faire avancer, a fait le tour des écrans cette semaine.
Le show est bien réel.
La foule en liesse se masse comme une horde pour les entre‐apercevoir.
Le Hamas Show a commencé, et ce n’est que le début, pour ces six semaines de libérations ultra‐contrôlées.
Je me souviens du temps où la télévision française avait encore de l’humour.
Une scène sur le plateau de Nulle‐Part‐Ailleurs : Antoine de Caunes faisant son entrée en grande pompe, moustache de pervers et chemise de mauvais goût, poussant devant lui une brouette dont il extirpera deux gigantesques sacs de tissus à la forme de deux grosses figues frippées. Il les posera devant lui sur la table, énormes, cachant presque son visage, avant de déclarer devant les invités morts de rire, “Bonjour. J’m’appelle Raoul Bitenbois!”
Des couilles, chez le Hamas je n’en vois pas.
Il faut quand même être bien lâche pour utiliser l’envoi de missiles sur des populations civiles, la prise d’otage, et la construction d’une image publique de victimes, comme stratégie militaire.
Et lorsque le lâche n’a pas de vergogne, il s’attaque aux points faibles.
La véritable arme du Hamas ce n’est pas celles que lui paient le Qatar, l’Arabie Saoudite et tous les Occidentaux bien‐pensant de la cause palestinienne.
Ce sont les corps humains. Les corps humains qu’il prend en otage – ceux du camp ennemi, mais aussi son propre peuple, qu’il empêche d’évacuer et met en avant de force lors des combats.
Des combats qui n’en sont pas, dans cette guerre sans champ de bataille.
Se cacher dans les tunnels. Sortir soudain, attaquer par derrière et puis retourner se cacher.
Se déguiser en civil pour mieux attaquer le soldat d’en face.
Attaquer depuis des hôpitaux, des écoles, des immeubles d’aide humanitaire, afin que l’armée d’en-face soit désarmée, et que l’opinion internationale s’époumone d’indignation en cœur : Israël a bombardé un hôpital !
Je dois dire que du point de vue stratégique, il y a du génie là‐dedans. Il faut juste assez de cynisme.
Du cynisme, on n’en a pas manqué lors de la libération des trois premières.
Chacune est revenue affublée, en plus du collier à l’effigie du drapeau palestinien, d’une petite enveloppe remise à chacune aux insignes du Hamas, comme après une remise des prix.
Diplômée comme otage du Hamas à Gaza.
Emily n’aura pas besoin de garder son enveloppe. Ses deux doigts manquants, et les regards commiséreux qu’elle recevra à vie, lui rappelleront tous les jours.
Lorsque je vois la foule des hommes masqués derrière le grand fusil noir dont ils caressent la crosse de temps en temps tandis que les gamins de Gaza les assaillent d’excitation et de selfies, je me dis, les voilà les guerriers sans couilles, qui essaient de compenser en brandissant le fusil dur en avant.
En les voyant aussi nombreux et fiers dans leurs uniformes impeccables, j’ai un frisson. Le Hamas a l’air de se porter plutôt bien. Et je me dis aussi, à quoi a servi cette guerre ?
Tous ces morts, des deux côtés, toute cette destruction. Quinze mois de lutte, la promesse de Bibi – éradiquer le Hamas.
“On ne négocie pas avec les terroristes.” J’ai grandi avec cette phrase.
Et voilà que, loin de les éliminer, on a fait un accord avec eux, un accord infâme dont ils tiennent les rênes, tout comme ils ont repris le contrôle de Gaza à l’instant où le dernier soldat israélien a tourné au bout de la rue, comme chacun sait.
Yair, le copain de Matan, nous l’avait déja dit au printemps dernier, à son retour de Gaza, assis sur notre canapé, défait.
“On ne sert à rien.Ca ne sert à rien ce que l’on fait.
Tu en tue un, ils prennent le premier gamin qui passe et lui donnent son fusil.
L’instant où on quitte un quartier, ils réapparaissent de sous terre.”
Je connais peu de choses plus tristes que cela : sacrifier sa vie pour une guerre qui, me semble‐t‐il ce jour‐là en voyant les rues de Gaza emplies de guerriers du Hamas triomphants et de jeunes hommes surexcités criant Allahu Akbar, comme la veille de la guerre, n’a pas servi à grand chose.
Quoi qu’en dise Bibi.
Car le reality show, n’est pas seulement celui des pervers encagoulés.
En face, le show à peine moins cynique du Premier ministre israélien, devenu une sorte de Berlusconi prêt, comme on a pu le voir, à tout pour ne pas perdre son trône, et qui sort sa plus belle voix, timbre chaleureux, à la fois assertif, paternel, et ému – “Citoyens d'Israël, je suis fier de vous!”
Et d’énumérer “ses” actes héroïques, ainsi que ceux de sa femme, pour libérer les otages, libérer Israël du Hamas et, en substance, Make Israel great again.
En l’écoutant, après la fin de son discours, moi aussi j’avais envie de l’embrasser et de lui demander où il faut signer.
Il suffit de fermer les yeux sur les faits.
Et on en a tellement envie.
Tellement exaltant, son discours. Tellement rassurante, sa voix.
Ce n’est pas pour rien que deux de mes élèves se sont accrochées cette semaine.
Aurélie, émue, avait posté avec enthousiasme dans le groupe Whatsapp le‐dit discours de Bibi, ponctué d’un “Am Israel Haï!” – Le peuple d’Israël est vivant.
Je la comprends.
Ce type de discours, pour peu qu’on y croie, donne de la force.
Il dit exactement ce qu’on a envie d’entendre. Cela rassure. Ça fait du bien. On a envie de se sentir fort, protégés aussi, et surtout, pas impuissant.
Bibi, comme un charme, donne tout cela en trois minutes de discours.
Que demander de plus ?
Le digne et l’indigne
Mais pour l’Israélien qui connaît l’envers du décor, comme Ora, qui vit exilée en France depuis des décennies, la propagande bibiesque, surtout en ces jours redoutables, est insupportable. Elle a réagi au quart de tour.
Embrouille sur le groupe Whatsapp.
On est tous à fleur de peau.
J’ai dû intervenir. Je me suis bornée à nous rappeler que l’heure nous appelle à l’unité plus que jamais, sur les groupes Whatsapp comme dans les familles, et que ce qui compte, c’est cette prière.
Cette prière juive traditionnellement récitée, depuis des siècles, pour les captifs d’Israël – un phénomène malheureusement pas nouveau dans l’histoire juive, mais qui est devenu trop douloureusement d’actualité aujourd’hui. Chantée ici magnifiquement par Maayan Linik, elle dit :
אַחֵינוּ כָּל בֵּית יִשְׂרָאֵל
הַנְּתוּנִים בַּצָּרָה וּבַשִּׁבְיָה
הָעוֹמְדִים בֵּין בַּיָּם וּבֵין בַּיַּבָּשָׁה
הַמָּקוֹם יְרַחֵם עֲלֵיהֶם
וְיוֹצִיאֵם מִצָּרָה לִרְוָחָה
וּמֵאֲפֵלָה לְאוֹרָה
וּמִשִּׁעְבּוּד לִגְאֻלָּה
הָשָׁתָא בַּעֲגָלָא וּבִזְמַן קָרִיב
Nos frères, toute la maison d'Israël
Qui sont donnés à l’étroitesse (souffrance) et à la captivité
Qu’ils se tiennent sur la mer ou sur la terre
“Le Lieu” (l’un des noms de Dieu) aura pitié d'eux.
Et ils les feront sortir de l’étroitesse à l’espace
Et des ténèbres à la lumière
Et de la servitude au salut
Maintenant, et dans un temps proche.
Il y en a un qui a fait preuve de dignité cette semaine, c’est Herzi Halevi.
Le chef d’état-major israélien est le premier de l’histoire israélienne à présenter sa démission avant la fin de son mandat. Il l’a fait mardi, disant que c’était prévu depuis plusieurs mois, qu’il attendait seulement que la guerre que mène l’armée israélienne sur sept fronts concomitants soit stabilisée. Dans sa lettre adressée au Ministre de la défense, il a écrit son aveu de défaite.
“Dans la matinée du 7 octobre et sous mon commandement, l’armée a failli à sa mission de protection à l’égard de tous les citoyens israéliens.
Ma responsabilité dans ce terrible échec m’accompagne chaque jour, à chaque heure, et elle me poursuivra jusqu’à la fin de ma vie.”
Il a admis, et il a pris acte.
J’aimerais voir les fanfarons des deux côtés l’imiter ne serait‐ce que d’un quart de millimètre.
Nous en attendant, on attend.
Shabbat dans quelques heures, et dimanche, ou samedi peut‐être, on en attend d’autres.
Le jeu de télé‐réalité pervers continue.
On a eu la liste des dix prochaines. Mais sur les dix, seuls quelques‐unes en sortiront*.
Qui seront‐elles ? La suite au prochain épisode.
Littéralement.
Le Hamas tient à garder son contrôle, et à tenir le pays entier en haleine, jusqu’au bout.
Pourquoi renoncer à un petit pouvoir misérable qu’on peut avoir ?
Quand on n’a pas son propre pouvoir, la seule chose qui reste, c’est de tenter d’en prendre un peu aux autres.
C’est bien là le sens profond de la prise en otage, littéralement comme symboliquement.
La prise de contrôle, et le geste d’humilier, de déshonorer, systématiquement.
Mais au fond, quoi qu’ils fassent, cela ne marche pas.
Je n’ai pas vu de plus grande dignité humaine que sur les visages émaciés des otages filmés par le Hamas, sur les vidéos diffusées cruellement au compte‐goutte, pour raviver la blessure en nous donnant à la fois nous donner un signe d’espoir, et nous rappeler qu’ils les tiennent – qu’ils nous tiennent tous captifs dans l’attente.
Oui, je n’ai pas vu de plus grande dignité que sur ces masques de vulnérabilité et de souffrance, d’un humain à qui on a tout enlevé, y compris toute visibilité sur son avenir, ou la perspective de tout espoir.
Cela me fait penser aux hommes, encore trop nombreux, qui refusent de donner le get, le document de répudiation qui tient encore de divorce selon la halakha.
Jusqu’au bout, garder le contrôle.
Jusqu’au bout.
Le premier pas
Et je dois dire qu’ils nous ont eu.
Ils ont trouvé le talon d’Achille. Nous parlons de deux cultures différentes. Dans l’une, l’individu ne compte pas. C’est le groupe qui compte. Dans l’autre, l’individu est central. Dans l’une, la vie humaine est plus précieuse que tout. Dans l’autre, c’est la culture du martyre, et il n’y a pas de plus grand honneur que de se sacrifier pour Dieu.
Ils nous ont compris, et ils savent que notre faiblesse, c’est la valeur que l’on accorde à une vie humaine.
Que pour une vie humaine, on est prêt à remettre en liberté 1027 meurtriers. Comme on l’a fait pour Gilad Shalit.
Ils ont trouvé notre talon d’achille et nous ont mis à genoux.
On fait ce qu’on peut pour s’en sortir, avec cet accord sordide.
Mais qu’on le veuille ou non, Israël et le Hamas sont englués dans un jeu de rapport de force.
Alors je me pose, comme beaucoup, la question douloureuse de l’avenir.
À ce rythme‐là, personne ne s’en sortira.
Qui fera le premier pas pour sortir du cercle ?
En attendant, on a choisi, me semble‐t‐il, la vie, et la dignité.
On fait profil bas, et on paie le prix pour récupérer nos otages.
C’est peut‐être un premier pas, peut‐être un premier vers la sagesse : on a mis l’ego de côté. On ne fait pas les malins.
On ne fanfaronne pas en uniforme.
On veut juste la petite.
On veut retrouver l’amoureux.
On veut que papa rentre.
Qu’ils fassent la parade ;
Nous on fait profil bas et on attend.
Et moi je me tourne vers le Roi du monde et je lui dis : regarde‐nous un peu, source de vie, et pleure avec nous.
Pleure avec moi s’il te plaît de notre folie humaine.
Je sais que tu n’arrêteras pas ces jeux du cirque.
Tu nous as fait libres – trop libres, semble-t-il, parfois.
Alors au moins, pleure avec nous.
Espère avec nous.
Prie avec nous.
Console avec nous.
Attend avec nous.
Dimanche, on en attend sept autres.
On n’a pas encore les noms.
* NDLR : Dans la journée de samedi, quatre otages ont été libérées : il s’agit de Liri Albag (19 ans) et de Karina Ariev, Daniela Gilboa et Naama Levy (20 ans), quatre observatrices de Tsahal (tatspitaniyot) enlevées dans la base militaire de Nahal Oz le 7 octobre 2023.