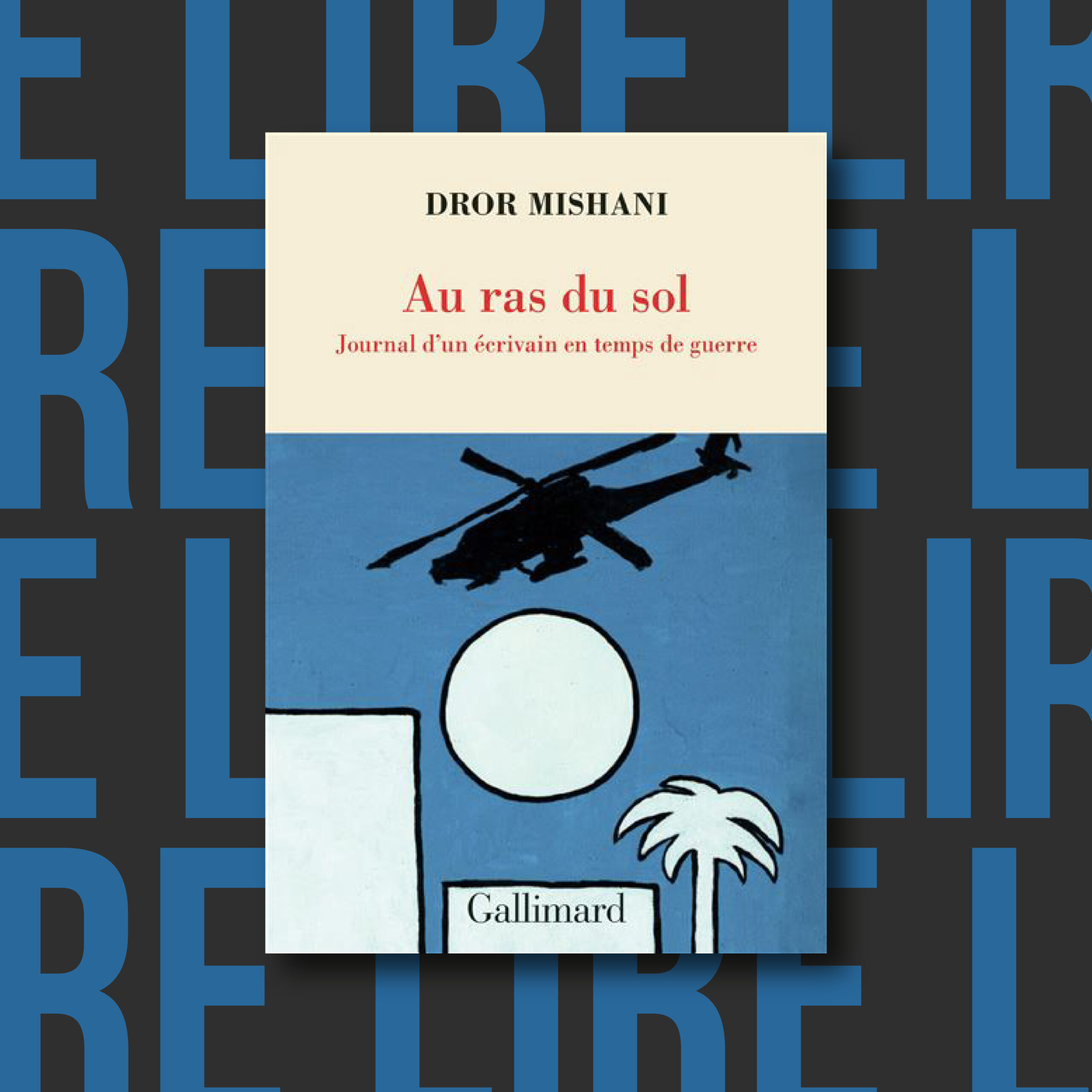Les semaines redoutables
Chaque année à l’automne, les juifs traversent des Yamim Noraïm, les “jours redoutables”.
Entre Rosh haShana (où l’on célèbre la naissance du monde en trempant la pomme dans le miel), et Yom Kippour (où l’on jeûne en vue de la renaissance de soi), les Juifs se tiennent droits pendant que leur âme passe devant le “roi du monde”, en espérant être inscrit dans le livre de la vie.
Depuis octobre 2023, les jours redoutables sont restés figés dans le temps.
Et depuis mi‐janvier 2025, alors qu’Israël a enfin signé avec le Hamas un accord cessez le feu contre une libération tant attendue de ses otages, nous voilà entrés dans une autre période suspendue hors du temps, d’autres jours autrement redoutables.
Les captifs seront rendus au compte‐gouttes. Qui vivant et qui dans un sac. Qui, quand et comment. Qui dans quel état, visible ou invisible. Qui, et même si.
Et on paie tout cela au prix fort : contre la libération des otages israéliens enlevés lors du pogrom du 7 octobre, la remise en liberté d’un millier de prisonniers palestiniens condamnés pour terrorisme. On est bien entrés dans six semaines redoutables.
Lire les textes des première semaine : Dimanche 19 janvier, 6h30 du matin, on attend, Vendredi 24 janvier: le temps arrêté, Vendredi 31 janvier: les arbres et l’attente
Sur le même sujet, lire le « Journal photo de l'attente » de Sarah Ohayon
Shabbat dernier, les hommes sont revenus.
Un jeune, un vieux, un entre les deux.
Un en forme, un famélique, un glacé.
Le samedi soir, c’est devenu pour moi l’étrange rituel depuis trois semaines.
J’y pense quand le soleil commence à descendre. Je regarde le ciel qui bleuit jusqu’au noir, je cherche les trois étoiles et, moi qui d’ordinaire rechigne à laisser partir le shabbat, à présent me voilà à attendre que la Reine sorte pour pouvoir rallumer mon ordinateur, et partir à la pêche en ligne pour les preuves en image :
Sont‐ils bien sortis – comment vont‐ils – et puis les retrouvailles.
Dans la journée j’avais pensé à Keith qui était peut‐être en train d’arriver. Je pensais à sa femme Avivah, sortie de captivité en novembre 2023, en train de respirer en même temps que moi, quelque part ailleurs en Israël. Elle l’attendait, les dernières heures d’attente ; elle venait de passer le dernier vendredi soir en se disant “demain, il sera là, demain, il devrait être là. On nous l’a dit”. Le doute peut‐être aussi, la peur qu’au dernier moment cela ne se fasse pas. Dernier shabbat d’attente, en se disant “tout à l’heure il sera là.”
Cette semaine, les libérations étaient différentes.
Les femmes et les enfants d’abord
“Les femmes et les enfants d’abord”, s’était-on entendu dans les termes de l’accord sordide entre Israël et le Hamas.
Alors c’étaient des femmes qui étaient revenues en premier. Des toutes jeunes filles restées captives pendant quinze mois, certaines en confinement solitaire, dans des tunnels suintants sans oxygène et sans lumière, pour des périodes allant de quinze jours à presque la totalité du temps.
La dernière libération avait inclus un vieil homme de quatre‐vingt ans captif du Jihad Islamique, et cinq travailleurs thaïlandais détenus… eux, pourquoi ?
Le 7 octobre, on l’oublie trop souvent, le Hamas n’a pas massacré et enlevé que des Juif. Des Arabes chrétiens, des Bédouins, des Africains et des Thaïlandais ont connu le même sort. Pour le Hamas, tous ceux qui ont un lien avec Israël sont coupables.
En réalité, comme dans tout régime de terreur, tous ceux qui ne collaborent pas avec le Hamas sont coupables. On connaît le sort de ceux qui ne coopèrent pas, à Gaza. Ceux qui ont tenté le dialogue de paix avec l’entité sioniste. Celles qui ont voulu sortir les cheveux libres. Ceux qui aimaient les hommes.
On parle d’une société entière radicalisée, et c’est probablement vrai. Mais n’oublions pas que nous parlons aussi d’une société régie par la désinformation, la propagande et surtout la terreur. Obligés de participer à la stratégie du Hamas, sinon… On se souvient, après le 7 octobre, lorsqu’Israël a demandé à la population civile d’évacuer les lieux avant son entrée pour la guerre, comme ils ont pris les clés des véhicules, confisqué les pièces d’identité, menacé et terrorisé tous ceux qui tentaient de s’enfuir.
La présence des civils dans le champ de bataille, tout comme les otages, est pour eux la première arme : créer un mélange de corps humains où les tueurs se mélangent avec les innocents pour mettre le soldat d’en face face à un dilemme impossible, un jeu de hasard sordide auquel, quoi qu’il choisisse, il perd.
Alors on a commencé avec les trois premières, les étoiles du soir d’un jour nouveau pour nous : Emily, Romi et Doron, des jeunes femmes enlevées de chez elles, étaient soudain revenues dans nos vies.
Certes Emily avec deux doigts en moins, Romi parlait arabe plus qu’hébreu, et tout le reste invisible qui ne nous regarde pas. Mais elles étaient libres.
Et puis on a eu les quatre petites, les tatspitaniot, enlevées de leur base pendant que le reste de leur équipe était massacré. Quatre, puis une autre la semaine dernière, le jour de Rosh Hodesh Shvat, la petite Agam avec ses bagues orthodontiques et son violon abandonné.
Et puis shabbat dernier, après Gadi et les cinq travailleurs thaïlandais – qui n’avaient pas forcément pensé à cela lorsqu’ils avaient fait le grand saut au Moyen‐Orient pour soutenir leurs familles, shabbat dernier, les premiers hommes ont réémergé de la géhenne : Ofer, Keith et Yarden.
Mais il y avait une dissonance dans cet ordre des retours.
Quelque chose qui ne collait pas avec “les femmes et les enfants d’abord.”
Ce trou béant nous laisse interdits depuis que la danse fantomatique des retours a commencé : Quid de Shiri Bibas et de ses deux petits?
Son mari, Yarden, est sorti avant elle, sans elle, et sans nouvelles d’elle.
Je me souviens du témoignage de l’un des otages libérés en novembre.
Ils étaient tout un groupe, dans les tunnels, du même kibboutz. Ils passaient le temps à se raconter des histoires – l’un d’eux, justement, professeur d’histoire, leur faisait des leçons organisées pour meubler les journées.
Car on oublie peut‐être cette forme de torture dans la captivité : l’ennui.
La torture du rien.
Des journées vides. Ponctuées de violence arbitraires et peut‐être du bruit des bombardements israéliens. Des journées trop calmes pour ne pas être obsédés par l’estomac qui crie famine, harcelés par la peur qui tenaille, jour après jour : “C’est peut‐être mon dernier jour. Je ne vais peut‐être jamais sortir d’ici”, épuisés par l’incertitude : “qui est vivant, chez moi ? Qui a été pris?”
Combien de temps cela va‐t‐il durer ?
L’un des motifs récurrents dans les témoignages des otages revenants, c’est que chaque minute semblait une éternité.
On peut lire les mêmes propos chez les témoignages de survivants de la Shoah : chaque journée s’étire comme une éternité en enfer. Le supplice absolu.
Alors ils essayaient de structurer le temps comme ils le pouvaient. Ils cherchaient à retrouver, à défaut de repères comme le soleil et la nuit, le sens du temps. Entre temps d’exercice et temps pour les histoires, ils tentaient de se créer un emploi du temps qui fasse sortir du cauchemar amorphe d’un temps figé.
L’un d’entre eux pourtant ne participait pas. Yarden Bibas, racontera un otage revenu en novembre 2023, restait dans son coin, prostré. Il ne voulait pas passer le temps. Il ne voulait pas se changer les idées. Il ne voulait pas aller mieux.
Lorsqu’il était allé le voir, Yarden lui avait dit, amèrement : “Toi, au moins tes enfants savent qui tu es. Moi, mon bébé il ne connaîtra même pas mon visage.”
Il pensait qu’il ne sortirait pas.
Il croyait alors que sa femme et ses enfants étaient restés derrière, libres.
Shiri et ses petits
Mais en voilà une femme, et des enfants, qui ne sont pas sortis selon l’ordre de priorité de l’accord.
Une femme dont les images de son enlèvement, chez elle, le 7 octobre 2023, éplorée, serrant ses deux petits dans ses bras et dans un drap, l’un alors de quatre ans, l’un de huit mois, font le tour des réseaux depuis près d’un an et demie maintenant.
De Shiri Bibas, dont j’aurais aimé ne jamais connaître le nom, on n’a pas entendu un traître mot de la part du Hamas lors de cet échange.
Depuis que Yarden est sorti, la pression d’Israël et de la communauté internationale s’intensifie. Des messages d’inquiétude quant au sort des petits rouquins se multiplient sur les réseaux sociaux. Les rassemblements aussi, pancartes oranges et ballons oranges, dans plusieurs villes de la diaspora, et à l’un d’eux au Royaume Uni la semaine dernière, un passant blanc, un monsieur d’une cinquantaine d’année plein de haine pour ces entités sionnistes qui avaient le toupet d’exprimer leur douleur pour la cause de deux bambins dont il n’avait pas envie d’entendre parler, était venu agresser et frapper les participants.
En attendant, le Hamas n’a pas répondu aux questions pressantes d’Israël. Où est Shiri ?
Où sont Ariel et Kfir, les deux petits ?
En allant en ligne vérifier le prénom d’Ariel je viens de voir.
On le sait déjà tous, au fond, mais je crois qu’on s’est mutuellement fait pacte de silence, pour retarder le moment où la nouvelle serait annoncée.
“Après une demande israélienne adressée par l'intermédiaire de médiateurs, le Hamas a approuvé la remise des corps d'une captive israélienne et de ses deux enfants, selon Al Jazeera Arabic”, annonce The Middle East Eye.
Le communiqué date d’hier. On ne veut tellement pas savoir que rien n’est encore sorti sur les médias israéliens.
On n’a pas les noms de ceux qui sont censés sortir demain.
Si ce sont eux, ce sera notre sortie d’otages la plus macabre.
Je pense aux trois cercueils, dont les deux minuscules qui accompagneront Shiri comme les deux ailes de la maman oiseau. Les petits coffres en bois concernant les corps de ses petits morts depuis presque un an, la dernière chose que Yarden pourra prendre d’eux dans ses bras.
Au moins ils ne seront pas forcés de faire coucou à la foule qui les hait sur l’estrade de leurs tortionnaires.
Au moins il n’y aura pas de jeux du cirque.
Pour ces petits‐là, les jeux sont finis.
Au moins il pourra les enterrer.
Au moins il pourra commencer son deuil.
Au moins on pourra pleurer avec lui. L’attente sera finie.
Et je lui souhaite, de tout mon coeur, que l’esprit de Viktor Frankl, sorti d’Auschwitz il y a quelques décennies sans sa femme et son fils, vienne le prendre dans ses bras et lui donne un peu de la force dont il aura besoin rebâtir une vie.
Yarden
Je crois qu’au fond, comme nous, Yarden le sait.
Il est sorti de captivité glacé. Pas un sourire. Le regard vers le bas.
Les autres étaient sortis avec pleurs et sourires.
Les petites avaient sangloté, ri, embrassé. Nos premières libérations étaient des scènes de soulagement et d’amour. C’est peut être pour cela aussi qu’elles avaient été diffusées sur la télé israélienne. On avait tous besoin de cela. Pas seulement leur famille, les parfaits inconnus, comme moi, on avait besoin de les voir de retour, de les voir réunis, de les voir pris dans les bras.
Pour le coup, parfois, la société du spectacle sert l’économie psychique collective. On vivait avec délice par procuration la fin du cauchemar, la fin de l’attente, la réunion de familles amputées d’elles-mêmes et torturées par l’incertitude pendant si longtemps.
Ofer avait fait rire ses quatre enfants, qui étaient venus se coller à lui dans un seul câlin, et lui qui les prenait tous ensemble dans ses bras comme une portée de petits poussins enfin soulagés “aba, aba!” (“papa, papa”), ils piaillaient de concert entre pleurs et rires de soulagement.
Il a commencé tout de suite à leur faire des blagues, et a promis au petit qui était resté derrière, celui qui avait réussi à échapper à l’enlèvement et à la mort, une randonnée à vélo, la semaine prochaine.
Son autre fils Erez était là, l’un de ceux qui avait été pris avec lui, le petit de douze ans qui était resté enfermé seul dans une pièce une semaine – ou deux, je ne me souviens plus –, au début de sa captivité, Erez que le Hamas avait forcé à regarder les vidéos des atrocités qu’ils avaient commises le 7 octobre. Erez à qui l’on avait répété pendant des semaines que tout le monde l’avait oublié, que personne ne l’attendait chez lui.
Erez enfin pressé enfin contre son père revenu de captivité, rit de grand cœur, l’éclat de vie tintinnabulant aux plaisanteries de son aba dont il ne savait pas, jusqu’à ce jour, s’il le reverrait un jour.
Ofer, comme Yarden, avait été traité très durement. Enfermés dans des cages au départ, dans un tunnel. Frappés, battus, insultés.
Ofer avait été traité comme un soldat israélien, je n’ose imaginer ce qu’on lui a fait endurer. Comme pour les petites, ils l’ont fait sortir en uniforme kaki tout neuf imitation uniforme israélien.
Comme pour les petites, dans les deux semaines précédant leur libération, il a reçu soudain plus de nourriture, on lui a permis de se laver, certains disent qu’on leur a donné des médicaments pour remonter le moral et de la dopamine, afin que le monde voit sortir des otages “en bon état,” et que les malveillants puissent dire : vous voyez, le Hamas les traite bien !
Oui décidément Saint‐Exupéry avait raison. L’essentiel est invisible pour les yeux.
Ofer est ressorti vivant, profondément vivant, non sans être passé comme les petites sur l’estrade de l’ego trip du Hamas.
Keith aussi, mais moins expressif. Pour marcher vers l’estrade et faire coucou à la foule selon la chorégraphie perverse, l’estrade sur laquelle, derrière lui, étaient écrits ces mots en arabe et en anglais : “nazi zionism will not win”, il avait besoin d’être soutenu par deux hommes noir, un de chaque côté était.
Quand j’ai vu ce message en anglais, je me suis dit que cela suffit à comprendre, s’il y avait encore un doute, que le message est dédié aux foules occidentales.
Keith n’avait probablement pas remarqué le message derrière lui. L’épuisement avait fait de son visage un masque presque mortuaire. Maigre, blême, faible, arrivé à l’hôpital, il se laisse prendre dans les bras par sa famille, fantômatique, très immobile, comme s’il allait glisser dans l’autre monde l’instant d’après. Mais il est bien vivant, et ses filles, comme Myriam et son tambourin après la sortie d’Égypte, l’accueillent en chantant et en tapant des mains, et l’entourent de leurs bras aimants.
Yarden n’aura pas cela. Yarden est sorti la tête basse. S’est laissé prendre dans les bras par sa mère. A demandé où était sa femme, où étaient ses fils.
N’a pas eu de réponse.
Il y a quelques mois, ils l’avaient fait venir pour l’une de leurs vidéos de propagande.
Ils lui avaient annoncé en direct, devant la caméra, que sa femme et ses enfants étaient morts dans un bombardement israélien.
Ils voulaient filmer sa réaction en direct, pour ensuite la diffuser au monde entier.
Je n’ai pas cliqué sur la vidéo.
S’il vous plaît, ne cliquez pas sur les vidéos. Ne rentrez pas dans leur jeu de l’exhibitionnisme et du voyeurisme de l’humiliation et de la souffrance de l’autre.
Je ne veux pas être connu
Yarden, nous dit sa famille, depuis qu’il est sorti, avec son naturel discret, demande que l’on respecte sa vie privée.
C’est vrai qu’il y a ce phénomène étrange, à la sortie des otages : ils sont traités, dans leurs rares apparitions dans l’espace public, comme des célébrités.
Tout le monde les connaît, on connaît leur visage et leur prénom, on a vu l’album de leur vie dans les films diffusés pour leur libération, on sait leur âge et ce qu’ils aiment faire dans la vie, on les as vus dans les postures de vulnérabilités extrême, filmés en sang et battus lors de leur enlèvement, filmés en captivité, et puis filmés dans leur intimité suprême, en larmes dans le premier instant où ils retrouvent leur famille. Et voilà que, dans la rue, la circulation s’arrête et tout le monde se met à klaxonner avec enthousiasme lorsqu’on voit Ofer monter dans un van de l’armée, “Hé, c’est Ofer ! On t’aime!”
Et les otages revenus, comme les petites depuis leur voiture qui les accompagne à l’hôpital, de rendre le salut de la main à tous les automobilistes qui leur font coucou avec effusion.
J’aurais peut‐être fait de même. Du moins j’aurais été tentée. Je sais que je me suis abstenue lorsque j’ai croisé, shabbat il y a deux semaines, les parents de Hersh. Ils étaient en conversation avec des amis à eux, au bout de la tayelet, après le rassemblement shabbatique de prière pour le retour des otages à Jérusalem. Je me suis arrêtée un instant, qu’allais-je leur dire ?
“Je vous connais ! J’ai tout suivi du calvaire de votre fils, et du vôtre.”
Je me suis abstenue. Ils étaient en conversation avec des amis. Ils n’avaient peut‐être pas besoin qu’une inconnue vienne leur rappeler.
Voilà un thème qui ressort ces derniers temps.
“Ani lo rotse lihiot mefursam”
“Je ne veux pas être connu”
Une chanson de deux jeunes israéliens que j’ai vue passer sur les réseaux sociaux, avec un clip qui montre les photos des otages, celles que l’on connaît tous par coeur maintenant, les dates, les âges, le visage souriant, celles qui font maintenant partie du paysage urbain tant que l’on a oublié ce que c’est qu’une rue en Israël sans ces visages encadrés de noir et rouge, sans ces rubans jaunes accrochés ci et là, à côté des autocollants portant d’autres visages souriant, ceux des gamins morts au combat.
Oui ces inconnus précipités dans l’ombre ont été aussi paradoxalement précipités dans le même temps dans la lumière des paysages urbains et des consciences collectives.
La présence visuelle de leur image figée, comme une misérable tentative de conjurer leur absence, se répète partout, grâce aux vertus de l’impression en couleur, dans les rues du pays et du monde – du moins en diaspora là où elles ne sont pas arrachées.
Les deux jeunes du post instagram que je ne retrouve plus chantent au nom de ceux qui ne le peuvent pas.
Ceux qui leur ressemblent, mais qui ont soudain disparu , il y a quinze mois.
Disparu de leurs bancs d’université ou de leur travail, de la table familiale et des bras de ceux qui dormaient avec eux, disparus en trois dimensions, et dont la présence a glissé à des posters. Sur le plan unidimensionnel d’une photo figée, ou de la vidéo de l’un des moments les plus vulnérables de leur vie, les voilà soudain, juxtaposés à leur absence, dans une omniprésence maudite. Les voilà exposées partout dans les rues et dans les abribus, sur les bancs et sur les fils instagram, imprimés sur des t‑shirts sur le cœur de ceux qui ne peuvent plus sentir la chaleur de leurs corps, voilà désormais leur absence omniprésente dans le même espace public dont ils ont été arrachés.
Alors des voix s’élèvent, pour nous appeler, nous, à les aider à protéger au moins un peu de ce qui reste de leur intimité, à leur redonner un peu de dignité, là où leur pudeur leur a été arrachée malgré eux.
J’ai vu passer notamment la vidéo d’une jeune instagrameuse juive américaine, Daphna je crois. Elle y raconte le prix qu’elle paie pour faire passer le message qu’elle a décidé de partager sur les réseaux : comment dans des cafés, des mariages ou des soirées, des gens viennent vers elle pour la prendre dans ses bras et lui dire merci, ou combien ils la trouvent forte, ou combien elle leur a fait du bien, car eux aussi, ont été violés. Elle raconte comme c’est difficile pour elle de se voir rappeler, à des moments où elle a juste envie d’être une autre partie d’elle-même que cette étiquette‐là, à des moments où elle n’y pense pas, à des moments où elle est en train de s’amuser et avait juste envie de vivre sa vie de jeune fille, de se voir rappeler qu’elle a été violée et parfois réduite à quelqu’un qui se remet de ce passé.
“Mais moi au moins, dit‐elle, je l’ai choisi. J’ai choisi d’exposer mon histoire pour en aider d’autres, et c’est le prix à payer”.
“Mais, elles, Naama, Liri, Daniela, Karina, poursuit‐elle, elles n’ont pas choisi”.
“Elles n’ont pas choisi qu’un pantalon de jogging plein de sang soit exposé en version gigantesque sur l’un des gratte-ciel de time squares.” Elles n’ont pas choisi les images que l’on a vues d’elles, et l’imagination que l’on a tous de ce qui a pu leur arriver.
Elles n’ont pas choisi d’être exposées.
“Alors si vous les voyez, conclut‐elle, s’il vous plaît, laissez-les tranquille. N’allez pas leur rappeler ce que vous avez vu, ce qu’elles ont vécu.”
Cela commence peut être par ne pas cliquer sur les vidéos ; par ne pas diffuser les photos.
Il y a quelques mois, la mère de Naama témoignait de la difficulté pour elle, dès qu’elle allait sur les réseaux, de “tomber”, à l’improviste, sur l’extrait vidéo devenu médiatiquement surprésent de l’enlèvement de sa fille.
“Je ne peux pas y échapper”, partageait‐elle à la journaliste. Ce n’est pas assez que sa fille ait été violentée et kidnappée, et que cela ait été filmé et diffusé, et partagé et repartagé. Pour Ayelet Levy, la possibilité même de choisir de ne pas voir lui a été enlevée. Et cela la prend toujours par surprise.
C’est l’un des drames de la configuration des nouveaux réseaux sociaux. On ne choisit plus ce que l’on voit. Ça nous saute à la figure. Et que l’on décide de cliquer dessus ou pas, c’est trop tard, l’image, même un instant, a surgi sans crier gare dans notre champ de conscience.
Cela constitue une agression au carré, une agression après l’agression : avant qu’on ait eu le temps de cliquer “non,” l’image est imprimée dans le cerveau, elle revient attiser la douleur, à tout moment, peut‐être à un moment où la mère en apnée avait une minute de répit ou elle pensait enfin, l’espace d’un instant, à autre chose.
Et puis quand c’est toi à qui c’est arrivé, et qu’on vient te montrer, sans que tu n’aies rien demandé, sans que tu aies choisi d’ouvrir la boîte, ce que tu as vécu, c’est encore une autre forme d’intrusion sur ton corps et sur ton âme.
La semaine dernière, la famille d’Arbel a relayé sa demande de ne plus diffuser les images de sa libération.
Ces images qui, comme une traînée de poudre, ont fait le tour du monde entier. Gros plan sur la fragilité ultime du visage, le petit visage si long et si pâle d’une otage qui a été maintenue dans des conditions particulièrement difficiles, seule quasiment tout le temps, dans un tunnel. Premier retour à la lumière du jour, amaigrie, éberluée, lente, effrayée, secouée par une foule de milliers d’excités se pressant autour d’elle, contre elle, vers elle, au point que les geôliers cagoulés en armes qui l’accompagnaient devaient repousser violemment les assauts ultimes visant la captive juive.
D’autant qu’on ne choisit pas qui nous regarde.
Le choix du regard
Car il y a toutes sortes de regards. Toutes sortes de regard sur la vulnérabilité humaine.
Il y a le regard de compassion, le regard qui se détourne pour protéger la dignité du déshabillé, le regard à la curiosité mal placée, le regard voyeur, et puis il y a le regard malveillant. Celui qui se délecte, celui qui cherche à dénier la souffrance de l’autre, et à renvoyer l’accusation.
Cette semaine, le Times of Israel a partagé les commentaires sur Instagram d’une employée de la marque de luxe Hermès, Islem Chargui qui, avant d’effacer ses comptes lorsque ses remarques haineuses ont été dénoncées, avait eu l’élégance de commenter au sujet de la photo d’Agam sur les genoux de sa mère “elle est revenue bien grosse”.
Cela après s’être moqué de la phrase d’effusion de sa mère d’Agam, “Maintenant on ne te quittera plus”.
“Ta phrase ne veut rien dire mais bon vous êtes pas très connus pour être smart”- émoticone “mort de rire”, suivi de “Salam alaykom du Hamas”.
J’ai la chance d’être très protégée de l’acide des discours de haine à l’encontre de mon peuple qui inondent les réseaux sociaux depuis le 7 octobre.
D’une part parce que les réseaux ne sont plus des forums d’espace public mais bien des “echo chambers”, des lieux où on ne reçoit que les informations qui nous ressemblent, choix des algorithmes IA pour des raisons de stratégie marketing, de sorte que personne n’est plus vraiment exposé à la perception d’en face, mais ne reçoivent que des confirmations de ses propres opinions.
Aussi parce mes amis non‐juifs, soit ne postent rien de malveillant sur mon pays, soit que je ne le vois pas car on ne se parle plus depuis longtemps et je ne m’en rends pas compte.
De l’antisémisme fou et de sa nouvelle langue, la mauvaise foi, notamment sous forme de malveillance vis‐à‐vis des victimes du 7 octobre, je n’ai quasiment rien vu. Ni affiches arrachées, ni manifestations de haine dans les grandes villes occidentales, ni carnavals déguisés sur les campus américains, ni slogans délirants.
De l’évolution du discours antisémite déguisé en antisionnisme, je ne vois que les reflets, à travers ceux de mes camarades qui y réagissent sur les réseaux. Et les reflets blessent déjà assez comme cela.
Alors ce commentaire, vu au hasard d’un article sur lequel j’ai cliqué au hasard, une simple émanation du type venin qui coule vers nous, par des millions d’être humain sur la planète, et les robots qu’ils paient pour harceler les réseaux sociaux de juifs et les inonder de haine de manière ininterrompue, ce pic aussi mesquin que méchant, m’a touchée.
Bien sûr, la malveillance touche. En ce qui me concerne, elle me touche toujours avec un mélange de tristesse et de stupéfaction. Mais pourquoi cette haine ? Pourquoi ce besoin de dénigrer, d’attaquer, de moquer ? N’a‑t-elle rien de mieux à faire avec son précieux souffle de vie, ses doigts faits pour créer, son cerveau fait pour comprendre le monde ?
Pourquoi prendre la peine d’utiliser son énergie à regarder les images de nos otages libérés, afin de prendre ensuite le temps, de commenter pour dégrader, moquer, sans répit. Pourquoi nos ennemis gaspillent‐ils leur précieuse énergie vitale pour nous harceler ?
Cela me stupéfait, je n’ai pas de réponse, et tant mieux.
Tant mieux que je ne puisse comprendre cela.
Je repensais à cet adage populaire “la bave du crapaud n’atteint pas la blanche colombe.”
Ce n’est pas vrai. J’ai mal. Je suis touchée.
En lisant le message de haine de cette dame, par le biais du langage sarcastique et de la plaisanterie dégradante et malveillante, j’ai mal. Je n’ai pas seulement mal pour le moment précieux de réunion d’Agam et de ses parents qui est sali par ce regard malveillant. Je n’ai pas seulement mal pour Israël, pour nous, les Juifs.
J’ai mal à mon humanité.
Le jeu de retournement des victimes
Oui la haine est bien vivante.
Heureusement, devant les proportions que cela prend, notamment aux États‐Unis, la société civile commence aussi à réagir.
Je suis tombée ce matin par hasard sur un clip court, posté à l’occasion du Super Bowl, le jeu épique des Américains. Une pub tournée par deux icônes culturelles américaines, Snoop Dog, un rappeur noir des banlieues et Tom Brady, un footballer blanc marié à une mannequin uber celèbre. Dans une sorte d’arène sombre, ils se font face, le visage dur, avec colère.
I hate you ‘cause we come from different neighborhoods.
I hate you cuz look different.
I hate you ‘cause I don’t understand you.
I hate you because the people I know hate you
Cuz you talk different
Cuz you look different!
Je te hais parce qu’on vient de quartiers différents.
Je te hais parce que tu es différent.
Je te hais parce que je ne te comprends pas.
Je te hais parce que les gens que je connais te haïssent
Parce que tu parles différemment
Parce que tu es différent
Puis l’écran affiche blanc sur noir :
“Les raisons de la haine sont aussi stupide que les mots qui l’expriment”
À la fin, Snoop dit :
“Et je hais le fait que ça va tellement mal qu’on est obligés de faire une pub comme ça.”
Me too. Répond Tom.
Et ils partent ensemble.
Les producteurs ont eu l’intelligence de ne pas prononcer les mots “juif” ou “antisémitisme”, le message ne serait pas passé.
Mais personne n’est dupe.
La situation aux États‐Unis devient alarmante, notamment pour les jeunes dans les lycées et les universités, qui se font harceler par leurs camarades mais aussi, de plus en plus ouvertement, par leurs professeurs.
Où sont les hommes ?
En attendant, pendant que nos hommes reviennent, d’autres reviennent aussi.
Pour certains d’entre eux, j’ai l’impression qu’ils reviennent de l’enfer.
L’enfer dans lequel je pensais qu’on pourrait les oublier.
Je savais qu’on libérait des otages contre des condamnés pour terrorisme et pour meurtre.
Mais cela restait un peu abstrait, et j’avais tout fait pour que ça le reste.
Mais voilà que soudain, la nouvelle m’a sauté au visage.
Lui aussi. Lui aussi ils l’ont libéré.
Je me fous de son nom.
Il avait tué Ori. Violée. Poignardée.
C’était en 2019. Elle avait 19 ans.
Je m’en souviens bien
J’étais à Jérusalem quand c’est arrivée.
C’était dans le jardin près du parc zoologique.
Elle était allée s’y poser sur l’herbe, avec un livre, au beau milieu de l’après-midi.
Cela aurait pu être moi.
Elle a disparu pendant trois jours.
J’ai suivi les jours d’attente. On a fini par retrouver son corps, déjà froid. Dégradé. Et le sien à lui, bien vivant, de retour dans son village.
Le sentiment de soulagement quand on l’avait pris. Lui.
Il l’avait poignardée, étranglée, traînée de quelques mètres, puis violée en continuant de la poignarder jusqu’à la mort. Je pensais que, comme elle, on ne le verrait pas revenir de l’enfer dans lequel il l’avait précipitée.
Il vient d’être libéré.
En échange de nos otages.
Je croyais que c’en était fini pour lui.
Mais le voilà de nouveau en liberté.
Je pense à la mère d’Ori.
Je ne la connaissais même pas et j’ai envie d’aller le tuer, lui, moi‐même, avec mes mains nues.
Je ne pense même pas seulement à la vengeance ; je pense au fait qu’il pourrait recommencer.
Qu’il recommencerait, s’il le pouvait ;
Qu’il prévoit peut‐être de recommencer.
Comme Sinwar, qu’on avait soigné d’une tumeur au cerveau dans sa prison israélienne.
Au lieu de le laisser mourir.
On l’avait soigné.
Et maintenant, lui, le violeur et le meurtrier d’Ori, à mains nues, est libre.
Ori ne reviendra pas.
Il est libre.
Voila le prix que l’on paie pour la prise d’otages de notre pays tout entier par une organisation terroriste qui méprise l’éthique et la pitié, et dont les meilleures armes sont la cruauté et la perversité.
Je me souviens encore des mots de la mère d’Ori.
Une mère qui apprend que sa fille à peine post‐adolescente est morte poignardée et violée.
Et qui nous dit “Elle s’appelait Ori - ma lumière”. Elle était une lumière.
Un article qui relate le procès raconte qu’il était entré en Israël muni d’une kippa pour ne pas être arrêté à la frontière, et d’un couteau.
Il n’avait pas de plan particulier, il savait juste qu’il venait “mourir en martyr” – c’est‐à‐dire, il était entré dans le pays des Juifs pour tuer un Juif et mourir ce faisant.
Il n’a pas indiqué que violer une jeune fille faisait partie du plan. Ça a dû venir sur le coup, la spontanéité du moment.
Il n’est pas mort en martyr.
En fait, il n’est pas mort.
Et aujourd’hui, il est libre.
Elle, par contre, Ori, ma lumière, elle est partie dans la grande lumière.
Elle est morte en martyre et elle n’avait rien demandé.
Que de vivre.
On vient de mettre un meurtrier et un violeur en liberté.
Pour récupérer un innocent kidnappé.
Et on a eu raison.
On a eu raison car la liberté d’un innocent vaut mieux que la captivité d’un coupable.
On a eu raison, et j’en perds la raison.
Mais on a eu raison.
De même qu’on a eu raison de condamner à la prison, cette semaine, l’un des soldats qui avait abusé extrêmement violemment, il y a quelques mois, d’un des détenus de Sdé Teiman, une prison militaire dans le sud d’Israël où, depuis le 7 octobre, des prisonniers du Hamas sont détenus. L’abus avait été filmé et reporté, la presse israélienne en avait parlé, les débats faisaient rage entre ceux de chez nous qui reprochaient à nos soldats d’avoir violenté un homme menotté les yeux bandés, au point de lui briser les côtes et de lui perforer l’anus, au nom de notre éthique martiale, et de se comporter comme ceux d’en face, et ceux qui défendaient les soldats agresseurs au vu des circonstances.
Bien sûr, que je les “comprends”. La tentation est forte, surtout si l’on sait ce que certains des détenus ont fait. Mais c’est justement cela, être humain, en tant que valeur éthique, et être juif : c’est résister à la tentation de la violence, de la vengeance. C’est pour cela que nous ne sommes pas les héritiers de Caïn, d’Ishmael ou d’Esav, mais bien d’Avraham, d’Ytzhak, et de Yaakov.
Le Talmud nous le rappelle par la bouche de Hillel, le principe élémentaire de la Torah est simple : “Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu’on te fasse”.
Le test est maintenant.
Nous avons le devoir de ne pas descendre au niveau de ceux qui nous font ce qu’ils nous font.
En condamnant notre soldat, Israël affirme, même avec un gouvernement qui devient de plus en plus d’extrême droite, que son armée a encore un sens de l’éthique.
Cela sauve notre humanité, et cela sauve aussi notre masculinité.
Un homme, un vrai, ne fait pas ce qu’a fait le meurtrier d’Ori.
Un homme, un vrai, ne torture pas sans raison un ennemi qui ne peut pas se défendre.
Et un homme, un vrai, va se battre quand il le faut.
Nos filles, les cinq petites qui ont été libérées, ont demandé à réintégrer l’armée pour finir leur service militaire.
En face, au même moment, on apprend qu’Israël a dû, et pour la première fois, envoyer des mandats d’arrêts à l’encontre des 1.212 haredim (ultra‐orthodoxes) qui ne se sont pas présentés à leur appel à l’armée. Seuls 461 des 3.000 appelés ont répondu à l’appel, pour servir leur pays.
Le refus des haredim de participer, que ce soit en travaillant ou en allant à l’armée ou en payant des impôts, à une société qu’ils méprisent et qui leur donne un salaire tous les mois tandis que certains d’entre eux ne reconnaissent même pas son entité politique, est l’une des lignes de fracture les plus importantes de la société israélienne.
Or devant la conscience du manque d’effectifs depuis le 7 octobre, le pays ne peut plus se passer de ses hommes valides.
Oui, aujourd’hui plus que jamais, Israël appelle ses hommes.
Que ce soit par le corps ou par l’éthique.
Qu’ils soient des hommes ou des femmes.
Et ce shabbat, dans le récit biblique, ce sont les femmes qui montrent le chemin.
Ce shabbat c’est Shabbat Shira (le shabbat du chant).
On y lit la sortie d’Égypte dans les synagogues.
On y lit la traversée de la mer et, juste après, Myriam qui se saisit d’un tambourin et qui emmène tout le monde dans un chant de joie et de soulagement.
Aujourd’hui, Myriam, c’est Daniella Gilboa, qui chante de toute sa voix, avant leur sortie de l’hôpital, lors d’une soirée, pour l’anniversaire de Liri.
Je clos ces lignes assise dans un café des puces de Yaffo, juste une heure avant shabbat ici. La musique tonitrue, les gens assis aux terrasses de café chantonnent, tapent des mains, certains sont debout et dansent.
Oui avec tout cela. Continuons de montrer le chemin, comme cela.
Et pourquoi pas, malgré tout, en chantant et en dansant, comme Myriam et ses tambourins, comme Daniella et son micro, enfin sortie de captivité.
Je n’ai pas les noms des prochains.
Je les attends.