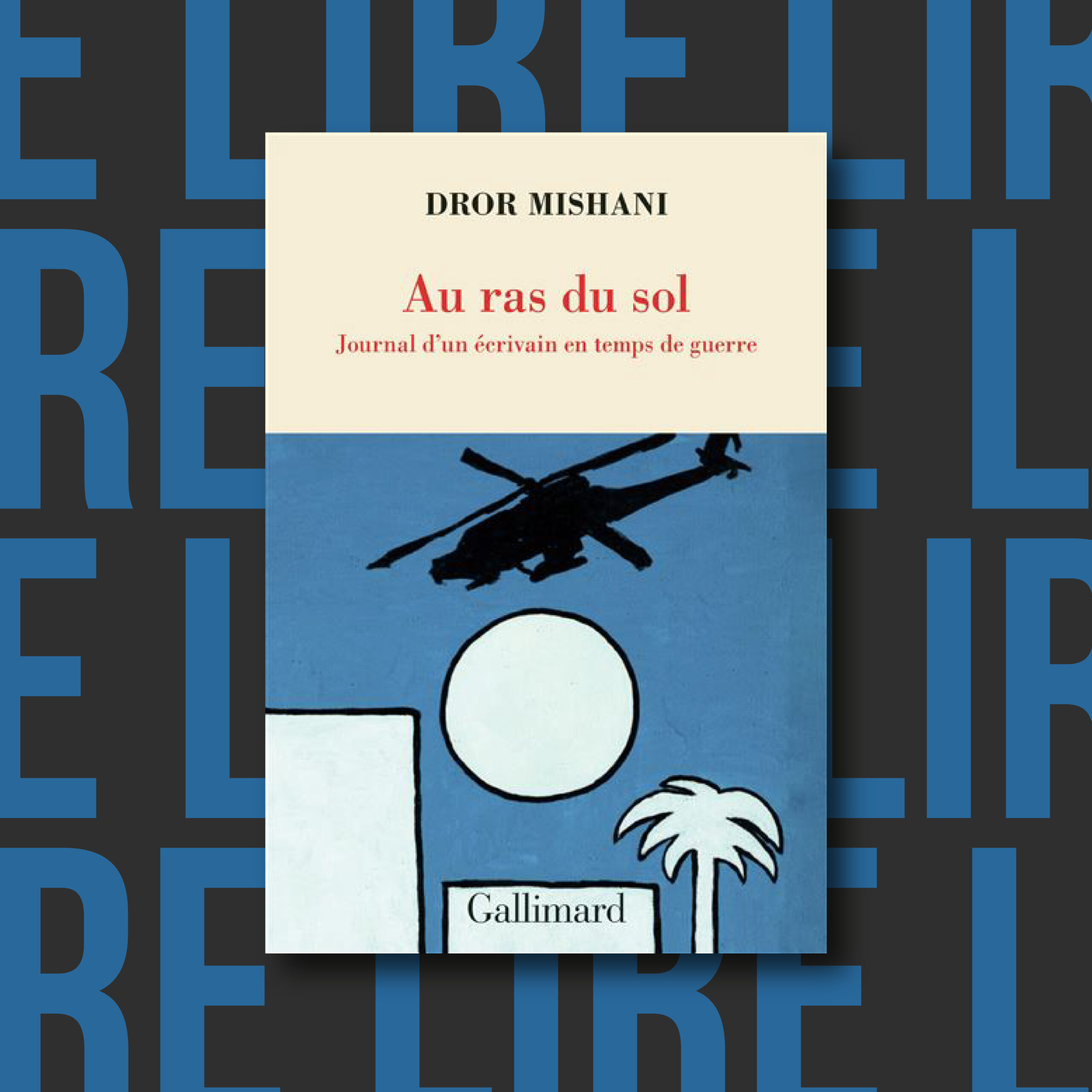Les semaines redoutables
Chaque année à l’automne, les juifs traversent des Yamim Noraïm, les “jours redoutables”.
Entre Rosh haShana (où l’on célèbre la naissance du monde en trempant la pomme dans le miel), et Yom Kippour (où l’on jeûne en vue de la renaissance de soi), les Juifs se tiennent droits pendant que leur âme passe devant le “roi du monde”, en espérant être inscrit dans le livre de la vie.
Depuis octobre 2023, les jours redoutables sont restés figés dans le temps.
Et depuis mi‐janvier 2025, alors qu’Israël a enfin signé avec le Hamas un accord cessez le feu contre une libération tant attendue de ses otages, nous voilà entrés dans une autre période suspendue hors du temps, d’autres jours autrement redoutables.
Les captifs seront rendus au compte‐gouttes. Qui vivant et qui dans un sac. Qui, quand et comment. Qui dans quel état, visible ou invisible. Qui, et même si.
Et on paie tout cela au prix fort : contre la libération des otages israéliens enlevés lors du pogrom du 7 octobre, la remise en liberté d’un millier de prisonniers palestiniens condamnés pour terrorisme. On est bien entrés dans six semaines redoutables.
Lire les textes des première semaine : Dimanche 19 janvier, 6h30 du matin, on attend, Vendredi 24 janvier: le temps arrêté, Vendredi 31 janvier: les arbres et l’attente, Vendredi 7 février: Les hommes sont revenus, on attend les hommes, Vendredi 14 février : Les revenants, Vendredi 21 février : Au moins
Sur le même sujet, lire le « Journal photo de l’attente » de Sarah Ohayon
Dernière salve de cette première phase de récupération de nos otages.
Depuis six semaines, on a vécu, semaine après semaine, de manière de plus en plus pénible, la libération au compte‐gouttes de chacun de nos précieux otages – j’allais dire de chacune de nos précieuses vies, mais non. On a récupéré des otages vivants et morts, en échange de centaines de prisonniers palestiniens condamnés pour terrorisme.
Petit à petit, de manière insidieuse et inéluctable, les retrouvailles se sont mêlées aux adieux. Après les jeunes filles gracieuses de vie qui se jetaient dans les bras de leurs parents, on a récupéré des hommes faméliques dont certains rentraient seuls, la tête basse, parce qu’on venait de le leur dire.
On venait de leur dire pour leur femme, comme pour Or Levi, avant qu’il n’aille récupérer son petit garçon de trois ans qui venait de passer la moitié de sa courte vie privé de ses parents.
On venait de leur dire pour leur femme et leurs enfants, comme pour Eli Sharabi, qui a perdu les quatre êtres qui peuplaient sa maison d’un coup.
On ne leur avait toujours rien dit, comme pour Yarden Bibas, qui, jusqu’à la semaine dernière, attendait toujours la confirmation du sort de ses trois rouquins, sa femme et les deux petits poussins.
La semaine dernière, on a récupéré les corps.
Enfin, pour le corps de Shiri, il a fallu attendre encore. Il avait été substitué à un autre dans son cercueil. Il avait fallu réclamer le bon cadavre.
Ce mercredi, ils ont été enterrés.
Au‐delà de la tristesse, j’ai ressenti un soulagement. C’est fini.
Et cette semaine, dans la nuit de mercredi à jeudi, pour ce dernier mouvement de la première phase de l’accord, on n’a récupéré que des morts.
Je suis assise sur mon coussin de méditation posé sur un tapis de Jérusalem, accoudée, lasse à la table basse qui me sert de bureau japonais le soir de Rosh Hodesh Adar et je n’ai plus rien à donner.
Je me souviens du temps où j’ai découvert la poésie de Francis Ponge.
J’avais quinze ans.
Il disait que son ambition pour la poésie était simplement de décrire ce qui était.
De ne rien ajouter de superflu, afin de laisser la réalité s’exprimer par elle‐même.
Le poète choisissait pour toute œuvre de faire de son mieux pour s’effacer derrière la description la plus sèche, la plus sobre, la plus fidèle, de la vie.
La vie, disait‐il, se suffisait à elle‐même.
Plus loin encore que Ponge, Yves Klein avait tâché de s’effacer en tant qu’artiste en supprimant même le pinceau. Son ambition était de laisser le feu, l’or, ou la couleur vive du bleu, s’exprimer d’eux-mêmes et créer un Art dont seuls eux connaissaient les desseins.
Alors que les réseaux s’agitent, je ne peux que laisser les faits s’exprimer d’eux-même.
Cette semaine, on a été réunis avec des morts.
Aurevoir les enfants
Mercredi 26 février.
Le ciel aujourd’hui est bleu Klein , et tout le pays est en deuil.
Voilà presque le premier ciel bleu depuis des jours gris et pluvieux qui ont semblé des éternités, ici en Israël où le ciel ne pleure jamais.
Dans la terre d’Avraham, d’Itzhak et de Yaakov, le ciel est bleu presque toute l’année, “comme la couleur du trône céleste”, nous dit le Talmud.
Et aujourd’hui après des jours d’orage, le voilà revenu à son azur limpide, comme si Dieu avait nettoyé sa chaise afin de se préparer à mieux les accueillir. Enfin.
Cela fait 16 mois qu’ils sont partis, un an et demi d’incertitude. Maintenant au moins, plus d’agonie de l’attente. Maintenant on peut simplement pleurer.
Je pense à ce que l’on a dit il y a tout juste dix ans à Bethany Haines, à propos de son père.
“Maintenant ils ne pourront plus lui faire de mal.”
C’est ainsi que l’on avait annoncé à la fille de David Haines, un bénévole international enlevé en en 2013 avant d’être décapité en live, à genoux dans le désert syrien, après un an de torture, que son père ne reviendrait pas.
Maintenant, on ne pourra plus leur faire de mal. Ni à Shiri, ni aux deux petits, ni à Tsahi, Yitzhik, Ohad et Shlomo.
Cette semaine, Bethany témoignait au procès de deux de ses geôliers présumés, deux Français musulmans membres de Daesh.
Maintenant elle n’attend plus. Elle fait justice.
De l’autre côté de la Méditerranée, le temps était aux pleurs. De manière informelle, mais spontanée, et évidente, “ tout le pays est en deuil”, comme l’a fait remarquer le président Herzog dans son adresse à la famille Bibas avant l’enterrement.
Les réseaux sociaux juifs aussi étaient en deuil. Floraison de dessins avec cœur orange brisé, drapeaux oranges, image d’une maman poule et ses deux petits rouquins, ballons oranges dans le ciel, drapeaux israéliens qui pleurent.
Le soir même, on pouvait voir d’immenses rassemblements aux ballons oranges libérés dans le ciel, à Paris ou à Buenos Aires, et la foule qui chantait, tout simplement, haikva, l’espoir.
Alors pour ce jour‐là, Dieu avait bien préparé la scène. Après la pluie et le clin d’œil de l’arc-en-ciel, le jour où les petits corps avaient été rendus, pour leur mise en terre, il avait préparé un bleu sans faille, comme s’il nous faisait la grâce de préparer la scène pour la couleur qu’on allait y ajouter.
Ceux qui ont pris des cours de peinture se souviendront peut‐être avec moi de ces règles aussi précises que des notes de musique, les fameux couples de “couleurs complémentaires” qui forment à deux celle qui les englobe toutes : le marron de la terre.
Oui pour leur jour où on allait les descendre dans celle qui les avait vu naître, voilà que là‐haut dans le cyan du ciel, les ballons libérés peignait l’harmonie parfaite en miroir à la terre froide et humide de l’hiver, les bulles d’air recouverte d’une fine pellicule de plastique orange dansaient dans la brise de l’azur en mémoire des petis rouquins devenus anges.
L’enterrement lui‐même était privé, même si les discours de Yarden, de sa sœur et de celle de Shiri ont été diffusés partout car, au fond, ils étaient un peu devenus notre famille.
Alors ce jour‐là, dans les rues du petit pays et du monde, pour dire un dernier au revoir à leurs enfants, les enfants d’Israël étaient dehors.
Sur le passage du cortège funèbre, des dizaines de milliers d’êtres se tenaient debout, au bord des autoroutes et aux carrefours, dans les rues de leurs villes ou sur les ponts, portant dans leurs mains photos et drapeaux, et ballons du dernier adieu, pour saluer les morts une dernière fois.
Plus tard dans l’après-midi, sur mon chemin à vélo vers la bibliothèque nationale, j’ai roulé à côté d’une ficelle dorée et d’un bout de plastique déchiré, orange pétant, écrasé sur le sol.
Yarden, t‑shirt noir déchiré par la kriya, kippa orange, tenant ses feuilles devant le pupitre jonché de fleurs oranges, a parlé à chacun de ses aimés, vite, la voix tremblante.
Il a dit à sa femme, comme si elle était là, comme si elle pouvait l’entendre : “Tu n’as jamais été si proche depuis le 7 octobre et pourtant je ne peux pas te prendre dans mes bras.”
Dans une phrase simple, il a dit le fait de la mort : ils sont là, ils ne sont pas là.
Reconnaissance de ce fait absolu qui défie tout désir qu’il en soit autrement.
Et reconnaissance de notre impuissance ultime : les corps morts et les corps vivants ne peuvent se toucher.
C’est là l’une des lois essentielles du judaïsme : il y a deux choses, par essence, que l’on ne peut mélanger, la vie et la mort.
Chacune a donné lieu à son équivalent dans le monde spirituel : tahara, la pureté, qui symbolise la vie, et toumah, l’impureté, qui symbolise la mort, forment les deux pôles opposés de l’existence humaine qui s’étire entre eux dans toutes ses nuances.
Mais ces deux pôles‐là ne sauraient se toucher.
C’est pourquoi quiconque revient d’un contact avec un mort, quiconque sort d’un cimetière, doit se livrer à l’ablution rituelle des mains, afin de se laver symboliquement de l’état d’“impureté”, contracté par la proximité avec la mort, corrélatif à une distanciation d’avec la vie, et de revenir, grâce à l’immersion dans l’eau vive symbolisant la vie, vers ce monde‐ci, celui auquel on est inéluctablement attachés tant qu’on est là : le royaume des vivants.
Oui le verdict est inexorable : Yarden est vivant et sa tête appartient à la surface de la terre, où il doit continuer, qu’il le veuille ou non, à respirer.
Sa femme et ses enfants doivent maintenant être recouverts de terre, car ils ne respirent plus depuis longtemps, et leur place n’est plus à la surface de notre existence.
Quiconque a mis un proche en terre a connu ce sentiment d’impuissance ultime : la séparation par excellence. Ils appartiennent désormais au monde d’en-deça, au monde intouchable.
Ils ne sont désormais plus qu’une présence convocable dans les tréfonds du cœur, une présence que Yarden a demandé à sa femme morte, pour l’aider à traverser cela, et à vivre après elle, une présence que la mère de Hersh a demandé à son fils “enfin libre”, libéré de la captivité par les balles qui l’ont achevé, il y a quelque mois. Le vivant demande au mort, désormais libéré dans l’azur, de l’aider à traverser le chemin du deuil.
Bientôt on fera cela pour Shlomo et Ohad, pour Tzakhi et Yitzhik, qui nous sont revenus discrètement dans la nuit qui a suivi l’enterrement.
En attendant, mercredi, tout Israël était debout sur les routes, comme le pays l’avait été la semaine dernière, acclamant de joie aux portes de l’hôpital où on emmenait Eliyah et Omer, le retour de ses enfants.
Dans la réjouissance comme dans le deuil, Israël accompagne ses enfants, qu’ils soient bébés ou qu’ils soient grand‐pères.
Cette semaine on a entendu Yocheved Lifshitz, la bouche rigide de souffrance, qui a exprimé de nouveau devant le cercueil de son mari le sentiment de trahison qu’elle ressentait vis‐à‐vis de ceux qu’elle avait dédié sa vie à aider et qui avaient fini par assassiner son mari.
Et puis il y a ce qu’on a fait aux petits.
Ce qu’on leur a fait
Le jour de la cérémonie de remise des cercueils, la grande affiche de cinéma du Hamas accusait Nétanyahou et “son armée sionniste” d’avoir tué Shiri Bibas et ses fils dans une frappe aérienne – ce qui aurait été, quoique triste, un inévitable fait de guerre, et l’un de ceux recherchés précisément par la stratégie du Hamas.
Pourtant ce n’est pas ainsi qu’ils sont partis.
Ce que l’on a fait aux petits Bibas, tout le monde le sait maintenant.
L’expertise a établi que les petits ont été étranglés à mains nues, puis leur corps abîmé de manières dont on nous a épargné la description, comme s’ils étaient morts dans une explosion, afin de masquer la manière réelle dont ils sont morts.
Tout le monde le sait, sauf ceux qui se contentent, comme certaines journalistes françaises, de “ne faire que répéter ce que dit le Hamas”.
La réplique était sortie naturellement, sur une chaîne de radio la semaine dernière, comme s’il y avait un quelconque bon sens à reprendre à son compte les déclarations d’une organisation terroriste dont un tiers de l’action est la propagande et le mensonge, un tiers l’usage de boucliers humains, et un tiers les massacres.
Le Hamas mentirait‐il ?
Passons sur le fait qu’ils ont prétendu que, le Coran interdisant le viol, il n’y a pas eu de viols le 7 octobre.
Qu’ils se déguisent en civils pour mieux attaquer les soldats de Tsahal, et ainsi ajouter le nombre de morts de leurs combattants au nombre de “civils” gazaouis tués.
Qu’ils ont prétendu “n’avoir jamais eu l’intention de tuer de civils” – comme le prétendra ce porte‐parole du Hamas l’hiver dernier lors d’une interview sur une chaîne de télévision anglaise et qu’il s’agissait simplement de “complications” lors de leur opération militaire.
- Mais vous êtes rentrés dans les maisons des gens, avait tenté de lui opposer le journaliste, perplexe.
À la suite de quoi Ghazi Hamad, faute de savoir quoi répondre, avait simplement enlevé son micro et, l’air mécontent, quitté le plateau.
Passons sur le fait que nombre d’images diffusées sur les réseaux pro‐Hamas sont fabriquées par l’IA ou Photoshop.
Comme cette image que j’ai vue la semaine dernière, tellement mal faite : ils ont essayé de reprendre à leur compte le principe des terribles photos d’avant-après la libération de nos otages publiées depuis quelques semaines sur les comptes Instagram tenus par des personnalités juives.
Sauf que leur photo criait le Photoshop et l’image virtuelle, le visage squelettique créé par effet spécial était non seulement trop exagéré, mais les raccords avec le visage de l’homme était mal fait. C’était tellement mal fait que cela me faisait presque de la peine pour eux.
Je vois passer désormais ce genre de délicatesses parce que ma page Facebook professionnelle se fait désormais harceler par des post de propagande pro‐Hamas.
Le temps de les bloquer les uns après les autres, au moins cela me donne l’occasion de voir les outils de leur propagande.
J’ai vu passer un extrait d’interview d’Eli Sharabi qui circule depuis ce matin sur les réseaux israéliens.
Eli est revenu sans son frère, sa femme et ses trois filles.
Avec je ne sais combien de kilos en moins et un visage devenu méconnaissable d’amaigrissement et d’épouvante imprimée, ce Sépharade hier bon vivant est devenu l’une des images les plus éloquentes de la souffrance que les otages ont traversée.
Je l’ai simplement entendu dire “Ils m’ont cassé les côtes mais je m’en foutais. Je voulais juste un autre bout de pita”.
“Ouvrir un réfrigérateur… dit‐il à la journaliste ; et sa voix se fige dans un pleur réprimé…
Tout le monde devait comprendre ce que cela signifie de pouvoir ouvrir un réfrigérateur, et de prendre ce que tu veux. Un fruit, un œuf, un bout de pain…
Un geste d’homme libre.”
Entendre Eli dans cet extrait m’a rappelé les récits de survivants de la Shoah comme Elie Wiesel ou Viktor Frankel. À la fin, on n’a plus d’émotions. On ne pense plus au père en train de mourir ou à l’époux assassiné. On pense au prochain bout de pain qu’on espère encore obtenir, on le fantasme en boucle, pour soulager un peu la torture de la faim.
La propagande
Plus que la concurrence des victimes, au cœur de leur propagande, c’est le geste systématique de retourner contre Israël ce qu’ils lui font.
La charte du Hamas déclare avoir pour but la destruction de l’État des Juifs et le meurtre de tout Israélien. Mais c’est Israël qui serait coupable de “génocide”.
Le Hamas discrimine et oppresse tout ce qui n’est pas Hamas, de sorte que ses opposants sont éliminés, en prison, ou exilés. Mais c’est Israël, dont la population arabe jouit des mêmes droits et devoirs que les Juifs, étudie avec eux, reçoit le chômage et l’assurance maladie avec eux, peut se présenter et être élue à la Knesset, qui serait un État d’Apartheid.
Le Hamas veut coloniser, au‐delà du Moyen Orient, le monde, afin d’y imposer un État islamiste radical global, mais c’est Israël, le peuple de retour après deux mille ans d’exil dans la terre qui porte son nom, qui serait le colonisateur.
Et les populations du monde entier gobent les mensonges et les incongruités avec une conviction qui me confond.
Le Hamas lance des grands mots et les Occidentaux au grand cœur les reprennent en chœur.
C’est là que réside la puissance de la propagande.
Peu importe son rapport à la réalité.
Peu importe que les accusations n’aient aucun fondement.
Importe que l’accusation s’enflamme.
Importe que les mots suscitent l’émotion.
Importe qu’on ait envie d’y croire.
Le Hamas avait diffusé une mise en scène de Danielle Gilboa “morte” en captivité sous les bombes israéliennes. Elle est sortie il y a trois semaines bien vivante.
Le Hamas a remplacé le corps de Shiri Bibas par un autre (visiblement ils savaient très bien où elle était, puisqu’il l’ont rendue le lendemain).
Faut‐il autre chose pour donner à penser à une journaliste, dont le métier est de s’informer pour informer le public, que la parole du Hamas devrait être prise avec une certaine distance critique ?
La cause de l’objectivité semble perdue chez beaucoup.
La journaliste française choisit d’interroger les faits déclarés par l’expertise médico‐légale d’une institution qui, contrairement au règne du mensonge qui caractérise toute organisation totalitaire terroriste, se soumet aux règles de droit, se contente d’affirmer à l’autorité de son micro “je ne fais que répéter ce que dit le Hamas.”
Sans crainte du ridicule.
Le lendemain du 11 septembre, cette dame pleine de scrupules professionnels aurait‐elle entendu ne faire que “répéter ce que dit Al‐Qaïda?”
Je ne sais si ce qui m’inquiète le plus serait sa sincérité, qui témoignerait d’un niveau d’ignorance assez problématique, ou la mauvaise foi caractéristique de ceux qui sont tombés dans la propagande du Hamas tout en prétendant travailler sous couvert d’impartialité.
Oui le temps est celui d’une grande désillusion quant aux institutions qui encadraient jusqu’à présent nos valeurs : l’ONU et l’UNICEF, les médias et la Croix‐Rouge.
La Croix‐Rouge, dont la raison d’être, en temps de guerre, est de protéger les civils, n’est jamais allée voir les otages israéliens, n’a pas délivré de médicaments.
L’organisation s’est contentée d’être là pour la sortie des rescapés et des cercueils – au point que le groupe satirique israélien eretz nehederet en a fait un sketch, comparant la Croix‐Rouge à Uber, un service de taxi n’ayant été utile que quelques minutes dans les quinze mois de captivité des otages, le temps de les récupérer des mains de Hamas et de les transférer à Tsahal.
Et voilà qu’une bénévole de la Croix‐Rouge est allée la semaine dernière critiquer la fille d’une amie, une jeune en plein service militaire dont la tâche était de distribuer du savon aux prisonniers palestiniens libérés, la critiquer sur le fait que lesdits savons étaient trop petits.
“Et toi, ils étaient comment les savons que tu es allée apporter à nos otages?”, lui a rétorqué la jeune fille.
Et puis dans la nuit, sans fête foraine macabre cette fois, on a reçu quatre autres cercueils.
Shlomo est revenu, le survivant du pogrom de Farhoud dans son Irak natal en 1941.
Je le précise, car j’apprends avec stupéfaction que le message qui circule chez les populations musulmanes du monde entier, et même chez les Blancs éduqués des grandes villes occidentales, en ce moment, c’est que les Israéliens seraient des Blancs venus d’Europe pour coloniser le petit pays du Moyen‐Orient.
Quid de l’Histoire multimillénaire dans la terre de ses ancêtres, où l’on trouve à chaque coin de cyprès un mikvé (bain rituel juif) datant de l’époque romaine – bien avant que l’Islam n’apparaisse ?
Quid des milliers de Juifs d’Égypte, du Yémen, de Syrie, d’Iran, d’Irak et du Liban, en plus de ceux que l’on connaît peut‐être davantage en France, du Maroc, d’Algérie ou de Tunisie, qui ont dû tout quitter du jour au lendemain pour sauver leur vie ?
Dans le monde des idéologies, peu importe le réel.
À chaque retour d’otages, les réseaux sociaux s’agitent.
Commentaires malveillants et détournement des faits chez les pro‐Hamas, indignation et tentatives de rétablissement des faits chez les Juifs.
“Rien de nouveau sous le soleil”, vient me chuchoter Kohelet c’est la triste danse de l’antisémitisme depuis la nuit des temps. Hier, c’étaient les pains azymes fabriqués à base de sang de petits enfants chrétiens ; aujourd’hui c’est la terminologie humanitaire qui est détournée – ces choses‐là même que les peuples ont faites aux Juifs il y a quatre‐vingt ans.
Quelqu’un me faisait remarquer que, comme dans toute dynamique projectionnelle, les accusations portées à Israël reflètent les fautes de celui qui pointe le doigt : chez les Européens et les Américains, le colonialisme, le nettoyage ethnique ; en Afrique du Sud, l’apartheid ; dans les pays multi‐ethniques, comme au Rwanda, les Européens aujourd’hui bien‐pensants qui tentente de se redonner bonne conscience avec ce qu’ils ont fait à un continent, le génocide.
Nathan Sharansky, le plus célèbre refuznik juif russe, avait survécu à neuf ans dans les prisons russes, dont une bonne partie en confinement solitaire. Il avait été emprisonné, parce qu’il avait voulu vivre sur la terre de ses ancêtres, a analysé depuis l’antisémitisme contemporain et la nouvelle forme qu’il prend : l’antisionnisme.
Il rappelle que cette idéologie est fondée sur ce qu’il appelle les trois D : délégitimation (du droit de retour du peuple juif diasporique sur la terre de ses ancêtres), démonisation (de l’État d’Israël, à l’aide notamment des gros mots cités précédemment), et double standard : juger l’État des Juifs, ce qu’il fait et ce qu’on lui fait, à partir de standards complètement différents de ceux que l’on applique aux autres peuples.
Ainsi, alors que certains féministes s’époumonent à crier au moindre scandale, silence radio sur les crimes de guerre sexuels perpétrés en Israël le 7 octobre, dont une partie a été documentée par le Hamas lui‐même, non content de violer jeunes, vieilles et enfants, mais aussi vivantes et mortes, se filmant et diffusant leurs exploits sur les réseaux et des fils Telegram désormais supprimés – ça n’allait pas trop avec l’image de héros de la “résistance légitime”.
Shlomo est revenu à sa femme, ses cinq enfants et ses douze petits‐enfants dans une caisse en bois.
Avec lui, les dépouilles d’Ohad, Tsachiet, Itzhik, morts depuis longtemps.
Le regard forcé
Je pense à Eitan, le fils d’Ohad.
Eitan avait douze ans quand il a été enlevé avec son père le 7 octobre
Il est revenu après 52 jours de captivité – à l’époque on comptait les jours. Cinquante‐deux, cela nous avait semblé alors énorme, insupportable. On ne pouvait pas croire que cela faisait plus d’un mois. Aujourd’hui, cela fait plus d’un an. On est à 511.
Et puis on sait, de la part de ceux qui sont revenus, comment les otages encore vivants sont traités.
Eitan a été détenu tout seul pendant deux semaines avant de rejoindre les autres otages.
Je le vois devant la caméra de l’intervieweuse invisible, le petit tout fin et gracile avant la mue, quelque temps après sa libération. Elle sait ce qu’ils lui ont fait.
- Ils t’ont fait regarder des films?
- Oui.
- Des films de quoi?
- Des films du 7 octobre.
- Et on y voit quoi?
Le regard se dérobe. Les mots sont économes.
- Comment ils tuent les gens.
À une autre intervieweuse qui lui demande s’il a détourné les yeux :
- Non, ils ne me laissaient pas. Silence.
Mais de toute façon, j’ai vu pire en vrai.
Yael, la fille de Tsachi, a aussi vu des gens mourir en vrai. Elle a vu sa sœur se prendre une balle et tomber, avant que les hommes armés n’entrent dans l’abri et les forcent à se serrer par terre dans un coin de la cuisine, avant de prendre le père en otage.
Sur une photo que l’on voit partout en ce moment sur les réseaux sociaux, on voit Tsachi, les mains pleines du sang de Maayane, son aînée, qui serre dans ses bras le petit frère qui pleure et crie “elle va revenir, elle va revenir?”
On a cette photo parce qu’on a la vidéo entière de la scène.
On a la vidéo entière de la scène, parce que les guerriers de ce qu’une députée européenne vient de qualifier à nouveau de “résistance légitime”, ont ajouté le carnage des images au massacre des corps : la diffusion vidéo de leurs exploits a été en partie partagée sur les réseaux sociaux de leurs victimes.
Ils ont donc pris le téléphone de la mère de Yael et ont diffusé sur sa page Facebook ce qu’ils étaient en train de faire à sa famille.
Avant‐hier, Tzachi est enfin revenu. Dans un cercueil.
Shabbat dernier, il y a eu une mise en scène d’un goût similaire.
Deux otages encore en captivité ont été emmenés sans qu’on les prévienne, dans une voiture toute neuve aux vitres teintées, à quelques mètres de l’estrade sur laquelle on libérait Eliya Cohen, Tal Shoham, Omer Shem Tov, Omer Wenkert.
Soudain la porte s’ouvre, et les deux maigres et blêmes, crâne rasé et sweat shirt marron, regardent avec stupéfaction la cérémonie
- Non, c'est Omer? C’est Omer!
Ils se cachent la tête entre les mains, étouffent un sanglot.
La voix du geôlier invisible qui les filme prend le ton faussement innocent du journaliste intéressé. Il leur demande dans un hébreu mélodieux d’accent arabe, d’une voix presque douce : “Comment tu te sens, maintenant?”
“Qu’est ce que tu voudrais?”
Et les deux jeunes de simplement supplier. Les mains jointes :
“S’il vous plaît, libérez-nous. On veut simplement rentrer à la maison. On veut juste rentrer à la maison.”
La scène interminable, que je me suis empressée de couper, et que les réseaux du monde entier se sont empressés de diffuser.
Les nôtres, avec indignation et ceux d’en-face, avec des commentaires qui estomaquent autant que tout ce que l’on entend dans les discours antisémites
“Ils ont l’air d’être confortablement installés. Regarde, ils sont bien traités, ils peuvent parler librement.”
Je vais épargner la force de mes doigts, et le respect à votre égard, en me gardant de commenter de tels commentaires.
Oui, le Hamas pratique, sous toutes ses formes, la torture psychologique, en forçant chacun à regarder ce qui fait le plus mal.
Mais c’est sans compter la force intérieure de l’homme, que personne ne peut lui prendre.
Et une partie de cette force se tient dans notre capacité à choisir notre regard.
Superhéros
Idan Amedi a choisi le sien.
Ces dernières semaines il est remonté sur scène.
Pour la première fois depuis sa blessure de guerre, il a recommencé une tournée.
Idan est une célébrité en Israël, un chanteur populaire et l’un des acteurs de la série Fauda.
Mais comme tous les Israéliens, il va se battre quand il faut défendre le pays.
Il aurait pu facilement se dérober aux “milouim” [la réserve], il y est allé. Une explosion accidentelle le 8 janvier 2023 à Gaza avait causé la mort de six de son unité, dont certains avec qui il faisait fidèlement équipe depuis la post‐adolescence, depuis le service militaire.
On n’imagine pas les fraternités que cela construit. Il avait été récupéré en lambeaux, le visage déchiqueté par des éclats, le corps en bouillie, méconnaissable au point qu’on lui avait mis l’étiquette “Ploni”, “untel”, avant de le monter dans l’hélicoptère qui l’amènerait à l’hôpital.
Je me souviens du jour où la nouvelle était passée comme une traînée de poudre – “dites des tehilim pour Idan Amedi, il est à l’hôpital entre la vie et la mort”.
Idan a survécu.
Avant de chanter, lors de son premier passage sur scène, ému, il enlève sa casquette puis la remet, et d’une voix qui se brise au milieu, il récite la prière “shehekhianou”: la prière que l’on dit après avoir acquis quelque chose de neuf, retrouvé quelqu’un qu’on n’a pas vu depuis longtemps, mangé un premier fruit de la nouvelle saison, ou célébré un nouveau cycle d’une fête juive, la prière avec laquelle on se rappelle que l’on ne prend pas pour acquis le fait d’être en vie, ni d’être resté en vie :
בָּרוּךְ אַתָּה, יְיָ אֱלֹהֵינוּ, מֶלֶךְ הָעוֹלָם, שֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ וְהִגִּיעָנוּ לַזְּמַן הַזֶּה.
Béni sois-Tu, Éternel notre Dieu, Roi de l'univers,
qui nous as fait vivre,
Et nous as soutenus
et nous as amenés jusqu’à ce moment.
Il dit la prière au singulier, et sa voix se brise un instant, lorsqu’il dit “qui m’a mis en vie”.
Il comprend maintenant différemment le sens de la prière. La chance incroyable d’être en vie. Ses amis sont morts et il est resté vivant. Et il a écrit de nouvelles chansons.
L’une d’elles s’appelle “Superman”.
Il la chante sur scène, avec derrière lui sur l’écran, les images en gros plan de ce à quoi il ressemblait il y a un an : un blessé en chemise de nuit d’hôpital, le regard défiguré, incapable de lever le bras, en train de se brosser les dents comme il peut, en pleine rééducation pour chaque geste, l’image de la vulnérabilité ultime.
Et il chante :
“Et après ma blessure,
Il y a eu des nuits où j’ai hurlé du fond de ma poitrine,
J’ai commencé à négocier avec Dieu :
‘Si Tu me donnes ça, Je Te donnerai ceci.’
Mais au fond de mon cœur, Brisé et pourtant entier,
Je n’avais plus aucun doute:
Ce n’est plus la mort qui me fait peur,
C’est de ne pas vivre.”
Oui, on est un peuple de super héros.
C’est ce que chante Omri Glickman du groupe israélien bien nommé “Hatikva” – l’espoir, dans cette chanson que j’écoute en boucle ces dernières semaines.
C’est ma copine Shiraz qui me l’avait envoyée, me disant “ma fille danse là-dessus”.
Moi aussi, je danse dans mon cœur, sur mon vélo, lorsque je l’écoute décrire ce que tout le monde vit ici. Lisez les mots qui suivent en écoutant la musique et, peut‐être, en dansant avec moi :
Alors le professeur de Torah est (enrôlé) dans Givati (une unité d’élite)
Le professeur de langue est dans Modiin (le renseignement),
Le voisin d’en-haut est entrepreneur en travaux, mais il est en milouim depuis un mois.
L’avocate est officier de communication,
Elle fait des gardes dans la division.
Son frère, un cadre supérieur dans la high-tech,
Il est maintenant sniper sur les toits de la bande de Gaza.
La directrice un peu stricte de l’agence bancaire
Est commandante en second en Judée-Samarie.
Doron, le propriétaire d’un magasin de jouets,
Est maintenant commandant de compagnie dans les blindés.
Et notre Amadi, notre chéri,
Qui d’habitude chante à Césarée, [ici il cite Idan Amedi]
Est un combattant du génie qui se remet courageusement
Après avoir été blessé au cœur de Gaza.
C’est vrai, ici tout le monde a l’air ordinaire, mais...
Nous sommes un peuple de superhéros.
En derrière chacun se cache toujours un soldat,
Prêt à sauver le monde.
[...]
Et peu importe si c’est en plein milieu de la vie
Ou en plein match de foot,
Tous laisseront tout tomber en une seconde
Si l’appel du drapeau retentit.
Ici, ce n’est pas un univers parallèle,
Ni un monde sorti de Marvel,
C’est notre histoire – le peuple d’Israël.
Cette semaine, Elyah Cohen, l’un des otages libéré à shabbat dernier, a posté sur Instagram un selfie de lui embrassant sa petite copine. Il écrit en légende :
"Sur cette photo ici, vous pouvez voir quelqu’un de fort.
Quelqu’un dont l’histoire est tout simplement un miracle.
Quelqu’un qui a tout perdu en plein jour et qui, pourtant, s’est relevé chaque matin, choisissant de se battre même quand tout semblait perdu, comme de la science-fiction, impossible et insensée.
Quelqu’un de patient, puissant et déterminé, avec du feu dans les yeux, qui n’a pas perdu espoir, parce que perdre espoir, ça n’existe pas.
Ah... et moi aussi, je suis sur la photo."
Il parlait de celle qui a survécu au festival et qui l’a attendu chaque jour de sa captivité.La chérie d’Elyah avait choisi son regard.
Je choisis le mien chaque jour.
Ce matin, je le tourne vers le ciel.
Le regard choisi
Aujourd’hui, c’est vendredi matin, et le ciel azur est léger et plein des âmes que l’on a mises en terre cette semaine et ces derniers mois.
Le soleil qui m’éclaire sur cette terrasse de café brille des sourires des Bibas et de Hersh, de Tsachi, Ohad, Shlomo et Itzik, et de tous nos morts – qu’ils veillent sur nous et que leur neshama monte légère.
Aujourd’hui on est Rosh Hodesh Adar, le premier jour du mois de Adar.
Chaque mois, la “tête du mois” est un jour de fête pour les femmes. Traditionnellement, ce jour‐là, on ne fait pas de travail ménager, on se fait plaisir, l’amoureux offre un bijou pour la prochaine fête.
Je suis allée retrouver ma copine dans ce café qu’on adore, à mi‐chemin entre nos maisons, Casa Lavi sur Derekh Beit Lekehm, pour prendre un “matcha-le’haïm”, un thé avec toast “à la vie” comme elle l’a appelé.
Ce mois‐ci on célèbrera la fête de Pourim (littéralement “les sorts”), la fête pendant laquelle, selon le récit mythique du Rouleau d’Esther, les Juifs de Perse d’il y a plus d’un millénaire auraient déjoué les plans de ceux qui voulaient, une fois de plus, les annihiler, et ont renversé leur sort.
Comment ?
À l’image de Mordehai et de la Reine Esther, par courage, par solidarité et par dévouement au collectif.
Demain dans les synagogues, on lira la parasha Teroumah : J’en dis un mot ici.
La teroumah est la contribution volontaire que chacun, parmi les Bnei Israël, est invité, dans le récit biblique, à apporter, par “générosité de cœur”, afin de construire ensemble le mishkan (le “lieu de résidence”), un édifice portatif pour leurs pérégrinations dans le désert, destiné à accueillir la “présence divine” (shekhina).
Là se trouve l’un des traits fondamentaux de l’ethos juif : chacun compte, parce que chacun, à sa mesure, contribue.
Ce sont par les contributions singulières de chacun d’entre nous, chacun à sa manière, que l’on construit l’édifice collectif de notre conscience.
Pour certains d’entre vous, cela passe par l’écriture ; pour d’autres, par coller des affiches, inlassablement ; pour d’autres, par se réunir chaque semaine à Kikar Paris à Jérusalem, ou place du Trocadéro. Par mener des actions en Justice. Parler sur des plateaux télé. Poster sur les réseaux. Parler à l’ami d’hier, au collègue peu convaincu, à qui veut bien écouter. Dessiner, chanter, jouer, pleurer, envoyer de l’argent, prendre l’avion pour faire du bénévolat, consoler, vous tourner à nouveau vers la culture de vos pères, recommencer à faire le kiddoush le vendredi soir.
Comme la reine Esther, nous sommes tous appelés à être des superhéros.
Peu importe comment. Ou peut être si, n’importe comment.
L’une de mes nouvelles super‐héroïnes est belle, jeune, noire, amérindienne et juive. Noa Fay, une étudiante à Columbia, n’aurait peut‐être pas choisir de devenir une Reine de sa génération si, comme la reine Esther, les circonstances ne l’y avaient pas forcée.
Depuis le 7 octobre, les jeunes Juifs des campus américains, européens et australiens, doivent choisir entre fuir, se cacher, ou à assumer leur identité avec une nouvelle force.
Dans ce contexte lunaire que l’on ne pensait pas voir revenir si vite depuis la Shoah, Noa, comme un feu brillant de grâce et de clarté, est venue nous rappeler un message important :
Ce n’est pas la première fois, que les Juifs ont à se battre.
Et, on sait comment se gagne réellement une bataille:
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité; seule la lumière le peut.
La haine ne peut pas chasser la haine; seul l'amour le peut.
Ces mots, nous rappelle‐t‐elle, sont de Martin Luther King.
C’est aussi le message de plusieurs survivants de la Shoah que l’on voit passer sur les réseaux dernièrement. Ces vieillards pleins de vie s’adressent aux générations d’aujourd’hui avec l’une des choses les plus importantes qu’ils ont appris de leurs propres épreuves : il faut se protéger de la haine. La haine détruit de l’intérieur peut‐être plus sûrement que les épreuves infligées. Se battre et se défendre n’implique pas de sombrer dans la haine.
Au contraire, on se bat avec plus de force, quand ce n’est pas pour détruire les autres, mais pour défendre les nôtres, et nos valeurs.
On se bat avec plus de clarté quand ce n’est pas vers le thanatos, mais vers la vie.
C’est cela, choisir son regard.
Cette semaine, Or Levy est allé rendre visite aux parents de Hersh. Il l’avait rencontré dans l’abri où ils avaient été pris ensemble en otage, Hersh le bras tout juste arraché par une grenade. Il a raconté aux parents endeuillés que lorsqu’ il a retrouvé Hersh, mutilé mais vivant, dans les tunnels, celui‐ci avait partagé avec lui le mantra qui le tenait chaque jour, une sorte de version israélienne du message de Viktor Frankel : lorsque tu as un “pourquoi”, tu as un “comment”.
Avoir du sens nous aide à survivre.
Or a pris cela pour lui, et il a survécu en pensant fort à son fils, qui l’attendait.
Eli a donné sa première interview cette semaine à une journaliste israélienne.
Elle lui demande pourquoi il a accepté de lui parler.
Pour Alon Ohel, a‑t‐il répondu.
Il était avec Alon quand on l’a fait sortir. Alon s’est accroché à lui, avant de devoir le laisser partir, la mort dans l’âme.
Il lui a dit : “Je suis content pour toi”.
Eli lui a promis d’être heureux pour lui. Et de le faire sortir.
On les attend. Alon et tous les autres.