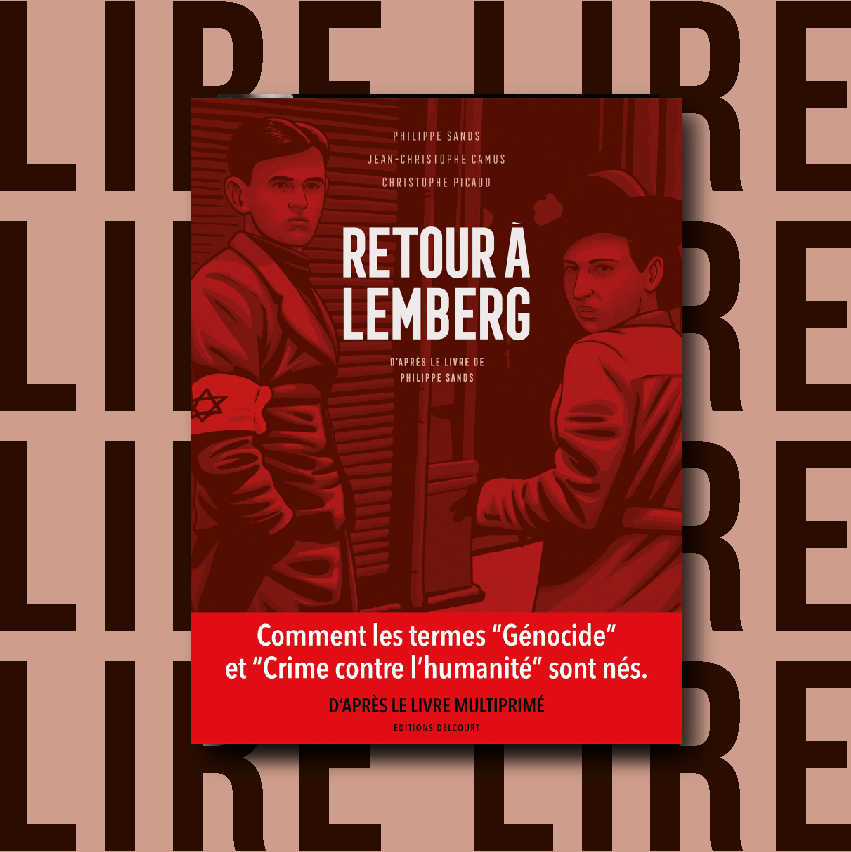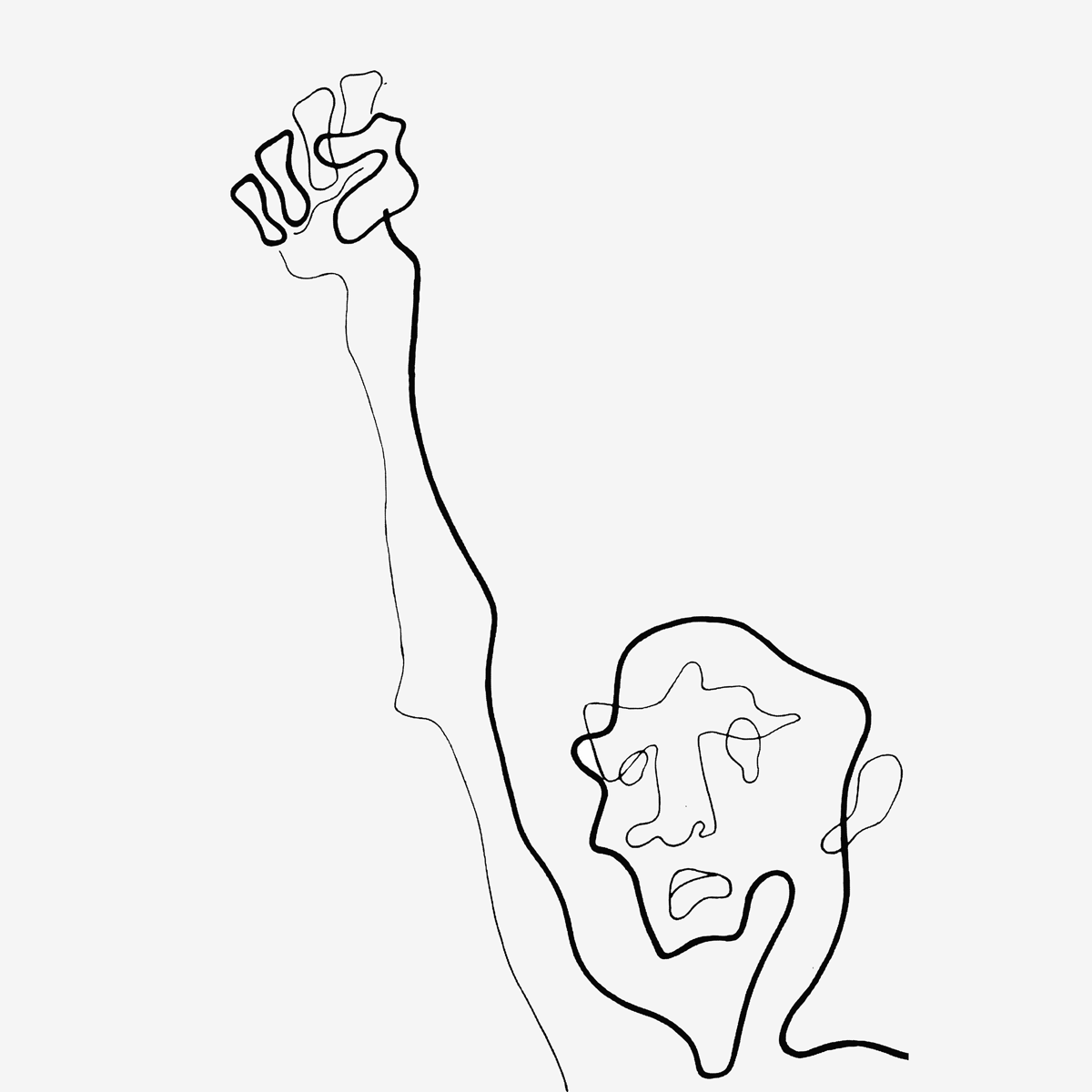Quel est votre premier souvenir cinématographique lié à la Shoah ?
Ophir Levy : Quand j’étais enfant, ma famille se réunissait religieusement autour du poste de télévision dès qu’une fiction ou un documentaire lié à l’histoire juive était diffusé. Il me semble que l’un de mes souvenirs les plus lointains, qui a marqué une vraie prise de conscience, est la mini‐série Holocauste, sortie en 1978 aux États‐Unis mais rediffusée à de nombreuses reprises. Des lois raciales de Nuremberg de 1935 jusqu’à la fin de la guerre, le téléspectateur y suivait sur dix années la persécution d’une famille juive allemande et, en parallèle, l’évolution d’un personnage sans envergure qui monte progressivement en grade dans la hiérarchie nazie. Du fait du succès planétaire de cette fiction, la mémoire de la Shoah est entrée de plain‐pied dans les foyers, dans les consciences et, plus globalement, dans l’espace public. Pour être tout à fait honnête, Holocauste est un mélo d’une piètre qualité cinématographique, mais par sa puissance d’identification, il apparaît rétrospectivement comme un moment d’initiation qui fut fondamental pour plusieurs générations, dont la mienne.
Et quelle réalisation récente vous a marqué ? La Zone d’Intérêt, La plus précieuse des marchandises, La vie devant moi, Voyage avec mon père, ou les récemment oscarisés A Real Pain et The Brutalist… Depuis un an, de nombreux films qui évoquent la Shoah sous différents aspects sont sortis en salle.
Je dirais La Chambre de Mariana [avec Mélanie Thierry, en salles depuis ce mercredi 23 avril], adapté du roman d’Aharon Appelfeld [publié en 2006]. Le film d’Emmanuel Finkiel parvient à traduire l’état d’attention extrême aux moindres sensations d’un garçon [juif, caché pour échapper à la déportation] pour qui le monde se réduit à ce qu’il en perçoit depuis un placard. Par le travail de l’écriture, Appelfeld donne a posteriori une forme langagière à ce qui, dans l’enfance, s’était inscrit confusément dans le corps. Le film restitue bien le point de vue entravé de l’enfant et c’est l’oreille qui guide le spectateur dans la perception des scènes.
Tout me bouleverse chez Appelfeld. Son timbre de voix, sa méditation si profonde sur le fait d’avoir dû renoncer à sa langue maternelle pour incorporer l’hébreu. Une langue maternelle, l’allemand qui, comme pour Paul Celan, était également celle des assassins de sa mère.
Quel regard portez-vous sur cette récente augmentation de productions de films sur la Shoah ? Est-elle comparable à de précédents « pics » dans l’histoire du septième art ?
Dès les années soixante, qui se sont ouvertes avec le procès Eichmann, on voit se multiplier les productions portant sur les crimes nazis et les camps de concentration. L’intérêt pour cette thématique ne cesse de croître pour culminer avec Holocauste et l’émergence dans les années quatre‐vingt (on pense bien sûr à Shoah de Claude Lanzmann en 1985) d’une grande vague dans laquelle nous sommes encore aujourd’hui.
Depuis cette époque, il y a à l’affiche chaque année au moins deux ou trois films liés à la Shoah. Au sein de cette grande vague, on peut observer des moments de « pics », comme c’est le cas aujourd’hui. Cette récente intensification peut s’expliquer par une sorte d’inquiétude au sujet de la possibilité de perpétuer une mémoire qui ne sera plus directement transmise par les contemporains de l’événement. Cette préoccupation conduit, de façon plus urgente qu’auparavant, à investir le cinéma comme un lieu où peut être accueilli ce besoin de raconter.
Une urgence notamment pour la troisième génération, celle des petits-enfants de survivants, comme les personnages du film A Real Pain. Traite-t-elle ce sujet d’une manière différente que ses prédécesseurs ?
Il y a d’abord eu au cinéma la génération de ceux qui ont survécu et qui ont raconté (Wanda Jakubowska, Marceline Loridan…). Puis celle de leurs enfants, qui ont réalisé de nombreux films dans lesquels ils interrogent leurs parents rescapés ou les accompagnent dans des voyages du souvenir. Par exemple, dans des documentaires israéliens comme Hugo (1989), du nom de cet ancien déporté interviewé par son fils Yaïr Lev, ou encore Pizza in Auschwitz (2007), qui suit le périple mémoriel d’un survivant qui tient absolument à raconter in situ l’histoire de sa déportation à ses deux enfants quadragénaires (et qui n’en peuvent plus de ces récits qui les hantent depuis leur plus jeune âge). La fiction récente Voyage avec mon père [réalisée par Julia von Heinz, avec Lena Dunham] se fonde sur un point de départ un peu similaire.
Depuis les années deux mille, on voit apparaître des œuvres réalisées par la troisième génération, qui montrent que la mémoire de la Shoah se transmet indirectement. Elle se manifeste sous diverses formes dans la vie quotidienne des personnages dont les souffrances ne semblent pas directement imputables à la Catastrophe. À la manière de sismographes, ces films mesurent le séisme et ses répliques sur plusieurs générations. Quelque chose des fêlures des personnages s’y révèle intimement lié aux traumatismes familiaux. Par exemple dans A Real Pain, qui se situe dans un lointain après‐coup. Comme si l’événement n’était pas tout à fait clos, qu’il continuait d’habiter le contemporain et de le structurer en profondeur. La Shoah constitue à la fois une référence à laquelle on pense sans cesse et un modèle noir qu’on ne veut pas voir se reproduire et contre lequel il faut se prémunir.
On entend souvent qu’il y a « trop » de films sur la Shoah…
Voire que l’on parle trop de la Shoah, de façon générale, on l’entend en effet.
Il est vrai que si l’on additionne tous les documentaires et les fictions qui, en salles et à la télévision, traitent du nazisme, de l’Occupation, de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, on constate que la production est gigantesque. Elle est quantitativement supérieure, et de loin, à celle concernant n’importe quel autre événement historique. Je suis d’ailleurs toujours frappé, en marchant dans les couloirs du métro, par la régularité avec laquelle je tombe sur le motif de la croix gammée que les concepteurs d’affiches de films prennent systématiquement le soin d’ajouter dans un coin de leur composition pour indiquer au passant qu’il s’agit bien d’une histoire qui se déroule sous le nazisme.
La vraie question est de savoir ce que l’on entend par « trop ». Cette rhétorique est ancienne et on a toujours déjà trop parlé du sort des Juifs. Au sens où l’expression d’une telle mémoire a toujours été suspectée d’être une revendication de particularisme. Comme si cette histoire ne pouvait se déployer qu’au détriment d’autres récits. Comme si, en somme, les Juifs continuaient d’exiger le bénéfice exclusif d’une sorte de privilège, même dans la souffrance.
Vous avez consacré votre doctorat d’histoire du cinéma à la persistance de la mémoire et des images de la déportation au sein des films contemporains, notamment dans des œuvres qui n’ont pas de lien avec la Seconde guerre mondiale, et vous avez alors observé, étudié, étudié un « magnétisme de la Shoah » au cinéma, selon votre expression. De quoi s’agit-il ?
J’ai pu observer que cette présence très forte, parfois obsédante, de la mémoire de la Shoah entraînait des phénomènes presque irrationnels, anhistoriques ou illégitimes de « vampirisation ». Elle vient s’immiscer dans des récits où elle n’a rien à faire. La puissance obsédante de la Shoah génère un « magnétisme » qui attire dans son giron des histoires n’ayant pourtant aucun rapport avec elle. La guerre des boutons, par exemple. Le roman de Louis Pergaud publié en 1912 raconte les rivalités entre des enfants de villages voisins. Lorsque les droits du livre tombent dans le domaine public, l’une de ses adaptations au cinéma situe l’action sous l’Occupation et introduit le personnage d’une petite fille juive que l’un des deux clans d’enfants décide de cacher. Finalement, les deux bandes se mettent d’accord sur l’importance d’aider la fillette juive. La Shoah – sa menace, mais sa mémoire aussi – est brandie comme le lien inévitable, le ciment nécessaire de toute citoyenneté, celui par lequel tout conflit pourrait être surmonté.
Dans nombre d’œuvres dont la Shoah n’était initialement pas l’objet, le recours à celle‐ci devient un « ingrédient » narratif commode, l’assurance à peu de frais d’offrir une plus‐value morale à son récit, d’en décupler la puissance émotionnelle.
Pour Claude Lanzmann, il ne fallait pas chercher à recréer les images qui manquent de ce qu’il s’était passé, dans les chambres à gaz, par exemple. À l’heure du négationnisme qui séduit un jeune public de plus en plus large sur les réseaux sociaux, sommes-nous obligés de répresenter dans la fiction ?
Il me semble assez vain de chercher à convaincre un négationniste puisque sa position ne se fonde pas sur un déficit de savoir, mais sur un profond désir de nier. On peut lui présenter toutes les preuves qu’on voudra ou l’emmener sur le site d’un ancien centre de mise à mort comme Sobibor, où 250.000 Juifs ont été assassinés, et lui rétorquera qu’il ne voit ici ni chambre à gaz, ni cadavre, ni installation homicide (les nazis ayant évidemment pris soin de tout démanteler).
Les négationnistes s’appuient aussi sur toutes les confusions, imprécisions ou erreurs qui furent diffusées lorsque le grand public a découvert l’existence du génocide et qu’on n’avait pas alors le recul historique pour en décrire la réalité avec la plus grande exactitude.
Lutter contre le négationnisme par les images me paraît compliqué et la fiction n’est pas d’un grand secours puisqu’elle est, par définition, une fabrication, une réinvention du réel qui n’a évidemment aucune valeur probante aux yeux d’un négationniste.
La question serait alors : la fiction peut-elle aider à lutter contre l’ignorance sur la Shoah, terreau favorable au discours négationnistes ? Comment intéresser des générations plus jeunes, qui n'ont pas été confrontées à l'événement ?
Non seulement elles n’y ont pas été confrontées, mais elles peuvent à peine se le représenter.
Toutefois, les mesures d’audiences montrent que l’intérêt pour les documentaires portant sur les crimes nazis est toujours aussi vif. Il s’agit souvent de films très didactiques, promettant des images inédites (ou colorisées pour la première fois, au détriment du respect de l’intégrité des archives), avec un commentaire lu par une voix grave et masculine qui cherche à susciter, à l’unisson avec la musique, un sentiment de tension permanente, l’impression d’une fatalité de l’histoire en train de s’accomplir sous nos yeux. Ainsi faut‐il absolument continuer à regarder puisque quelque chose de terrible est amené à se produire.
La fiction a, quant à elle, un pouvoir particulier, qui est de nous plonger dans la sensibilité et la psyché des personnages. Elle nous permet d’appréhender les questionnements, les hésitations, les peurs, en nous réinscrivant dans le temps de l’incertitude, où l’histoire n’est pas encore écrite. « Faut‐il ou non se déclarer ? Porter l’étoile jaune ? Se cacher ? » Mais jusqu’où est‐il supportable d’aller ? Souhaitons‐nous nous mettre dans les conditions psychologiques d’un déporté au seuil de la mort ? N’y aurait‐il pas là une forme d’obscénité, comme le dénonçait Claude Lanzmann ? Aujourd’hui, les films qui évoquent la Shoah tendent à se tenir à distance : on en parle depuis l’après-coup (The Brutalist), on adopte un point d’observation extérieur aux lieux d’assassinat (Le Zone d’intérêt) et, quand on se situe dans l’épicentre de la mort, on réduit la part visible au bénéfice d’une représentation sonore (Le Fils de Saul).
La fiction a cette capacité de rendre, pour un jeune public, intelligible ou du moins envisageable un monde lointain dans lequel la persécution des Juifs a pu avoir lieu. Elle tente de retrouver des manières de se tenir, de se vêtir ou de parler, des objets disparus, des paysages urbains, des codes sociaux. Elle offre aux jeunes spectateurs la reconstitution d’une époque où sont réunies les conditions de possibilité du pire : discours politiques, haine ordinaire, situation économique, basculement dans la guerre. Les films donnent l’illusion de voir un monde se déployer, de voir l’histoire s’incarner. Ils s’appuient en vérité sur la grande vertu du cinéma, qu’il soit documentaire ou fictionnel : celle d’offrir l’épiphanie d’un visage bouleversant, l’apparition d’un paysage, la présence d’une voix déchirante… Ce rapport du cinéma à l’étoffe sensible de l’Histoire, c’est ce que l’on peut, encore aujourd’hui, attendre de lui.
Propos recueillis par Myriam Baron
Ophir Levy est aussi l’auteur d’Images clandestines. Métamorphoses d’une mémoire visuelle des « camps » (Hermann, 2016). Il a récemment dirigé, avec Emmanuel Taïeb, Puissance politique des images (PUF, 2023).