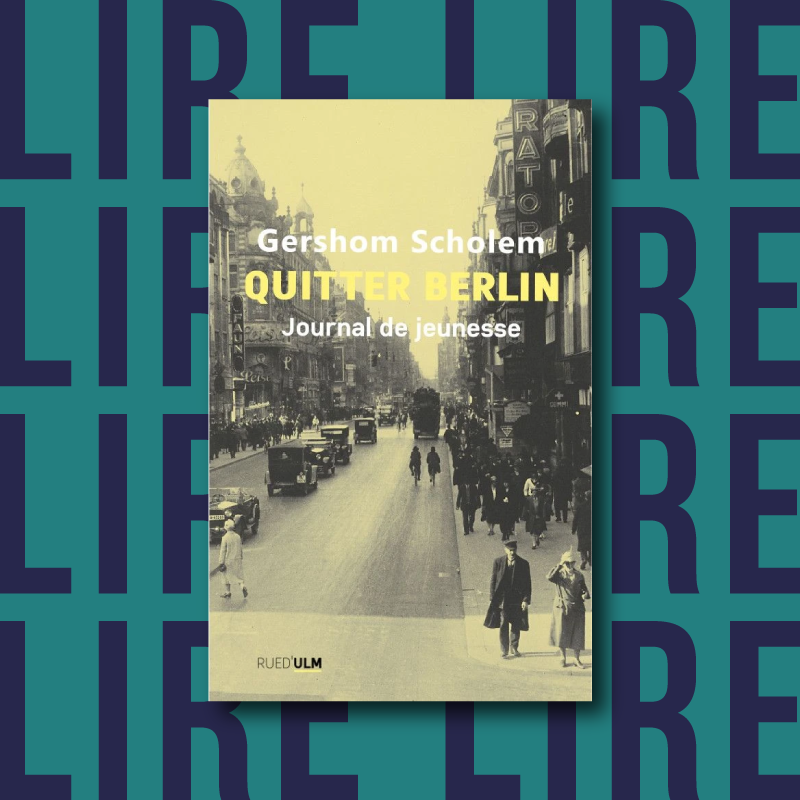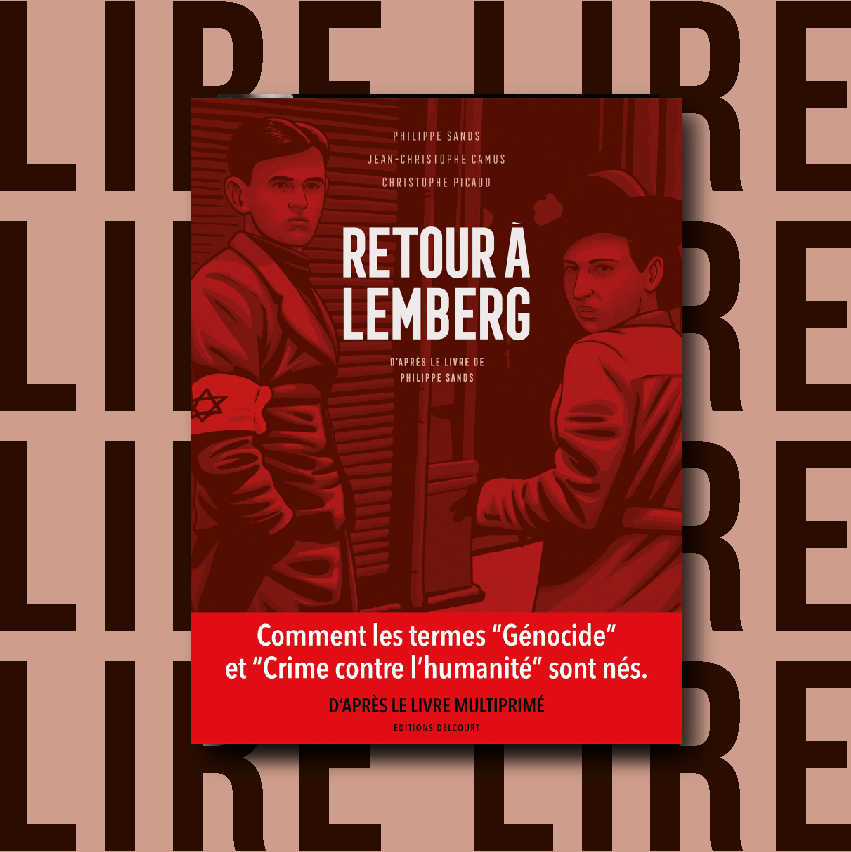Lire la critique de Quitter Berlin. Journal de jeunesse de Gershom Scholem par Fanny Arama
Fanny Arama Gershom Scholem est né à Berlin le 5 décembre 1897. Le journal de jeunesse commence en 1913, il a 16 ans et finit en 1923, il a 26 ans. Selon vous, quelles sont les principales ruptures dans la vie de Scholem, les grandes étapes de sa vie intellectuelle à cette période ?
Sonia Goldblum Vers 1915, dans les premières années de la guerre, Scholem rencontre Walter Benjamin. Cette rencontre correspond plutôt à une ouverture, mais elle coïncide avec un moment de rupture familiale et idéologique. Dans ces premières années de la guerre, Scholem s’oppose à sa famille en écrivant un texte pacifiste qui lui vaut d’être exclu de son lycée. C’est également le moment où il rompt avec Martin Buber (1878−1965), parce que Scholem est pacifiste et lui reproche sa position belliciste.
C’est la première fois qu’on voit Scholem s’opposer publiquement à des idées. Il s’expose publiquement et prend un risque : le risque de se faire renvoyer de son établissement scolaire et le risque de s’opposer à la grande figure du judaïsme de l’époque, Martin Buber.
Scholem gagne des contours à ce moment‐là : il n’est plus simplement pris dans le mouvement de la renaissance juive, de la redécouverte du judaïsme pour lequel Buber a joué un rôle très particulier, il se contraint à trouver un chemin qui lui est propre.
C’est le point qui le fait basculer vers une approche qui va être la sienne et qui va être très originale pour son époque.
FA Il acquiert son libre‐arbitre à ce moment‐là ?
SG Oui ! Franz Rosenzweig traite Scholem de nihiliste, mais c’est un nihiliste productif : Scholem se construit en s’opposant, et se nourrit de cette opposition. En outre, il sait réviser ses positions : il est capable de les revoir et de les faire évoluer.
FA Scholem vient d’une famille juive allemande plutôt très assimilée : dans sa famille, est‐il le seul à s’intéresser aussi intensément à la langue hébraïque et à vouloir « en faire le tour » ? D’où lui vient ce goût forcené de l’hébreu et de la tradition juive selon vous ?
SG Il y a eu quelques publications sur la famille Scholem ces dernières années : The Scholems: A Story of the German-Jewish Bourgeoisie from Emancipation to Destruction (Cornell University Press, 2019), par Jay Howard Geller et aussi celles de Noam et de Mirjam Zadoff, respectivement sur Gershom Scholem et sur son frère Werner. Dans le livre de Howard Geller, on lit qu’il y a eu toutes les positions du judaïsme allemand dans la fratrie Scholem. Les deux frères aînés suivent la voie paternelle : Arthur Scholem, le père, est quelqu’un de très autoritaire. Les deux figures d’opposition à ce père sont Werner et Gershom. L’opposition à des pères autoritaires est assez caractéristique de cette génération de jeunes Juifs allemands et plus globalement des avant‐gardes de la République de Weimar, comme l’écrit l’historien Peter Gay.
Werner Scholem est d’abord membre de la social‐démocratie puis du parti communiste. Il aura un destin tragique. Il est déporté à Dachau dans les premiers moments du national‐socialisme, en 1937, mais il mourra à Buchenwald. Sur son acte de décès, il est écrit qu’il s’est fait tirer dessus alors qu’il tentait de fuir. En réalité, il a probablement été exécuté. Un masque de lui a été réalisé à Dachau et a été exposée à Munich en 1937 lors de la grande exposition antisémite sur « Le Juif éternel ». C’est donc vraiment une des figures du martyre juif, d’une certaine manière.
Gershom Scholem de son côté embrasse la renaissance juive à la lecture de Buber. Dans les années 1910, il y a ces récits hassidiques qui paraissent, qui constituent une réécriture des contes juifs d’Europe de l’Est, traduits par Buber, qui valorise cette tradition hassidique.
Buber redécouvre, comme les Frères Grimm au début du XIXe siècle, des formes narratives et rend accessibles ces récits. Cela ravit Gershom Scholem, comme énormément de Juifs germanophones de cette époque. Cela a nourri son imaginaire, son envie de s’intéresser à la mystique et puis, cela a nourri une opposition qui a fait qu’il s’est intéressé à la Torah d’une manière différente de Buber.
Scholem est seul dans sa famille mais pas du tout seul dans sa génération : à cette époque‐là, les jeunes Juifs en rupture de ban avec leurs familles assimilées sont nombreux à se retrouver à Hanouka ou à Pessah, pour faire un retour à la tradition.
FA Qu’est-ce qui le mène à s’intéresser à la Kabbale, c’est-à-dire à la mystique juive, et pas au Talmud, par exemple ?
SG Il y existe une tradition en Allemagne depuis le XIXe siècle de réhabilitation du savoir juif par la science du judaïsme. La science du judaïsme est l’idée qu’on peut travailler sur le judaïsme de manière scientifique, qu’il y a une forme de rationalité juive dont on peut rendre compte, pouvant être un outil intellectuel de lutte contre l’antisémitisme. On y voit les premières sources dans le livre de Moses Mendelssohn, Jérusalem ou Pouvoir religieux et judaïsme (Gallimard, Tel, 2007), où il explique qu’on peut adhérer à la rationalité des Lumières et être juif, qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre ces deux voies. Scholem se saisit de ces méthodes scientifiques développées au XIXe siècle et nourries à l’université allemande et il aborde le domaine que la science du judaïsme a laissé de côté, à savoir la Kabbale. Les tenants de la science du judaïsme ont évité de s’intéresser à tout ce qui pouvait faire dire que les Juifs étaient des hérétiques, des magiciens… En fait, ils craignaient de passer pour des illuminés. L’autre élément est que Scholem est lecteur des romantiques allemands dans sa jeunesse, eux‐mêmes nourris de la Kabbale. Il y a notamment une figure importante qui s’appelle Franz Joseph Molitor (1779−1860) qu’il a beaucoup lu. L’intérêt de Scholem pour la Kabbale de nourrit donc de sources multiples : les textes de la tradition, son opposition à la science du judaïsme, dont il conserve pourtant les méthodes et son intérêt pour les romantiques allemands.
FA On retrouve le nom du philosophe Hermann Cohen (1848−1918) très souvent au cours de ce Journal : pouvez‐vous nous dire dans quelle mesure cette figure très connue de la pensée juive allemande a marqué Scholem ?
SG Hermann Cohen, c’est d’abord un professeur juif, et il n’y en a pas tant que cela à cette période : quand on est juif, cela devient difficile d’être professeur d’université après lui. C’est la grande figure du néo‐kantisme. À la fin de sa vie, il consacre un certain nombre de travaux au judaïsme.
Cohen est une figure de la convergence de la pensée juive et de la pensée allemande, en adhésion avec l’élément allemand d’une manière qui ne sera plus possible après lui. Il atteint une limite dans un texte qui s’appelle Germanité et judéité, publié en 1915, qui est hallucinant, où il considère qu’il y a une source commune de la judaïté et de la germanité et que les Juifs d’Allemagne sont à l’avant-poste du judaïsme mondial. C’est un texte extrêmement nationaliste, très particulier.
Scholem s’oppose à cette idée d’une « symbiose judéo‐allemande » (Cohen n’a pour sa part jamais employé cette formule). Il croit que quand les Juifs parlent d’une « fusion » judéo‐allemande, ils se font des illusions : les Allemands, eux, ne croient pas du tout à cette fusion. Ils n’y ont aucun intérêt.
Alex Bein a écrit un grand livre sur la question juive en allemand et écrit que le problème de cette idée de symbiose ou de synthèse est que la population minoritaire a l’impression de faire symbiose, alors que la population majoritaire a l’impression que la minorité mène une existence parasitaire.
Scholem s’oppose donc à ce que Cohen incarne : un judaïsme assimilé qui fasse synthèse avec l’élément allemand.
À l’échelle individuelle, Scholem est pourtant le produit d’une synthèse, puisqu’il réunit en lui une culture allemande mise au service d’une étude du judaïsme mais en revanche, la revendiquer politiquement n’est pas une position tenable pour lui.
FA Diriez‐vous que Scholem était un romantique ? Je pose cette question parce que je pense notamment à sa radicalité, ou à son penchant à la spiritualité, même si la sienne n’était pas d’ordre religieux.
SG Je dirais que dans ce Journal, ce qui est romantique est son penchant à l’ironie, ainsi que la productivité du fragment.
Il est lecteur des romantiques : de Jean Paul (Johann Paul Friedrich Richter) et de Hölderlin par exemple, mais également lecteur des lecteurs des romantiques : Nietzsche, Rilke, Stefan George, … Par contre, il n’y a pas d’esthétisme chez Scholem.
FA Dans le Journal, il y a l’édification d’une posture de marginal, de celui qui est isolé…
SG Il est jeune ! On l’oublie, parce sa plume est très puissante… À seize ans, c’est encore un adolescent ! Scholem a eu plusieurs épisodes dépressifs dans sa vie, dont il rend compte dans sa correspondance et on sent, dans son journal de jeunesse, qu’il traverse des périodes difficiles à vivre : dans ses enthousiasmes, dans ses pensées sombres, il est bien de son âge. C’est ce que ce Journal a de touchant : certains aspects montrent le jeune homme, mais ils montrent aussi la construction d’un individu. Je pense notamment à la mort de Walter Benjamin en 1940, qui est un moment très dur de son existence par exemple. Il en rend compte dans son journal De Berlin à Jérusalem. Et puis il retourne en Allemagne très tôt, en 1946, parce que l’université hébraïque de Jérusalem essaie de récupérer les manuscrits les plus importants qui se trouvent dans un énorme dépôt à Offenbach à côté de Francfort où ils ont été réunis. Scholem retourne en Allemagne pour consulter ces documents, voir ce qui a de la valeur et essayer de le faire venir à l’université hébraïque pour la bibliothèque. Il voit l’Allemagne détruite et il dit que cela lui a brisé le cœur (dans la correspondance avec Hannah Arendt).
Cela doit être dur de se tenir en opposition, d’adhérer à des groupes, de s’y opposer. À de nombreuses reprises, il déclare ne pas vouloir dépendre de « maîtres », et je pense que cela est lié à sa volonté de s’interroger sur les fondements de la connaissance. Le fait qu’il ait étudié les mathématiques en parallèle de la Kabbale a beaucoup influencé son approche de ces textes et de leur histoire.
FA Pensez‐vous que la Première Guerre mondiale est venue altérer son rapport au politique ?
SG D’abord, il faut dire qu’il n’a pas fait la guerre : il s’est fait exempter, il s’est fait passer pour un fou… C’est important parce que cette génération, quand elle a fait la guerre, en est très affectée. Son pacifisme est sans doute né de la nécessité de prendre position par rapport à la guerre.
La Première Guerre mondiale lui donne l’occasion d’une première prise de position politique forte. Cela accélère ses études, une rupture familiale, cela a constitué un accélérateur de prise de position.
FA Dans son Journal, ne se sent‐il pas plus Juif qu’Allemand quand survient la guerre ? Il écrit que la guerre fait tirer des Juifs sur d’autres Juifs, russes ou français… Il voyait les nationalistes européens comme quelque chose qui ne correspondait pas à sa vision des choses.
SG Oui, c’est certain : c’est à ce moment qu’il s’oppose à Hermann Cohen. Pour Cohen, la guerre signifie la solidarité des Allemands entre eux, Juifs ou non. Il partage la foi dans la grande trêve demandée par Guillaume II : « Je ne connais plus de partis, je ne connais plus de religion, je ne connais que des Allemands ».
Pour Scholem, les Juifs ont des intérêts propres, et ces intérêts disparaissent dans cette cause qui est celle de la guerre. Il y a donc une conscience juive largement éveillée à ce moment et qui s’affirme par la guerre.
Il y a un moment antisémite pendant la Première Guerre mondiale en Allemagne, qui se manifeste notamment à partir de 1916, dans ce qu’on appelle « le comptage des Juifs ». On a commencé à dire : « Peut‐être qu’il y a moins de Juifs sur le front, ils ne prennent pas leur part ». On s’est mis à compter les Juifs. Cela a été un traumatisme pour tous ces Juifs qui se sont engagés et étaient dans les tranchées pour servir leur pays. Cet élément‐là était de l’eau au moulin de Scholem qui pensait que les Juifs n’étaient véritablement pas en sécurité en Allemagne.
FA Son Journal témoigne qu’il est un lecteur régulier de littérature juive. Il y a chez lui une grande conscience de la condition des Juifs européens : il veut faire sortir les Juifs du ghetto.
SG Scholem lit les auteurs juifs mais il lit aussi les antisémites. Il a une conscience très forte de l’hostilité à laquelle les Juifs sont confrontés alors même qu’il se trouve dans un milieu juif. Cette conscience de l’hostilité est assez originale, dans une population qui a tendance à se croire « acceptée » et bien intégrée à la société allemande.
FA En quoi Scholem était‐il un homme de son temps et en quoi n’était-il pas un homme de son temps, ou disons, un intellectuel qui surplombait son époque ?
SG Je pense que Scholem est vraiment un homme de son temps. Il est pris dans une génération qui règle ses comptes par rapport à la question de l’assimilation et il n’est pas du tout le seul : je parlais de Franz Rosenzweig, mais il y a aussi Martin Buber, et des gens moins connus comme Moritz Goldstein (1880−1977) qui a critiqué le fait que les Allemands utilisent les Juifs pour faire vivre leur héritage culturel mais en même temps leur dénient la légitimité à le faire… Il y a toute une génération à l’époque qui fait le procès de l’assimilationnisme de la génération précédente. C’est un homme de la modernité dans tout son aspect de modernité critique : critique des périodes antérieures et critique de la modernité qui se nourrit de sa propre critique. C’est une vision partagée par W. Benjamin. Il est aussi de son temps parce que c’est aussi un homme de la bourgeoisie intellectuelle, un professeur. Il représente une certaine génération. Ce n’est pas un homme complètement solitaire. Il faut l’envisager dans les groupes auxquels il a appartenu et au sein de sa génération.
FA Scholem est‐il présent dans l’espace intellectuel aujourd’hui ?
SG En Allemagne, c’est une figure qui continue de susciter de l’intérêt. On l’utilise comme texte primaire, mais des inédits continuent de paraître : les Poetica (recueil de textes littéraires, de poésies, de critiques littéraires et de traduction) chez Suhrkamp Verlag par exemple (2019).
Il reste présent dans l’espace intellectuel allemand dans la réflexion sur les Juifs d’Allemagne. Ces dernières années, une biographie de Scholem a paru sous la plume de Noam Zadoff, pas encore traduite en français (De Berlin à Jérusalem et retour à Berlin. Gershom Scholem entre Israël et l’Allemagne). Une biographie de son frère parue sous la plume de Mirjam Zadoff (Werner Scholem. A German Life. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2018). Il y a une production qui s’intéresse à Scholem, aux Scholem. Ce n’est pas du tout un auteur oublié.