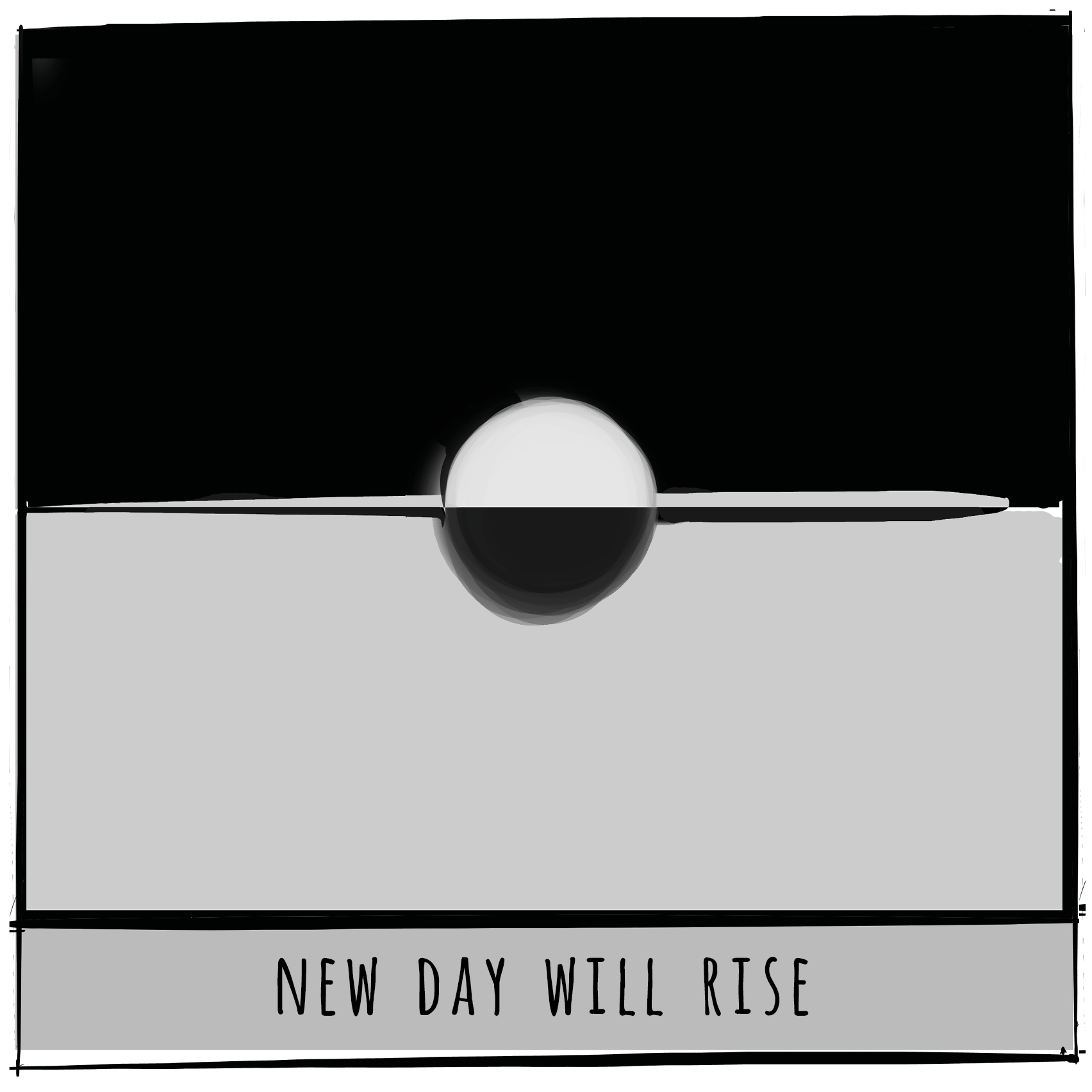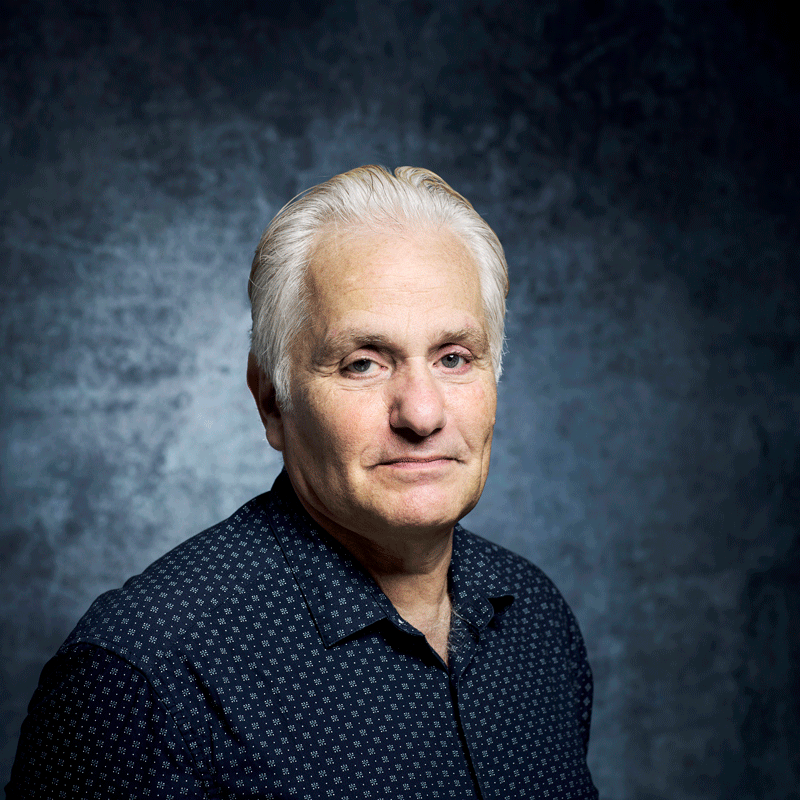7 octobre 2024, New York.
Sur Instagram, des associations “pro‐palestiniennes” de Columbia appellent à manifester au cœur du campus. En guise d’illustration, une image : Ramallah, 2000, un homme lève les bras, ses mains sont couvertes de sang. Il vient de tuer deux réservistes israéliens. Je remarque que certains camarades ont liké ce post.
Vers midi, une foule masquée, coiffée de keffiehs, se presse devant la Butler Library. Elle exulte. Hurle. Brandit des pancartes où l’on peut lire “Glory to Resistance”[ Gloire à la Résistance], “No peace” [Pas de paix]. Distribue un journal titré “One year since Al‐Aqsa Flood, revolution until victory!” [« Un an après le déluge d’Al-Aqsa, révolution jusqu’à la victoire !].
D’autres collectifs déploient des drapeaux israéliens et américains. “Laissez‐nous faire notre deuil en paix”, disent‐ils. Les deux groupes sont séparés par des barrières métalliques. En face, sur la pelouse baignée par le soleil de l’été indien, des étudiants juifs ont créé un mémorial pour les victimes du 7 octobre. Il y a des peluches tachées de faux sang, une peinture représentant le visage de Hersch, cet otage Américano‐Israélien tué par le Hamas et abandonné par Netanyahu. Quand les cris des manifestants reprennent, deux étudiantes se prennent dans les bras. L’une me dit que nombre de ses amis juifs ont eu peur de se rendre à l’université ce 7 octobre.

À l’école de journalisme, nous devons couvrir la manifestation. La conclusion est nette dans notre classe : ces manifestations sont pro‐palestinennes et n’ont rien d’antisémite. Malgré les slogans pro‐Hamas, on lira que ces étudiants se mobilisent pour la paix et la Palestine, des professeurs renommés les soutiendront inconditionnellement. À Columbia, ce jour‐là, je retrouve ce même déni de la violence, cette même minimisation de la haine qu’à Sciences Po l’année dernière.
Nos communautés étudiantes ont été empoisonnées par cette guerre. Disons‐le : quand je suis arrivé à Sciences Po en 2019, on ne parlait pas du conflit israélo‐palestinien ; l’UEJF organisait sans problèmes des événements avec d’autres associations étudiantes. Le 7 octobre a tout saccagé.
*
Après l’attaque terroriste du Hamas, j’ai vu des camarades partager le communiqué du NPA (daté du 7 octobre) en soutien aux massacres, qui disait notamment que « Cette fois‐ci l’offensive a été du côté de la résistance » . Au sein du microcosme universitaire, je ressens un malaise. J’entends que les Juifs sont privilégiés et qu’ils se plaignent trop. Lors d’une conférence sur l’antisémitisme, une étudiante prend la parole pour louer l’action du Hamas.
Même en classe, je m’interroge. Un prof de l’AFP nous explique qu’on ne peut pas utiliser le mot “terroriste” pour qualifier le Hamas. Un autre de Radio France, refuse qu’on emploie “Tsahal” dans nos papiers sur Israël – ce terme serait trop “affectueux ». À Columbia, un enseignant remet en question les témoignages que j’ai recueillis sur l’antisémitisme vécu par de jeunes Newyorkais. Il se montre tatillon, plus qu’à l’accoutumée, me demande des preuves, des enregistrements, des captures d’écran, explique que ça n’a peut‐être rien de raciste. “Avec tous les morts à Gaza, ce n’est pas forcément le genre d’articles qu’on a envie de lire”, ajoute‐t‐il.
C’est après le 12 mars 2024 que les tensions atteignent un niveau que je n’aurais jamais pu imaginer à Sciences Po. Ce jour‐là, une étudiante juive, membre de l’UEJF, est empêchée d’accéder à un amphithéâtre occupé par le Comité Palestine.
L’enquête a beau avoir confirmé ces faits, nombreux sont ceux qui continuent d’accuser l’UEJF d’avoir menti. Ils dépeignent l’étudiante discriminée comme une sioniste pro‐génocide, faisant fi de son engagement contre l’extrême droite israélienne. À l’école de journalisme, certains veulent même tourner un documentaire à la gloire du Comité Palestine en réécrivant l’histoire.
Je lis des tribunes de camarades. À propos de la “censure institutionnelle des voix en soutien au peuple palestinien”, des étudiants de Lille dont des étudiants de l’école de journalisme de la ville écrivent : “Nous tenons pour responsable le gouvernement français, les groupes médiatiques, les associations sionistes finançant le crime en Palestine.” Des tropes antisémites – le complot juif, la double allégeance – distillées façon dog whistle, et personne ne voit pas le problème.
Dans une autre tribune inter‐écoles de journalisme, des étudiants lâchent : “les attaques sans précédent du 7 octobre n’étaient pas un coup de tonnerre dans un ciel calme. Elles s’inscrivent dans un contexte de colonisation et d’occupation qui dure depuis plusieurs décennies”. Avant la publication, j’explique à l’une des rédactrices que ce passage est problématique, qu’il s’agit de terrorisme, que les victimes étaient en majorité des civils, qu’on peut dénoncer l’horreur à Gaza sans écrire de telles choses. Elle me répond qu’ils n’ont pas utilisé le terme “terroriste” car “cette qualification est extrêmement politisée”. Le texte est partagé, liké par des camarades, ils sont fiers d’eux, ça leur donne l’impression d’être engagés et courageux. Peut‐être devraient‐ils se plonger dans le livre 7 octobre de la journaliste Lee Yaron pour nuancer leurs certitudes.
Mais à l’école de journalisme de Sciences Po, on lit peu, le temps est grignoté par le montage, le recrachage de dépêches AFP. Il faut produire. On ne réfléchit plus, on choisit un camp, on se range derrière un seul drapeau alors que nous vivons à 4000 kilomètres du conflit. Je ne peux pas m’empêcher de trouver ça déplacé. Comme si c’était difficile, quand on n’est pas directement concernés, de dénoncer dans un même souffle le Hamas, le gouvernement d’extrême droite israélien, de demander à la fois un cessez‐le‐feu et la libération des otages.
Ils sont peu à se remettre en question. Plusieurs fois, j’ai partagé mes désaccords. J’ai davantage récolté du silence ou du mépris que du soutien. On crie à l’intifada devant Sciences Po, piétine la mémoire de David Gritz, étudiant de notre école mort lors d’une attaque du Hamas à Jérusalem, l’UEJF documente des dizaines de propos antisémites prononcés à Sciences Po. Le déni persiste chez ceux qui regorgent de pureté morale sauce intersectionnelle. Le Comité Palestine ne se cache plus de soutenir le Hamas dans ses posts sur les réseaux sociaux, ironise sur le sort des otages libérés, souhaite créer une “zone anti‐sioniste” au sein du campus, manifeste avec le drapeau du collectif pro‐terrorisme Samidoun…
*
Les voix des étudiants palestiniens de Sciences Po, directement concernés par cette guerre de destruction, ont été recouvertes.
C’est un mélange de haine de la part de certains extrémistes et de lâcheté dont se rend coupable le gros ventre mou. Je persiste à croire que l’antisémitisme à l’université provient d’une minorité. La majorité rejoint le noyau dur sans condamner les dérives ou bien reste apathique. Les voix des étudiants palestiniens de Sciences Po, directement concernés par cette guerre de destruction, ont été recouvertes. “Le dialogue était possible avec les Palestiniens engagés, dit l’étudiante de l’UEJF qui fut au cœur de la polémique du 12 mars. Ce sont des personnes que j’aime beaucoup, nos échanges étaient toujours respectueux, ils me parlaient de comment c’était à Bethléem.”
J’aurais aimé que Sciences Po remplisse son rôle d’université en sciences sociales : dépasser l’émotion pour réfléchir à des solutions, proposer de nouveaux cours plutôt que des conférences qui ne rassemblent que des gens déjà convaincus ou du même avis.
Il y a une soif de débattre, de parler de ce sujet. On ne réglera rien en laissant des débats se muant souvent en anathèmes sur des boucles Whatsapp ou Messenger, ces lieux de “glaciation de la conversation”, selon les mots de l’écrivaine Nathalie Azoulai. Je repense à son roman Les manifestations publié en 2005, à ce trio amical dans lequel les divergences politiques se sédimentent au cours du temps jusqu’à éclater un beau jour, en pleine seconde intifada ; ce moment où Anne, le personnage principal, a l’impression de redevenir juive. Les autres la croient paranoïaque ; elle est obsédée par ça, ne parle que de ça, relève les détails dans les conversations, traque certains mots pouvant contenir la haine. “Notre intimité aujourd’hui, c’est la situation géopolitique du monde. Je me dis que c’est ça le début de la guerre, quand les rapports entre les proches font entrer les États, les traités d’alliances, les réformes administratives”, écrit‐elle. Des mots qui résonnent encore, à l’heure où l’on assigne des idées politiques aux gens en fonction d’une identité réelle ou supposée, à l’heure où on ne parle que d’identité.
Il y a les bons Juifs et les mauvais Juifs, les Arabes purs et les Arabes de service. Si vous prenez la parole contre l’antisémitisme en France, alors vous êtes juif. Si vous le faites et qu’en plus vous portez un prénom arabe, alors vous êtes un traître, un vendu aux sionistes. L’étudiante refoulée de l’amphithéâtre explique l’aspect mortifère de ces réifications identitaires : "J’étais sioniste et c’est tout. Réduite à ce mot, je n’étais plus rien d’autre. Tous les liens que j’avais créés, les relations vécues, les débats tenus, les amitiés forgées, tout a été annihilé par ce mot. Sioniste. Une fille de ma classe avait annoncé la couleur : les sionistes, la moindre des choses ça serait de vous faire discret. J’étais isolée dans mes problèmes de juive, avec mes amis juifs, ma famille juive, et mes peurs juives. J’avais perdu tout le reste".
*
Faudrait‐il donc désespérer ? "Ma vraie tristesse, c’est que j’ai vu mon université se fendre, des amitiés se sont brisées, raconte Alexandre. J’ai cru qu’il était possible de colmater les brèches mais l’effet de groupe a des conséquences immenses. À Sciences Po, c’est impossible de faire du collectif".
Cette année, à Columbia, le climat est moins étouffant. Il n’y a pas eu de manifestations massives tous les jours. Les professeurs ont ouvert des espaces de dialogue, où chacun peut exprimer ses idées sans être jugé. Un cours sur la couverture médiatique de la religion, avec un chapitre sur le conflit israélo‐palestinien, était co‐enseigné par un Juif sioniste et un Palestinien.
Le 7 octobre 2024, alors qu’une manifestation pro‐Hamas avait lieu sur le campus, Columbia avait installé des “tables du dialogue”. On pourra juger le geste naïf, mais les échanges ont eu lieu. Des malentendus ont été levés : une étudiante a expliqué que chanter “From the River to the Sea” signifiait, pour elle, revendiquer le droit à l’autodétermination des Palestiniens, pas appeler à la destruction d’Israël ; une autre, qui s’est présentée comme sioniste et pro‐palestinienne, a évoqué sa famille, dont certains membres ont servi dans Tsahal.
À la fin, elles se sont demandées leur compte Instagram pour poursuivre, peut‐être, la discussion.