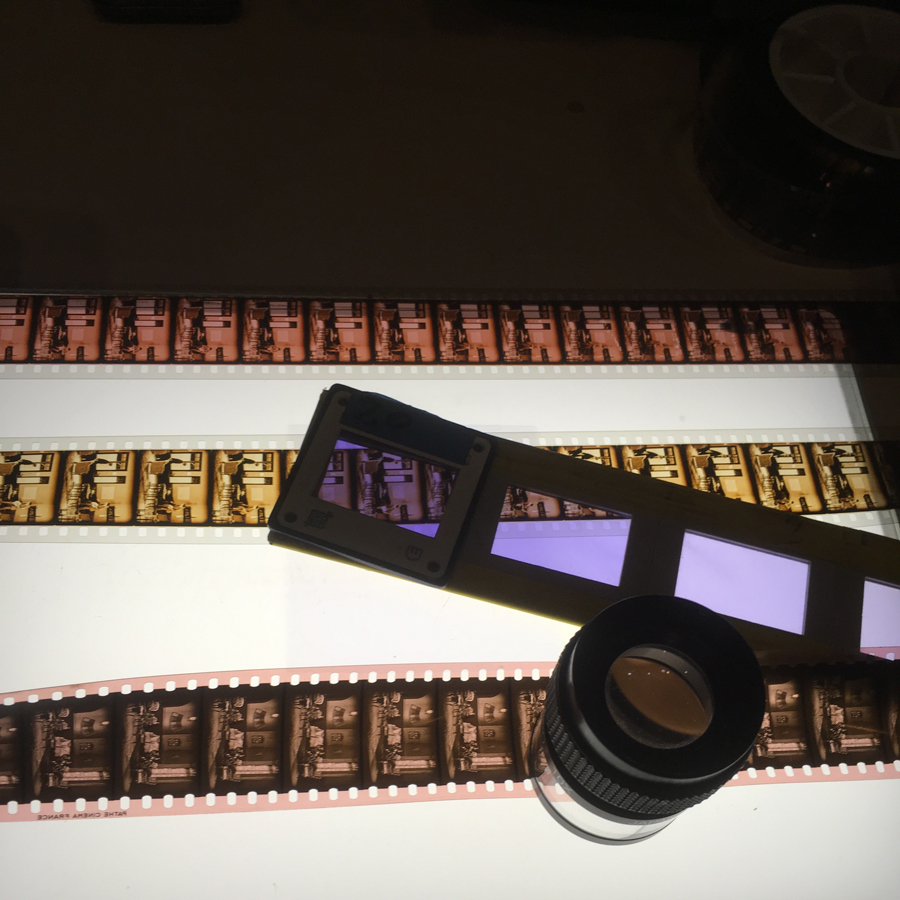Une pomme en clin d’œil à l’aimée du Chant des Chants et du miel pour une année douce. Une hallah ronde pour symboliser le début d’un nouveau cycle de jours, la grenade des mérites espérés qui luit comme un rubis sur la nappe blanche. Un séder à tête de poisson pour ouvrir l’année, et une corne de bélier que l’on sonnera plus de cent fois pour réveiller les cœurs endormis.
Dix jours plus tard, un jeûne total d’une nuit et d’un jour, et des rites de deuil pour l’expiation qui nous fera renaître.
Soudain au coeur du mois, sous la lune pleine, on s’installera pour sept jours dans de drôles de cabanes pas terminées, brandissant trois branches végétales et une sorte de gros citron, et on festoiera en accueillant les invités mythiques ou en chair qui viendront se « réjouir avec nous dans notre festival ».
Après le huitième jour convoquant la sainte assemblée (shemini atseret), on sortira les rouleaux de Torah pour danser en célébrant l’ouverture d’un nouveau cycle de lecture. Ce sera la « joie de la Torah » qui accompagnera un nouveau Bereshit (début) d’année.
De Rosh haShana (la tête de l’année) à Simhat Torah (la joie de la Torah), le mois des fêtes juives qui accompagne nos automnes, nous invite à un long parcours rituel dont le sens profond semble trop souvent, au moins en partie, nous échapper.
Chaque année nous retrouve ainsi tendus entre excitation anticipatoire et pragmatique des préparatifs, entravés par l’ambivalence entre joie et poids des retrouvailles familiales, mitigés entre émotionalité sensorielle et sentiment trop fréquent d’un manque de transmission, désemparés de retrouver à la fois avec joie et ennui le chemin de la synagogue pour des heures de prière millénaire dans une langue à la fois si familière et, en un sens, inaccessible.
Qu’on le veuille ou non, alors qu’approche le mois de Tishri, nous voilà à l’orée du portail rituel le plus profond de l’année juive, avec un sens de manque, le sentiment que quelque chose du sens ces fêtes nous échappe.
Comment faire sens d’un calendrier rituel que l’on n’a pas forcément choisi ?
Peut‐être en l’observant, et en voyant ce qu’il a à nous apprendre.
Le mot sens lui‐même, s’entend ici dans les deux sens du terme : signification et direction.
Or celles‐ci sont liées. Tishri nous invite bien à un parcours rituel au fil de ces quatre fêtes, Rosh haShana, Kippour, Soukkot, Shemini Atseret /Simhat Torah, quatre fêtes qui ont pour vocation de faire traverser à notre être individuel et collectif un parcours initiatique transformateur alors que s’ouvre une nouvelle année.
Voyons simplement deux aspects de ce sens.
La tête de l’année : quel est le début ?
Rosh haShana veut dire « la tête de l’année ». Communément, c’est cette date que l’on entend comme le nouvel an juif.
Pourtant, le récit biblique semble démentir cette tradition religieuse devenue culture populaire : selon le texte du Lévitique, Rosh haShana et Kippour ont lieu le septième mois du calendrier, le premier étant Nissan, au printemps – le mois où l’on fêtera Pessah.
Contradiction ?
Non point.
Cet apparent paradoxe de calendrier vient en réalité nous enseigner qu’un début n’en est jamais un. Il est multiple, complexe, et souvent en plusieurs étapes.
En réalité Nissan et Pessah pointent sur deux étapes de notre naissance :
Rosh haShana est la naissance du monde.
Pessah, en Nissan, sera notre naissance en tant que peuple.
À un niveau plus profond, ces deux temps du renouveau nous enseignent quelque chose d’essentiel par rapport à la notion de naissance. Au débat bioéthique contemporain brûlant sur la question de la datation du début de la vie – conception ou naissance –, la tradition juive répond : les deux.
Ainsi le Zohar, cet ouvrage majeur de la Kabbale, nous enseigne‐t‐il que Rosh haShana, est la conception – le début invisible –, tandis que Nissan est la naissance – le début manifeste –, ce qui lui vaudra le rang de premier mois dans le compte du calendrier.
Et c’est en harmonie avec la conception juive du temps : la journée juive ne commence pas à l’aube ou avec le lever de soleil, mais le soir, à son coucher.
De même, notre année commencera à l’automne, alors que la nature décline et s’apprête à se coucher pour l’hiver, avant son réveil au printemps, qui marquera sa renaissance manifeste.
Descendre pour mieux remonter
Oui le temps juif, dans l’espace d’une journée comme d’un cycle d’année, on commence par un déclin.
Et c’est aussi ce que nous enseigne la hassidout, quant au chemin de l’humain : de même que le début du monde (Bereshit) commence par le chaos (tohu va vohu) et l’abîme, chaque nouvelle émergence en nous et dans nos vies, nous enseigne le Meor Einayim, l’un des premiers disciples du Baal Shem tov, a souvent commencé au départ par une crise, voire une brisure, ou une chute.
Ainsi en va t‑il des lois de la nature : la chenille ne doit‐elle pas se détériorer pour que le papillon émerge ? Au plan symbolique comme littéral, c’est aussi ce que nous montre, histoire après histoire, le récit biblique.
Avraham doit perdre de vue la maison de son père pour aller vers lui‐même. Yaakov devra connaître l’exil avant de bâtir sa famille.
Yossef sera descendu littéralement au fond d’un trou puis en prison en Égypte, avant de s’y voir élever au rang de vice‐roi, d’où ses fils, les ancêtres des douze tribus d’Israël, « descendront » géographiquement puis, symboliquement, en esclavage avant de jaillir vers la liberté qui l’amènera à l’alliance au mont Sinaï.
Oui l’existence humaine est loin d’être linéaire, et la Torah, ce « miroir de l’âme humaine » selon le Meor Einayim nous le rappelle à travers chaque histoire.
De là, le principe que les descentes sont nécessaires afin de pouvoir remonter, est devenu un principe au cœur de l’ethos de la hassidout. Yeridah tsorekh aliya – la descente pour les besoins de la montée.
Descente et remontée sont les deux mouvements jumelés qui forment la dynamique du vivant – pensez au rythme cardiaque ou à notre respiration – comme, au plan symbolique, qu’on le veuille ou non, celle de nos propres évolutions.
Et le parcours de Tishri nous invite chaque année à retraverser cela.
Au niveau rituel, c’est bien une telle sinusoïde transformatrice de soi que dessine le calendrier des fêtes de Tishri.
À Rosh haShana, on proclamera Dieu « roi du monde ». Si je traduis en nous sauvant de l’anthropomorphisme patriarcal classique qui mutile trop souvent le sens : Dieu est un nom de code pour la Source de Vie – c’est‐à‐dire la Vie par excellence.
Et c’est la vie, au cas où on ne l’aurait pas remarqué, et non pas notre volonté, qui règne.
Depuis un peu plus d’un siècle, grâce ou à cause des, progrès incroyables de la science qui ont éloigné la mort, raccourci les distances, nié la nuit et permis à l’homme de se croire maître, par l’action rationnelle, de son corps et de la nature, nos sociétés occidentales ont oublié à quel point nous ne sommes rien face à la grandeur de la vie.
La vie est plus forte que nous.
Et ceux d’entre nous qui ne le savent pas ont simplement été épargnés.
Le 7 octobre, la terrible guerre qui s’étire depuis, et les drames qui ont frappé les Juifs de diaspora depuis, nous le rappelle plus que jamais : nous ne sommes rien, nous ne savons rien, pas grand chose n’est entre nos mains.
Bien sûr, c’est plus complexe que cela – et c’est là la beauté de l’existence et la profondeur de la sagesse juive, comme nous le rappellent les Pirké avot : « Tout est écrit (littéralement prévu), mais le pouvoir d’action est donné. »
Oui notre vie s’étire entre l’inévitable et le libre arbitre, entre les accidents de la vie et les choix de l’humain, et c’est à cette double reconnaissance, et à sa mise en acte, à travers la prière à Rosh haShana et le jeûne à Kippour, que nous invitent les fêtes juives.
À Rosh haShana, nous célébrerons le début du monde et couronnerons, donc, la Source de vie sur nous, nous rappelant que irah – la révérence profonde pour la Vie – est le début de la sagesse.
De Rosh haShana à Kippour, c’est la descente jusqu’au point zéro de l’existence.
À Kippour, en nous abstenant de boire et de manger et en nous adonnant aux rites de deuil, nous flirterons avec la mort pour mieux expier – littéralement sortir de nos âme – tout ce qui les détruit de l’intérieur (kapara) et renaître à une nouvelle année, où nous espérerons être inscrits dans le livre de la vie.
Et puis nous viendra Soukkot, l’un des trois pèlerinages du Houmash, l’une des trois convocations sacrées où les Bnei Yisrael étaient invités à « monter » au temple de Jérusalem sur la montagne sacrée, nous célébrerons le soulagement d’avoir passé ces « jours redoutables » à l’enjeu existentiel, et nous réjouirons, du coeur même de la conscience de notre fragilité, entre terre et ciel.
Et puis viendra la joie de la Torah.
Or, depuis le 7 octobre 2023, qui était le jour de Simhat Torah, le jour où le sud d’Israël a soudain été envahi et où plus d’un millier d’hommes, de femmes et d’enfants ont été tués, violés, torturés, décapités et éventrés, et 250 pris en otage dont vingt encore captifs vivants, squelettiques comme des prisonniers de camp de concentration, et autant de déjà morts qu’on refuse de nous rendre, il semble que l’on soit dans une descente qui n’en finit plus.
Peut-on se réjouir encore à Simhat Torah?
On touche ici à un point essentiel : celui de l’art juif du travail des émotions.
Spontanément, nous avons tendance à avoir un rapport passif, uniquement réactif, aux émotions : je reçois un cadeau ou un compliment, je suis contente. Je reçois un mail de critique ou un automobiliste m’insulte dans la rue, je suis contrariée.
La tradition juive, comme beaucoup de pratiques spirituelles dans le monde, nous rappelle que les émotions sont aussi des dispositions d’être, des expressions d’un rapport au monde qui se choisissent, et qui se cultivent.
Ainsi, un grand nombre de mois du calendrier juif s’accompagnent-ils de prescriptions d’intentionnalités particulières, de mise en disposition émotionnelle spécifique : en Adar on augmentera en joie, en Av ce sera l’inverse. Et Soukkot sera appelée la fête de la joie.
C’est la raison pour laquelle le Hamas a attaqué ce jour‐là.
Cela fait partie de la stratégie du terrorisme : on ne cherche pas seulement à tuer.
On cherche à marquer les corps, et les âmes, à jamais – par delà les générations.
Lorsque l’on est conscient de cela, on comprend que choisir de continuer de choisir, et de cultiver la joie d’être vivants, la joie d’être soi, sans ignorer pour autant nos brisures, nos souffrances, et nos cicatrices, est l’une des armes les plus importantes de résistance contre le terrorisme.
Avant même cela, le choix de ne pas tomber dans le désespoir est au cœur de l’éthos hassidique – « il est interdit de désespérer », martelait Rabbi Nachman, qui était par ailleurs un dépressif chronique.
C’est aussi pour ne pas se laisser vaincre dans son âme que la culture israélienne contemporaine cultive le choix de la joie et de l’optimisme, tout en accueillant de plus en plus la réalité d’une condition post‐traumatique qui l’accompagne inéluctablement comme une ombre.
Lorsque j’ai vu, il y a environ un mois, la photo de Rom B. – avant même de voir un quart d’instant de la vidéo publiée d’un Eviatar D. squelette tout juste recouvert de chair, forcé à creuser sa tombe devant la caméra perverse –, j’ai eu envie de vomir.
Je n’ai plus eu envie de rien.
J’étais à la bibliothèque nationale de Jérusalem, en train d’écrire, en un vendredi matin lumineux d’été. J’ai hâtivement fermé Instagram.
J’ai tenté de revenir à mon texte, de replacer les mains sur le clavier.
Je n’ai pas pu. Tout me semblait absurde.
Je suis sortie.
J’étais glacée. Plus rien n’importait, plus rien ne faisait sens.
J’ai appelé ma copine Claire‐Sophie, en France.
Elle m’a dit :« Tu sais, si j’étais otage, moi, là, à Gaza, je n’aimerais pas qu’ils utilisent l’image de ce qu’ils sont en train de me faire pour détruire le moral des autres ».
Oui le terrorisme ne tue pas seulement les corps. Il s’attaque aux âmes, de l’intérieur.
Les mots de mon amie m’ont réveillé.
Je suis allée me remettre à écrire, la mort dans l’âme, et j’ai fait partir, ce matin‐là, l’article qui devait être envoyé. Et le soir je chantais avec les autres à la synagogue.
Le Hamas a choisi d’attaquer un Simhat Torah pour nous gâcher la joie de la Torah à jamais.
Israël le sait, et c’est pourquoi, loin d’appeler cette guerre comme la guerre de Kippour, lors de l’attaque de 1973 à la date tout aussi soigneusement choisie, on a choisi sobrement la date grégorienne : 7 octobre.
Bien sûr que nous sommes marqués à jamais.
Mais notre tradition ne nous enseigne‐t‐elle pas que nos premières tables de la Loi, celles précisément qui avaient été brisées, reposent dans l’Arche à côté des nouvelles, et voyagent avec nous ?
Chez les peuples d’Océanie, la gloire d’une vie initiatique bien remplie se lit au nombre des cicatrices.
Chez nous, le Kotzer Rebbe nous enseigne que rien n’est plus « plein », intègre, complet, shalem qu’un cœur brisé.
Et ce n’est pas tout.
Les descentes connues par le peuple juif au cours de son histoire si tourmentée ont toujours donné lieu à des remontées spectaculaires : la destruction du Premier Temple a accouché de la proclamation de la Torah, celle du Second au passage d’un service sacrificiel au service plus intime (du coeur), la naissance de la culture de la prière.
La dispersion mettant fin à la possibilité d’une culture orale a donné naissance au développement du Talmud, dont les Coréens s’arrachent aujourd’hui l’étude, croyant – non sans raison –- y voir le secret du génie juif.
La Shoah enfin, la dernière et la plus profonde de nos blessures, jusqu’au sept octobre, a accouché dans le sang à la reproclamation, attendue pendant deux mille ans, d’une souveraineté politique d’Israël sur la terre de ses ancêtres.
Oui si l’on croit réellement au principe de yeridah tsorekh aliyah qui structure le récit biblique comme l’éthos hassidique, et de facto, l’histoire juive, à nous de choisir, cette année encore, de croire que la descente sans fin qui semble nous engloutir, en Israël comme en diaspora, n’est que l’élan profond d’une remontée qui n’attend que nous pour la faire advenir.