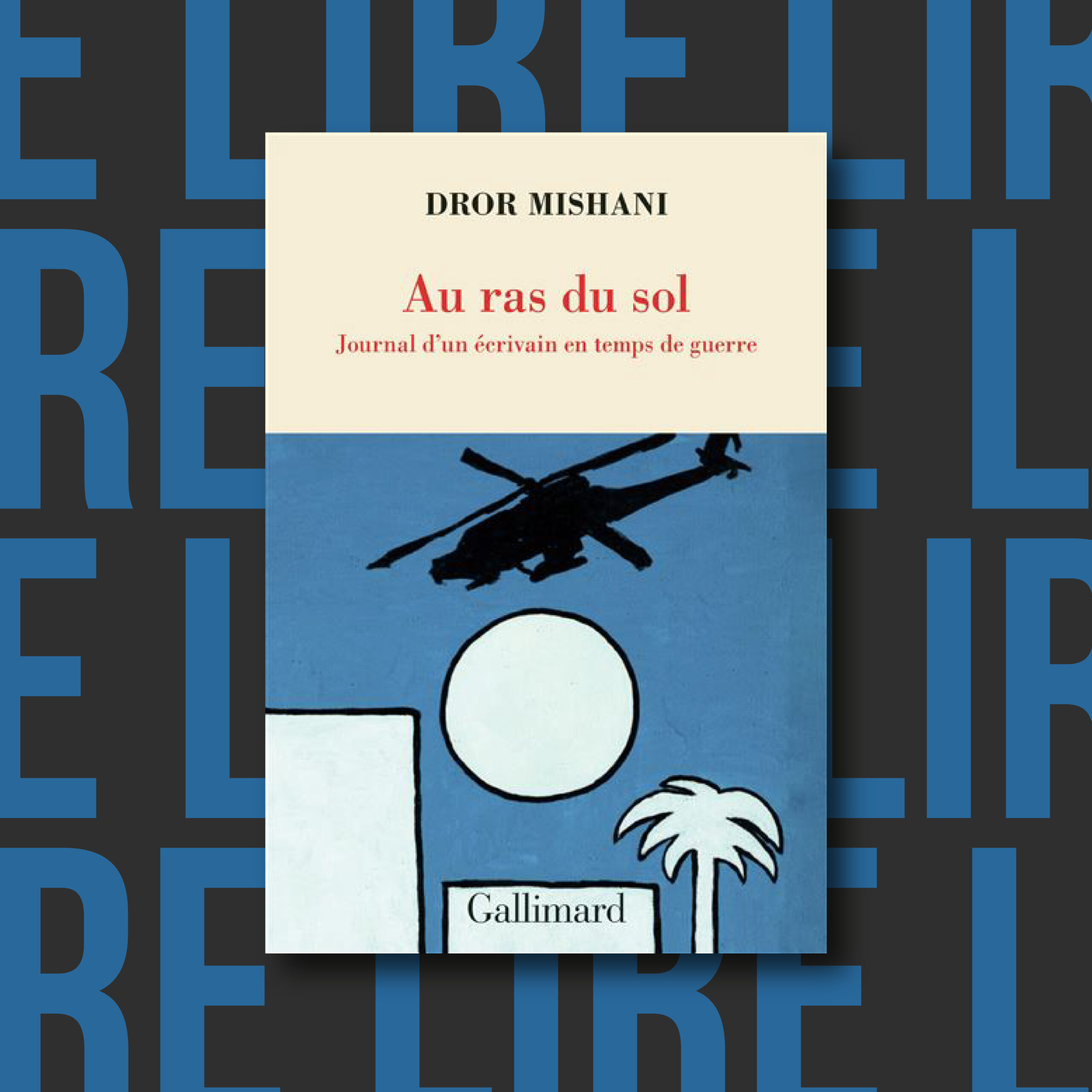Les jours d’après
Carnet d’une française en Israël
Ce deuxième volet du carnet de guerre prend la suite du Carnet d'une semaine de guerre. Il déroule les ressentis et les instants de guerre d’une Telavivienne d’aujourd’hui, moderne et religieuse, une intellectuelle ordonnée rabbin, une enseignante de méditation, une artiste et une contributrice régulière de Tenou’a. Afin de faciliter la lecture de ce carnet chapitré, vous trouverez ci‐dessous des liens vous permettant de circuler dans le texte.
1. Presque normal
2. La terre et le ciel
3. L’humour sauvera le monde
4. Coping Strategies
5. Arrière-front
6. Cyber guerre
7. Ensemble
8. Prejugés
9. Le rabbin en colère
10. War Porn 2.0
11. Reality check
12. Pudeur
13. Traumatisme au carré
14. Chance
15. Bloody wisdom
16. Héros
17. Les oubliés
18. Rachel
19. Un shabbat en guerre
20. Le clair et l’obscur
21. Kikar Dizengoff
Combien disparaîtront et combien naîtront ?
Qui vivra et qui mourra ?
Qui vivra le temps qui lui a été imparti et qui disparaîtra avant la fin de ce temps ?
Qui périra dans l’eau et qui par le feu ?
Qui mourra par le glaive et qui par une bête sauvage ?
Qui sera emporté par la faim et qui par la soif ?
Qui finira dans un tremblement de terre et qui dans une épidémie ?
Qui sera étranglé et qui sera lapidé ?
Qui connaîtra le repos et qui errera ?
Qui vivra dans la tranquillité et qui sera attaqué ?
Qui aura une vie agréable et qui souffrira ?
Qui s’appauvrira et qui s’enrichira ?
Qui subira la déchéance et qui s’élèvera ?
Ounetané tokef. Poème ouvrant le service de Moussaf pendant Rosh haShana et Yom Kippour
Aujourd’hui, vendredi matin, 27 octobre, cela fait vingt jours que le monde a basculé.
Pas seulement notre monde à nous, Juifs.
Bien au‐delà des frontières d’Israël, que mon ami Samuel appelle “le petit pays”, le monde entier s’agite :
Chacun a son mot à dire ; chacun manifeste ; chacun parle ; chacun poste ses bannières, et ses opinions.Chacun, comme le dit ma copine Cynthia, est devenu “un spécialiste du Moyen Orient”. Chacun envoie de l’argent, ou ses bateaux de guerre.
Le monde a basculé, et chacun pose ses pions.
Et en attendant, où que l’on soit, la vie continue. Il y a le travail, les courses, les enfants, les chiens à sortir, le dîner à préparer, les emails à répondre.
Mais en ce moment, quand je reçois des emails du “NYT cooking” “dîners cozy pour les soirs de semaine,” des flyers de collègues qui font des spectacles, ou des invitations à des cocktails d’universitaires, j’ai envie de vomir.
On a encore sur nous les éclaboussures du sang des nôtres, on apprend que dans des grandes villes des étudiants comme il faut manifestent “pour la Palestine libre” en montrant en riant des photos de victimes expirant, ou des croix gammées, et nous, pendant ce temps on s’apprête à entrer au Gaza et au sud Liban, avec les conséquences que l’on imagine.
Ne me parlez pas des trois meilleures manières de cuire le tofu.
Ces deux dernières semaines, j’ai eu du mal à écrire. Et puis je n’ai pas pu écrire à l’aube ou le soir tard. J’avais besoin de dormir, énormément. Comme un bébé.
Les bébés, ils dorment presque toute la journée. C’est parce qu’ils absorbent beaucoup d’information. Ils apprennent la vie.
Moi aussi. Depuis trois semaines, j’apprends à vivre en guerre.

1
Presque Normal
Et l’une des choses les plus bizarres justement, c’est que la guerre, de là où je suis, à Tel Aviv, on ne la sent presque pas.
Certes il y a des missiles à peu près tous les jours, parfois plusieurs fois. Cela fait partie maintenant du quotidien.
Je vois comme le corps s’est habitué. Parfois pendant le silence, mon cerveau joue en replay, presque compulsivement, le bruit de l’alarme qui se déclenche. Comme s’il était en manque d’adrénaline et voulait en sécréter encore.
J’ai été tellement souvent interrompue pendant des cours sur zoom, le soir, que lorsque ça n’arrive pas, je suis nerveuse. Quelque chose en moi attend. Je suis presque déçue. Mon corps s’est paré à l’attaque pour rien.
Je crois vivre en alerte, prête à la prochaine, et pourtant, à chaque fois, lorsqu’elle se déclenche, immanquablement, je suis prise de court.
En train de m’habiller. À la table de shabbat. Sur le point d’aller me coucher. En train de cuisiner. En train d’enseigner. En train d’essayer de finir un email. Pendant un coup de fil. En train de dormir.
Et tout d’un coup il faut tout lâcher, s’habiller comme on peut, courir pieds nus dans la cage d’escalier, et descendre en espérant que ça ne touchera pas l’immeuble.
Tel Aviv, il y a quelques années, on l’appelait “la bulle”.
C’était la ville internationale, laïque, où les roquettes tirées par le Hezbollah et le Hamas ne paraissaient qu’un conte d’horreur pour enfants pas sages. Même pendant les guerres, ici rien ne se passait. Les cafés étaient ouverts. Les plages bondées. On croyait à la coexistence.
C’est bien fini, la bulle.
Elle a éclaté, et même, Tel Aviv est devenue l’une des cibles principales des missiles depuis Gaza, depuis qu’ils ont augmenté leur portée. À cause de la proximité, mais aussi à cause du symbole : on n’a plus peur de s’attaquer au cœur de la société israélienne. Au contraire, c’est le message.
En témoigne aussi le nombre d’attentats qui ont eu lieu ces deux dernières années à Tel Aviv, chose impensable il y a cinq ans.
Les boums, on les sent fort. Ils font trembler l’immeuble.
Vendredi, avant shabbat, un bâtiment non loin de nous a été touché, a pris feu. On a entendu les pompiers.
Je demande à Matan : “Mais ils tombent où, ces gros éclats de missiles?”
“On ne sait pas. Ils ne le disent pas”. Pour ne pas faire peur aux gens, et aussi pour ne pas qu’ils connaissent mieux notre géographie.
Car, bien sûr, tout est écouté.
2
La Terre et le ciel
Je dois dire que j’ai peur à chaque fois que Matan sort dans la rue.
J’ai peur qu’il ne revienne pas. Tout est possible. Au mauvais endroit, au mauvais moment, un éclat de missile, ou une attaque.
Les trois dernières attaques que Tel Aviv à connues ces deux dernières années, c’est dans un périmètre entre 20 et 100 mètres autour de chez nous, sur le parcours sur lequel on sort le chien quotidiennement. L’une d’entre elles, on a évité le mec à deux minutes. On venait de partir en voiture. Il a tiré sur quelqu’un juste à l’endroit où l’on était, en face de chez nous.
Tout est possible.
Matan, il a peur que je me fasse attaquer. Il craint les surenchères des Arabes de l’intérieur, dont les réactions à l’attaque du Hamas, dans de nombreux endroits, ont été non équivoques : cris de réjouissance, Allahu Akbakh.
Je ne vais plus chez ma psy, qui habite au fin fond du quartier arabe de Yaffo, là où il y a des poules dans la rue, des gamins arabes sur leurs vélo, et des femmes voilées.
Là‐bas au détour d’une rue, c’est un autre pays.
Les caissières éthiopiennes chrétiennes de ampam, le supermarché sur Dizengoff, ont cessé d’aller au travail. Elles ne sortent plus de chez elles.
Elles ont peur.
La tension, on la sent sur le trottoir. Elle est dans le ciel aussi.
Le matin, la semaine dernière, à moitié réveillés avant l’aube, on entendait le chant du muezzin.
Nous on est dans le vieux nord de Tel Aviv, la ville qui s’étire le long de la mer, et en temps normal on ne les entend pas.
Mais là, quand la guerre a commencé, ils ont mis les baffles à fond la caisse.
Invasion de l’espace sonore. Menace de la voie sucrée – j’adore, l’appel du muezzin – sur le silence de la nuit noire.
Si nous on les entend comme ça, de l’autre bout de la ville, je n’ose imaginer ce que c’est pour les habitants plus proches.
Depuis cela s’est calmé, ou je me suis habituée. Je ne les entends plus.
Ce que j’entends, la nuit, ce sont les avions, et maintenant les hélicoptères. Ce sont ceux qui amènent en urgence, au grand hôpital de Ichilov, les soldats blessés.
Ce matin j’écoutais par hasard sur la télé australienne, l’interview d’un chirurgien spécialiste des blessures de guerre. Cela faisait une semaine qu’il n’était pas rentré chez lui. Il travaillait en capsule, avec trois autres collègues, non‐stop, quelques heures de sommeil dans la salle des docteurs, et retour au bloc.
Toute l’unité des soins intensifs, ils l’ont déplacée au troisième sous‐sol, à la place du parking, cause des missiles.
L’inverse du Hamas, dit la blague en Israël.
Le Hamas, il y a des années déjà, ont trouvé cette stratégie de génie en termes de guerre médiatique : l’hôpital, ils l’exposent le plus possible aux missiles : en y cachant les terroristes qu’ils mélangent le plus possible avec les malades, ils entendent mettre Israël dans une situation impossible et causer la mort du plus de civils possible.
Les kamikazes et boucliers humains étant leur arme par excellence. Ce faisant, pour les gentils Occidentaux des classes moyennes et les jeunes étudiants passionnés en tête de cause, une tête d’affiche disant que l’armée israélienne a bombardé un hôpital à Gaza, tuant plein de civils, voilà de quoi indigner comme il se doit l’opinion publique internationale. Ce n’est pas top en termes de Droits de l’Homme, mais ça vaut le coup pour le Hamas.
“We don’t care”, il n’arrêtait pas de dire à la journaliste. “On est là, on a les meilleurs médecins, on a les meilleures formations, le meilleur équipement, on est tous là jour et nuit, et on ne s’arrêtera pas.”
“We don’t care”
Cette manière crâne de répéter cette expression tellement désinvolte, comme s’il ne recevait pas chaque jour des gars entre la vie et la mort, risquant l’amputation ou la paraplégie à vie, à la minute près, c’est une manière tellement israélienne de supporter l’horreur.
On feint le flegme, on montre qu’on n’a pas peur, et surtout, qu’on est prêt à tout.
Et ce n’est pas étonnant : la société israélienne vit sous attaque constante depuis 1948, et avant. Ils ont vécu les pires trucs. Les pogroms d’avant la déclaration d’indépendance, les viols systématiques des juives pour intimider les nouveaux arrivés, l’attaque dès la déclaration Balfour… Amos Oz, dans son autobiographie, raconte l’embuscade arabe d’un bus d’universitaires en direction de Har Hatzofim, sous les yeux des Anglais impassibles. Ce bus dont son père aurait dû faire partie s’il n’était pas malade ce jour‐là. Il n’en était resté aucun survivant. Et ce n’était que le début. Tous les pays arabes qui se liguent contre eux, une fois, deux fois, trois fois, l’attaque surprise massive de Kippour, les bus qui sautent, les attentats kamikazes sans fin, les missiles au quotidien depuis qu’Israël s’était retiré de Gaza pour avoir un peu de paix.
Le flegme parfois impertinent de l’Israélien typique : “We don’t care”, se parle en réalité à lui‐même : il faut bien, pour continuer à vivre, se dire qu’on s’en fout.
Il faut bien se dire que même si des hélicoptères sanguinolents arrivent, même s’ils ont massacré 1400 humains (israéliens, arabes, palestiniens, touristes, civils, familles, militaires, bébés), violé, découpé, brûlé, et pire en quelques heures, même si on a le cœur en miette en pensant aux otages, au fond, ils ne peuvent pas nous toucher.
“Je peux faire ça pendant des mois, des années s’il le faut. Je ne m’arrêterai pas. Bring it”, dit conclut‐il comme un défi au micro de la journaliste ébahie.
C’est comme ça qu’on survit.
Avec l’humour, aussi.

3
L’humour sauvera le monde
Depuis le début de la guerre, on voit passer sur les réseaux sociaux israéliens pas mal de vidéos, de photos ou de sketchs assez drôles.
Il y a ceux d’Eretz Nehederet, un groupe de comiques similaires aux” Nuls” en France dans les années quatre‐vingt‐dix ou à SNL (Saturday Night Live) aujourd’hui aux États‐Unis.
De l’humour acide, très critique de l’ordre établi, irrévérencieux, qui se moque autant des politiques que de la beaufitude généralisée de la société civile.
Ils pratiquent beaucoup l’auto-dérision sur la société israélienne, et cela me rassure un peu sur l’état de la culture du “petit pays”, dont un délitement général de de la pensée se constate depuis quelques décennies.
En ce moment, Eretz Nehederet, ils prennent des événements marquants de ces jours de guerre, comme la vélocité de la BBC à accuser Israël d’avoir bombardé l’hôpital gazaoui touché par un missile envoyé en réalité par le Djihad islamique, et le temps que cela leur a pris de démentir l’information, ou la parodie de cette présentatrice télé égyptienne qui adressait un message à Israël en lisant son prompteur dans un hébreu translittéré incompréhensible.
Ils ont aussi fait une vidéo qui m’a beaucoup touché. On y voit une soldate qui fait l’appel devant son camion. Elle crie : “Quand je vous appelle par votre nom, vous montez!” Et de commencer sa liste :
“Anarchistes ! Bibistes ! Traîtres ! Gauchistes de m…! Racistes anti‐Arabes ! Vendus aux Arabes ! Ceux qui haïssent Israël ! Fondamentalistes ! » etc.
Ces noms doux, c’étaient toutes les insultes que ceux de gauche et de droite s’adressaient mutuellement, pendant les mois de manifestations à Kaplan et partout en Israël, au moment de l’opposition populaire massive aux réformes du gouvernement.
Et là ils se retrouvent tous ensemble, montant dans le camion vers un combat commun ; en se tapant dans les mains avec de larges sourires.
J’ai beaucoup ri aussi devant un montage photo qui circule sur les réseaux, à partir de la photo d’une manif je ne sais où (États‐Unis ? Allemagne?) mêlant drapeaux palestinien et arc‐en‐ciel, avec une grande banderole “Gays for Palestine.”
Le monteur avait apposé au‐dessus une photo de poulets, mêmes poses et mêmes drapeaux, avec la même grande banderole disant cette fois : “Chickens for KFC.” (une chaîne de fast food dédiée au poulet frit).
Car à Gaza, les homosexuels, on les pend, et ensuite on traîne leur dépouille attachée à une voiture, dans les rues, pour l’exemple. Je ne sais pas si les Gays for Palestine le savent.
Eretz Nehederet semble le savoir, et ne les a pas manqués non plus, ainsi que tous les jeunes woke américains (y compris les woke juifs d’extrême gauche comme Jews For Peace), qui ont tenté d’ignorer comme ils le pouvaient le difficile reality check du 7 octobre, car il était trop dissonant avec leur idéologie.
Face à la possibilité que les “militants pour la liberté” de la Palestine n’étaient peut‐être pas les héros – ou les victimes (on pense souvent les deux ensemble) – qu’ils croyaient, la plupart ont choisi le déni.
Les croyances ont souvent la tête plus dure que la réalité.
C’est pourquoi aujourd’hui, on entend dire ci et là que même les vidéos montrées par le Hamas sur ce qu’ils ont fait ne sont pas vraies. Que tout ce qu’Israël raconte n’est pas arrivé. La victime ne peut pas être coupable.
Alors à choisir, on sacrifie le réel pour protéger ses croyances.
Et la meilleure réponse que je connaisse, face au déni, c’est celle que je vois en ce moment chez les Israéliens : la parodie.
L’humour sauvera le monde.
Il y a aussi les soldats qui, depuis leurs bases, envoient des vidéos drôles sur Instagram, Tiktok ou Facebook. Il y en a un, Moshe Korsia, qui n’arrête pas de faire des courts sirtonim (petites vidéos) à mourir de rire. Dans l’une d’elles, il chante avec une belle voix de ténor en faisant le con, et en disant “c’est pour toi Azza, boubi (ma poupée), on va casser ta face” (le mot visage en anglais) avec des gros bisous à la caméra.
Sur une autre vue hier, un groupe se filme autour de son camion en imitant les gangsters d’un Western : music de saloon, poses crânes et regard menaçant sur la caméra filante, cigare à la bouche, la main caressant la moustache, tapotant le canon du fusil, minant de se raser au couteau.
J’ai ri, mais j’ai eu mal aussi.
Ils sont beaux. Ils sont jeunes. Ils sont en bonne santé. Leurs vêtements sont propres. Leur équipement aussi. Jusqu’ici, tout va bien.
Combien d’entre eux reviendront ? Et dans quel état ?
Tfou tfou ‘hamsa bli ayin ha ra.
Matan me dit qu’il y a une nouvelle mode, chez les soldats israéliens : se laisser pousser une petite moustache. qui me fait penser à Inglourious Basterds. C’est le mot qui passe en ce moment : “On va les baiser. Alors autant le faire comme de vrais acteurs porno”.
Humour israélien.
Il y a aussi l’humour qui parle d’amour.
Ils font beaucoup de petites vidéos où ils expliquent tout ce dont ils ont besoin que les civils leur envoient, à l’armée :
L’un filme une station de thé dans une base, avec un assortiment de sachets que n’aurait pas dénié un hôtel de luxe :
“Il nous manque du thé hibiscus rose”, commente la voix off.
Deux autres se filment avec un grand sourire et une liste de ce qu’ils ont absolument besoin et qu’il faut leur envoyer : “des shnitzelim”. Beaucoup de Shnitzelim ; “Guitares”. “Playstation 5”; “iPhone 14”. “Des Teslot (pluriel de Tesla, la voiture électrique de luxe), beaucoup de Teslot.” La liste est longue, et il n’y pas de limites à l’absurde.
Certains, à la fin de telles vidéos, rappellent que pour eux, les vrais héros, ce sont les femmes, restées à la maison, qui s’occupent des enfants, et leur envoient tout ce qu’il faut.
C’est leur manière : une drôle de pudeur.
Car c’est de la gratitude qu’ils expriment. Une façon de dire qu’ils ont tout ce qu’il faut, qu’on les a gâtés. Qu’ils vont bien. Qu’ils nous remercient. Qu’on va assez bien, sur le front, assez bien pour faire des blagues.
Bien sûr tous les jours certains d’entre eux sont blessés.
Hier soir, à Gaza, deux sont morts. Vingt ans. Faisaient‐ils partie de ceux qui avaient envoyé une vidéo drôle, la veille ?

4
Coping Strategies
Chacun fait comme il peut pour gérer l’incertitude, la peur, la peine.
L’autre jour, en plein milieu de la nuit, on a entendu des hélicoptères.
C’était tellement fort que Matan aussi s’est réveillé, et a vérifié son téléphone. “Ça doit être les otages”, me dit‐il, d’une voix à moitié endormie.
Il apprend en direct que deux autres otages viennent d’être libérées, deux Israéliennes, une vielle femme en fauteuil roulant, habitante d’un des kibboutzim du sud, et sa voisine. “On les emmène à l’hôpital Ichilov”
Ichilov, c’est le grand hôpital non loin de chez nous, au nord de Tel Aviv, où certains des blessés de guerre sont soignés.
Là aussi est hospitalisée la mère de Noa, la jeune israélienne vue sur les couvertures des journaux internationaux, au lendemain du 7 octobre, enlevée sur une moto, éplorée, les bras tendus.
On avait vu une annonce sur Facebook demandant de venir leur rendre visite, pour les soutenir.
On est partis à vélo à Ichilov pendant une pause déjeuner.
Il faisait beau, il faisait chaud. Matan regarde autour de lui, la rue, les gens, tout à l’air comme avant.
“C’est fou, me dit‐il. Ça pourrait être le début de la troisième guerre mondiale”, et tout le monde vit comme si tout était normal.
Il le faut bien.
On arrive à l’hôpital, dont l’immense rez‐de‐chaussée ressemble à un centre commercial. Des boutiques, des bars à jus, une librairie, un supermarché.
Une immense gerbe aussi, sur un pan de mur, avec des lumières en formes de bougies électriques, et les noms des morts.
Mais le gloss des commerces s’effrite rapidement quand on monte dans les étages. On arrive à celui des parents de l’otage.
On voit pêle‐mêle des soignants, des visiteurs, des bouts de pieds jaunis de malades sur brancards, des robes d’hôpital, des plateaux repas sous cloche en plastique à moitié mangés.
Lorsqu’on demande où est la chambre des parents de Noa, une femme, assise avec un petit groupe qui a l’air en bonne santé, nous interpelle : “On les attend ! Venez vous asseoir avec nous!”
Il n’y a plus de place. On s’accoude au muret, et on attend.
Ils arrivent. La mère, en chaise roulante, l’air faible, a un sourire collé au visage qui fait peur. Un sourire tout à fait absent. Un sourire de démence. Elle tend mollement sa main à ceux qui viennent la prendre.
Le père, maigre, tendu derrière elle, nous tient un discours diplomatique irréprochable qui ne me glace pas moins :
“Merci à tous d’être venus ; vraiment désolés ; on est très touchés, vous ne pouvez pas savoir. Ça nous donne de la force que vous soyez venus.
On est vraiment désolés, on ne pourra pas vous recevoir. On a une visite maintenant (du docteur, ou d’un membre de l’armée, je n’ai pas bien compris).
Alors vraiment, merci. Votre présence nous donne de la force.”
Il doit terminer avec des formules de circonstances comme des bénédictions, am yisrael haï, ou yahad nenatzea’h, je ne sais plus.
Matan et moi on se regarde interdits : comment fait‐il pour sourire ? Pour parler si poliment, pour se tenir droit, même ? Pourquoi s’excuse-t-il, comme un officiel devant un parterre de journalistes qu’il ne pourra pas recevoir ?
Il est vrai que cela fait deux semaines qu’il vivent avec “ça”.
Peut‐être ont‐ils pris cette carapace protocolaire pour survivre. Et je les comprends bien. La question demeure : comment vont‐ils gérer, à long terme ?
Le trauma, on l’intègre tous. Ou bien c’est lui qui nous insémine.
Les animaux aussi.
Shabbat dernier, on était chez des amis. Leur chienne n’arrêtait pas d’aboyer. Sur nous, dès qu’on bougeait d’un centimètre, sur n’importe quel bruit dans la rue, devant la porte.
Des aboiements perçants qui déchirent les oreilles, mais le cœur aussi.
“Elle est devenue folle”, dit tristement Rachel.
Rachel, sa maîtresse, elle vient d’arriver en Israël. Elle avait tout lâché il y a tout juste un mois, un magnifique poste dans l’un des plus grands musées de Londres, un bel appart, pour venir se marier avec Tsion, un Franco‐Anglais monégasque qui vit à Tel Aviv.
Elle a fait venir son chien, et puis c’est la guerre.
Les chiens sont en détresse, avec toutes ces sirènes.
Hier soir on est descendus aux abris, et le chien des voisins aussi, il n’arrêtait pas d’aboyer.
Nissim, notre chien, il reste calme. Il nous suit sans broncher dans les cages d’escalier quand sonne l’alarme. Il fait comme si de rien n’était.
Sauf que tous les matins, vers quatre heures, il se lève plusieurs fois, inquiet, et se poste devant nos visages, au‐devant du lit, comme pour vérifier si on est là.
Et presque chaque nuit, je ne sais pas comment il fait, il déplace son petit lit à grands coups de pattes, pour le coller contre le nôtre.
Le matin quand on se réveille, on voit son matelas bleu sombre contre le nôtre, et Nissim qui dort paisiblement, comme si de rien n’était.
Et je ne veux même pas parler des enfants. Eux ils donnent le change, ils continuent de jouer, comme si de rien n’était, mais personne n’est dupe. Ça rentre profond dans le système.
5
Arrière‐front
Hormis ces moments où la guerre soudain nous attaque de sa sirène tonitruante. C’est ça, la vie à l’arrière-front :
Presque tout est redevenu normal.
En ces derniers jours d’octobre, à Tel Aviv, il fait chaud comme un beau mois de juillet à Paris. C’est le ciel bleu. Les fleurs de monoï embaument dans les rues. Les chiens continuent de faire caca partout. Les filles de se promener en mini tenues de yoga.
Les amis ont recommencé à se retrouver aux terrasses qui ont rouvert.
C’est une façon aussi, pour les Israéliens, de défaire la guerre.
Ils ont l’habitude de la terreur.
Une des façons de résister, ici, c’est de continuer à vivre.
“Regarde”, semblent‐ils dire. Même pas mal. Même pas peur.
Même saignant au fond de nous – car on vit tous avec en tête quelqu’un au front, quelqu’un qui est mort, quelqu’un qui connaît un otage, ou un survivant. Même portant nos deuils, on va relever crânement le front, et aller le manger, ce houmous, du côté de Florentine.
Et si vous envoyez des missiles, on courra se mettre à l’abri, et puis après on ressortira, et on retournera à la même table de café, comme s’il ne s’était jamais rien passé.
On l’a vécu ce vendredi matin avec Matan.
Il y avait eu une première alerte à la maison, alors qu’on s’apprêtait à sortir prendre un sandwich après avoir préparé la maison pour shabbat.
On voulait voir aussi l’installation qui avait été faite autour de la fontaine de Kikar Dizengoff, des nounours en peluche géants aux yeux bandés et aux pattes souillées de tâches de sang, au nombre des enfants gardés en otage à Gaza.
On était sortis avec le chien, dans le ciel lumineux de fin octobre, lunettes de soleil et main dans la main. Arrivant au niveau du kikar, je m’étonnais de la voir si plein, alors qu’il venait de tomber des missiles.
Les gens à la terrasse du café, la queue à la boulangerie, les groupes d’amis posés sur les chaises en plastique ou le faux gazon qui entourent la fontaine.
Deux gamins Chabad postés de part et d’autre de la place ronde avec une petite table et un set de tefilin qu’ils font poser à qui veut bien s’arrêter et lire d’un air pénétré la bénédiction écrite en gros sur une feuille A4 plastifiée.
Ça me fait presque rire de voir ça. Je me dis, avant la guerre, peut‐être que le petit Chabad, il aurait été lynché pour avoir eu le toupet d’envahir l’espace sacré ‘hiloni de Kikar Dizengoff– Tel Aviv demeure l’un des seuls fiefs en Israël où on peut prétendre que la religion n’existe pas. Ils y tiennent. Et je les comprends.
Tout aurait semblé être comme un vendredi ordinaire, ne serait‐ce les bougies consumées qui ornent désormais le tour de la grande fontaine ronde, et aussi le sol.
Et les drapeaux, et les mots, et des photos de certains des morts, déposées par leurs amis ou leur famille, avec un mot, un nom, une déclaration d’amour, une fleur qui a maintenant séché, une bougie qui a brûlé et qui a pris aussi un peu l’eau.
Lorsqu’on s’assoit, désormais, sur l’une des places les plus connues du nord de Tel Aviv, on ne fait pas seulement face à la fontaine dont l’eau turquoise brille au soleil.
On fait face au nouveau mausolée et à ceux venus le visiter, allumer une bougie, pleurer, se recueillir.
J’ai grandi bercée de livres sur la première et la deuxième guerre mondiale, de récits de la Shoah. Et je réalise : c’est cela, vivre à l’arrière-front.
Une guerre, ça peut durer longtemps. Alors ‘il faut manger”, comme disait la mère Fisher de Six Feet Under. Il faut continuer à vivre.
Alors il y a cette drôle de dichotomie :
Ceux qui sont au front, et ceux qui ne le sont pas.
Ceux qui, comme mon ami Jérémie, ont tout lâché et vivent depuis plusieurs semaines en kaki, avec leur unité, sans lâcher leur fusil, d’opérations en repos à la base selon les ordres. Né dans une bonne famille française avec des aïeux militaires hauts gradés mais un côté juif caché qui ne lui avait pas échappé, Jérémie, après avoir accompli le désir du père et complété des études prometteuses à l’École Normale, était allé vers le sien : il avait fait son aliyah, s’était engagé dans l’armée au grand dam de sa famille, et il s’était retrouvé dans le feu de l’action. En 2014, il faisait partie de ceux qui étaient entrés à Gaza lors de l’opération Bordure protectrice.
Jérémie, je lui ai écrit hier. Comme je le craignais, il a été mobilisé tout de suite, dès le 7 octobre, et c’est là qu’on l’a envoyé de nouveau. Cela fait trois semaines qu’il est à la frontière de Gaza.
Je n’ose pas imaginer ce qu’il a dû voir, et faire.
Je sais le danger dans lequel il se trouve. Comme tous ceux qui sont là‐bas, et qui vont au combat chaque jour.
Et moi, dans les rues calmes et le chant des oiseaux, tout juste dérangée par des missiles de temps en temps. C’est oui, surnaturel.
On vient du même monde, on est à quelques dizaines de kilomètres l’un de l’autre, et on ne vit pas dans la même réalité. Lui il vit dans la guerre, et moi je fais partie de ceux de l’arrière-front.
Pour nous, le paysage n’a pas changé ; nos vêtements, nos occupations, sont les mêmes. Alors on vit dans cette réalité flottante. On a même le luxe de pouvoir oublier la guerre un instant, car tant qu’il n’y a pas d’alarme, tout est calme et lumineux ici, presque à l’ordinaire.
Certes, nombre d’entre nous font des choses qui sortent de l’ordinaire : cuisiner pour quatre‐vingt soldats de passage, aller aider dans un atelier de mode transformé en atelier de couture de gilets militaires multi‐poches, aller dans les hôpitaux visiter les malades, aller dans les hôtels où on a placé temporairement ceux du sud qui ont perdu leur maison où vivaient dans une zone de combat, pour faire faire des activités aux enfants.
Mais cela ne se voit pas sur la surface des choses.
Certes on voit des soldats dans les rues en permission, en uniforme ou en civil, toujours le fusil à l’épaule. Avec leur copine, leur chien, sur leur vélo, au supermarché.
On sait que dans quelques heures ils repartiront.
L’autre jour on en a croisé un en chaise roulante. J’ai refusé d’avoir pitié de lui.
Il mérite mieux que de la pitié.
Certes dans notre paysage, il y a désormais partout des posters des otages, noir et rouge, avec les photos qui font si mal. Et puis les grands posters blancs et bleu : “ensemble, nous gagnerons”
On a vite intégré tout ça au paysage. La culpabilité du survivant aussi, on l’intègre. Alors l’habitude, qui nous “prend dans ses bras comme un petit enfant”, comme le disait si bien Proust, nous fait presque oublier.
Et puis il y a une sirène, et on est choqués quand la guerre se rappelle à nous.
On vit dans une dichotomie qui déstabilise.
Je pense aux récits lus de Paris occupé, pendant la guerre.
Et les gens allaient quand‐même au café. Les femmes s’habillaient. La vie continuait. Il le fallait.

6
Cyber guerre
La vie continue, et on est touchés, à l’arrière front, par une autre dimension de la guerre.
On doit faire attention à tout ce qui passe par internet.
On nous dit d’éviter les zooms. Les terroristes hackent les zooms, notamment dans les écoles israéliennes. Parfois pour traumatiser les enfants avec des images d’horreur, parfois aussi, pour prendre contrôle de systèmes et les détruire.
On nous dit de ne pas répondre aux numéros de téléphones qu’on ne connaît pas. Ils essayaient de terroriser les gens avec des enregistrements d’horreur, des messages de menace, ou de prendre contrôle sur leur téléphone.
Pareil avec les groupes WhatsApp, qu’il ne faut surtout pas ouvrir. Nombre de faux groupes WhatsApp de hacking circulent. C’est sans compter les faux groupes, sur WhatsApp et Facebook, de soutien à Israël, pour récolter des fonds qui seront ensuite distribués au Hamas.
L’avantage c’est qu’on a compris la blague. Alors si vous avez donné récemment à un appel à fonds en soutien à la Palestine qui a récolté plus d’un milliard de dollars en quelques jours, sachez que vous avez donné à un groupe de nerds ultra‐orthodoxes juifs qui ont tout reversé à l’aide pour Israël.
Il faut bien jouer selon les règles du jeu.
Le jeu nouveau de cette guerre, comme toutes les performances du terrorisme global contemporain, est d’abord une guerre contre la terreur.
La semaine dernière une parano a pris tout le monde en Israël : des posts alarmants passaient sur Facebook, montrant des Arabes qui se promenaient dans les immeubles juifs et prenaient des photos. On a tellement eu peur, tous, qu’ils essaient d’entrer chez nous, comme ils avaient fait dans le sud – nos immeubles, nos appartements, n’ont pas de protection.
L’affaire a été démentie comme une rumeur, mais le parfum de peur était éloquent.
Être prudents, on est obligés, mais continuer à vivre est essentiel.
Et pour cela, les Israéliens sont pas mal : ils prennent de la force dans l’être ensemble.
7
Ensemble
Certes, ce resserrement des liens sociaux commence par un manque.
La plupart des femmes ici, leur mari, leur frère ou sœur, leurs fils et filles, leur cousins et cousines, ils sont au front. Donc l’absence, elles la vivent au quotidien.
Elles sentent le vide dans le lit, à la table familiale, et quand il faut gérer la maisonnée.
En Israël, les femmes ont en moyenne trois, quatre enfants – y compris chez les ‘hiloniot [les laïques] (chez les religieuses, ça va encore facile vers les dix, voire plus) pour deux chez les Françaises.
Alors les grand‐mères arrivent en renfort. La mère de Matan passe son temps, encore plus que d’habitude, de famille en famille, à prendre soin de ses petits‐enfants, surtout ceux dont les pères sont au front. L’une de ses belles‐filles, évacuée de chez elle car elle vit trop près de la frontière Nord, est chez sa mère. Elle a quatre petits, et elle doit bientôt accoucher. C’est dur pour elle, de ne pas être chez elle, d’avoir perdu ses repères.
C’est dur de ne pas savoir pour combien de temps.
C’est dur d’attendre son mari, sans savoir.
Joanna, une amie de la famille, nous dit que sa belle‐fille Karen ne dort plus. Son mari a elle a aussi été envoyé près de Gaza.
Alors les familles sont écartelées, les couples séparés, les enfants arrachés, mais la société se resserre.
Matan était rentré tôt ce vendredi matin‐là de promener le chien, avec une grosse ‘hallah, du vin pour shabbat, et un large ruban jaune au poignet.
« C’est pour les otages », me dit‐il.
On les distribuait dans la rue.
Oui, quelque chose dans le paysage urbain a changé.
On distribue des rubans pour porter avec nous le lien avec les disparus, pour se les rappeler les uns aux autres.
Et puis là où hier il avait des affiches partout, appelant à la “mered” la révolte, pendant des immenses manifestations du samedi soir où des milliers d’Israéliens protestaient contre les réformes et la direction ultra droite que prenait le gouvernement, une dissension interne qui a duré près de neuf mois et nous a fait frôler la guerre civile, aujourd’hui, les nouveaux posters ont comme inversé le message :
“Ensemble”. “ya’had nenatzea’h” : « ensemble, nous gagnerons », lit‐on sur tous les murs de la ville.
C’est beau.
C’est triste aussi, que les Israéliens – les Juifs en général – ne se souviennent de leur a’hdout (fraternité), que dans les moments où la survie est en enjeu.
Mais c’est mieux que rien.
Le jour de Kippour, il y a à peine plus d’un mois, il y avait eu un conflit sur kikar Dizengoff, qui avait secoué la société israélienne.
Une synagogue, où on va parfois le vendredi soir, avait décidé d’organiser une prière collective dehors, sur la place. Cela avait scandalisé les ‘hiloni de Tel Aviv, qui voient dans les manifestations religieuses dans les lieux publics de Tel Aviv comme des invasions, et des provocations insupportables. Le nœud de la discorde, c’était la me’hitza : c’était une communauté orthodoxe, qui priait avec une séparation symbolique entre hommes et femmes, et cela c’était insupportable pour les laïcs. C’était comme leur forcer un modèle d’être ensemble qu’ils refusaient de tout leur être.
Il y avait eu de la bagarre, et ils avaient fait dégager les priants par la police.
Cela avait beaucoup fait de remous dans l’opinion publique, dans les semaines qui ont suivi. N’aurait été le 7 octobre, le scandale aurait continué à faire parler.
Or m’a‑t-on raconté, dès le lendemain du shabbat noir, alors que les habitants du quartier s’étaient retrouvés comme un seul homme sur la même place pour envoyer des paquets aux soldats et allumer des bougies, un hiloni et un religieux qui s’étaient embrouillés à Kippour s’étaient reconnus.
Ils étaient tombés dans les bras l’un de l’autre.
Aujourd’hui, comme le disent certaines affiches, il n’y a “plus de gauche, plus de droite.”
Il n’y a que des Juifs. Des Israéliens, qui veulent que leur pays continue d’exister.
Aurait‐on enfin, ne serait‐ce qu’à la faveur d’une situation extrême, retrouvé un semblant d’unité ?
8
Prejugés
J’aimerais dire que oui.
La réalité semble plus complexe.
Tout d’abord, il y a les préjugés. Et cela, aucune guerre ne semble parvenir à en avoir raison.
Dammara, elle avait été appelée en urgence pour aider un soldat à se rendre, depuis Jérusalem, à sa base. Elle devait venir de Tel Aviv à Jérusalem, puis à la base, puis retour. En dernière minute. Ils avaient vraiment besoin.
Quand on est volontaire en temps de guerre, on ne choisit pas forcément ses tâches. On vous appelle. C’est toujours urgent ; c’est pour maintenant ; et c’est ça.
Donc elle est partie, avec son mari Sam, en voiture, vers Jérusalem, récupérer ce soldat.
Ils avaient besoin de quelqu’un de confiance, le rabbin les avait mis en contact avec elle et avait dit qu’on pouvait compter sur eux.
Et puis en chemin, Dammara suggère qu’on envoie directement son numéro au soldat en question, pour ne pas avoir à déranger les organisateurs à chaque fois, pour se trouver.
Super, lui a‑t‐on dit.
Alors elle a envoyé son contact whatsapp.
Sur son contact il y a sa photo. Dammara est noire. Sa mère est ashkénaze, son père jamaïcain.
Immédiatement, ils ont reçu un message :
“On n’a plus besoin, merci beaucoup.”
Dammara a dû faire demi‐tour et rentrer chez elle.
Moi, je suis blanche. L’autre jour, je voulais faire du volontariat dans un hôtel. Un ami rabbin m’avait donné le contact de la coordinatrice des activités pour les familles réfugiées du Sud dans un hôtel de Tel Aviv, il m’a dit qu’ils avaient cherché des activités de yoga et de méditation pour les familles.
J’ai contacté la fille, elle a eu l’air super contente. Elle m’a dit oui, super ! Elle m’a demandé mon nom. Je lui ai envoyé le lien de ma page Facebook et Instagram pour qu’elle voie ce que je fais.
“Alors le truc, c’est qu’on évite les activités religieuses”, m’a‑t-elle répondu.
“Aucun problème, je lui réponds. Je peux leur faire de la mindfulness laïque, je suis formée à ça aussi”.
Elle ne m’a jamais répondu.
J’ai essayé de la rappeler une fois, sans succès.
Apparemment, ils n’avaient plus besoin.
J’imagine qu’elle ne sait pas que quand je me promène dans la rue, en jean et en t‑shirt, ou pis, en tenue de yoga, les religieux me prennent pour la cause pour laquelle Dieu nous a punis.
Et quand je me promène dans la rue le shabbat, avec Matan, de blanc vêtus tous deux, lui la casquette et moi le chapeau, les hilonim de Tel Aviv nous lancent des regards noirs. Car c’est à cause de nous, et de notre politique d’extrême droite – car ils savent, en voyant nos silhouettes de loin dans la rue, pour qui on a voté, que les Arabes nous haïssent et nous ont attaqués.
Shabbat dernier, on a croisé un camion avec deux Arabes dedans.
Ils nous ont regardé avec haine.
Puis on a croisé sur le trottoir étroit un mec avec un Brompton, le même vélo anglais que nous. Matan lui a fait une blague pour sympathiser, le mec n’a pas compris et nous a lancé un regard de haine, en maugréant quelque chose de pas sympa entre ses dents.
Mettre les autres dans des boîtes, c’est ce qui permet, un jour, de tuer des inconnus aveuglément.
Où est la limite ?
9
Le rabbin en colère
L’un des plus grands mekoubalim d’Israël aujourd’hui vit dans un village presque à la frontière de Gaza.
C’est une personnalité intéressante, car bien que situé dans une lignée ashkénaze, il est d’origine mizrahi (du Moyen‐Orient) et, bien qu’ayant dédié sa vie, depuis vingt ans, à donner la Torah sans rien demander en échange, il vient d’un background universitaire, bouddhiste, très hiloni et très “smolani” (de gauche) comme il le dit lui‐même, un ardent militant de la paix avec les Palestiniens. Alors de sa posture singulière, il a une réelle compréhension des autres, et des complexités de la société israélienne.
Ce rabbin haredi, j’écoutais son cours une semaine après le début du conflit. Il fulminait. Je ne l’avais jamais vu si en colère.
Il commence par partager avec nous ce qu’il fait de ses journées, depuis le 7 octobre :
Il enterre.
Ils sont là, à chercher à rassembler des corps découpés, pour essayer de leur donner un peu de respect dans la mort. Une jambe ci, un doigt là. Ils essaient de faire coïncider des têtes avec des épaules.
Ils le font sous les missiles et sous les tirs de balles. Il en a enterré des dizaines, il en reste des centaines.
En attendant, les corps, parce qu’on n’a nulle part d’autre où les mettre, sont stockés dans des sacs, dans des camions réfrigérés de boucherie.
Le rabbin partage avec nous cette image qui l’a marqué : une petite silencieuse, debout devant la tombe ouverte où ont été déposés ses deux parents.
Souvent, des familles entières, dans la fosse.
L’une de ces familles, les deux parents et les trois enfants, ils s’étaient préparés, ce shabbat‐là, à aller faire voler des cerfs‐volants avec une famille palestinienne, de chaque côté de la frontière gazaouie, comme ils le faisaient chaque samedi depuis des années. Je me demande combien de temps la famille gazaouie les a attendus, de l’autre côté de la ligne désormais défoncée.
Deux frères morts enlacés dans les bras l’un de l’autre, pour un dernier câlin.
Voilà à quoi il occupe ses journées, à enterrer des morts, et à consoler les vivants comme il peut, en leur rendant visite en shiva.
Puis il nous dit que nous, les Juifs, on n’a toujours rien compris.
Certes, dit‐il “on fait les mitsvot comme jamais”. On est arrivé à un niveau d’excellence technologique insurpassé de la shkhitah (l’abattage rituel), on a la possibilité d’avoir facilement de superbes souccot, des ‘hallot ou des matsot sans gluten, on donne des millions pour les pauvres, les universités, pour avoir des bibliothèques prospères et des sifrei Torah bien décorés… Aujourd’hui, d’un point de vue technique, les Juifs accomplissent les mitsvot comme jamais…
Et ils ont oublié la plus essentielle, la seule qui compte :
“Ve ahavtah la reakhah kamokha”
“Et tu aimeras ton prochain comme toi‐même.” (Lévitique 19,34)
Il nous raconte que, depuis le 7 octobre, il entend et voit passer des commentaires, chez ses élèves religieux : “c’est parce qu’ils sont ‘hiloni” (laïcs) que ça leur est arrivé”; “C’est parce qu’ils ne gardaient pas le shabbat”. Notamment à propos des milliers qui étaient au Nova Festival. « Dieu les a punis”, ou encore “Dieu nous a punis, à cause d’eux”.
“Alors je vous explique », fulmine le rabbin tout seul devant sa caméra : « si je vois passer un seul, un seul message de ce genre, je vous vire et je ne veux plus entendre parler de vous !
Et ce que c’est clair ?
Et il faudra faire une très très sérieuse tshouvah (repentir)avec beaucoup de jours de jeûne, pour que j’accepte de seulement considérer vous reprendre comme élèves.
Je ne veux pas entendre un mot ! Pas un mot, vous entendez ? Pas un mot, contre ces Juifs saints qui sont morts. Ce sont des saints juifs, ils morts pour la sanctification du nom divin.”
Car le rabbin, qui connaît son audience, sait que l’humanisme ou l’éthique ne vont malheureusement pas convaincre ceux parmi ses milliers de followers orthodoxes ou ‘haredi qui ont proféré de telles paroles.
Alors il avance deux arguments halakhiques.
Le premier, c’est un principe énoncé dans le Talmud (Brakhot 20a): tout Juif qui est tué parce qu’il est juif, est considéré comme mort “pour la sanctification du nom Divin” (pour le kidoush hashem), la distinction la plus élevée que puisse faire un Juif.
Peu importe s’il était à un festival de musique le shabbat de Simhat Torah, peu importe qu’il ait des tatouages sur tout le corps, peu importe comment il a vécu.
Sa mort même devient la sanctification la plus élevée du Dieu d’Israël.
Le second, c’est le concept du Tinok she nishba : le « bébé en captivité » : c’est la catégorie halakhique qui encadre les juifs ayant grandi dans un environnement non‐juif.
Comment les ternir responsable, dès lors, de ne pas vivre selon la Halakha ? Le rabbin applique ce principe rétrospectivement à tous les Juifs non religieux victimes du 7 octobres : ils ont le statut de tinokot she nishe’ou. On ne peut les blâmer de ne pas garder les mitsvot, car on ne sait pas d’où ils viennent et ce à quoi ils ont été exposés, ou non.
Et il prend une grande inspiration.
“Et dites-moi, une petite fille de sept ans qui subit un viol collectif, dit‐il rageusement en regardant la caméra, elle a fait quelque chose?
Dites-moi, c’est de sa faute, ce qui lui arrive?”
Il souffle. Moi aussi. Il s’est décidément passé des choses qui dépassent mon imagination.
“Alors taisez‐vous Je ne veux pas entendre un mot, pas un mot !
Contre ces saints juifs qu’on enterre aujourd’hui. Oui je les enterre, avec tous leurs tatouages (les tatouages sont interdits par la loi juive, et c’est traditionnellement un problème pour pouvoir être enterré dans un cimetière juif), et ce sont des saints juifs, qui sanctifient le nom de Dieu.
Et vous, vous devez vous réveiller faire tshouvah. Et vite.”
Le rabbin pleure dans son âme, et au lieu de dépenser son énergie sur le fait de blâmer des “coupables” – le gouvernement, les terroristes, les ‘hiloni, il tente de nous réveiller.
Car il faut se réveiller.

10
War Porn 2.0
On a atteint un autre niveau.
J’apprends qu’une grande partie des vidéos récupérées vient de body cams attachés au fronts des terroristes.
Ils sont partis tuer en se filmant, voire, dans certains cas, en live streaming.
J’avais entendu parler, il y a quelques années, de cette nouvelle forme de porno : POV (point of view). L’homme, si j’ai bien compris, s’attachait une caméra sur le front, comme la lumière des spéléologues, ceux qui vont dans les grottes. Ainsi, le spectateur pouvait jouir du spectacle non pas de côté, comme un tiers, mais “comme” du point de vue de l’acteur. Comme s’il vivait l’expérience.
Oy ce qu’ils ont fait.
Ce faisant, on écrase la distance nécessaire au jeu. Il n’y a plus de jeu. Plus de distance. On essaie de faire comme si on était dans la réalité, en prétendant que le “comme si”, ce qui fait précisément le jeu, n’existe pas.
On devient terriblement premier degré.
Dans cette nouvelle forme de performance, toute la trilogie du jeu qui fait théâtre : un performant, une scène, des spectateurs, disparaît. Et on essaie de se faire croire que ce que l’on voit est ce que l’on vit.
La procuration essaie de se faire passer pour la réalité.
Oy vey sur nous, les humains, si on en est arrivés là.
Et on en est arrivés là : on a tenté d’abolir le sens du jeu.
Que ce soit dans le “jeu” sinistre du porn, ou dans la mise en scène obscène du meurtre, les performeurs veulent donner au spectateur l’impression de “faire lui‐même”.
Certaines de ces vidéos, les vidéos qu’ont partagé, parfois en direct, en live streaming, les meurtriers, les forces israéliennes ont décidé de montrer, dans un visionnage privé et sécurisé, aux journalistes internationaux .
Car la presse internationale nous demandait des preuves.
On en est là, secouait la tête, tristement, Matan.
On n’a même pas le temps de pleurer nos morts. On n’a même pas l’espace de se recroqueviller sur nous‐mêmes pour faire le deuil tout ce que l’on sait, et de tout ce que l’on ne sait pas.
Il faut prouver qu’on ne ment pas.
Car pour l’opinion internationale, qui aime tellement le noir et blanc, l’”oppresseur” (Israël), ne peut pas être victime. On doit bien mentir, ou exagérer quelque part.
C’était trop dissonant avec l’image qu’on avait de nous, et l’image qu’on avait d’eux.

11
Reality check
Alors c’est à nous qu’on l’a demandé, le reality check.
Figurez‐vous que la presse internationale a demandé des preuves des choses atroces qu’on avançait. Les bébés décapités etc.
À croire que les films d’horreur qui passaient sur les réseaux sociaux ne suffisaient pas.
Je me demande si on leur avait demandé, à l’époque, aux Rwandais en deuil devant leurs familles mutilées, des preuves en images.
Je vois passer l’extrait du journal d’une télévision américaine, où la présentatrice blonde interviewe un reporter asiatique qui a vu le footage que l’armée israélienne a donc accepté de partager à un parterre de journalistes internationaux.
Avant même de l’interroger, elle dit à la caméra : “Je veux prendre un moment, et dire à notre audience que ce que vous allez raconter est extrêmement graphique, et extrêmement violent et choquant”.
“J’ai lu moi‐même une partie de votre rapport, et je peux dire que c’est extrêmement graphique, et extrêmement violent et choquant, donc je veux avertir notre audience.”
C’est le temps qu’elle laisse à chacun de faire le choix pour lui‐même : rester, et écouter, ou couper la télé. Il ne s’agit même pas d’images. Il s’agit du rapport verbal d’un journaliste. Et même de cela, on nous met en garde contre la violence de ce dont il va témoigner, même au troisième degré.
Je sens bien sûr monter en moi la curiosité, la curiosité morbide, l’attirance du vide. Celle‐ci, on l’a tous, on est humains.
C’est pourquoi les vidéos et récits qui tournent partout en ce moment ont un tel succès. Qu’on l’admette ou non, on est tous attiré par l’horreur.
Comme par les chips et autres junkfood addictives. Comme par le bingewatching. Comme par le sexe facile.
Tout ça, c’est une seule et même chose : l’attirance par les instincts les plus bas.
A‑t‐on vraiment besoin de savoir les détails de jusqu’où ils sont allés ?
A‑t‐on vraiment besoin de le voir, ou de l’entendre ?
Et que va‐t‐on faire, après, avec ces images qui tournent dans la tête ?
Il n’y a pas une personne que je croise qui ne me dit pas d’un air triste qu’elle a vu quelque chose qu’elle n’aurait pas dû voir. Quelque chose qui l’a traumatisé, et qui ne la quitte pas.
Pourquoi se fait‐on cela ?
Le Talmud nous met en garde. Il y a des choses vers lesquelles il ne vaut mieux pas tourner son regard.
Si on veut que la vie en nous reste vivante, il faut se préserver de l’horreur.
Il faut avoir la force de s’empêcher de faire ce qu’a fait la femme de Lot, juste dans la parasha de la semaine dernière, Vayera : elle a regardé en arrière, vers Sodom détruite et en flammes.
Elle n’a pas pu s’empêcher de se tourner pour regarder l’invoyable. Et elle s’est retrouvée paralysée à vie, transformée en statue de sel.
Combien de statues de sel aujourd’hui, marchent dans la rue, font leurs courses, vont au travail tant bien que mal, avec quelque chose dans l’âme qui a été abîmé à jamais ?
Et puis le système est pervers jusqu’au bout : parfois, le fait même de se connecter à un réseau, c’est ouvrir la boîte de Pandore. Sur YouTube, sur Facebook au moins, on peut choisir de cliquer ou pas. On peut voir de loin, en flou, et décider de s’éloigner.
Mais pour ceux qui sont allés sur Instagram, et qui ont eu le malheur de cliquer sur un “reel”, en voici un autre qui leur saute au visage, sans qu’ils l’aient vu venir.
Matan, hier soir, est venu me voir. Il n’était pas bien.
“J’ai vu quelque chose de difficile”, il a dit.
“Un reel, sur Instagram. Je ne l’ai pas vu jusqu’au bout. J’ai coupé tout de suite. Mais c’était trop tard.”
Je lui demande s’il veut me raconter, pour ne pas être tout seul avec ça.
Je sens aussi la curiosité morbide qui monte en moi.
“C’était quoi?”
Il refuse de me dire. Il a un air triste.
Il me dit juste un mot. “Cadavre.”
La vidéo impliquait un cadavre. Il n’a pas voulu m’en dire plus.
Il a coupé tout de suite, mais c’était trop tard.
Il avait vu juste un peu trop. Il était abîmé.
J’ai compris plus tard qu’il s’agissait de quelque chose qu’on faisait à un cadavre de femme.
Pas besoin de savoir plus.
Il faut détourner le regard.
Mais pas seulement pour nous. Pour eux.
12
Pudeur
En tant que Juifs, on a l’obligation de détourner le regard.
Selon le Talmud (Bava Batra 60a‑b), les tentes d’Israël dans le désert, elles sont dos à dos : il n’y a pas d’ouvertures face à face, pour préserver la pudeur des intérieurs.
On protège l’intimité du vivant en la voilant.
On protège encore plus l’intimité de la mort.
Lorsqu’on voit des vidéos violentes, il faut détourner le regard. Pas seulement pour se protéger, nous. Mais aussi par respect pour les victimes. Les vivants, comme les morts.
Chez les Chrétiens, il y a cette tradition du cercueil ouvert, pour la veillée mortuaire.
Le mort est habillé, souvent de ses plus beaux vêtements, maquillé, et puis pendant des heures, parfois des jours, les proches et amis viennent le “voir”, lui faire ses adieux.
Chez nous les adieux, ça se fait devant un sac.
Sous le sac, une forme humaine, oblongue, avec une aspérité à chaque extrémité : la petite colline de la tête, le petit pic des deux pieds. Dans le sac, un corps nu, souvent enveloppé d’un tallit blanc.
Le sac sur le brancard, que ceux de la 'hevra kadisha et quelques‐uns de la famille, porteront ensuite, vers la tombe.
Chez nous, on enterre le plus vite possible. On ne laisse pas le mort exposé à la vie, aux mouches, ni les vivants exposés à la mort.
C’est pour cela aussi, et pas seulement parce que les Juifs avaient déjà, en tant que rite, l’habitude de se laver les mains souvent – le matin, avant un repas – qu’ils mourraient dix fois moins de la grande peste, au Moyen Âge.
C’est aussi pour cela, à l’époque, qu’on les avait pourchassés, traqués et tués. On n’aime pas le Juif fort. On ne pardonne pas à Israël d’avoir acquis une puissance.
On oublie que ce sont des réfugiés et des survivants qui ont fait cet État, et qui sont arrivés, eux aussi, la clé autour du cou d’une maison qu’ils ne reverraient jamais, une main devant, une main derrière. Mais ils avaient décidé, eux, de regarder devant.
On regarde la vie, pas la mort.
Et les morts, on les laisse tranquille.
Rachel, qui est curatrice d’art contemporain, me racontait à quel point elle était choquée de la licence des partages des images des mourants et des morts depuis le 7 octobre, notamment par contraste : l’année dernière, alors qu’elle organisait une exposition sur Lee Miller, la seule photographe de guerre femme à avoir été présente au moment de la libération des camps de concentration en Europe, le comité éthique de son musée s’était torturé la tête pendant six mois pour savoir comment faire.
Comment, à la fois, montrer la vérité, témoigner de l’Histoire, et rendre compte d’un travail humain et artistique remarquable, tout en préservant la pudeur et le respect des morts ?
Ces questions éthiques qui datent d’à peine il y a quelques mois, elles semblent appartenir à un siècle aujourd’hui. Comme si l’ère de l’auto-production et des partages dérégulés avait tout balayé. L’autocensure comme la pudeur.
Chez nous, le respect des morts est l’un des devoirs les plus importants des vivants. Dans les prières du matin, c’est l’un des principes essentiels de l’éthique de la générosité qui nous incombe, avec ceux d’accueillir les invités, d’aider le pauvre, de visiter le malade, de respecter ses parents, et de réjouir la mariée.
Alors par respect les morts, on les enterre tout de suite, avant qu’ils ne pourrissent. On les rend à la “poussière de la terre” (afar min ha adama) (Genèse 2,7), se souvenant que l’on vient de là et qu’on y retournera : la terre (adama) dont l’humain, (adam) porte si bien le nom.
On a fait ça la semaine dernière.
On a rendu à la terre la mère de Pierrot, Paulette, une Juive alsacienne morte à 97 ans, qui en avait vu des guerres, en son presque siècle de vie. Elle avait un Alzheimer très avancé. Je ne sais pas si elle était consciente de ce qui se passait. J’espère pour elle que non.
On était à son enterrement à Jérusalem, l’un de ses petits‐fils, posté près de Gaza, avait eu la permission de venir. Il était là aux côtés de son père à la chemise déchirée, en uniforme. Il repartirait juste après. La famille témoignait : cela faisait bizarre d’être là à un enterrement “normal”, de quelqu’un parti de sa belle mort, en plein milieu de la guerre alors que, dans les cimetières militaires, les convois d’enterrement se succèdent les uns après les autres, et qu’on demande aux familles, à cause de l’affluence, d’avancer vite pour qu’on puisse procéder à l’enterrement suivant.
Paulette de mémoire bénie, sa metapelet (sa soignante) philippine, dans un dernier adieu s’était jetée sur le brancard, caressant les petits pieds raides sous le sac de toile, en pleurant, dans un dernier adieu à son employeuse de nombreuses années, qu’elle appelait “maman.”
C’est ainsi, la vie continue, et la mort en fait partie. Chen va accoucher, et Joanna célèbre la semaine prochaine la bar mitsva de son premier petit fils.
Et puis il y a les mariages. En uniformes parfois (souvent pour les deux), dans des tanks s’il le faut, dans des bases, des jardins, à dix ou avec toute l’unité, sous une ‘houpa improvisée qui est la plus belle qui soit : un tallit brandi à portée de main par les amis des mariés. On célèbre la vie, coûte que coûte.
Et sa lumière n’en étincelle que davantage d’être si juxtaposée à l’ombre.
Mais quand même, je me suis surprise à être contente de ne pas avoir d’anniversaire ou de célébration en cette période. À être soulagée qu’on soit en heshvan, et qu’il n’y ait pas de fête à préparer, à célébrer.
La prochaine qui nous attend, début décembre, c’est Hanoukka.
On sera sûrement encore en guerre, vu la tournure globale que prennent les choses.
Hanoukka, la fête de la victoire de la lumière sur l’obscurité, la commémoration de la lutte courageuse d’une minorité détestée contre un Empire voulant annihiler toute trace d’une culture sur sa propre terre, sera au moins de circonstance.
Pourim, en Mars, encore plus : le récit de la Megilat Esther raconte le dessein déjoué d’un royaume dont certains avancent qu’il serait situé en Perse ancienne, d’annihiler tout le peuple juif.
Serons‐nous encore en guerre ?
Où en sera le monde ?
Mais nous n’en sommes pas là.
Aujourd’hui il faut continuer à vivre, et se protéger l’âme.
13
Traumatisme au carré
Car après le choc du 7 octobre, est venue une seconde couche de douleur.
Celle‐ci n’est pas physique, mais elle nous blesse encore.
Elle est infligée par le silence de certains, et les paroles d’autres.
Certes, il y a eu la présence, le soutien exprimé, presque immédiatement, par les nôtres. Non seulement nos amis et proches juifs, mais aussi ceux, dans le monde non‐juif, qui ont fait partie de notre vie :
amours de jeunesse, amis du fin fond des âges, anciens voisins, collègues oubliés, tous ces gens avec qui on n’avait pas parlé depuis quinze ans.
Ceux qui avez pensé à écrire, et qui l’avez fait, merci. Je vous remercie du fond du cœur.
Peut‐être que certains d’entre vous jugeaient limite que l’on ait choisi d’habiter l’État sioniste qui pratique l’apartheid et opprime les Palestiniens. Si c’est le cas, merci d’avoir mis cela de côté, tout simplement pour demander si on allait bien. Ou pour exprimer votre choc, de ce que l’humain avait fait à l’humain. Merci.
L’amour sauve le monde.
Bon, la famille, c’est une autre histoire, n’est-ce pas ?
Dans les familles mixtes, comme la mienne, ça a été un panaché. Il y a eu ceux, “juifs du mauvais côté” devenus comme leurs parents, fidèlement antisémites et incapables de prononcer le mot “Israël”, qui n’ont cependant pas réfléchi à deux fois avant de prendre leur téléphone. Il y a eu les Chrétiens, croyants ou athées, qui ont témoigné leur soutien et leur amour. Et puis il y en a eu d’autres, Juifs assimilés ou à moitié, dont on n’a entendu un traître mot.
Pour certains amis que l’on croyait proches, juifs ou non, pareil.
Autour de nous, c’est comme en Allemagne après la Kristallnacht : depuis le 7 octobre, le contenu des boîtes mails et WhatsApp trace une ligne de démarcation révélatrice : il y a eu ceux qui se sont révélés présents, et ceux qui se sont révélés, soudain, par un silence inattendu.
Et puis il y a eu les autres voix. Celles de la foule : l’opinion internationale.
C’est cela que j’appelle le “traumatisme au carré.”
Ce n’était pas assez que l’on soit là, tremblant sous le choc et pour l’avenir de notre pays. Il a aussi fallu recevoir les déferlements de haine.
Cela a été immédiat.
Dès le lendemain du 7 octobre ont commencé les réactions passionnées, partout dans le monde. Il y a eu tout de suite deux camps :
Ceux qui, chrétiens ou juifs, musulmans ou athées, de par le monde, élevaient leur voix pour exprimer leur peine, et leur soutien à Israël.
Et ceux qui, à grand coups de “Free Palestine”, se réjouissaient souvent ouvertement de ce qu’on nous avait fait.
À mon échelle, je n’ai reçu que des allusions de vaguelettes de ce nouveau séisme.
Le dimanche 8 octobre, encore sous le choc, j’avais envoyé un email à ma mailing list. J’ai proposé un zoom de méditation pour la résilience, pour le lundi 9 octobre.
La première réponse était un email très court de quelqu’un que je ne connaissais pas. C’était un message en deux mots : “fuck israel”.
Quand j’ai posté mon invitation dans un groupe de méditation juive sur Facebook, le premier commentaire était d’une femme avec un nom allemand. Par rapport au gentleman mentionné ci‐dessus, il y avait eu un progrès : on était passé à quatre mots. “Israel is a war criminal”, écrivait éloquemment cette citoyenne du monde qui avait dû se perdre sur les réseaux sociaux pour se retrouver comme ça, dans un groupe de méditation juive certainement lié aux lobbies de l’État sioniste.
Le jour même, j’ai vu par hasard un post de l’écrivain Marianne Williamson, qui candidate aujourd’hui pour la présidence américaine.
Un long message sur Instagram qui m’avait un peu réconforté. Elle se contentait de dire qu’il n’y avait pas de débat, juste du deuil. Au lendemain du 7 octobre, elle se disait simplement écœurée, le cœur lourd de tristesse.
Elle rappelait qu’elle, d’ordinaire la première à faire des remarques à Israël quant aux droits des Palestiniens, prenait une position ici non équivoque : le terrorisme, disait‐elle à ses millions de followers, est humainement intolérable. Point.
Et voilà que les premiers commentaires apparaissant sous son post, ce sont des messages haineux, des reproches : “Marianne, tu m’as déçue”, “ah oui, et où étais‐tu quand Israël bombardait Gaza l’été dernier”, etc.
J’ai fermé Instagram.
Depuis, je me protège comme je peux. Je sais que je n’ai rien vu. Et c’est le but.
Je me détourne de toutes les images, vidéos, discours, de haine.
La haine d’Israël, elle est comme la mer face au ciel : elle reflète sa couleur. Elle lui est indissociable.
D’ailleurs, pour les kabbalistes, la haine du non‐Juif à l’égard du Juif est le reflet de lui‐même – en particulier de ses propres actions. Elle est le miroir de notre capacité à vivre une véritable éthique, à incarner le “ tu aimeras ton prochain”.
Dans cette perspective, l’antisémitisme enflammé d’aujourd’hui n’a rien pour nous étonner.
D’où qu’elle vienne, la haine, c’est un poison. Un poison pour l’âme.
Alors je me protège.
Je ne regarde pas les échanges vains, je ne lis pas les polémiques qui tournent en boucle.
Hier par hasard, sur je ne sais plus quel réseau, je suis tombée sur une vidéo d’une manifestation pro‐palestinienne sur Time Square, à New York.
New York, ville de mon cœur. Ville où j’ai vécu trois ans, mariée avec Akiva.
Ils sont là, des Arabes, des blonds, des Noirs de tous pays, visiblement tous très concernés par la « cause palestinienne » et de ce petit bandeau de terre à l’histoire si complexe qui a catalysé leur combat le plus enflammé pour la justice dans le monde, le drapeau palestinien brandi, les yeux allumés, des cris de rage, ou de grands sourires en faisant des doigts d’honneur aux passants et à la caméra, ou en montrant des visages d’Israéliens morts sur leurs portables.
Je me demande : qu’aurait dit l’opinion internationale si, après les massacres au Rwanda ou en Bosnie, il y avait des gens du monde entier, ni rwandais, ni bosniaques, à manifester pour l’agresseur, à se réjouir, et à promener fièrement des vidéos des victimes expirant ?
La haine du Juif, repimpée sous les habits de la libération de la Palestine, est en bonne santé. Y compris chez les soi‐disant éduqués. Ma copine juive anglaise me disait son douloureux étonnement d’avoir vu soudain la moitié de ses collègues de la Tate Modern de Londres, à une manifestation pro‐palestinienne. Y compris chez la jeunesse brillante à l’esprit critique des campus européens et nord‐américains, comme semble en témoigner l’action enthousiaste “libérez la Palestine” en réponse aux massacres du Otef Aza. Ils n’ont pas bien réussi à me convaincre du lien entre le projet de libérer la Palestine et ce qu’a fait le Hamas. Oui pour un peuple libre !
Je ne vais pas dépenser plus d’énergie sur la haine se déversée sur nous depuis début octobre, ni sur la mauvaise foi remarquable dont elle se maquille comme une voiture volée.
Je dirais juste ceci : aux woke bien‐pensants pour qui le pogrom du 7 octobre est l’occasion de relancer un débat sur la libération des peuples opprimés, je préfère les masques de haine qui crient “mort aux juifs” en brandissant des fonds d’écran de croix gammés. Au moins, ça a le mérite d’être honnête.
La pudeur, le monde n’en n’a plus.
Alors ayons‐en, nous, un petit peu.
Il faut choisir vers où on tourne son regard.
14
Chance
La guerre nous appelle à la prudence, la guerre nous appelle à la pudeur.
Elle nous appelle aussi à une grande humilité.
Car une autre chose qui la caractérise, c’est le hasard total.
Appelle cela la chance. Le destin. Hashgakha Pratit (l’appétence, selon la pensée juive, du divin à veiller aux détails – c’est à dire au destin de chaque individu).
La vérité c’est cela : aucun de nous n’a vraiment de contrôle sur la réalité. On ne sait pas. Qui vivra, qui mourra, qui subira quoi, qui sera épargné.
On ne sait pas par quelles séries de hasards, ou de malchances, l’un sera sauvé, l’autre pas.
Woody Allen aussi semble fasciné par ces questions. En 2005, il avait fait un film sur le cynisme du hasard, Match Point. Dix ans après, il avait développé le même thème, en 2015, avec Irrational Man. Et j’apprends à l’instant qu’en septembre de cette année, il vient de sortir un film au titre encore plus explicite : Coup de Chance.
Je ne peux m’empêcher de repenser à Ounetané tokef, ce poème que l’on dit plusieurs fois lors des prières de Rosh haShana et de Kippour, et qui nous décrit toutes les manières dont certains d’entre nous vont mourir dans la nouvelle année.
On ne sait pas qui, on ne sait pas quand, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment.
Qui vivra et qui mourra?
Qui vivra le temps qui lui a été imparti et qui disparaîtra avant la fin de ce temps?
Qui périra par l'eau et qui par le feu?
Qui mourra par le glaive et qui par une bête sauvage? (...)
Cela résonne étrangement avec les événements du shabbat Simhat Torah. Et pour les otages et leur familles, on est encore à ces questions.
On ne sait pas. On ne peut que témoigner.
L’autre jour, je lisais le récit d’un pilote de tank qui se trouvait non loin de la fête du désert transformée en boucherie, ce shabbat‐là.
Il était arrivé avec son tank et ses gars, ils étaient 4.
Ils ont été immédiatement entourés et attaqués de toutes parts, grenades et missiles antitanks.
Presque tout de suite, le commandant est mort, puis les deux autres à l’intérieur. Il s’est retrouvé seul avec un tank en feu, essayant de disperser les terroristes pour faire gagner du temps aux survivants, qu’ils évacuent. Ils s’est retrouvé entouré ; ils sont montés dans son tank. Il s’est retrouvé à l’intérieur, le fusil vers l’entrée, en haut, shootant ceux qui essayaient d’entrer ; ils ont fini par jeter des grenades à l’intérieur et l’ont laissé pour mort.
Le tank brûlait, il a mis son casque, son gilet pare‐balles et il est sorti avec son fusil.
Il a réussi à se cacher dans la forêt.
Ils étaient trop nombreux.
Lorsque cinq Arabes sont arrivés près de lui, déjà blessé, allongé sur la terre, il a fait le mort.
Ils n’avaient pas d’arme.
Ils se sont approchés pour s’emparer de son fusil. Alors il s’est défendu. Ils ont pris des rochers, à cinq sur lui, et lui ont fracassé la mâchoire, les pommettes, les dents, l’ont planté de coups de couteau partout.
S’il n’avait pas eu son casque sur le crâne et son gilet, il serait mort.
Il lui ont arraché son fusil, lui ont tiré dessus.
Par miracle il n’est pas mort.
Il a réussi, il ne sut comment, à se traîner dans un autre bosquet épais, où il a trouvé deux autres survivants. Ils l’ont aidé à éponger l’hémorragie sur son visage. Ils sont restés comme ça des heures, peut‐être six, jusqu’à ce que l’armée arrive.
À l’hôpital, quelqu’un l’a reconnu. Il lui a demandé si c’était lui qui avait sauvé des centaines de personnes à la fête, avec son tank.
Combien de fois avait‐il failli mourir, combien de chances a‑t‐il connues, ce héros dont je ne connais pas le nom, qui a réussi à s’en sortir ?
Je ne peux m’empêcher de repenser à la Shoah, aux récits des survivants, qui relatent combien de hasards, combien de circonstances folles, l’une après l’autre, il a fallu, pour qu’ils survivent. C’est ce que racontent Elie Wiesel, Victor Frankel, Imré Kertesz.
Ce chauffeur de tank a eu un courage incroyable. Il a aussi eu de la chance, et il le sait.
L’histoire est toujours racontée par ceux qui sont revenus.
Ceux qui ont eu moins de chance ont disparu dans leur silence.
Hersch a eu moins de chance.

15
Bloody wisdom
Hersh Goldberg Polin, c’est l’un des 241 otages encore détenus à Gaza.
Ou peut‐être est‐il mort, on ne sait pas.
J’aurais préféré ne pas connaître son nom. Car je le connais comme une victime.
J’ai suivi son histoire d’un peu plus près parce que l’une des participantes américaines de mon cercle de femmes de Rosh hodesh, a posté sur notre groupe WhatsApp, la semaine dernière “je viens d’apprendre que le fils d’une amie est l’un des otages à Gaza.”
Il y a quelques jours, par hasard, j’ai vu passer sur YouTube une vidéo titrée du nom de l’amie en question, qui prononçait un discours à l’ONU.
Cela titrait « la mère d’un otage raconte l’histoire de son fils”.
Titre aguicheur comme sait le faire la presse.
C’était tellement, tellement plus que cela.
Certes, elle commence par raconter ce qui s’est passé, ce matin‐là.
Ils habitent à Jérusalem, le fils était parti le vendredi pour le Nova festival.
Le samedi matin, réveillée elle aussi par des missiles, elle avait allumé son téléphone.
Elle avait reçu deux messages successifs : “I love you.”
Puis “I’m sorry”.
Le téléphone n’était déjà plus joignable.
Elle avait compris que c’était grave.
Le reste, elle l’a appris de la bouche de témoins qui avaient fait les morts, enfouis sous un tas de cadavres, et par une vidéo du Hamas, où on voit son fils, dont l’un des bras devenu un moignon saignait abondamment, emmené dans un camion avec d’autres survivants que l’on prenait en otage.
Hersh, avec d’autres participants, s’était réfugié dans un abri.
Les terroristes avaient jeté grenade sur grenade. L’ami de Hersh tentait de les ramasser les unes après les autres, au plus vite qu’il pouvait, et de les jeter dehors avant qu’elles n’explosent.
Mais il n’a pas tout pu rejeter.
La grande majorité étaient morts.
Ils étaient entrés, laissant la fumée se dissiper, et avaient demandé aux survivants de se relever. Hersh s’était levé, l’un de ses bras avait été arraché.
“Nous vivons sur une autre planète”, sa mère articule froidement, sobre, robe anthracite, cheveux tirés.
Elle, sa vie s’est arrêtée depuis que son fils a été pris, et elle ne sait pas s’il est mort, alors, le 7 octobre, d’hémorragie dans le camion, ou s’il est vivant, ou s’il vient de mourir, il y a cinq minutes. Elle ne sait pas.
“Un signe de vie ! On ne peut pas avoir un signe de vie.”
“On a l’air d’appartenir au même monde, vous et moi, mais nous – elle parle au nom des autres familles des otages – depuis le 7 octobre, nous, nous vivons sur une autre planète ».
Et alors elle délivre son message.
Cela va tellement plus loin que le témoignage d’une mère d’otage.
Glacée de peine, elle réussit à s’extirper de son effondrement personnel pour nous rappeler que ce qui se passe, nous concerne tous : car cela nous parle de l’humain.
Elle nous rappelle que l’on a tous un ennemi commun : la haine.
Je crois qu’elle ne parle même pas des Israéliens et des Palestiniens. Elle ne prononce même pas le nom Hamas. Elle parle à un niveau beaucoup, beaucoup plus large.
“C’est tellement facile, de haïr, nous rappelle‐t‐elle. C’est tellement tentant.” Et c’est notre plus grand piège.
C’est cela la force de son message.
Droite comme une flamme brûlant de douleur, elle brille de clarté.
Son message à l’ONU, c’est un appel pour l’humanité, à se réveiller.
Et elle ne partage pas seulement sa mise en garde, contre une haine qui nous pousse à nous entre‐tuer. Elle partage aussi avec nous un espoir.
Son espoir, dans l’humanité, c’est de savoir que ce jour‐là, c’est un Arabe, musulman, qui a essayé de les sauver, ces jeunes.
Le Bédouin qui gardait la porte du kibboutz leur avait dit de se réfugier dans cet abri, il avait poussé la porte, et il s’était mis devant.
Quand les terroristes étaient arrivés, il leur avait parlé en arabe : “Frères, je suis un musulman comme vous, c’est ma famille à l’intérieur, ne leur faites pas de mal.”
Ce qui avait touché la mère de Hersh, c’est qu’il avait dit cela : “c’est ma famille.”
Les témoins avaient entendu les coups par lesquels le Bédouin s’était fait sauvagement frapper. Ils ne savent pas ce qui lui est arrivé.
J’ai jeté un coup d’œil aux commentaires de la vidéo.
“Pauvre femme, c’est atroce”, “son enfant, je suis mère moi‐même, je ne peux pas imaginer”.
Et je me dis : ils n’ont rien compris.
Ils sont restés collés au biographique, au sensationnel, au drame.
Elle, elle avait tout fait pour s’élever au‐delà de cela, et pour nous délivrer un message d’humanité, pour l’humanité.
Un wake up call.
Bloody wisdom. Qu’au moins, on l’écoute.

16
Héros
Qui vivra et qui mourra?
Vraiment, “le caché relève de Dieu” (Deutéronome 29,28).
Une autre jeune fille qui était à la fête était invitée la semaine dernière à la télé américaine.
Elle racontait comment, par une série d’heureux hasards improbables, elle avait survécu à l’attaque.
Elle était allée aux toilettes, juste avant que les terroristes n’y entrent et ne tuent tout le monde. Ils s’étaient enfuis, dans la bonne direction.
Ils avaient trouvé un flic seul, échappé du poste de police dont ils avaient pris le contrôle. Il ne pouvait appeler du renfort car ils avaient pris le contrôle de sa radio.
Ils couraient, marchaient, couraient, entre champs et chemins.
Ils étaient arrivés près d’un fossé, ou d’autres se cachaient. Ils leur avaient proposé de leur faire de la place. Sa copine avait dit : « pas une bonne idée. S’ils arrivent ici on est coincés comme des lapins ».
Ils avaient continué.
Ils avaient appris que tous ceux qui avaient été dans ce fossé avaient été tués.
Après quatre heures de marche, course, marche et course sous le soleil, sans eau, ils s’étaient arrêtés sous un arbre.
Ils avaient vu un pick‐up blanc s’approcher d’eux à toutes vitesses.
Ils s’étaient dit “c’est la fin”.
Mais voilà que c’était un habitant de la ville d’à côté qui, ayant appris ce qui s’était passé, était venu à la rescousse. Il les avait pris à l’arrière, les avait amenés à l’abri dans la ville.
“Je n’ai même pas eu le temps de le remercier », dit la jeune fille à la présentatrice.
“Je ne saurai jamais son nom. Il nous a déposés à l’abri, et il reparti, immédiatement, tout seul, là‐bas, sauver d’autres jeunes”.
Ce sauveur inconnu fait partie des héros ordinaires qui se révèlent dans des situations extraordinaires, comme ceux‐ci :
Celui qui a sauté sur une grenade
Celui qui est allé s’asseoir sur le canapé
Celle qui a donné toutes ses économies
Celui qui est allé en guerre
Celui qui a caché sa sœur
Celui qui a pris le fusil
Celui qui s’est déguisé en civil
Celui qui a mis les mains sur le ventre
Celle qui a fait des cookies
Celui qui a sauté sur une grenade, il s’appelait Matan, comme mon mari.
Zi’hrono le’vrakha, ce Matan-là
Il était dans une voiture avec six autres, quand on leur a jeté une grenade à l’intérieur. Il s’est jeté dessus et l’a recouverte de son corps. Elle lui a explosé dedans. Tous les autres ont été sauvés.
Dans ces cas‐là, on n’a pas le temps de penser. Alors il a agi.
Il s’est fait exploser pour ne pas que sept autres meurent.
Celui qui est allé s’asseoir sur le canapé, c’est le grand‐père d’une famille, dans l’un des kibboutzim du Sud. Le 7 octobre, ils s’étaient réfugiés dans leur maamad à l’intérieur de la maison. Ils avaient entendu des voix en arabe. Ils avaient compris qu’ils étaient entrés.
Le grand‐père leur a dit : je vais sortir, me mettre sur le canapé. Je vais leur faire croire que je suis tout seul dans la maison. Ils s’arrêteront à moi.
Il s’est assis sur le canapé, en les attendant.
Il s’est fait tuer pour sauver ses petits.
Celui qui est allé en guerre, c’était un soldat de l’unité Golani qui se trouvait avoir pris une permission pour aller au festival Nova.
Lorsque l’attaque a commencé, il a tout de suite compris. Il a eu le temps de prendre la voiture et de s’enfuir avec trois potes.
Il aurait pu juste aller se mettre à l’abri. Ils n’étaient pas assez, ils n’étaient pas armés.
Il se souvenait qu’il avait un pote de l’armée dans un kibboutz tout proche. Ils se sont dirigés vers là‐bas. En arrivant, je ne sais comment, ils ont tué les terroristes qui se trouvaient devant l’entrée, et ils ont pris leurs armes.
Ont trouvé la maison du pote, qui se réveillait à peine. Ont libéré une maison prise en otage en tuant ceux qui les avaient assaillis. Ont pris possession de cette maison. Ont compris qu’ils n’étaient que trois face à des centaines dans le kibboutz, et qu’ils ne pouvaient pas partir à leur assaut.
Ont enfilé des uniformes de Tsahal, les tenues de rechange du pote.
L’un d’entre eux, posté sur le toit avec une kalachnikov, tuait tous les terroristes qui s’approchaient.
Eux, en bas dès qu’ils voyaient des habitant s’enfuir, les appelaient pour qu’ils viennent se mettre à l’abri dans cette maison.
Lorsqu’une unité spéciale de Tsahal est arrivé à la rescousse, il les a contactés, et ensemble ils ont libéré le kibboutz.
Juste par stratégie, bravoure, et chance aussi. Ils ont foncé au combat sans attendre l’armée.
Son père, rappelle le post Facebook qui raconte l’histoire, c’était une des têtes des manifs de Kaplan contre le gouvernement. Quelqu’un que tous ceux de droite appelaient “un ennemi d’Israël.”
Celui qui a caché sa sœur, c’est un autre type de héros national.
Juste un petit garçon de neuf ans. Ce qu’il a fait, c’est qu’il a pris sa sœur de quatre ans, et ils se sont cachés dans un placard, dans le maamad de leur maison. Pendant six heures. Pendant ces heures de folie, de cris, de coups de feu, de grenades, de massacre. Ils sont restés très calmes, silencieux. Sans boire, sans manger, sans aller aux toilettes. Comme Noé dans son arche le temps que les “yamei ha zaam” (les jours de fureur) ne passent, selon l’interprétation du maître ‘hassidique Mei Ha Shiloa’h, ils sont restés à l’intérieur, sans bouger.
Et comme cela, il a sauvé sa vie et celle de sa sœur.
Celle qui a donné ses économies, c’est une metapelet (une soignante) philippine.
On n’a pas assez parlé des Philippins. Des autres non plus, d’ailleurs.
17
Les oubliés
En Israël, il y a ces deux clichés : les Thaïs et les Philippins.
Deux peuples doux qui vivent à nos côtés, qui nous aident énormément, et auxquels on ne pense que quand on a besoin d’eux.
Les Thaïs, ce sont ceux qui travaillent dans les champs de poivrons, et les autres récoltes qui ont besoin de mains méticuleuses, dans la chaleur du Sud.
Les Philippins, ce sont ceux qui prennent soin de nos vieux. Et il y en a, en Israël, des vieux. Des survivants de la Shoah, des vieux plus vieux que l’État d’Israël, et puis surtout, des retraités du monde venus mourir ici, sur la terre de leurs ancêtres.
Quand les nouvelles des morts et des vivants ont commencé à monter, la semaine dernière, on a appris que les Thaïs aussi avaient été attaqués, massacrés, pris en otage.
Matan me racontait plusieurs vidéos qu’il a vues dans lesquelles des témoins racontaient qu’ils avaient vu passer la même vidéo d’un Thaï par terre, en train de se faire lacérer la poitrine avec une grande fourche agricole, pendant que les gars du Hamas, en cercle au‐dessus de lui, riaient, lui crachaient dessus tout en le labourant de coup de pied.
Les “Philipinim”, comme on les appelle en Israël, ceux qui s’occupent de nos vieux, ils en sont venus à faire partie intégrante du paysage social en Israël. Certains s’installent même, et ont des enfants. Aux yeux bridés, à la peau brune, et à l’hébreu parfait comme de vrais ados israéliens qu’ils sont.
Celle‐ci, elle s’apprêtait à rentrer sur sa terre à elle, voir sa famille, et leur donner de l’argent, comme nombre d’entre eux le font, environ tous les deux ans.
Elle avait tout : son billet, tout son cash. Elle devait prendre l’avion, je crois, le lendemain. Elle était restée un jour de plus, shabbat, pour prendre soin de sa vieille.
Lorsqu’ils étaient arrivés, dans ce village du Sud, dans leur maison, elle avait dit à sa vieille : “Ne t’inquiètes pas, je m’en occupe.”
Elle s’était plantée devant eux, et elle leur avait dit : « Écoute, regarde, qu’est-ce que tu veux de nous, une vieille, une Philippino ? J’ai de l’argent. Prends tout, et laisse‐nous.”
Elle lui avait donné tout son argent. Tout son précieux argent, amassé pour sa famille, pendant des mois et des années de travail sans fin.
Il avait pris l’argent et était parti.
Celui qui a pris le fusil, c’est un des gars de la sécurité de l’Université de Beer Sheva, un Bédouin qui habite dans une ville très pauvre non loin de Gaza. Quand il a vu ce qui se passait, il a pris son fusil, et il est allé se battre, pour protéger la population civile.
Et puis il a posté une photo de lui et de son collègue, un Juif orthodoxe à kippa, et il a dit quelque chose comme : “C’est notre pays ; on le défend ensemble.”
Celui qui s’est déguisé en civil, c’est un Bédouin de Tsahal. Quand ils sont arrivés au festival, il a enlevé son uniforme, s’est habillé en civil, est allé se mêler aux terroristes en leur parlant arabe, comme s’il était des leurs. Et comme ça, il en a neutralisé beaucoup, et ça a considérablement limité les dégâts.
Car j’ai écrit la semaine dernière qu’ils étaient 1500 à débarquer par la terre, le ciel, la mer. Ils étaient 2500.
Et s’ils n’ont réussi à tuer “que” 1400 humains en Israël, c’est en grande partie grâce à la bravoure de ces humains : les soldats, les civils, les Arabes, les Juifs, qui ont pris les armes parce qu’ils refusaient la barbarie.
Celui qui a mis les mains sur le ventre, c’est un réfugié érythréen qui n’a pas la citoyenneté israélienne. Il se trouvait près de la base militaire dans le sud qui avait été prise par les terroristes, alors que l’ancien chef de la base, ayant compris ce qui se passait, bien que n’étant plus en poste mais habitant tout près, était venu spontanément à la rescousse. Sans équipement, il s’était pris tout de suite trois balles dans le ventre, et il était là, allongé. Il allait probablement mourir, quand il avait levé les yeux et vu un grand noir qui le regardait, les yeux souriants, appuyant ses deux mains sur le ventre troué pour éviter l’hémorragie : “T’inquiètes frère, t’es pas tout seul. Je te lâche pas, à la vie à la mort”
Il était passé par là par hasard, alors que lui aussi sûrement s’enfuyait. Il avait laissé la voiture qui l’emmenait et était resté là, avec l’ancien militaire, jusqu’à l’arrivée des secours. Ils ont survécu tous les deux.
Voilà juste quelques histoires que j’ai entendues.
Il y en a certainement des centaines d’autres. Je l’espère, et je les en remercie.
Nos héros, ils sont juifs, israéliens, olim, bédouins, philippins, musulmans, chrétiens, érythréens, druzes, thaïs et bouddhistes, et tous les autres dont j’ignore la bravoure.
Parce que la société israélienne, c’est aussi tout cela.
Il y a eu tous ces héros anonymes, et puis il y a eu Rachel.
18
Rachel
Rachel Derri, elle est devenue une célébrité internationale, avec son café et ses cookies. Pas seulement en Israël, où les acteurs du programme eretz nehederet ont déjà fait des parodies sur elle (Rachel devenue reine de l’Intelligence des services secrets israéliens), mais aussi internationalement, depuis que Biden est venu la saluer.
Tant est si bien que le magazine juif de fooding The Nosher lui a dédié un article, mêlant le récit de son exploit avec des anecdotes sur le type de petits gâteaux et de café que l’on sert traditionnellement en Israël.
Je peux comprendre, qu’en tant que blog de fooding, ils essaient d’en placer un peu sur le café afou’h et les gâteaux israéliens, mais j’avais trouvé ça moyen d’en profiter pour faire un petit reportage culinaire sur Israël.
Certes, Rachel a survécu en servant de la nourriture aux terroristes qui l’avaient prise en otage, mais il s’agit de tellement autre chose.
Rachel, quand les terroristes sont arrivés dans sa maison, elle a décidé de la jouer contre‐intuitif : elle les a traités comme des invités.
Il fallait beaucoup de sang froid pour cela. C’était très pragmatique. Elle voulait gagner du temps. Mais il y avait peut‐être plus que cela. Peut‐on désarmer l’aggresseur par de la gentillesse ?
Elle a décidé de se comporter comme si elle n’avait pas peur d’eux, en les traitant comme leur mère.
Elle était persuadée qu’elle allait mourir, donc de toute façon elle s’est dit qu’elle n’avait pas grand‐chose à perdre. Alors elle a essayé.
Au lieu de paniquer, de fuir, ou de hurler, comme la plupart de nous l’auraient fait – au lieu de faire le lapin devant le chasseur – face à un terroriste cagoulé venu la tuer, elle a fait face.
Elle les a regardés dans les yeux, elle leur a souri, et elle leur a demandé s’ils voulaient quelque chose à boire.
Il y a dans ce volte‐face quelque chose de radical, qui ne m’est pas inconnu.
C’est un enseignement bouddhiste très célèbre, à travers la parabole d”“inviter Mara à prendre le thé”.
Mara, c’est la figure destructrice dans la cosmogonie bouddhiste. Quand l’ennemi entre dans la pièce, nous enseigne le Bouddha, il ne sert à rien de le repousser.
Résister ne fait que renforcer l’opposition. L’avez-vous remarqué, dans vos propres blocages, ou dans vos différents conflits ?
"What you resist, persists”, dit la sagesse populaire américaine.
Le courage radical, selon la sagesse bouddhiste, c’est d’opérer ce retournement : accueillir amicalement ce qui vient nous attaquer, un interlocuteur difficile, une douleur chronique, une pensée qui tourne en boucle, un souvenir qui nous assaille.
Pas parce que c’est bien. Mais parce que c’est là. Et que de toute façon, ça ne va pas partir ni changer tout de suite. Surtout pas si on le combat.
Alors le seul pouvoir qu’il nous reste, c’est de choisir comment on s’adapte à ce qui est là, et de “befriend it” comme on dit en anglais : d’en faire, si l’on peut, notre “ami”, notre allié.
Tout le système de mindfulness, la méditation pleine conscience appliquée comme protocoles de santé, notamment dans les cas dépression et de maladie chronique depuis les années quatre‐vingt dans le monde entier, est basé sur cette parabole bouddhiste ancienne :
Quand Mara entre, loin de le repousser, le Bouddha lui dit : « Oh Mara, c’est toi ! Entre, viens prendre le thé.«
Quelque chose qui vient nous attaquer, si, loin de s’enfuir ou de résister, on lui offre le thé, que lui reste‐t‐il ?
Soudain Mara se trouve pris au dépourvu : il devient un invité. Il est assis confortablement, on lui donne un thé chaud réconfortant, des biscuits qui font plaisir. Il se sent pris en charge, soigné, c’est agréable. Il se détend.
Qu’était-il venu faire, déjà ?
Rachel la Marocaine, que je soupçonne de ne pas être une grande spécialiste des paraboles bouddhistes classiques, a fait exactement la même chose.
Elle s’est mise à leur niveau.
Elle leur a parlé en arabe – elle avait la chance de parler arabe, ce qui, je crois a certainement joué un rôle non négligeable dans le fait qu’elle ait survécu.
Elle s’est imaginée qu’ils devaient avoir faim, et soif
“Quand on a faim, on est de mauvaise humeur”, a‑t‐elle dit par la suite aux journalistes.
Donc elle s’est dit, très pragmatiquement, déjà, on va leur proposer du café et des gâteaux, et puis je vais leur faire un poulet.
Elle leur a proposé de les soigner.
Elle a bandé le bras de l’un d’eux, blessé.
Voyez‐vous le retournement qu’elle a opéré ?
Elle était devenue la mère. Elle était dans le soin. Il y a peu de choses plus désarmantes que cela.
Il devrait y avoir des thèses de psychologie, de bouddhisme et de pratique spirituelle, sur ce qu’a fait Rachel. Et non, même si cela passe par la nourriture, cela n’a rien à voir les gâteaux.
Rachel est restée quinze heures otage, gardée par cinq terroristes avec son mari David.
Le fils de Rachel, qui faisait partie des forces spéciales, a fini, je ne sais comment, par les tuer tous, et libérer ses parents sains et saufs.
Mais ce n’aura pas été sans des scènes difficiles, comme de voir sa mère descendre l’escalier pas à pas, des grenades autour du cou, tenue étroitement par un gars du Hamas souriant, son couteau – ou un fusil, peu importe les détails – pointé sur elle.
Le danger était tel que le fils avait dû, dans un premier temps, opter pour le retrait, quitter la maison, et entamer avec eux, depuis l’extérieur, un très long processus de négociations.
Rachel nous épate avec la ruse, le courage et le sang‐froid dont elle a fait preuve.
Elle nous rappelle une leçon spirituelle, à nous tous : le pire ennemi, il faut savoir oser lui faire face.
Mais pas de manière vindicative : la force, c’est de savoir le rencontrer sur son propre terrain, l’accueillir car, de toute façon il s’est invité de force.
Si on identifie ses besoins, et nourrit ce que l’on peut, alors peut‐être que l’ennemi peut se dissoudre, ne serait‐ce qu’un peu, et il peut rester un être humain en face.
Il en va de même avec les pensées difficiles : si, au lieu de la repousser, on décide de nourrir la peur, non pas avec elle‐même, mais avec de vraies nourritures qui apaisent, comme l’écoute et l’amour, la peur, elle se calme.
On a tous besoin de ce type de sagesse, aujourd’hui, alors que, bien au‐delà de la frontière gazaouie, “le monde est empli de Hamas [vol/destruction]” (Genèse 6,11), nous rappelle la parasha Noah.
Que s’est-il passé dans la tête du terroriste ?
Il aurait pu les massacrer tout de suite.
A‑t‐il cru tactiquement qu’il pourrait profiter d’un bon repas, puis tuer et reprendre sa route ?
A‑t‐il flanché un moment, en voyant cette femme de l’âge de sa mère, qui ressemblait, peut‐être à sa mère, sans foulard, une Arabe de l’autre côté, qui parlait la langue de sa mère, qui comme sa mère, avait pensé en premier qu’il devait être fatigué, qu’il devait avoir faim et soif, qui comme sa mère, l’avait soigné, et qui comme sa mère, avait empli la maison du fumet du poulet qui cuisait pendant qu’elle lui servait le café chaud ?
On ne le saura jamais.
Tout ce que l’on sait, c’est que la stratégie incroyablement courageuse de Rachel a marché.
La réponse contre‐intuitive : faire face au danger, et proposer le thé à celui qui vient nous heurter, c’est tellement radical, comme réponse, que cela peut être désarmant.
Ça amène l’autre (le conducteur de voiture grossier, le collègue ambitieux, le partenaire en colère, la pensée difficile), sur un autre plan : un plan où il est accueilli, entendu, nourri.
Et on a tous à apprendre de cela.

19
Un shabbat en guerre
Shabbat dernier, c’était le troisième shabbat depuis le « shabbat noir » du 7 octobre, et notre deuxième shabbat en guerre.
À Tel Aviv, le Musée d’Israël avait exposé, devant le musée d’Art moderne, une installation artistique : une immense table de shabbat dressée, vide, du nombre des 224 otages emmenés à Gaza.
J’avais reçu juste avant shabbat le message d’un ami rabbin, qui suggérait à tout le monde de dresser un couvert de plus, à notre table de shabbat, pour faire vivre la présence d’un otage.
Alors on l’a fait. On a mis la belle table, et un couvert en plus. Avec le même soin. Le même espace. Notre table est minuscule, mais pendant les repas, on a pris garde de ne rien poser sur “son” assiette. C’était la place de quelqu’un. L’absence, on la porte tous avec nous, et on continuera.
Ce shabbat‐là, on avait invité un couple rabbinique anglo‐américain, avec leurs enfants, et une jeune femme réfugiée d’Ashkelon qui était venue passer deux semaines dans notre immeuble, chez nos voisins qui étaient restés en Italie.
En ce moment, les hôtels d’Israël sont pleins de survivants des kibboutzim, ou de réfugiés des villes du Sud, où les missiles tombent toutes les heures, et où ils ont trente secondes, parfois moins, pour se mettre à l’abri.
La semaine d’avant, une voisine à elle était morte, chez elle. Un missile avait frappé.
Pour le risque, mais aussi pour la santé mentale – des alertes jour et nuit toutes les heures, ça doit être épuisant – certains habitants des villes du Sud venaient passer du temps plus vers le Nord, chez des habitants qui prêtaient leur maison vide.
Entre ceux qui sont restés ou partis à l’étranger et ceux qui sont partis à l’armée, il y en a, des maisons vides, en Israël. Et les gens, tout simplement, postent ce dont ils ont besoin ou ceux qu’ils ont à offrir sur les réseaux sociaux, et les gens s’entraident comme ça.
On ne se connaît pas, mais chacun donne ou prête ce qu’il peut. C’est aussi cela Israël, ce sentiment d’être une grande famille.
Alors May arrive chez nous pour le dîner, puis le déjeuner de shabbat, et je ris du contraste chez nos invités : elle en mini‐short en jean, tatouages plein les jambes et les bras, téléphone au sac, et nos invités en chemise, lunette, et foulard sur les cheveux, modern‐orthodoxe comme il faut, qui aurait cru qu’ils se retrouveraient un jour à la même table de shabbat ?
Ils ne le sont pas resté longtemps, parce que les petits ont fait des leurs, et le couple est vite rentré.
May est restée avec nous. Elle avait l’air bien, tranquille. On parlait de plein de choses, on a ri, aussi. Et puis elle nous a raconté comment elle l’avait vécu, elle, ce 7 octobre.
Elle aussi avait été réveillée par l’alerte des missiles. Mais comme elle a l’habitude – à Ashkelon, dans le Sud d’Israël en général, c’est toute l’année –, elle n’a pas pensé qu’il se passait quoi que ce soit de différent.
Mais sa copine, qui avait ouvert son téléphone, avait reçu des messages de leurs potes partis à la fête en plein air. Elle était arrivée chez May en pleine détresse, pendant que les missiles tombaient.
Elles s’étaient enfermées dans la chambre de May, qui est un maamad (un abri anti missiles). May a allumé son téléphone, et là – ses yeux, tout d’un coup, se sont embués quand elle nous a raconté cela – elle a reçu les vidéos envoyées par des amis qui y étaient. May a pleuré un petit peu, n’en a pas dit plus, et puis on a changé de sujet.
Je ne sais pas si ses amis ont survécu.
Je sais juste cela : May m’a rappelé que même quand on a l’air tout tranquilles, sous la surface, chez la plupart des Israéliens, en ce moment, c’est cela que l’on trouve, des pleurs.
Je l’ai vu chez Tal aussi, d’une manière différente. Tal, c’est notre voisin du dessous. Avant, il travaillait dans le marketing pour une boîte pharmaceutique. Puis l’hiver dernier, il avait tout plaqué pour aller passer quelques mois en Inde.
Quand il était revenu, il était resté dans cet entre‐deux, passant beaucoup de temps à jouer de la flûte, rêvant, contemplant le type de vie qu’il voulait vivre.
Et puis, dès le lendemain du 7 octobre, il avait été mobilisé.
C’était la première fois que je le revoyais.
Alors que j’étais descendue accueillir nos amis frum (religieux pratiquants) avec leur poussette, enfants et babka, j’ai vu la silhouette de Tal, ses bras musclés sous un débardeur bleu ciel, en civil mais le fusil en bandoulière, des grands sacs de supermarché avec une grosse hallah et des tomates et concombres qu’il venait de s’acheter.
Je lui ai dit « mais viens, viens chez nous ! Il y a à manger, tu viens quand tu veux, tu restes le temps que tu veux, tu fais ce que tu veux ». Je pensais, ignorante encore que je suis, qu’il serait content d’avoir de la compagnie.
Il a tout décliné, gentiment mais fermement. Il avait douze heures de permission. Tout ce qu’il voulait, apparemment, c’était être seul.
Je lui ai demandé où il était, comment ça se passait.
C’est là que ses yeux à lui aussi se sont embués.
“Kashé”. C’était dur.
Il était arrivé dans les villages attaqués le 8 octobre, dès le lendemain.
“La première semaine, c’était dur, dit‐il avec soudain comme un voile sur le regard.
Mais maintenant ça va. On ne fait pas grand-chose. On protège. De temps en temps on va chercher un terroriste."
Comme si de rien n’était.
Il ne m’en dit pas plus sur la première semaine, mais je sais que les combats, après le 7 octobre, avaient continué dans les villages près d’une semaine, tant qu’il restait des attaquants. Ils se cachaient, et continuaient de tenter de tuer. Pendant une semaine, tous les jours, il avait dû voir des cadavres, faire sortir des vivants, et rechercher les terroristes embusqués.
Il y a un mois, il jouait de la flûte chez lui en regardant le ciel. Je préfère ne pas savoir avec quelles images en tête il va devoir passer le reste de sa vie.

20
Le clair et l’obscur
Heureusement, ce n’est pas tout.
L’obscurité ne vient pas seule. Elle est immanquablement accompagnée de son autre face, le deuxième côté de la même pièce : la lumière.
Il semblerait même, d’après le Zohar, que l’obscurité soit sa matrice : “Il n’y a pas de plus grande lumière que la lumière qui émerge de l’obscurité” (Zohar, Tetsaveh, 10).
Et oui, parfois, dans nos trajectoires individuelles comme dans l’histoire de l’humanité, les plus grandes lumières sont nées des plus grandes nuits.
Aujourd’hui, alors que les foules du monde entier s’enfoncent grossièrement à pieds joints dans les antagonismes, les clichés et la haine, la lumière de nouvelles consciences se révèle, et brille plus que jamais.
En voici quelques‐unes. Ce sont les voix d’intellectuels musulmans francophones qui ont eu le courage, tout de suite, de prendre la parole, et de s’exprimer très fermement :
“Je m’adresse tout particulièrement, écrit l’enseignante et philosophe Myriam Ibn Arabi, dans un post Facebook publié le 11 octobre par Tribune Juive, à mes compatriotes marocains et français, qui au mieux restez silencieux face aux attaques terroristes subies par Israël, au pire, qui vous en réjouissez ouvertement.
L’agression barbare du Hamas n’a strictement aucune justification. Aucune. Rien n’explique ou ne justifie que des civils soient enlevés dans leurs propres maisons pour être abattus, violés, démembrés, décapités, devant leurs familles.”
Sa voix, cette lumière dans le nuage de haine noire qui nous entoure depuis et ne fait que s’épaissir à mesure que la guerre avance, n’est pas restée isolée.
“Le 7 octobre, la cause palestinienne est morte, assassinée”, a le courage d’écrire Tahar Ben Jelloun dans Le Point du 13 octobre, qui ouvre son article sur ces mots : “moi, arabe et musulman de naissance, de culture et d'éducation traditionnelle, marocaine, ne trouve pas les mots pour dire combien je suis horrifié par ce que les militants du Hamas ont fait aux Juifs. La brutalité, quand elle s'attaque aux femmes et aux enfants, devient barbarie et n'a aucune excuse ni justification.”
“Pas de 'oui mais'”, écrit Abdenour Biddar dans Le Monde paru le même jour. “Oui, en tant qu’intellectuel musulman, je condamne sans réserve, sans ambiguïté et sans aucune hésitation les massacres et prises d’otages perpétrés par le Hamas, et je les dénonce comme une pure barbarie et sauvagerie absolument injustifiables”.
Je partage quelques‐unes de leurs paroles ici parce qu’ils m’ont redonné espoir.
En l’humanité.
En la capacité de consciences éclairées que n’aveuglent pas les appartenances.
L’une de ces consciences, qui m’a le plus touché, celui qui m’a touché en premier, c’est Eric Adams, le maire de New York – après les manifs aux croix gammées de Time Square et Washington Square Park, il fallait bien un tikkoun pour New York.
C’est d’ailleurs pour cela qu’il a parlé : en réaction aux manifestations pro‐palestiniennes/de haine contre Israël qui avaient éclaté comme des boutons trop mûrs, juste dans les jours qui ont suivi les massacres.
Il a pris la parole pendant quatre minutes et il a dit : “Je vais être bref. Je vais vous dire quatre mots : We are not all right”.
“On ne va pas bien.”
“On ne va pas bien, quand on voit des femmes se faire traîner dans la rue hors de chez elles pour être prises en otage
On ne va pas bien, quand on voit des enfants, des grand‐mères, des bébés, des familles entières se faire décapiter.”
Il décrit des faits, condamne la terreur.
Il est l’un des premiers, quand la presse internationale hésitait encore – apparemment elle hésite toujours – à décrire Hamas comme une organisation terroriste, à l’avoir dit clairement :
“C’est une attaque terroriste.
Et non, on ne va pas bien. Et on ne devrait pas aller bien.
On a le droit d’être en colère. On devrait être en colère.
Israël a le droit de se défendre. Point. Et on est avec vous.”
Et là où Eric Adams m’a le plus touché, c’est quand il a rappelé deux choses :
La première, c’est qu’il a mentionné que les terroristes avaient choisi “le jour le plus saint” de l’année pour nous attaquer.
Quand je l’ai entendu dire cela, j’ai éclaté en sanglots. J’étais en train de marcher dans la rue.
///// interruption alerte.
Retour.
On était le lundi ou le mardi, quelques jours après le début de la guerre. C’était la première fois que j’arrivais à pleurer. Je lui garde beaucoup de gratitude pour cela.
J’avais presque oublié ce “détail’ : le jour choisi. Et ça m’a touché, qu’il souligne cela.
“New York, rappelle‐t‐il, a la plus grande concentration mondiale de Juifs après n’importe quelle ville israélienne.
Et en tant que votre maire, je suis là pour vous protéger.”
Le maire de New York est noir.
Et cela m’a touché encore plus particulièrement.
Juifs et Noirs, dans la société américaine des Trente glorieuses, ils étaient également exclus des Country Clubs, également mis à part dans les mêmes dortoirs pour “gens de couleur.” Ils ont mené des combats en commun. Leurs relations se sont dégradées depuis que les Juifs ont opéré leur processus de gentrification. Aujourd’hui, il y a un antisémitisme noir très fort aux États‐Unis, dont les exploits verbaux de Mr West ne sont qu’un triste exemple.
Alors la deuxième chose qui m’a beaucoup touché, c’est quand il nous a aussi rappelé cela :
“Je n’oublie pas que vous étiez à côté de nous, quand Martin Luther King marchait pour les droits civiques (vous avez peut‐être en tête la fameuse photo où Heschel marche avec MLK).
Alors, maintenant, nous, on est à vos côtés.
“Et je veux que vous sachiez.
Je suis avec vous. Pas seulement comme votre maire.
Je suis votre frère.
Votre combat et mon combat.
Votre combat est mon combat.”
Je n’interviens jamais dans les réseaux sociaux ;
Cette fois je l’ai fait.
J’ai simplement écrit ‘merci”, en commentaire de sa vidéo.
J’ai reçu, moi aussi, un commentaire : “quiet, kike” (tais‐toi, juive).
C’est comme ça.
L’ombre et la lumière dansent ensemble, immanquablement on ne peut rien y faire.
En attendant, il faut continuer à vivre.
21
Kikar Dizengoff
Alors Matan et moi, comme si la vie ne s’était pas arrêtée, on se promène ce vendredi matin‐là, le troisième depuis qu’on sait qu’on est en guerre, vers Kikar Dizengoff.
On remarque qu’Anastasia, le célèbre restau vegan de Tel Aviv, a réouvert. Sur la grande terrasse de bois clair, les tables sont pleines, les assiettes de salades, de brioches et de curry de légumes viennent se déposer devant les yeux souriants des convives.
On s’étonne qu’ils soient tous là en train de manger, alors que des missiles sont tombés il y a dix minutes à peine ;
Et puis une autre alarme a sonné.
On arrivait alors tout juste à côté du café Nahat (la “tranquillité”), où j’avais eu l’habitude, l’hiver dernier, de m’asseoir le matin, après le yoga, pour écrire.
C’est un des rares cafés en Israël qui sert du thé du Palais des thés, et un café que l’on dit excellent sur de minuscules plateaux argentés, comme en Italie.
On était tous descendus, avec les clients, et des passants comme nous. Un soldat en civil faisait de grands gestes de la main pour que l’on rentre en vitesse.
C’était un peu surnaturel, parce que l’abri, c’était le sous‐sol d’un magasin de mode, l’un des plus chers de Tel Aviv, dont l’entrée est de l’autre côté, sur le boulevard Dizengoff. Dedans, ça sentait le parfum et c’était plein de couleurs.
Des Américaines à côté de nous, plaisantent : “bon ben du coup on va faire du shopping”.
J’avoue que j’ai regardé les shorts en coton hors de prix pour Matan. Lui il fulminait dans son coin, que j’aie l’air tellement déconnectée de ce qui se passe.
On gère chacun comme on peut.
Tout, au quotidien, est comme si de rien n’était. Ou presque.
Certes, la plupart des boutiques restent fermées.
L’autre jour, Matan passait devant Mystic, notre glacier préféré, juste derrière chez nous (Mystic sur Dizengoff et Gordon, allez‑y, c’est bien meilleur que Bertillon).
C’est un artisan glacier français, ses glaces sont incroyables. Et ses cornets, il les fait à la main.
Le pauvre Marc, le patron, il avait ouvert juste avant le Covid. Sa boutique, à force d’économies, de prévoyance, de talent et de ténacité, avait survécu on ne sait comment, au confinement. Le business avait repris tranquillement, et voilà que maintenant, un an seulement après le grand chamboulement corona, voici la guerre.
Alors l’autre jour, Matan, qui passait et promenait le chien, il voit Marc assis sur un banc devant sa boutique, l’air complètement dépité.
“C’est calme, hein”, lui dit Matan.
L’autre secoue la tête tristement.
“M’en parle pas. C’est mort”.
Il n’ouvre même plus le soir, alors que d’ordinaire, c’est le moment où les Tel‐Aviviens et les touristes se promènent pour prendre une glace.
Marc, dont le gendre, blessé au combat, est à l’hôpital, ferme désormais vers quatre‐cinq heures de l’après-midi. Ça ne sert à rien de rester.
C’est ça aussi, la guerre. L’impact sur les vies, à travers l’économie.
Un impact moins visible, mais qui endommage à long terme.
On le sait ici, c’est l’une des manières dont ils tentent de nous mettre à genoux.
Ils ont détruit tout ce qu’ils pouvaient dans les kibboutzim du Sud. Éventré les grands conteneurs de lait, dont le liquide blanc s’est répandu dans la poussière.
Mais ce qui signifie surtout qu’il n’y a plus de conteneurs pour le lait. Donc nulle part où mettre du lait nouveau.
Alors les vaches qui n’ont pas été tuées le 7 octobre, se tiennent là, le pis gonflé, meuglant de douleur, avec de surcroît plus personne pour les traire.
Les champs demandent des volontaires des villes pour aller cueillir les patates douces et les poivrons, car leurs travailleurs ne sont plus là.
Ils ont été tués, ou ils ont été appelés à l’armée.
Alors dans les villes comme dans les champs, on essaie de faire avec qui est là.
Les cafés ont réouvert timidement. Les citadins se rendent faire du volontariat dans les champs. Les gens organisent des dîners où ils s’invitent et jouent de la musique, pour se consoler. Et on essaie de faire marcher les commerces, et d’acheter les fruits et les légumes cultivés dans le Sud, qui n’ont plus personne pour les récolter et pour les vendre.
C’est peut‐être aussi pour cela que la vie a repris.
Pas forcément parce qu’on oublie.
Mais parce qu’il faut vivre. Il faut vivre, et faire vivre.
Ce jour‐là devant le glacier déserté, Matan, qui n’avait besoin de rien et essaie de perdre du poids, avait pris un café et un cookie – ses cookies, énormes, une généreuse pâte sablée avec des noisettes grillées entières et de gros morceaux de chocolat, sont les meilleurs du monde.
J’y suis retournée d’ailleurs, hier, prendre un cookie, pour moi.
Il faut bien aider le commerce.
Lire le premier carnet de guerre de Mira Neshama Weil