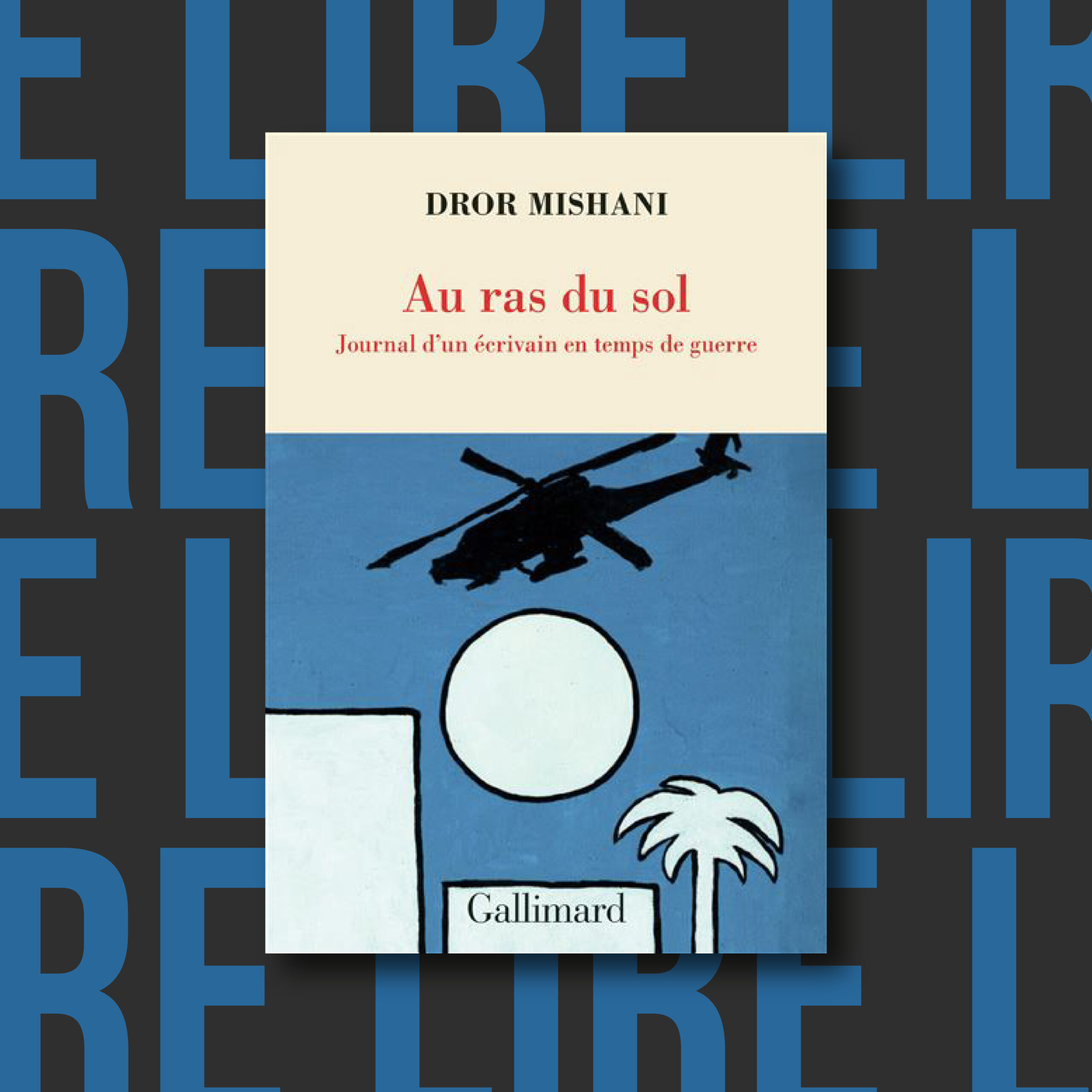Hier [dimanche 1er septembre], j’étais à l’enterrement de ma lumière.
“Ma lumière”, c’est la signification du prénom Ori en hébreu.
Ma lumière.
Hier, j’étais à l’enterrement d’Ori Danino, l’un des otages tués ce week‐end par Hamas.
Après 328 jours de survie, dont une grande partie dans un tunnel à 20 mètres sous terre à Rafah, ils ont été liquidés d’un coup, lui et cinq autres, d’une balle dans la tête, entre 48 et 72 heures avant que l’armée israélienne n’arrive à les récupérer.
Le Mont et la Main
Ori était soldat. Il a été enterré à Har Herzl, le cimetière militaire, en haut de l’une des collines de Jérusalem, presque en face de Yad Vashem.
Le cimetière des soldats et le mémorial de la Shoah se font face par delà les voies express et les immeubles modernes de la ville, comme pour se tendre la main entre les nuages, à l’horizontale : de morts à morts.
Eux, peut‐être, ils étaient la preuve que ceux de la shoah ne l’avaient pas été “pour rien.” Car après les brûlés d’Auschwitz, et peut‐être grâce à eux, une grâce si cruelle que l’on doit encore à leurs cendres, l’État d’Israël est né de nouveau des siennes après plus de deux mille ans d’exil.
Ceux enterrés à Har Herzl savaient pourquoi ils étaient là. Ils étaient morts dans la dignité d’appartenir à leur pays, dans leur souveraineté signifiée par l’uniforme que d’ordinaire j’abhorre mais qui, chez nous, dit d’abord l’indépendance : le pouvoir d’être à soi. Ils étaient morts parfois dans de grandes violences, mais pas impuissants. Ils étaient tombés en se battant pour que leur pays demeure. Et grâce à eux, chaque minute, malgré les attaques presque continues que l’on connaît depuis 1948, les Juifs continuent d’avoir un pays.
Ces morts sous les stèles de pierre à l’ombre des grands arbres, ces corps qui ne respirent plus, ils sont notre respiration à nous : une grande respiration qui nous relie les uns aux autres, un souffle remis en vie à chaque instant, grâce au souffle du suivant, celui qui se lève pour nous défendre à son tour.
Eux, les morts qui ont donné leur force pour protéger les leurs, et après eux leurs petits frères, leurs enfants, leurs cousins, leurs amis, leur vie, chacun d’entre eux, est un souffle du grand coeur qui bat, ce pays pour lequel ils se sont battus et pour lequel leurs descendants, même si cela nous brise le coeur, s’il le faut, tant qu’il le faut, continueront à se battre.
Sous les cyprès
Je suis arrivée au cimetière et c’était un soulagement.
Un soulagement physique, d’abord : les grands arbres hauts, sapins, pins, et cyprès, dont l’ombre odorante embaume l’air, soulage le corps de la lumière trop chaude de l’été.
Un soulagement de l’âme, enfin : soudain sortis des grands axes de circulation de la Jérusalem moderne, la grâce d’un cimetière ombragé aux arbres dignes et silencieux.
M’y sont revenus ces vers de la chanson des Négresses Vertes : “Sous le soleil, le silence, à l’heure, où les cyprès se balancent… les morts reposent au cimetière, sous le sable, face à la mer”.
Ici ce n’est ni le sable ni la mer étincelante qui nous font face, mais une mer sèche de pierres sous les aiguilles de pin, et, bougeant entre les stèles immobiles, des corps vivants d’où sortent des rivières de larmes.
Les morts reposent enfin. Ceux‐ci en ont vu avant de se reposer.
Je n’ai quasiment pas besoin de demander où se trouve la levaya, l’enterrement. Je suis la foule calme qui avance vers le cœur de ce bois odorant, le cimetière des soldats morts.
Là aussi quel soulagement. Une foule oui, mais une foule silencieuse.
Enfin, un peu de dignité. Les gens ne se parlent pas. Pas de selfies. Pas de rires.
Une foule ensemble dans son silence et dans sa peine.
À mesure que je m’avance vers le grand chapiteau blanc sous lequel a lieu le tekes (la cérémonie), on voit des yeux bouffis, des larmes qui coulent.
Les gens sont là seuls ou en grappe ; en couple ou en groupe d’amis ; soldats, civils, jeunes et vieux ; beaucoup de religieux ; jupes longues, kippot – des crochetées, d’autres en noir et blanc.
Ori vient d’une famille sépharade pieuse de Yerouham, une ville pauvre dans le sud d’Israël, l’une de ces villes perdues dans le désert où l’on parquait les réfugiés du Maroc ou de Tunisie, ceux qui venaient, des rêves sionistes plein les yeux, prêts à tout donner pour un pays qui les utilisa comme chauffeurs de taxi et petites mains, réservant la Jérusalem de leur coeur à l’élite ashkénaze de l’époque.
Hesped
Je ne verrai rien de l’enterrement, la foule est trop épaisse. Je serai comme la majorité, à quelques mètres du cœur de l’action dont je verrai le lendemain des extraits en gros plan au journal télévisé.
Je me contente des voix invisibles retransmises par les hauts parleurs postés au milieu des pins.
Lorsque j’arrive, je comprends au discours que c’est l’un des jeune frères.
“Ori, Ori. Mon frère”.
Il parle et sanglote et parle, et dans ses sanglots, des mots d’amour, des mots d’admiration, des mots de cœur fracassé. Ce qui me frappe surtout, c’est l’amour rond et lumineux, presque palpable, qui irradie dans l’air rien que dans la manière dont il prononce le nom de son frère.
Puis son ami David : “Pourquoi y es-tu allé? J’avais un pressentiment, je t’avais dit de ne pas y aller. Mais toi tu ne laissais personne derrière. Tu y es retourné. Tu en as sauvé trois de plus. Et toi tu n’es pas revenu.”
“Danino, Danino”, la voix enveloppe le nom d’amour : “Je t’appelais Danino, mon ami, où es tu? Je n’arrive pas à croire que l’on va continuer sans toi. Je t’attendais et voilà que tu nous reviens – il sanglote – dans une boîte!”
“Pardon mon frère, pardon qu’on n’a pas réussi; j’avais dit à ta mère, je vais aller le sortir de là, et je n’ai pas réussi!”
Deux rabbins parlent l’un après l’autre.
Le premier, plus froid, offre un dvar Torah. Il parle de la grandeur de celui qui meurt pour le kiddoush haShem – la sanctification de nom de Dieu, au point que, selon Maïmonide, même le plus grand des mécréant en devient plus près que personne du trône céleste. Il parle de la sanctification sans pareille de ceux qui, comme Ori, sont morts parce qu’ils étaient juifs. C’est cela, Kiddoush haShem. Mourir pour qui l’on est. Mourir parce que l’on est. C’est comme ça que sont morts ceux pris par surprise le sept octobre, et à vingt millions de reprises dans l’histoire des Juifs.
L’autre parle avec plus d’émotion dans la voix. Je ne me souviens plus de ses paroles. Mais il parle d’amour. D’amour pour Ori.
Sa tante vient au micro. Elle crie sa douleur d’une voix rauque. Un cri guttural, un cri animal, un cri qui nous soulage, car il sort sans honte ce que l’on ressent tous à l’intérieur. Le cri cathartique de la peine sans filet.
« Ori, hayim sheli! Ori, ma vie. Atah Gibooooor, tu es un héroooos.«
Elle crie avec la voix rauque de la pleureuse, le cri de douleur et de rage de l’animal blessé qui n’a plus que faire de la pudeur.
L’appui
Son père commence d’une voix forte. “Dieu a donné, Dieu a repris”.
La formule consacrée lorsqu’on apprend la mort d’un être cher – souvent d’un enfant.
Le père, dont on sent, au fond de la peine profonde, la piété encore plus profonde, même si brisée. C’est peut‐être elle qui lui donne la force de ne pas retourner sa peine, ce jour‐là, contre Dieu.
Son père nous confie qu’il avait toujours dit à ses plus jeunes fils “Ne prenez pas exemple sur moi. Prenez exemple sur Ori”.
“La générosité. Celui qui faisait toujours passer les autres avant lui.
Trop, nous rappelle‐il. Il les a littéralement fait passer avant lui. Il est resté en arrière. Il en est mort.”
Il poursuit : “Sache mon fils qu’il n’y a pas un endroit où ta mère n’est pas allée, aux États-Unis, en Australie, depuis onze mois, pour parler de toi, pour réunir de l’aide pour qu’on te sorte de là. Pas un endroit où je ne suis allé, en Europe, en Orient, pour qu’on te sauve.
Pas une prière, pas un psaume, qu’on n’a pas dits.”
Et puis le père qui prend son courage dans sa voix, pour chanter pour son fils une prière qu’il aimait. Il chante d’une voix forte, qui se brise à la fin.
Il a fait venir le hazan qu’il aimait écouter pour Kippour, et lui aussi chantera une prière.
Le père termine dans un sanglot : “Peut-être que je n’ai pas prié assez!”
Lui s’appuie sur Dieu dans sa peine, sur sa piété. Son jeune fils s’appuie sur l’épaule de Hanan Ben Ari.
Au micro des endeuillés, l’artiste israélien chante l’une de ses chansons a capella, avec beaucoup de sobriété. Des soldats autour de moi chuchotent avec lui en se balançant doucement, les yeux fermés.
Donne moi la force
De trouver du courage en moi
voir un signe
Parce que l'enfant qui était en moi
Est mort depuis longtemps
Le lendemain, je verrai en gros plan à la télévision ce que j’ai entendu de loin à ce moment, Hanan chantant lui aussi les yeux fermés, serrant dans son bras libre l’un des jeunes frères d’Ori.
Et tu pleures à l'intérieur
Je te vois brûler
Tu as peur d'être d'accord
Que ce n'est pas seulement une période passagère
L’ado sanglote le visage vers le ciel sans chercher à se cacher, kippa rouge sur ses boucles noires, orthodontie découvertes par les lèvres tordues par le sanglot, le petit corps mince s’abandonne contre celui du chanteur, au moins dans la douleur il y a cela. Se laisser tomber contre quelqu’un, écouter la chanson les yeux fermés, se laisser bercer par les mots, et sangloter devant le cercueil fermé.
J'écris un poème la nuit
Cela efface ma tristesse
Quand je manque d'air
Je pleure seul dans la voiture
Combien d’entre eux ont pleuré seuls depuis 11 mois !
Silence
Un autre petit frère parle. Et puis une voix féminine monte entre les arbres.
Elles
Elle parle dans un seul sanglot doux, sans s’interrompre. Les autres faisaient des pauses, se reprenaient. Éclataient en sanglots ; reniflaient ; se taisaient.
Elle, rien de tout celà. Son hesped (adieu), c’est une rivière qui coule.
Haim sheli, “Ma vie”. Elle parle moins longtemps que les autres mais dans un seul flot. Elle parle dans un même sanglot sans discontinuer, un long pleur sans aspérité façonné de paroles, il sort d’elle un flot d’amour qui enrobent le mort, et qui, au delà, comme seul sait le faire l’amour, éclairent le lieu entier, nous éclaire tous, d’une même lumière.
“Mon amour, ma vie, je n’arrive pas à croire que je suis là.
J’ai tellement attendu, tellement espéré, tellement prié.
Je pleure pour le mariage qu’on n’aura pas, pour les enfants qu’on n’aura pas.
Mon amour, ma vie.
Ma moitié… Maintenant je resterai une moitié, pour le reste de ma vie.
J’ai un trou dans le cœur qui a la forme de ton corps.
Et sache, dit-elle en terminant d’un ton plus ferme, sache que dans tous mes gilgoulim (réincarnations) à venir, je te chercherai!”
Vient une autre voix de femme, plus mûre.
“Mon fils, Ori, mon aîné, toi qui m’a donné le diplôme [toar en hébreu] de mère.
Tu étais si beau (iafeh toar) – beau de forme, comme la Bible le dira de Rachel (Genèse 29,17)
si beau, sanglote‐t‐elle. Mon enfant.”
Cette beauté là ne parle pas d’apparence. Elle parle de l’amour d’une mère pour son petit.
Le coup de foudre immédiat de l’accouchée pour son nourrisson.
C’est l’histoire viscérale et sacrée de l’amour d’une mère, surtout, quoi qu’on en dise, pour son premier‐né, et surtout pour son garçon. Amour primordial, amour sacré car interdit, amour éternel. Celui que nous raconte la Bible avec la naissance de Moïse (Exode 2,2), cet amour plus fort que la raison, et qui lui sauvera la vie :
וַתַּ֥הַר הָאִשָּׁ֖ה וַתֵּ֣לֶד בֵּ֑ן וַתֵּ֤רֶא אֹתוֹ֙ כִּי־ט֣וֹב ה֔וּא
“La femme conçut et enfanta un fils ; et elle vit combien il était beau/bon”
Oui il était bon, nous dit sa mère. “Mon fils si beau, maintenant dans un cercueil…”
Car, contrairement à la Yocheved biblique, Einav Danino, cette femme dont le prénom (Einav, à la fois “son oeil” et “la grappe de raisin”), dit la fertilité et d’abondance, ne pourra pas cacher son petit. Contrairement à l’esclave descendante d’esclaves qui sauva le sien de la mort dans la terre d’Égypte, cette Israélienne revenue dans le pays de ses ancêtres ne pourra protéger celui‐là.
Car l’enfant est libre, et le pays en guerre.
Et l’enfant a choisi d’être un héros et de se battre pour sa mère. Il sera soldat, et il se déclarera, sans hésitation, prêt à mourir pour son pays.
“Nous on pleure, mais toi tu dois être content, lui dit son père presque rageusement entre le cercueil et le ciel. Tu as eu ce que tu voulais.”
Plus fort que la mort
Sa petite sœur, une voix fluette de petite fille, sanglote. “Tu étais toujours là pour moi. Quand l’autre me tapait, tu me protégeais. Tu étais toujours là pour m’écouter. Tu m’apportais toujours ce que j’aimais manger.” Dans un sanglot de petite désormais sans son grand frère. “Sache que je ne t’oublierai jamais, jamais!”
Le pacte du souvenir prendra la suite de celui des friandises.
Tous lui ont dit à un moment ou à un autre “pardon”
Pardon que je n’ai pas pu te secourir.
Pardon que je ne suis pas venu avec toi.
Pardon que je n’ai pas su t’empêcher.
Pardon que je n’ai pas assez prié.
Pardon.
Son ami David lui promet qu’il veillera sur ses parents, toujours.
Que lui aussi sera prêt à donner sa vie pour Israël. Son petit frère dit la même chose. À l’enterrement de leur ami et de leur frère, ils se disent, eux aussi, prêts sans hésitation à donner leur vie pour ce pays.
Pour que leurs frères et que leurs mères, pour que leurs enfants, aient un pays.
Pour que moi et vous ayons un pays.
Voilà le degré d’amour ici.
Ce n’est pas l’amour du Chant des chant (8,6), “fort comme la mort”.
Leur amour pour le pays, comme leur amour les uns pour les autres, est un amour plus fort que la mort.
Plus fort que la peur de mourir.
Et cet amour là devient une lumière, une lumière de consolation qui rayonne du fond de la peine et nous éclaire tous en ce jour d’été en deuil, en ce jour trop beau et trop triste qui descend sur les pins, à Har Herzl.
Un tissu humain
“Fermeture du cercueil”, dit le haut‐parleur.
Des pleurs.
Un cri rauque d’homme “Oriiii!”
Le rabbin, de sa voix forte et triste : “De même qu’on béni pour le bon, maintenant on bénit le juge de la vérité.”
ברוך דיין האמת
C’est le moment invisible de la kriya, la “déchirure”.
On déchire le col des endeuillés. On les aide à matérialiser la blessure. Ils porteront le vêtement déchiré tout le temps de la shiva (les septs jours de deuil ou les endeuillés s’asseoient chez eux pour pleurer leur mort).
Barou’h… Dayan… Haemet ! Béni soit le juge de la vérité ! crie, dans un sanglot progressif, le père.
“Ori, ma lumière.
Tous les jours je pensais à toi quand je disais ce psaume”, avait dit sa mère.
Le psaume 27 qui commence par ce smots
יְהוָ֤ה ׀ אוֹרִ֣י וְ֭יִשְׁעִי
“Dieu est ma lumière et mon salut.”
Voilà ce que j’ai vu à cet enterrement. Une lumière incroyable.
Malgré les pleurs, à travers les pleurs, la lumière de l’amour. La manière dont ils prononçaient son prénom, avec tant, tant d’amour.
Un amour meurtri, mais impérissable.
Et nous qui étions là tout autour, des centaines, des milliers peut‐être, beaucoup d’entre nous qui ne le connaissions pas, qui ne le connaîtrions jamais, nous pleurions avec eux, car nous savions bien : ce n’était pas seulement qu’il était mort pour nous. Il était à nous aussi. Notre frère. Notre fils. Notre amant. Notre ami. Plus profondément, peut‐être, il était nous.
Je repense à cette chanson chantée chaque année lors de Yom haZikaron, le “jour du souvenir” pour les morts tombés depuis l’indépendance de l’État d’Israël.
Elle nous dit :
“Lorsque tu mourras,
Quelque chose de toi, en moi
Mourra avec toi. (…)
Car nous tous, oui nous tous.
Nous sommes tous un même tissu humain, une même vie.”
Une même vie.
Je suis allée pleurer Ori pour pleurer avec les autres, pour pleurer lui et tous les autres.
Pour pleurer ce qu’on nous fait et ce qu’on nous oblige à faire.
Pour pleurer ce que l’humain fait à l’humain.
La lumière‐vie
Le lendemain de l’enterrement je parlais avec mon ami Antoine. Il me partageait cette réflexion qu’il avait écrite pour ces pages, que le vrai problème selon lui, ce qui fait le plus mal, avec le terrorisme, c’est qu’au fond, il gagne toujours.
Oui, quoi qu’on en dise, Ori est mort. Et Alex, et Eden, et Almog, et Hersh, et Carmel. Qu’on le veuille ou non, ceux qui ont été massacrés le 7 octobre et depuis ne reviendront pas.
Oui, les captifs, et leurs familles, mais nous aussi, le pays entier, vivons tous encore en otage.
Ils ont bien réussi. Et ils nous tiennent encore.
Et même après, un après que l’on a parfois du mal à entrevoir, nous resterons marqués : une génération entière aujourd’hui, une nouvelle, après le Liban, après Kippour, traumatisée.
Le terrorisme a frappé et le coup s’imprime.
Mais surtout, le terrorisme gagne toujours parce que, disait Antoine, il t’entraîne sur son terrain.
Il te force à jouer à un jeu absurde auquel tu ne veux pas jouer. Un jeu dans lequel tu n’as aucune chance de t’en sortir, car il en change les règles sans cesse. Un jeu auquel tu te perds parce qu’en réalité il ne joue pas.
Et alors que te reste‐t‐il ? Il te force à faire des choses que tu ne veux pas faire. Il te force à jouer son jeu. Il te force parfois à briser tes propres valeurs pour lui mettre des limites.
Il t’entraîne sur le terrain du rapport de force dans lequel tu aurais voulu ne jamais mettre les pieds.
Oui tout cela est vrai, et c’est l’impossible double-bind dans lequel Israël vit depuis le 7 octobre.
Et pourtant. À l’enterrement d’Ori, j’ai vu au fond pourquoi ce n’est pas vrai.
Le terrorisme ne gagne pas toujours. L’amour est plus fort.
Il y a quelque chose avec le choix de la vie, qui guérit de la haine.
Oui l’amour, pulsion de vie par excellence, est plus fort que la pulsion de mort. Je l’ai vu aujourd’hui. Il survit à la mort. Il guérit de la haine qui accompagne tous les terrorismes depuis le début de l’Humanité. Dans la lumière de l’amour, tout le reste se dissout.
Il y a quelque chose dans le fait de continuer à aimer, de continuer à choisir la vie, de continuer à choisir de construire, malgré les brisures.
Ici on se relève amputés, on se relève brisés, on se relève traumatisés, mais on se relève. Car on a une raison de vivre. Un amour les uns pour les autres. Un amour pour le pays. Un amour pour le peuple.
J’ai vu dans la lumière de l’enterrement de Ma Lumière un amour de la vie plus fort que la mort, n’en déplaise au Cantique des Cantiques.
Un amour qui, à l’image du Dieu d’Israël, est, la vie.
C’est peut‐être pour cela que, malgré tout, Israël continue à vivre.
Malgré les attaques permanentes, malgré le terrorisme acharné, malgré l’obsession à le détruire, dont il fait l’objet en tant que pays depuis 1948, et en tant que peuple depuis 597 avant notre ère.
“Et tu choisiras la vie afin que tu vives.”
Dans tout juste quelques semaines, on s’apprête à dire ces mots (Deutéronome 30,19), quelques semaines avant de clore ce cycle annuel de lecture de la Torah et cette année si sombre qui a suivi Simhat Torah 5784.
Oui Ori, Ma Lumière, notre lumière, avait choisi la vie.
Quand on a une raison de mourir, et quand cette raison est l’amour, on a une raison de vivre.
L’amour plus fort que la mort, c’est ce que j’ai vu ce jour‐là sous les pins du Mont Herzl.
Je suis allée à l’enterrement d’Ori et j’ai reçu de la lumière.
Je suis allée à l’enterrement d’Ori et je me suis souvenue de ma lumière, de notre lumière.
À nous de continuer à la porter.